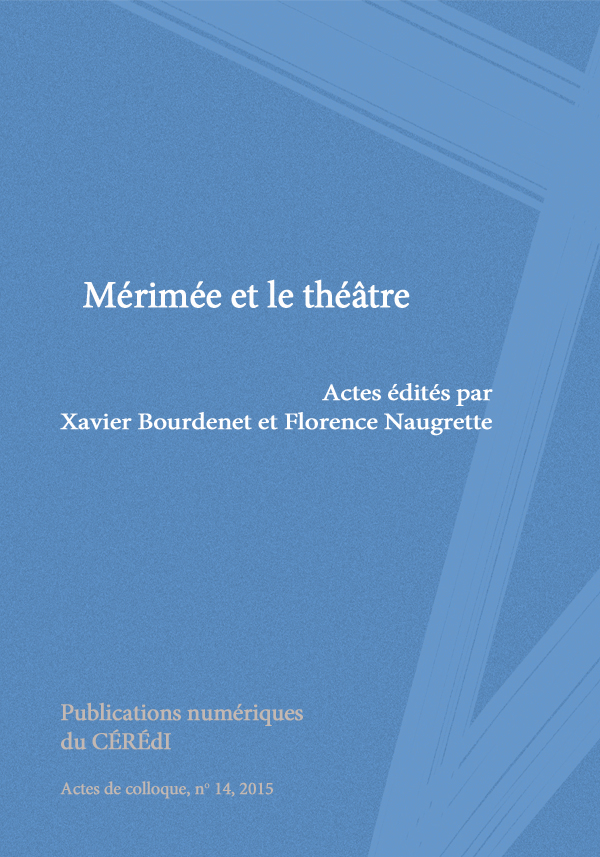Mérimée, qui a laissé tant de chefs-d’œuvre brefs, a écrit avec La Jaquerie une de ses œuvres de longue haleine, ou qui paraît telle par son grand nombre de scènes, et dont on peut étudier bien des aspects : sa composition, sa cohérence, le nombre élevé des personnages, le sujet choisi, ou encore la question de savoir si La Jaquerie serait jouable, à quelles conditions et sous quelle(s) forme(s). Je ne m’intéresserai ici qu’à un seul de ces aspects, l’affleurement de la documentation accumulée visible dans l’appareil des notes de l’auteur, et les jugements portés sur l’œuvre, à partir de l’étude même de cette documentation, par deux des bons chercheurs mériméens qui se sont penchés sur elle dans le cadre de deux projets différents (un essai, une édition) : Pierre Trahard et Pierre Jourda.
Rappelons d’abord d’un mot l’identité éditoriale de notre objet d’étude. La Bibliographie de la France du 7 juin 1828 enregistre sous le no 3446 (p. 425) un volume sorti des presses de Balzac et publié chez Brissot-Thivars sous le titre La Jaquerie, scènes féodales, suivies de La Famille de Carvajal, drame, par l’auteur du Théâtre de Clara Gazul. Ce Théâtre avait lui-même été publié en 1825 sans nom d’auteur, mais en 1828 les amateurs avertis savent qu’il s’agit de Mérimée. Le succès fut assez faible pour que les bibliographes enregistrent deux remises en vente des exemplaires invendus, avec, les deux fois, la même appellation fictive de « deuxième édition », chez Alexandre Mesnier en 1829, et chez Fournier jeune en 1833 ; seule la fabrication d’une couverture de relais a demandé du travail aux typographes. Il faut ensuite attendre 1842 pour voir paraître chez Charpentier une édition collective contenant le Théâtre de Clara Gazul, augmenté de deux pièces nouvelles en 1830, La Jacquerie, dont le titre comporte cette fois le c omis en 1828, et La Famille de Carvajal ; cette édition a été réimprimée telle quelle en 1857, 1860, 1862, 1865 et 1870 pour ce qui est du vivant de Mérimée, sans que l’auteur se soit à nouveau penché sur le texte ; les variantes de 1842 elles-mêmes ne portent généralement que sur de petits détails. C’est donc essentiellement le texte de 1828 et, en amont, les lectures historiques faites par Mérimée, qui sont propres à retenir notre attention.
Nous sommes aidés dans les réflexions qu’il est aujourd’hui possible de mener sur les sources de La Jaquerie par le travail attentif de deux prédécesseurs. L’un est Pierre Trahard, qui, dans le premier ouvrage de sa somme classique sur la vie et l’œuvre de Mérimée, a consacré un développement de cinquante pages à cette œuvre, plus des notes sur ses sources [1]. Peu après, c’est Pierre Jourda qui, dans le cadre de l’édition critique des Œuvres complètes de Mérimée par le même éditeur, propose un volume contenant, comme dans l’édition originale de 1828, La Jaquerie et La Famille de Carvajal [2]. Le vif intérêt, pour le chercheur et tout simplement l’observateur d’aujourd’hui, de ces deux contributions aux études mériméennes, c’est qu’elles sont inspirées d’un même esprit péjoratif à l’égard de l’œuvre elle-même, presque toujours jugée négativement. Essayons de bien voir comment les choses se présentent.
La première moitié du XXe siècle est, on le sait, l’âge d’or de la « critique des sources », et l’on ne concevait pas, alors, d’étude universitaire digne d’estime qui ne s’y astreignît. Henri Guillemin lui-même (pour citer quelqu’un que l’on verrait a priori aux antipodes de Trahard), commençant autour de 1930 sa thèse sur Le « Jocelyn » de Lamartine sous l’étonnante direction du très sorbonnard Daniel Mornet, ne put contourner cette obligation ; mais quarante ans après il ne décolérait toujours pas ; je cite quelques lignes, non parce que je veux citer mon cher Guillemin, mais parce qu’elles nous projettent au cœur de la question que je voudrais évoquer :
J’ai assez peiné, jadis, deux ans de ma vie, deux années entières, sur « les influences » décelables dans Jocelyn – enquête, alors, exigée par les pontifes ; assez perdu mon temps pour en avoir soupé de ces investigations puériles. Si l’écrivain s’atteste écrivain, à quoi bon s’enquérir des sources où il peut avoir bu ? Il n’est pas une citerne, ni un robinet. Il est devenu source lui-même, et cela seul compte [3].
Mais voilà : vers 1930, à la Sorbonne, pour devenir un docteur ès lettres, il fallait « faire un travail universitaire, très officiel, […] attentif aux sources (les fameuses sources) et très dans la ligne [4] ». Plus tard, il fallut être structuraliste, ou docile à d’autres conformismes plus ou moins théorisants, qui ont pour seul point commun de tuer les œuvres, à tout le moins d’en ignorer la vraie signification. Il n’est pas mauvais, sans doute, de rappeler ces évidences de l’histoire universitaire française. Elles ne suffisent cependant pas à expliquer pourquoi et Pierre Trahard et son suiveur Pierre Jourda ne tirent de leur enquête si consciencieuse que des conclusions défavorables à l’auteur sur lequel ils travaillent.
Repartons de l’édition de Pierre Jourda et donnons quelques indications sur les résultats de son investigation, largement redevable au travail juste antérieur de Pierre Trahard.
La principale « source » de Mérimée pour La Jaquerie est la Collection de chroniques nationales écrites en langue vulgaire publiée sous la Restauration par Jean-Alexandre Buchon, un ami de Mérimée [5]. Ce dernier y « prend les éléments de son drame : le scénario, les faits historiques essentiels, les mœurs, les détails, toute la couleur locale, voire partie de son vocabulaire [6] ». C’est notamment dans ce vaste ensemble qu’il lit Froissart. À la fin d’une lettre de mars 1828 au docteur Edwards, qu’il invite chez lui à la lecture d’« une petite tragédie romantique intitulée la Jaquerie », Mérimée ajoute : « Je vous envoie les neuf volumes de Froissart que vous m’avez prêtés en vous renouvellant tous mes remerciemens [7]. » C’est la seule indication de sa plume concernant la genèse de La Jaquerie, mais elle nous invite à croire qu’il a, en effet, lu Froissart [8].
Il n’utilise aucune source inédite. Il lit notamment les Mémoires pour servir à l’histoire de Charles II le Mauvais de Denis-François Secousse (1758) [9], les Mémoires sur l’ancienne chevalerie de La Curne de Sainte-Palaye réédités en 1826 par Nodier [10], ou la continuation de la Chronique latine de Guillaume de Nangis par Jean de Venette [11]. À toutes ces sources, écrit Pierre Jourda, Mérimée emprunte
les couleurs assez crues avec lesquelles il fait sa palette : des traits de mœurs, des détails précis, des allusions aux façons de vivre du Moyen Âge. [Il] ne cherche dans ces écrits que les menus faits qui lui permettent de créer l’atmosphère de son drame et non des épisodes précis, des textes qu’il transpose tels quels. (p. VIII-IX)
De ce fait on peut allonger presque à l’infini la liste des modèles auxquels il peut avoir pensé, notamment des textes littéraires non médiévaux : Henri IV de Shakespeare pour tel détail sur la jacquerie anglaise, ou Goetz von Berlichingen de Goethe, et bien d’autres.
Une fois qu’il a donné une idée de l’étendue de ces sources possibles, Pierre Jourda se lance dans une appréciation de l’œuvre elle-même telle qu’elle est issue de la documentation, et cette appréciation (dans quelle mesure est-ce, de sa part, conscient et volontaire ?) se fait de page en page plus réticente. Si La Jaquerie est d’abord « moins un drame ou une étude psychologique et morale qu’une série de chroniques découpées en tableaux colorés, en dialogues plus ou moins vivants » (p. X), ce qui peut passer pour un jugement modéré, presque objectif, bientôt ce sont les griefs qui prennent le dessus : « L’attention du lecteur se disperse trop souvent et, trop souvent, ne sait où l’auteur veut en venir », avec, en note, ce jugement aujourd’hui difficile à comprendre : « Cette absence de sujet est peut-être le plus grave défaut de La Jaquerie » (p. XII et n. 2 [12]). Mais Pierre Jourda ne dit nulle part ce qu’eût dû ou pu être ce « sujet », et nous qui avons bien le sentiment que Mérimée évoque la montée, puis l’échec de la révolte des « Jacques » en juin 1358, en Beauvaisis, Picardie et Champagne, nous avons du mal à entériner une formule aussi cassante que celle-ci : « Il n’y a dans La Jaquerie ni action, ni caractères » (p. XIV). Plus loin dans son avant-propos, Pierre Jourda semble revenir à une position moins condamnatrice, en déplorant, certes, que l’auteur « brode sur des données historiques un scénario de drame sans se soucier des dates ni de la réalité » (p. XXI), mais en admettant comme un mérite relatif « l’évocation colorée du passé » (p. XXII) ; cette atténuation ne « tient » plus, toutefois, lorsque arrive le moment du bilan, et là le verdict tombe sans appel : « Œuvre manquée du point de vue historique aussi bien que du point de vue littéraire » (p. XXIII-XXIV).
Lorsque, de cet étonnant avant-propos qui passe de l’énumération érudite des sources à la conclusion que leur somme n’a servi qu’à fabriquer un échec, on remonte vers la source originelle que constituent les travaux de Pierre Trahard, on s’aperçoit que Pierre Jourda n’a fait que se couler dans le moule des appréciations déjà négatives du grand spécialiste. Dès le titre du chapitre consacré par Pierre Trahard aux deux pièces de 1828, on dresse l’oreille : le dramaturge du Théâtre de Clara Gazul y proposerait « Le Moyen Âge mis en mélodrame et la parodie du mélodrame [13] ». Que La Famille de Carvajal soit une parodie ne va pas de soi, et ce n’est pas mon sujet ; mais on sent ici combien ont pu être indispensables en leur temps les travaux désormais classiques de Daniel Sangsue sur la parodie et sur le récit excentrique, ou, quelques années plus tôt, de Jean-Marie Thomasseau sur le mélodrame [14] ; le nombre de ceux qui jugent ces genres « inférieurs » a notablement et heureusement faibli, de nos jours, au profit d’une appréciation autre d’écritures elles-mêmes différentes, et qui ne peuvent certes pas être jugées à l’aune de la perfection théâtrale classique. Dans le « mis en mélodrame » de Pierre Trahard, au contraire, nul doute possible : c’est, d’entrée, une appréciation négative, l’annonce d’un chapitre sur deux ratages. Ne nous en tenons qu’à La Jaquerie, qui nous retient ici : c’est « un essai dramatique manqué, où Mérimée gaspille son talent » (p. 306), et d’ailleurs il ne pouvait en être autrement, car « la forme dramatique […] ne convient pas à son tempérament » (sic, même page). Dès lors, on ne parlera de ces deux avortons que parce qu’il faut bien parler de tout Mérimée.
La démarche suivie est déjà exactement celle qu’adoptera Pierre Jourda. De l’indispensable examen des sources, on peut avoir au premier abord l’impression qu’émane une appréciation la moins tendancieuse possible : « Il butine à droite, à gauche, élimine ensuite, dispose enfin » (p. 323) – seulement une telle phrase vient après les deux que j’ai citées plus haut, ce qui invite à la relire dans un autre esprit, surtout si on lui adjoint ce qui peut se lire dans la suite de l’étude : non seulement le savoir de Mérimée ne relève que d’une « érudition factice » (p. 326) parce qu’il n’est fait que de compilation, mais même cette compilation est si mal faite qu’on est obligé de dresser une liste de détails faux ou d’omissions (voir p. 328). Et ces erreurs n’eussent-elles pas été commises, La Jaquerie ne serait tout de même qu’une ébauche illisible (« des traits épars qu’on a peine à ramasser en un faisceau », p. 332), un brouillon profus qui ne dit rien (« au lieu d’une large évocation digne d’un Michelet ou d’un Delacroix, voyez, c’est une poussière de détails qui reste au bout des doigts, c’est un peu de l’esprit mort, ce n’est pas l’âme ressuscitée », ibid.). Il n’y a dans ce texte mort-né que « la certitude des minuties », alors qu’on attendait et demandait « la justesse du sentiment général, la vérité de la couleur » (p. 333 [15]).
Pour finir Pierre Trahard revient à Michelet, qui fait vrai en dépit d’une foule d’erreurs, pour l’opposer à Mérimée qui n’y arrive pas en dépit d’une foule de détails vrais. La flèche du Parthe est décochée à la fin du développement sur La Jaquerie : Mérimée n’aurait pas dû se lancer dans cette écriture de « scènes dialoguées », genre « où il est inférieur à Vitet et où seul, à défaut d’une érudition qui n’étouffe pas le cœur, le génie peut triompher et triomphe » (p. 335). Que Vitet, avec ses scènes historiques sur les guerres de Religion publiées à la même époque que La Jaquerie, ait joué un rôle capital dans l’évolution de la littérature théâtrale, aucun doute [16] ; mais le juger, en tant qu’écrivain, supérieur à Mérimée, c’est un peu fort de café, non ?
La différence formelle la plus visible entre le travail de Trahard et celui de Jourda, et qui ne vient pas de ce que l’un bâtit un essai et l’autre une édition critique, c’est que Pierre Trahard place à part, dans un des petits ensembles situés à la fin du second volume de La Jeunesse de Prosper Mérimée, l’énumération des sources elles-mêmes, qui dans le corps de l’essai n’ont été qu’évoquées à mesure des besoins. Or on constate, en lisant de près ces huit pages, la vanité relative de la quête. Pierre Trahard donne des listes de « sources » tirées de Shakespeare (« de façon générale, les scènes violentes », t. II, p. 382), ou de Goethe : c’est là que Pierre Jourda a trouvé ce qui vient de Goetz von Berlichingen, mais ce qui est intéressant c’est de voir que selon Trahard « une comparaison de détails avec Les Brigands de Schiller donne à peu près les mêmes résultats » (p. 383), ce qui les relativise fortement ! Il en est de même pour Froissart, Venette, La Curne de Sainte-Palaye, et pour une foule d’« autres emprunts » (p. 386) : accumuler les signes et même les preuves de lecture ne résout absolument rien, et lorsqu’au terme de cette anthologie de références Trahard se résout à reconnaître : « On n’en finirait pas de relever les emprunts de mots faits à Joinville » et à d’autres (p. 388), il me semble qu’on touche aux limites mêmes de la critique des sources considérée par son côté absurde. Relisons les quatre lignes de Guillemin citées en commençant !
Au fond le meilleur de tout cela c’est la façon dont Mérimée lui-même joue à fabriquer des notes pour son propre texte, et il est bien caractéristique que ni Jourda ni Trahard n’en parlent vraiment. Jourda, au lieu de les placer en bas de page, les relègue en petits caractères à la fin du texte de Mérimée (p. 308-311 de son édition), avant le long relevé de variantes le plus souvent infimes, et avant ses propres « Notes et éclaircissements » (p. 413-443) imprimés, eux, dans le même corps que le texte de Mérimée. Ces notes ne sont pas du tout inintéressantes, et même elles étonnent par une liberté parfois aventureuse du commentaire, témoin ceci, qui concerne le personnage si accentué du « Loup-Garou » :
Le chef des Jacques se nommait en réalité Guillaume Karle. Mérimée, pour corser le scénario de son drame, fait de ce capitaine […] une sorte d’outlaw qui rappelle les héros des romans sataniques de Maturin, de Lewis ou d’Anne [sic] Radcliffe, et ceux de d’Arlincourt et de Pixerécourt. Il va plus loin : il en fait un personnage mystérieux auquel il donne le nom d’un être cher à la superstition populaire. (p. 414)
À vrai dire chacune de ces références à la littérature du tournant du siècle mériterait d’être discutée ! Mais nous aimerions surtout que les commentaires de Mérimée lui-même, faussement sérieux ou vraiment facétieux, ne soient pas relégués dans l’ombre. Ainsi lorsque le Loup-Garou – restons avec lui puisque nous l’évoquions – proclame devant ses partisans : « Nous prendrons ce que saint Nicolas nous enverra » (scène 1, p. 11), Mérimée propose cette note dont la désinvolture est signée : « Comme il faut que chaque métier ait un patron, les voleurs ont choisi saint Nicolas » (p. 308). J’aime ce sourire d’auteur, auquel nos deux Pierre semblent bien insensibles.
Il n’est pas si facile de conclure, car une fois qu’on se sera encore étonné que de grands érudits puissent prendre en charge l’édition ou l’étude d’une œuvre qui leur paraît manquée, savoir comment l’aborder aujourd’hui continue d’être une vraie question. Qu’à nous (qu’à moi en tout cas) La Jaquerie, loin de sembler ratée, apporte le plaisir d’une vraie fresque, ne nous dispense pas de prendre en considération le travail de l’écrivain. Nous découvrons, certes, dans ces pages la courbe qui mène du souffle brut d’un élan initial venu des tréfonds jusqu’à la retombée du découragement et de la désunion, en passant par le cynisme des châtelains et de leurs courtisans ; mais comment ce résultat est-il obtenu, et eût-il pu l’être sans la consultation de documents et de témoignages ? La réponse est non, bien sûr, mais il s’agira quand même toujours, au bout du compte, de se taire devant l’indicible de la création littéraire. Mérimée lui-même savait qu’il avait eu raison de beaucoup lire, fût-ce en feuilletant et en grappillant à sa guise, mais que ce qui comptait, c’était – pardon du jeu de mots – l’effet et non les faits. Sa brève préface le dit au mieux, qui se termine par cette toute simple phrase : « J’ai tâché de donner une idée des mœurs atroces du XIVe siècle, et je crois avoir plutôt adouci que rembruni les couleurs de mon tableau » (éd. Jourda, p. 3). Couleurs, tableau, autrement dit la palette de l’artiste : même Pierre Jourda avait employé ce mot dans son commentaire ; et qu’importent, alors, l’érudition, ses failles et ses vanités ?