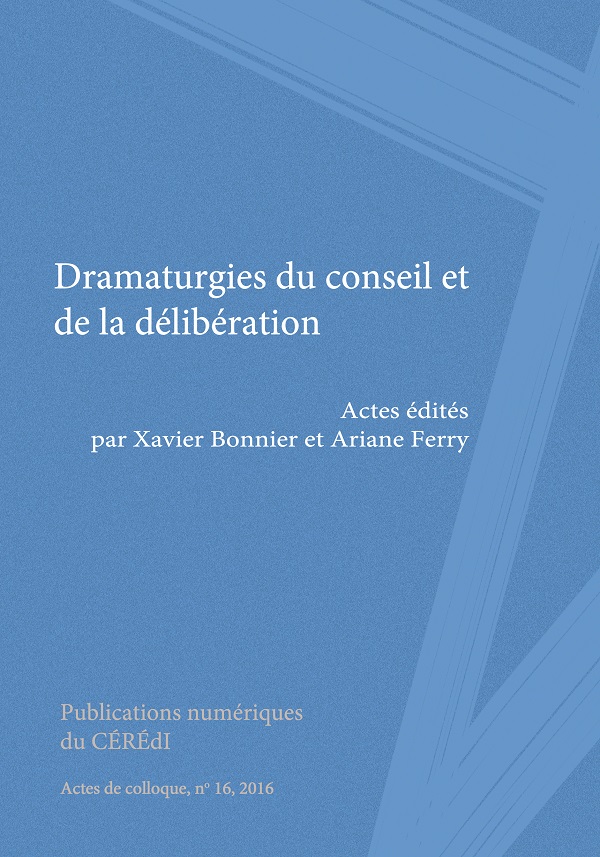On comprendra sous le terme de « tragédies tardives » les tragédies du « vieux Corneille » : ce dernier syntagme renvoie à une construction critique, fondée sur une scansion de la carrière de Corneille, son retour à la scène en 1659 après les années de « retraite » consécutives à l’échec de Pertharite en 1652 [1]. Mais cette construction, si elle a une dimension biographique contestable, est largement fondée aussi sur le sentiment d’un obscurcissement progressif du monde cornélien, au sens d’un théâtre tragique à la fois plus sombre dans sa tonalité et moins clair dans sa formulation, jusqu’à paraître « illisible », voire pur « galimatias ».
Corneille « illisible » : tel est en effet le jugement porté sur les tragédies, à partir d’Œdipe (1659), par le meilleur ennemi de Corneille, l’abbé d’Aubignac en ses Dissertations [2]. Ce jugement est partagé par Somaize, à propos d’Œdipe encore [3], et la critique à partir de Voltaire en a prolongé la portée jusqu’à Suréna (1674), comprenant donc aussi Sertorius (1662) Sophonisbe (1663), Othon (1665), Agésilas (1666), Attila (1668), auxquelles on ajoute les comédies héroïques de la toute fin de la carrière de Corneille, Tite et Bérénice (1671) et Pulchérie (1673), largement appréhendées comme des tragédies [4].
Ce Corneille longtemps supposé plus difficile à déchiffrer et quasi impossible à jouer paraît aussi plus sombre, plus « tragique » aux yeux de la critique. Michel Prigent classe ainsi ces tragédies tardives dans une troisième partie intitulée « Le tragique », divisée en quatre chapitres : « La condamnation du héros », « La faillite de la politique », « Suréna ou la catastrophe de l’univers cornélien », et enfin « La politique tragique et les perversions de l’héroïsme ». Le héros cornélien se trouve désormais face à l’État, contre l’État et bientôt sa victime, dans Suréna ; pire, l’héroïsme est « au passé », « sans effet », « sans pouvoir », stérile, en déclin [5]. Serge Doubrovsky classe ces mêmes tragédies dans une partie intitulée « Le déclin du héros » (d’Œdipe à Pulchérie), suivie de « La mort du héros » (Suréna). Un vocabulaire critique particulièrement éloquent file cette métaphore décliniste : « usure », « vieillissement », « naufrage de l’essence héroïque », « lâcheté », « impuissance », « volatilisation de l’être », « démission », « faiblesse », « renoncement », « stérilité », effémination enfin [6]. La même ligne critique se rencontre chez André Stegmann, qui évoque la « dégradation du héros », le « déclin de l’éclat du sacrifice politique », le « pathétique des généreux désabusés », la « destruction de l’amour héroïque », à partir de la « cassure interne » que représenterait Pertharite [7]. Marc Fumaroli parle du « dolorisme » de ces tragédies, marquées par une sombre attirance pour la mort, dont la dramaturgie fait l’anatomie [8]. On peut faire l’hypothèse alors que cet assombrissement relève de ce qu’Adorno [9], puis Edward Said [10] nomment le « style tardif », une écriture travaillée par des forces de déliaison.
Pourtant, à lire ces tragédies tardives, sombres en effet sinon obscures, une clarté demeure, au sens de l’« éclat » propre au théâtre de Corneille et le ressort de l’admiration est toujours en place. Qu’est-ce qui a changé alors ? On ne peut que s’étonner de la cécité tenace de la critique, largement aveugle au déplacement de « l’héroïsme cornélien » du héros… vers les héroïnes. Ou, quand ce déplacement est perçu, du refus de lui accorder la moindre valeur. La critique a volontiers stigmatisé le choix par Corneille de héros masculins désormais trop amoureux, « tendres » voire faibles face à des héroïnes prétendument « viriles », qui leur enseignent ou leur rappellent les chemins de la gloire et de la liberté [11]. Cette inversion apparente des rôles et des « genres » explique peut-être en effet qu’un préjugé d’illisibilité ait pesé, pèse encore peut-être sur ces tragédies tardives : illisibles, parce que trop lisibles peut-être, parce qu’offrant à l’assombrissement tragique de l’univers cornélien une voie de salut qui passe, scandaleusement, par un héroïsme de femmes qui n’auraient rien de « féminin » ? L’obscurité prêtée à Corneille en ce sens tient, selon d’Aubignac, à la rhétorique, mais aussi à la vraisemblance : est obscur dans son théâtre tardif ce qui s’énonce mal, en termes d’élocution donc, mais aussi et surtout ce qui heurte les attentes en matière d’invention des arguments et de respect de bienséances. Ces deux aspects de l’obscurcissement sont donc liés, et l’examen des structures dramaturgiques de la délibération, du dialogue et de la décision permet de mettre en évidence ce lien, et sa signification.
Si on considère donc le « héros » masculin, le « premier acteur », ces tragédies paraissent en effet, pour une large part, des tragédies de la décision, de l’indécision plutôt. Une extraordinaire complexification de la « politique », un spectaculaire envahissement de la scène par le discours machiavélien viennent obscurcir les termes du fameux « dilemme cornélien » et jeter les héros pris par cette « politique » dans une indécision structurelle, et fatale. La lumière sur la décision juste vient alors « d’ailleurs » : pour le dire vite, le plus souvent du foyer d’un désir préservé, tel que le conçoit et le soutient cette incroyable et très spectaculaire « galerie de femmes fortes », de femmes politiques, de princesses et de reines que présentent ces tragédies tardives. Dircé, Viriate et Aristie, Sophonisbe et Eryxe, Plautine et Camille, Mandane, Ildione et Honorie, Bérénice et Domitie, Pulchérie, Eurydice : autant d’amantes, mais inflexibles, exemptes des « faiblesses de femmes », indifférentes aux bienséances, autant de femmes qui ne cèdent pas sur l’objet de leur désir et qui, pour la plupart d’entre elles, ne savent dissocier l’amour vrai de la décision héroïque, glorieuse et de la préservation d’une liberté fondamentale, quel qu’en soit le prix.
Il s’agira donc de montrer comment l’envahissement de la scène par le discours machiavélien stérilise la délibération héroïque, avant de présenter le rôle régénérateur confié aux « premières amoureuses », dans une dramaturgie qui substitue à la délibération solitaire l’affrontement constructif du couple. Au régime des monologues ordonnés et des tirades arrondies, Corneille substitue un régime de la coupure et de l’interruption, marqué par l’inachèvement des « raisons ». La décision héroïque et royale s’inscrit alors dans une temporalité qui, au-delà des simples exigences techniques de l’unité de temps, se trouve pressée par l’urgence d’échapper au calcul, dilatoire par essence : de cette dramaturgie au tempo accéléré, littéralement à couper le souffle, Corneille tire de puissants effets, au risque peut-être de cette fameuse obscurité.
Envahissement du discours machiavélien et stérilisation de la délibération héroïque
Hélène Merlin-Kajman a montré comment « la politique » prenait toujours chez Corneille un sens péjoratif, et indiqué ainsi la nécessité de la différencier « du politique [12] ». Cette politique est par excellence la « politique des conseillers » et se manifeste notamment par le déploiement, volontiers verbeux, de « maximes », qui opposent le succès à la « vertu délicate [13] ». Par définition, la maxime se fonde sur la généralité, sur le travail d’une ratio. Elle est donc étymologiquement calcul, et prétend par là enseigner la prudence. C’est une « raison » d’État (machiavélienne ou non), qui s’énonce en une argumentation souvent sophistique et captieuse, dont Corneille protège son spectateur par l’ironie dramatique et dramaturgique : ainsi dans Cinna le rôle d’empoisonneur d’âme confié au vil affranchi Euphorbe, au nom de plante toxique, ou dans Polyeucte les spéculations affolées mais tragi-comiques de Félix sur l’attitude de Sévère, dont le spectateur connaît au contraire la parfaite magnanimité.
Face à cette honteuse politique, le monarque vertueux et le couple héroïque s’avancent en terre inconnue, se risquent à l’inouï, tranchent sans calcul, agissent. Emblématiques de cette rapidité d’action économe de paroles, le reproche que s’adresse Rodrigue d’avoir « tant balancé », l’espace de quelques vers [14], ou encore l’immédiateté de la réponse d’Horace au choix que font de lui et le sort et Rome [15]. Cette même fulgurance caractérise encore la « raison » sans raisonnement qui lui dicte le meurtre immédiat de Camille, contre tout suspens : « C’est trop, ma patience à la raison fait place [16]. » On peut encore évoquer la hâte extrême de Polyeucte à rejoindre la cité céleste : toute délibération est insupportable retardement à ce qui est tranché, dans une souffrance vive, mais dans la joie aussi d’un élan qui ne « s’explique » pas.
Or c’est ce partage net entre le lent et tortueux conseil de la politique et la fulgurance de la décision royale ou héroïque qui se brouille dans les tragédies tardives, où la politique se fait envahissante, et corrompt jusqu’au héros lui-même, l’immobilisant dans ce qui est moins un conflit de valeurs ou une aporie qu’un atermoiement.
Dès l’ouverture de la plupart de ces pièces, le cadre est posé : celui de la guerre civile et du désordre de l’État, le plus souvent d’une tyrannie, en germe ou installée, d’un triomphe de la politique de cour, du machiavélisme à visage découvert, ou pire encore d’un règne du seul intérêt personnel. Ce n’est plus un vil affranchi, c’est un soldat romain, tribun de la plèbe, Aufide dont le nom rime si bien avec « perfide », qui conseille ouvertement à Perpenna le meurtre de son général, Sertorius :
Avez-vous oublié cette grande maxime,
Que la guerre civile est le règne du crime,
Et qu’aux lieux où le crime a le droit de régner,
L’innocence timide est seule à dédaigner,
L’honneur et la vertu sont des noms ridicules [17] ?
La possibilité même d’une énonciation si ouvertement cynique signale le progrès de la politique au cœur même des personnages héroïques ou royaux, à qui l’on peut oser parler ainsi. Le progrès de cette politique dans les cœurs nobles demeure certes imparfait, donnant à la tragédie sa tension dynamique, mais son omniprésence risque de priver aussi la pièce, comme Corneille le dit de Sertorius (1662), des « grâces » que confèrent « les tendresses d’amour », les « emportements de passion », les « descriptions pompeuses » ou les « narrations pathétiques ». La politique semble tout absorber, devenir le seul fond et la seule matière, comme le note Corneille lui-même à propos de « […] Sylla, dont le nom odieux, mais illustre, donne un grand poids aux raisonnements de la politique, qui fait l’âme de toute cette tragédie [18]. »
Au centre de cette pièce, la très fameuse « conférence » entre Sertorius et Pompée est consacrée à un étalage des « raisons d’État » les plus nobles, « de généreux à généreux », ornement apprécié de « quelques-uns des premiers de la cour », mais qui constitue néanmoins, sur le plan dramaturgique, un « entretien inutile » (v. 1430) : Pompée ne reconnaît pas en Sertorius la légitimité romaine, et Sertorius refuse de désarmer. Corneille reconnaît volontiers l’inutilité dramatique de la scène : à l’impuissance des raisons déployées de part et d’autre, correspond la « gratuité » d’un ornement dramaturgique qui semble venir remplacer le principal, jusque-là indispensable ornement de la tragédie cornélienne, l’amour.
Celui-ci n’est pas absent néanmoins de ces tragédies « politiques », tant s’en faut. Les « premiers acteurs », et souvent les « tyrans » (ce sont parfois les mêmes, selon le personnage qui les considère et les nomme) sont des amoureux : leur trait commun est la faiblesse, dont ils ont conscience, face à leur passion. Thésée a pu ainsi choquer dans Œdipe, en soulignant cette priorité donnée à l’amour : « Je dirai seulement qu’auprès de ma Princesse / Aux seuls devoirs d’Amant un Héros s’intéresse [19] ». Les exemples peuvent être multipliés dans chacune de ces pièces tardives, « galantes » si l’on veut : la hiérarchie qui place l’intérêt d’État au-dessus de l’amour, dont Corneille a fait le principe même de sa dramaturgie tragique, semble battue en brèche par ses héros mêmes. Thésée « galant » et Attila « dameret », le vieux général Sertorius amoureux transi, Agésilas « Lacédémonien beau parleur » : la critique s’est souvent déchaînée sur ces héros affaiblis, amants trop parfaits au péril de leur gloire, et qui laissent aux femmes, aux princesses et aux reines qu’ils aiment la tâche de leur rappeler les sentiers de l’honneur et de la dignité royale.
Le choix des héroïnes
Quelque chose qui s’apparente à une structure semble en effet se dégager de la situation de ces tragédies : face au tyran ou à l’instabilité dangereuse de l’État, un héros masculin largement oublieux de sa gloire entre dans une délibération aporétique entre la politique et l’amour. La reine ou la princesse à laquelle il aspire lui offre alors une issue héroïque, fondée sur le refus de renoncer au désir, qui ne saurait délier l’amour ni de la gloire ni de la liberté. Ainsi dans Attila, Honorie s’exclame :
Eh bien, si j’aime Valamir,
Je ne veux point de Rois qu’on force d’obéir […].
Enfin je veux un Roi, regardez si vous l’êtes,
Et quoi que sur mon cœur vous ayez d’ascendant,
Sachez qu’il n’aimera qu’un Prince indépendant [20].
Octave Nadal, un des rares critiques à avoir examiné les héroïnes de Corneille de façon systématique, propose de ces personnages féminins une interprétation toute « politique », ne leur reconnaissant pas d’amour véritable, mais seulement amour de soi, orgueil et ambition [21]. Il place ainsi le choix de ces héroïnes sur le même plan que les menées ambitieuses des personnages secondaires et vils (Perpenna dans Sertorius, Martian l’affranchi dans Othon, Aspar dans Pulchérie). Il semble pourtant que dans le cas de ces héroïnes, ce n’est justement pas la « politique » qui prévaut, mais le refus farouche de céder sur l’objet du désir, c’est-à-dire de trahir le lien quasi organique de l’amour à la gloire. Pulchérie rappelle à Léon cette exigence de la gloire : « L’amour entre deux cœurs ne veut que les unir, / L’hyménée a de plus leur gloire à soutenir [22]. »
Au moment où le héros semble prêt de renoncer à sa gloire au profit de son amour, les héroïnes se trouvent confrontées au choix forcé, terme par lequel François Regnault, à la suite de Lacan, a formalisé la logique du dilemme cornélien [23]. Le choix forcé représente la structure d’aliénation selon laquelle, « quel que soit celui des deux partis qui soit choisi, le sujet y perd [24]. » Face à la perte inéluctable, la tentation ordinaire est de tâcher de sauvegarder quelque chose malgré tout, la vie le plus souvent, en renonçant à son désir. La réponse héroïque au contraire consiste à ne pas céder sur son désir, à accepter de tout perdre sauf ce désir en tant que désir, et de préserver ainsi, peut-être, une chance de tout (re)gagner : en l’occurrence, la gloire, l’honneur, la liberté, et l’amour par surcroît. Ce choix est celui de Rodrigue, de Cinna, et de façon infiniment plus douloureuse de Rodelinde dans Pertharite. C’est ainsi également que Mandane enseigne à son frère Spitridate le moyen, en surmontant l’amour, de conserver une gloire à laquelle il semble renoncer [25].
L’acte héroïque ou royal se distingue du discours qui le décrit et qui l’explicite, se dégage des « raisons » de la délibération, pour apparaître dans une épiphanie de la décision, dont la source se dérobe : le secret du Prince éclatait déjà dans la décision d’Auguste. À la différence de la source sénéquienne reprise par Montaigne, qui montrait Auguste heureux d’avoir trouvé en Livie « un avocat de son humeur [26] », le geste de clémence qui dénoue la tragédie apparaît délié des « conseils d’une femme », délié même de la délibération interne de l’empereur : c’est par une douloureuse indécision que se conclut le monologue d’Auguste, « Ou laissez-moi périr, ou laissez-moi régner [27] ». La décision héroïque ou royale s’avère un acte exceptionnel, inconditionné, dont l’éclat surprenant et éblouissant, sublime, emporte l’adhésion.
Mais face aux héros amoureux prisonniers de la politique, les héroïnes vont devoir désormais dire, expliquer et même dicter à leurs amants ou époux l’évidence héroïque et royale, afin de régénérer en eux cette dignité menacée. Les « leçons » infligées par les héroïnes constituent ainsi un paradoxe, en ce qu’elles sont une explication et une explicitation de la majesté, la leur propre et / ou celle qu’elles attendent de l’objet de leur amour. C’est une nécessaire et peu glorieuse pédagogie de la gloire, qui mêle le conseil à l’exemple, quand précisément la gloire serait d’agir sans maxime ni exemple.
Cette fonction de régénération de la dignité royale ou héroïque du « premier acteur » par la « première actrice » me semble inaugurée par Pertharite en 1652, pièce dont nous avons dit l’échec cuisant. Pertharite, roi de Milan, a été chassé par un usurpateur vertueux, qui retient en otage son épouse Rodelinde. Amoureux de sa captive, Grimoald pense fléchir Rodelinde en menaçant son fils. Elle lui fait alors cette réponse sidérante, que toute la critique jugera « monstrueuse » : je me soumets, mais je veux d’un tyran un acte tyrannique : tuez l’enfant, je porterai même le premier coup, de sorte que toute votre vertu s’abîme irrémédiablement dans ce crime. L’explication de cette décision inouïe vient ensuite : cet héritier d’un premier lit est de toute façon perdu, tôt ou tard, sa liquidation discrète est inéluctable. Placée dans la situation du choix forcé maximal, c’est-à-dire de tout perdre quel que soit son choix, Rodelinde par cette riposte inouïe, se conserve au moins la liberté et la gloire de faire éclater la tyrannie qui la torture [28]. Épisode scandaleux, étrange aussi puisque cette scène n’a pas de suite. Pertharite en effet, qu’on croyait mort, revient à ce moment précis, non pour reconquérir son trône les armes à la main, mais pour demander la liberté de son épouse. Rodelinde refuse de reconnaître son monarque et son époux dans ce suppliant avili, qu’elle oblige alors à la régénération. Au terme d’un parcours quasi christique, Pertharite rayonne d’un tel éclat de majesté que le peuple reconnaît son monarque et que Grimoald lui rend son trône. L’épisode du chantage à l’enfant et la façon héroïque et royale dont Rodelinde a répondu à ce choix forcé paraît alors prendre sens : la hauteur héroïque de cette réponse a qualifié cette épouse et reine pour la psychagogie du monarque.
Corneille explique l’échec de la pièce par le peu d’éclat qu’ont les vertus de « bon mari » de Pertharite. Mais ce rôle révélateur et régénérateur de Rodelinde pouvait bien aussi dérouter un public qui ne suivra plus Corneille désormais avec l’enthousiasme qui l’avait saisi lors du Cid et de Cinna. On peut se demander alors ce qui motive l’obstination de Corneille à proposer une telle structure, certes finement modulée, dans chacune des tragédies qu’il compose à partir de 1659, si ce n’est, pour une part au moins, le bénéfice qu’elle apporte à un théâtre qui cherche, chez le spectateur, le plaisir de la surprise et de l’admiration. Un tel plaisir passe par la (re)dynamisation agonistique de la délibération, et par la mise en évidence d’une temporalité de la décision troublée par l’urgence politique et les menaces sur l’amour vrai qu’elle représente.
Le temps de la décision
Après Octave Nadal, Marc Fumaroli a montré ce que le théâtre de Corneille doit à l’univers pastoral, évoquant ainsi le « vieux berger » qu’est Sertorius, amant trop discret. Fumaroli prend surtout pour exemple Suréna, où le couple se replie tout entier dans une utopie pastorale, farouchement préservée de l’univers politique, mais qui n’ouvre que sur la mort. Pour les pièces tardives, Suréna mis à part donc, on ne saurait souscrire cependant pleinement à cette vision : car si les héros sont devenus des bergers, ils n’ont pas en face d’eux des bergères, occupées aux seuls soins de l’amour, pourtant le partage de leur sexe. Les héroïnes, reines, princesses ou amantes ambitieuses, s’inscrivent de gré ou de force dans le temps politique auquel le héros trop amoureux cherche à échapper. Quoi qu’elles pensent du présent, elles l’assument, et elles l’affrontent.
Ces tragédies tardives sont, faut-il s’en étonner, des tragédies du temps, en un chiasme saisissant avec les tragédies de la jeunesse. À l’impatience héroïque du Cid, le Roi opposait le travail réparateur et libérateur du temps : « Laisse faire le temps, ta vaillance, et ton Roi [29] ». L’aube encore crépusculaire de Rome dans Horace devient dans Cinna le zénith d’un règne qui semble s’immobiliser à son brillant apogée. Polyeucte ouvre le temps à l’éternité, dans une urgence enthousiaste que tempère une eschatologie qui laisse encore à l’Église militante le temps large des œuvres et des efforts pour mériter le salut.
L’affaiblissement du héros, voire son avilissement dans les tragédies tardives, est désormais lié au temps de la délibération, devenu le temps de l’indécision funeste. La confiance que fait Sertorius au temps, pour accoucher de la décision juste, lui est fatale. Dangereusement, Flavie dans Attila conseille à Valamir d’attendre, « […] comme le cœur le temps sera pour vous [30] », tandis que Flavian s’inquiète de la décision de Tite de « ne résoudre rien » : « L’irrésolution doit-elle être éternelle [31] ? » Les héroïnes paraissent plus conscientes de la contraction tragique du temps au seul « moment opportun » que dicte la politique, et dans lequel doit s’inscrire, comme par effraction désormais, l’action héroïque. C’est pourquoi, avec acharnement, elles luttent contre les atermoiements, les délais, et la délibération en est un. Elles-mêmes donc s’inscrivent, héroïquement, dans ce temps rétréci, annulé. La délibération s’efface, la décision éclate.
Ainsi Corneille, comme il l’avait fait pour Auguste, ne laisse rien voir du cheminement de la décision en Rodelinde, différente en cela de Médée et de la Cléopâtre de Rodogune, auxquelles Corneille donnait le temps de plusieurs monologues délibératifs.
GARIBALDE
Pour en délibérer vous n’avez qu’un moment,
Madame, il faut résoudre et s’expliquer sur l’heure,
Un mot est bientôt dit, si vous voulez qu’il meure,
Prononcez-en l’arrêt, et j’en prendrai la loi
Pour faire exécuter les volontés du Roi.
RODELINDE
Un mot est bientôt dit, mais dans un tel martyre
On n’a pas bientôt vu quel mot c’est qu’il faut dire,
Et le choix qu’on m’ordonne est pour moi si fatal
Qu’à mes yeux des deux parts le supplice est égal ;
Mais il faut obéir, fais-moi venir ton Maître.
GARIBALDE
Quel choix avez-vous fait ?
RODELINDE
Je lui ferai connaître [32].
Le temps presse, parce qu’il faut que la décision éclate comme un coup de théâtre et un coup de majesté, qu’elle soit immédiate : la décision héroïque féminine est de même nature que la majesté, et permet à l’héroïne d’enseigner au héros, au roi lui-même cette voie perdue de la souveraineté. Bérénice, venue quatre jours trop tôt, refuse hautement l’abdication que Titus se propose (IV, 1, et à nouveau V, 5), pour prendre en un instant fulgurant la décision qui la maintient au-dessus de Rome, à la hauteur de sa propre estime et de celle qu’elle entend conserver pour Tite : « C’est à force d’amour que je m’arrache au vôtre », affirme-t-elle, et c’est bien ainsi que Tite l’entend : « Madame, en ce refus un tel amour éclate [33] ».
Une telle structure commande alors des changements notables dans l’écriture dramaturgique, et qui fournissent peut-être une des clefs de cette tension entre « éclat » et « obscurité » qui caractérise le théâtre tardif de Corneille. Le public de Corneille attendait les « beaux endroits » que constituaient les échanges, délibérations, les « conférences », dont celle d’Auguste, Cinna et Maxime était demeurée le modèle et le chef-d’œuvre : « Quand l’un a parlé, vous êtes persuadé qu’il n’y a plus rien à répliquer ; cependant l’autre enchérit, & vous subjugue par l’énergie de ses raisonnemens [34]. »
D’Aubignac lui-même, nous l’avons vu, reconnaissait ce talent suprême à Corneille, mais pour en déplorer justement l’absence dans Sophonisbe :
[…] les choses que l’on y peut estimer y sont rares, et même imparfaites, en sorte que l’on n’y voit Monsieur Corneille qu’à demi […]. Ce n’est pas que dans celle-ci les hommes ne disent de fort excellentes choses, mais je ne les ai pas trouvées de l’air de Monsieur Corneille, parce qu’elles ne sont pas achevées, et qu’elles demeurent presque toutes à moitié chemin [35].
Ce même critique compte ainsi les interruptions dans Œdipe, où les personnages, dit-il, « s’interrompent à tout propos, se ferment la bouche l’un à l’autre en plusieurs occasions qui mériteraient bien que l’on sût tous leurs sentiments ; ils commencent à dire plusieurs choses qu’ils n’achèvent pas, tant celui qui les écoute précipite sa réponse [36] […] ».
Corneille en effet semble à plaisir désormais rompre la rotunditas de chacune de ses tirades, que saluaient à la péroraison les acclamations du public. De plus en plus, les personnages de Corneille se coupent la parole. Les « raisons » n’ont plus l’espace de leur déploiement, la tirade interrompue ne s’arrondit plus. Médée ne comptait aucune interruption, Le Cid 4, et on parvenait déjà à 24 dans Nicomède, 26 dans Pertharite, soit une moyenne de 14 interruptions par pièce dans les premières tragédies de Corneille. Cette moyenne double dans les tragédies tardives : Œdipe en compte 24, mais Sertorius 54, Othon 52, Suréna 35, soit une moyenne de 32. La progression du style coupé est notable, s’installe un régime du dialogue qui tend à remplacer le régime de l’alternance entre tirades et stichomythies, caractéristique du théâtre de la première moitié du siècle :
DOMITIAN
Dites que vous m’aimez, et que tout son Empire…
DOMITIE
C’est ce qu’à dire vrai j’aurai peine à lui dire,
Seigneur, et le respect qui n’y peut consentir…
DOMITIAN
Non, votre ambition ne se peut démentir,
Ne la déguisez plus, montrez-la tout entière,
Cette âme que le trône a su rendre si fière,
Cette âme dont j’ai fait les plaisirs les plus doux,
Cette âme…
DOMITIE
Voyez-la cette âme toute à vous […]
DOMITIAN
C’est là ce qu’à mon tour j’aurai peine à lui dire,
Madame, et le devoir qui n’y peut consentir…
DOMITIE
À mes vives douleurs daignez donc compatir,
Seigneur, j’achète assez le rang d’Impératrice,
Sans qu’un reproche injuste augmente mon supplice.
DOMITIAN
Eh bien, dans cet Hymen qui n’en a que pour moi,
J’applaudirai moi-même à votre peu de foi,
Je dirai que le Ciel doit à votre mérite…
DOMITIE
Non, Seigneur, faites mieux, et quittez qui vous quitte [37] […]
Mais l’interruption et l’enchaînement, invitant le spectateur à « achever » mentalement la tirade interrompue, l’empêchent aussi d’éclater en cris et applaudissements à l’issue de chaque morceau de bravoure. Ils l’obligent à une forme d’intériorisation de l’admiration : « Les spectateurs, écrit l’auteur anonyme de la Lettre sur les Remarques qu’on a faites sur la Sophonisbe de Monsieur Corneille, sont sans cesse dans l’admiration, & sentent une joie intérieure qui les retient dans un profond silence [38]. » Un public que Corneille conduit désormais à suivre, souffle coupé, la vivacité d’échanges plus elliptiques et plus complexes. Théâtre de l’écoute active, de l’intelligence, théâtre exigeant, difficile, dont le tempo précipité s’accorde au temps inéluctablement « politique », dans lequel l’éclat de l’héroïsme fait effraction.
Les enjeux d’une telle dramaturgie sont aisés à entrevoir, peut-être moins à suivre. Le caractère inconditionné de l’acte héroïque, le sublime sans chaîne causale de l’épiphanie royale ne peuvent se subsumer en maximes à l’usage du spectateur. Le théâtre de Corneille ainsi ne conseille pas, montrant au contraire en chaque tragédie un kaïros dont le sens est indéterminé. Que l’occasion tombe aux mains de la « politique », ou que le bien s’en saisisse est affaire « d’un moment » et d’un mot, qu’on n’aura pas le temps de peser. La pédagogie de la décision royale incarnée par celles qui conservent le lien de l’amour à la gloire s’offre alors comme une paradoxale propédeutique de l’inouï, une préparation à la surprise de vivre et de décider en vertu d’un amour inséparable de la gloire, dans l’urgence des temps historiques, temps impurs que domine, inéluctablement, la politique.