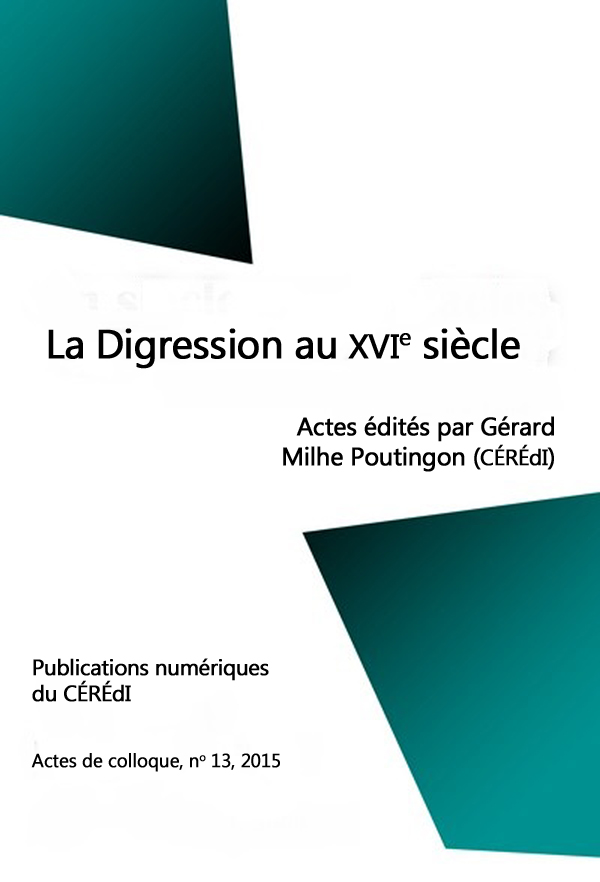Remise au goût du jour à la faveur du renouveau des études rhétoriques, soit dans les années 1960 à 1990, la notion au départ assez spécialisée d’ekphrasis [1] a progressivement envahi l’espace de la critique littéraire, et cela probablement pour deux raisons complémentaires : d’une part, une prise de distance des études rhétoriques vis-à-vis de l’approche structuraliste des premières heures, soucieuse de systémique et de critique interne à base de linguistique, au profit d’une recherche d’ancrage érudit dans les textes grecs et latins de l’Antiquité [2] ; d’autre part l’extension sémantique inexorable, sinon prévisible, dont ce concept a récemment fait l’objet, et qui a consisté à donner le nom savant d’ekphrasis à toute description plus ou moins recherchée et sentie comme artificielle, tout « morceau de bravoure » exhibé comme un petit chef-d’œuvre en soi au sein d’un matériau narratif qui ne l’exige pas au départ. Ironie de l’histoire, cet élargissement récent de la notion n’est que justice, puisque pendant des siècles, jusqu’à la fin d’un XIXe siècle obnubilé par l’histoire de l’art, elle désigne une façon vive et animée de faire faire au lecteur ou à l’auditeur le tour d’une créature ou d’une chose remarquable, sans qu’elle fasse forcément elle-même l’objet d’une représentation préalable [3]. Autrement dit, c’est l’équivalent grec antique de notre « description ». Il s’est produit sensiblement le même phénomène pour cette notion que pour celle d’oxymore ou celle d’hybris [4], qui ont aujourd’hui gagné droit de cité non seulement dans les manuels et la littérature parascolaire, mais aussi dans les médias les plus massifs et bien entendu l’analyse des discours politiques par les professionnels de la communication [5]. D’où l’agacement de maint universitaire devant ce qui est ressenti au mieux comme une inconséquente braderie, au pire comme un snobisme ridicule qui sacrifie à la mode langagière du moment une réalité scientifique – exactement comme les géographes qui tonnent contre l’abus du terme de « microclimat », et les psychanalystes contre un « travail de deuil » censé se déclencher à la moindre avanie.
Une brève illustration de ce difficile équilibre entre pertinence historique et efficacité contextuelle s’est manifestée tout récemment, lorsqu’en réponse à une sèche critique de Bernard Vouilloux, qui lui reprochait de sortir le terme de son univers de pertinence dans ses travaux, Liliane Louvel a répondu par un plaidoyer pro domo extrêmement circonstancié, prenant appui sur des théoriciens anglo-saxons mais aussi sur les textes antiques, et défendant le maintien de l’usage de cette notion, susceptible selon elle, moyennant un aggiornamento théorique somme toute mineur, d’en respecter l’esprit tout en éclairant nombre de textes modernes [6]. Mais ce qui reste pendant, sur tout le spectre d’une critique contenue entre ces deux extrémités, c’est le lien entre l’ekphrasis et son environnement, ou son inscription protocolaire : qu’il s’agisse de parler d’« effet-tableau », de « peinture en image », d’effort tendant à « rendre visible le lisible qui dit le visible », pour reprendre quelques-unes des expressions les plus courantes au sujet du procédé, son caractère « détachable », son aspect de « bloc » plus ou moins autonome, qui le rapproche des exercices scolaires – Roland Barthes s’était risqué à le théoriser [7], avant de se voir reprocher une torsion des réalités rhétoriques de l’Antiquité au profit d’une grille sémiotique généraliste [8] – pose toujours la question du bien-fondé de sa survenue dans le tissu du discours global. Le lien de l’ekphrasis avec d’autres réalités de la culture rhétorique, comme le genre épidictique, dont elle paraît relever en priorité sans en être l’apanage, ou comme l’enargeïa [9], qui la met en concurrence avec l’hypotypose [10], n’éclaire pas forcément sa spécificité d’artifice, et ne fait même que renforcer l’interrogation sur ses fonctions, voire simplement ses valeurs. D’une certaine manière, l’ekphrasis peut apparaître comme une digression ornementale qui agrémente le discours et lui donne du lustre en se référant implicitement aux modèles anciens, au premier rang desquels le fameux bouclier d’Achille [11].
Si toute digression n’est pas ekphrasis, loin de là, il se pourrait en revanche que toute ekphrasis soit une forme de digression, dès lors que le lecteur ou l’auditeur perçoit un changement de régime discursif, et repère comme déviation, sinon déviance par rapport à un fil conducteur, une description particulièrement brillante et soignée prenant le prétexte d’un détail ou d’une circonstance. C’est de cet effet de sens qu’il faut partir en effet, surtout si compte est tenu de cette fameuse « norme de la pertinence » que Gérard Milhe Poutingon a su exploiter dans sa Poétique du digressif : la digression fait saillie sur un avant et un après, mais peut, le cas échéant, masquer plus ou moins ce qui pourrait la faire trouver incongrue, d’où la vaste gamme de procédés et de marqueurs syntaxiques qui sont censés renforcer ou au contraire amortir la distance avec le fil conducteur : c’est ainsi que Gérard Milhe Poutingon, justement, identifie des « procédés d’estompage » chez le Ronsard des Odes, censés « atténuer les disjonctions trop fortes entre les diverses strates de ses poèmes (sa poésie repose sur un imaginaire de l’ordre et de la concorde) » [12].
L’interrogation sur le caractère digressif de l’ekphrasis se justifie d’autant plus que, pour rester sur le cas de Ronsard, des critiques ont cherché à dégager les valeurs, ou les fonctions de l’ekphrasis dans son œuvre, et que celles-ci évoquent à s’y méprendre celles que l’on peut assigner à la digression : tantôt il s’agit de divertir, tantôt de figurer la suite, etc. Mais avant de revenir sur ces possibilités et de tenter de les classer, il faut s’arrêter un bref instant sur le distinguo qui vient d’être fait entre valeurs et fonctions de l’ekphrasis : parler de « fonction », c’est postuler une cause finale, une vocation décidée en droit et en amont, c’est présupposer un effet visé et un statut structurel bien défini, qui dépendent d’un lectorat intériorisé, virtuel, alors que parler de simple « valeur », c’est s’arrêter au constat d’un effet de sens, d’une conséquence tangible, d’un résultat esthétique de fait mais qui n’engageait peut-être pas un paramétrage a priori du texte considéré : peut-on assurer que l’effet de sens implique un encodage délibéré destiné à l’obtenir ? Cette question est un peu le pont aux ânes de la critique, mais elle ne doit pourtant pas, en cette occasion précise, être tout à fait éludée, car elle incite à éviter deux écueils : d’un côté, un excès de prudence qui s’en tiendrait à la « valeur », et qui présupposerait un spontanéisme créatif d’autant moins probable chez Ronsard qu’il est par excellence le poète de la réécriture et de la variante, affichant la persistance d’un regard très conscient d’artisan sur sa propre production ; de l’autre côté, un excès de raccordement sémantique, l’herméneutique ayant par essence un penchant à l’exhaustivité, à l’hégémonie, à l’établissement de symétries plus ou moins savantes, à la reconstitution d’un ordre, de correspondances symboliques, quitte à concéder quelques démentis ponctuels à la règle et quelques bizarreries irréductibles, comme l’ombilic du rêve dans la théorie freudienne de la « science du rêve » [13] – la tentation est grande, en effet, de tout ranger sous un même principe systémique [14].
Faut-il se tenir à mi-chemin ? Ce n’est guère envisageable, mais une sortie de dilemme est possible d’une autre manière, en décidant provisoirement que toute valeur est susceptible d’être réputée fonction, mais à condition de se situer clairement dans l’une des deux catégories possibles, en fonction de son degré de stabilité ; il y aurait ainsi d’une part quatre fonctions toujours valables, ou peu contestables, quel que soit le texte ronsardien, et qu’ont déjà repérées certains commentateurs de manière plus ou moins isolée :
1. s’appuyant sur l’avis Au lecteur des Odes de 1550, François Rouget détecte une fonction de retardement délibéré de la fin du poème : les « vagabondes digressions, industrieusement brouillant, ores ceci, ores cela » [15] (le passage est fameux) ont pour but selon lui d’« infléchir l’hommage direct et [d’]allonger le temps qui le sépare de la fin de son poème » [16]. Cette fonction de retardement, voire de « différance » au sens derridéen, peut toujours être supposée, dans la mesure notamment où elle a aussi à voir avec la copia uerborum.
2. une fonction de uarietas, qui tient prioritairement au delectare rhétorique, et dont la digression, et / ou l’ekphrasis, ne sont que deux concrétisations possibles. Michel Dassonville insistait naguère sur ce rôle, qui aboutissait à la suprématie provisoire du parergon sur l’historia, et qui tenait selon ses termes à une « haine du statique » [17].
3. une fonction militante ou concurrentielle, donc implicitement argumentative, pour la primauté de la poésie sur la peinture sur le terrain de la puissance évocatrice, dans la tradition du Paragone de Léonard de Vinci, mais prenant naturellement le contrepied du maître toscan. Malcolm Quainton et Elisabeth Vinestock parlent ainsi de l’ekphrasis du panier de Léda comme d’un commentaire implicite sur ce débat renaissant [18].
4. une fonction de mise en avant, d’ostentation même d’une « manière » personnelle, comme le pense Agnès Rees à la suite des travaux de Perrine Galand-Hallyn, en évoquant volontiers un « maniérisme » ronsardien [19]. Ce qui est valable pour les ekphrasis des Hymnes l’est évidemment pour celles que proposent les Odes, la « fantasie » débordant le seul souci de mimesis.
Il y aurait d’autre part, de manière conjoncturelle cette fois, quatre fonctions plus ou moins plausibles selon les pièces considérées :
1. une fonction structurale, dans laquelle Philip Ford voyait l’une des trois fonctions « néoplatoniciennes » de l’ekphrasis – par opposition aux fonctions « aristotéliciennes », de type allégorique et de décryptage élémentaire, dépourvues de mystère –, et qui la fait agir à l’intérieur du poème comme rappel ou effet d’annonce d’un événement, ce qui est censé « éviter la monotonie […] d’un récit linéaire » [20], et ce qui rejoint en fait la fonction de uarietas mais de manière spécialisée.
2. une fonction paradigmatique (toujours selon Philip Ford), qui consiste à dresser une scène parallèle à celle de l’événement principal, par effet de figuration plus ou moins flagrant. À divers titres, Anne-Pascale Pouey-Mounou et Hélène Moreau ont également remarqué les fonctions annonciatrices, prémonitoires, de l’ekphrasis, soit dans son esprit global soit sur certains détails (par exemple, le renversement de la jatte de lait que se disputent deux satyres dans la Defloration de Lede annonce probablement le viol de celle-ci) [21].
3. une fonction mystique, l’ekphrasis ayant cette fois la propriété non pas d’appeler à l’élévation jusqu’aux vérités divines grâce à l’inspiration, comme c’est parfois le cas, mais bien de délivrer « aux initiés un mystère voilé » [22]. Une sorte de stylisation des personnages et un examen de leurs aventures débouchent sur une traduction philosophique.
4. il faudrait ajouter enfin une fonction « publicitaire », pour reprendre l’expression de Terence Cave, qui voit dans la Defloration de Lede et le Ravissement de Cephale (considérés dans leur ensemble, pas seulement dans leurs ekphraseis) des promesses implicites du grand œuvre épique à venir, par le biais du récit de naissances célèbres et fabuleuses – ce qui est une façon évidente de se recommander en tant que poète [23].
Comme elles sont parmi les plus fréquemment citées par ces divers critiques à l’appui de leurs lectures, et que certains les traitent même comme un « diptyque » – c’est notamment le cas de Philip Ford [24] –, autant essayer de voir en quoi la Defloration de Lede et le Ravissement de Cephale assurent ces fonctions ou revêtent ces valeurs, étant entendu qu’il s’agit surtout de juger si les ekphraseis qu’elles contiennent peuvent les faire considérer comme des digressions, avec ce que la notion implique d’écart assumé.
Une première remarque touche à la singularité structurelle de ces deux amples compositions : la Défloration et le Ravissement sont des odes très complexes sur le plan de la dispositio et de l’unité thématique, et l’ekphrasis qu’elles contiennent y contribue énormément. Dans aucune des deux, la succession des scènes et des descriptions ne va de soi, dans aucune des deux le parcours discursif n’est limpide, et encore moins prévisible. À vrai dire, et c’est déjà là un trait de connivence ou de proximité avec la digression, les bizarreries sont nombreuses et diverses : le passage des reproches de l’amant à Cassandre qui ouvre la Defloration à l’« amoureuse rage » de Jupiter est un peu abrupt, au point que le lecteur se demande s’il y a identification implicite, et donc menace au moins simulée [25] ; la description du panier manque d’unité, au moins à première lecture ; en outre elle s’achève avant la fin de la « seconde pose », alors que l’ekphrasis aurait pu, sinon dû, être sagement délimitée avec une coupure bien nette (la cueillette des fleurs occupe les strophes 16 et 17 et précède la troisième « pose ») ; dans le Ravissement, Ronsard fait de Neptune le père de Thétis (v. 21 et 255), ce qui est tout à fait hétérodoxe et incongru, les poètes et mythographes faisant de la future épouse de Pélée la fille de Nérée [26] ; il n’impute pas la mort de Procris au dépit amoureux de l’Aurore, là encore à la différence des Anciens, et particulièrement d’Ovide [27], mais explique l’innamoramento de l’Aurore par sa vision de Céphale en pleurs auprès de son épouse déjà mourante ; quant à la prédiction finale de Thémis, comme le remarque Laumonier, elle n’a « pas de rapport avec le sujet central, à moins que ce ne soit par l’allusion à l’une des futures victimes d’Achille, Memnon, le “noir enfant de l’Aurore” » [28] – apaisante hypothèse, à ceci près qu’Aurore n’a pas eu cet enfant de Céphale, mais de Tithon, qui n’apparaît nulle part ici ; enfin, on peut se demander pourquoi c’est l’histoire de Céphale qui prend place pendant l’achèvement de la confection du manteau de Neptune, sujet de l’ekphrasis : il y a là certainement une énigme posée au lecteur, qui, même familier de la fable antique, a du mal à saisir le rapport.
Outre ces bizarreries, cependant, ces deux odes ont de solides points communs thématiques et formels : d’abord, elles reprennent des fables mythiques centrées sur une violente prise de possession de mortels (ou de divinités non olympiennes [29]) par des Immortels (Jupiter féconde Léda malgré elle, Aurore enlève Céphale malgré lui) ; ensuite, elles s’achèvent sur la promesse de naissances illustres et prestigieuses (les Dioscures et Hélène naîtront de Léda, et Achille de Thétis, à l’occasion des noces de qui on évoque Céphale – mais dans ce dernier cas, évidemment, il y a décalage, partiellement soluble par l’invite évidente à la projection analogique) ; enfin, elles sont de facture alexandrine, par le raffinement de la dispositio comme de l’elocutio, ainsi que par l’éclectisme des sources de l’inuentio, Ronsard mêlant plusieurs sources. Il en est d’autant plus étonnant de voir un Deimier, en 1610, mettre au pinacle ces deux odes (encore une fois associées) au motif de leur « clarté », et dans un chapitre justement consacré à cette qualité de l’art d’écrire [30]. Certes, le critique parle ici de pureté ou de sobriété des expressions, aux antipodes selon lui, dans ces deux pièces, de l’amphigouri métaphorique et syntaxique d’un Du Monin par exemple [31] ; pourtant, il ajoute avec effusion qu’elles sont « divinement formées » (je souligne), qualification qui fait plutôt appel à une virtuosité de composition d’ensemble.
Cette composition, justement, mérite d’être examinée, en particulier au niveau des temps grammaticaux et des plans d’énonciation qu’ils déterminent : dans la Defloration tout d’abord, les quatrième et cinquième strophes évoquent Jupiter dans un mélange de présent et de passé composé, ce qui rappelle la toute première strophe ; mais alors que la métamorphose en cygne est donnée sous ce régime, une brusque énallage de temps évoque la mise du collier au passé simple au début de la strophe 6 (« En son col meit un carcan »), dont vient immédiatement la description d’abord au présent, puis à l’imparfait, et ensuite à nouveau au présent, tout cela en l’espace de huit vers, et même, pour la dernière énallage, dans la même phrase. C’est un peu étrange, car le récit n’est pas encore lancé selon un régime bien sûr, qui hésite entre l’historique classique (qui débute avec le passé simple, et que confirme largement l’imparfait) et le présent narratif, avec lequel l’imparfait est tout aussi compatible. La septième strophe paraît partir dans cette direction (« Il fend le chemin », « Tire ses rames »), mais c’est pour déboucher à nouveau sur un autre régime, le mélange imparfait / présent à la huitième strophe, qui évoque la descente du cygne divin sur l’étang : le passé simple eût été au moins aussi logique que le présent (« tant qu’il arrive ») entre les deux imparfaits « voloit » et « soulloit », ou bien à l’inverse le présent pouvait se maintenir sur ces deux derniers verbes (*« [Et] ainsi le Cigne volle » [32]).
Le présent semble donc commander l’essentiel du récit, et pourtant, dès la strophe suivante, nouveau glissement : un passé antérieur décale la vision (« Quand le ciel eut allumé »), et le verbe dont Léda est sujet est au passé simple (« mena jouer »)… mais deux vers plus loin, le présent revient, là où un imparfait descriptif était attendu (« En sa main un panier porte »). S’ouvre alors l’ekphrasis proprement dite, délimitée par le titre de la « seconde pose », et à l’imparfait (« s’ouvroit », « couvroit », « vagoient »). Sans motif apparent, la strophe 11 fait revenir le présent (« Il tourne tout à l’entour »), et cette fois pour longtemps, jusqu’à la strophe 14 incluse (« Le lait se verse sur eux »)… mais à la strophe 15 revient l’imparfait avec les béliers qui « se heurtoient », dans une scène en tout point comparable à celle des deux satires qui précédait et qui, elle, était au présent. Et tout aussi curieusement, le passé simple revient dans la même strophe 15, sur le ton d’une chansonnette moralisatrice (« en ses mains meit », « la feit / Femme »), mais en incluant au passage un présent (« Lede qui sa troppe excelle ») au lieu d’un imparfait sans doute plus logique. La seconde « pose » pourrait s’achever sur cette belle formulation conclusive, mais Ronsard la prolonge en narrant la cueillette des fleurs au présent (« L’une arrache d’un doi blanc ») alors qu’on était resté au passé simple, et en donnant priorité à une autre coupure, celle du discours direct de Léda, qui ouvre la « tierce pose ».
Cependant, le présent estompe la coupure entre deuxième et troisième pose, puisqu’il se prolonge à la strophe 18 avec le discours direct de Léda et le récit de son approche de la rive (mais l’auditeur ou lecteur ne peut être tout à fait sûr que le « dist » de la strophe 17 n’était pas en fait un passé simple). Les plans sont donc hésitants ou légèrement brouillés, en tout cas instables, et ce n’est pas terminé, puisque la rencontre entre Jupiter et la jeune fille débute au passé simple, ce qui crée un nouveau décalage : mais en l’espace d’un vers resurgit le présent (strophe 19, on passe de « lui tendit la main » à « qui tresaut d’aise »), un présent qui se prolonge jusqu’aux premières privautés excessives du cygne, lequel brusquement « devint plus audatieus »… avant que le présent ne reprenne le dessus, puis à nouveau le passé simple, encore en l’affaire d’un vers (« le sein de la vierge touche, / Et son bec lui meist »), puis à nouveau le présent à la strophe 22, qui narre le viol proprement dit (« Contraint la rebelle », « se debat fort »). Et l’énallage de recommencer avec le passé simple pour exprimer la réaction de Léda (« Coulora », « parla »), puis, dans la même strophe, rendu plus logique par le passage au discours direct, le présent ; l’évanouissement de Léda mêle quant à lui le présent et l’imparfait, et dans la même phrase, avant que le passé simple n’y succède pour annoncer le discours direct de Jupiter (« lui répondit »).
La quatrième pose, la seule réellement homogène, réinstalle jusqu’à la fin le système du présent, avec simplement l’inclusion d’un passé composé, d’un impératif et de futurs prophétiques qui suffisent à éviter la monotonie au long de quatre huitains. C’est peu de dire que la situation se calme aussi bien sur le plan événementiel que sur le plan discursif et grammatical. Pour récapituler de manière schématique :
Structure temporelle de La Défloration de Lede [33]

Quant au régime temporel du Ravissement, cette « ode très particulière » comme le dit prudemment Olivier Pot [34], il est de la même eau, avec cette complexité supplémentaire que l’accessoire qui fait l’objet de l’ekphrasis ne fait pas partie intégrante de la fable centrale, puisque le manteau de Neptune n’a rien à voir avec l’enlèvement de Céphale, alors que le panier de Léda a tout à voir avec la perte de sa virginité. Le récit de l’éveil des Néréides sous les encouragements d’une « vierge vigilente » débute au passé simple, comme n’importe quel récit de fable, mais le mélange des plans ne tarde guère : la troisième strophe montre les Néréides au travail à l’imparfait (« Elles brodoient »), en aspect sécant parfaitement typique du récit au passé simple, mais qui succède quand même à un présent de narration (« chacune est ardente ») inséré à la suite du discours direct de la vierge, mais pour réinstaller juste après un présent d’arrière-plan (« où son mari l’appelle »). Le début de l’ekphrasis mêle encore et plus nettement les temps (du passé simple passif au présent, puis à l’imparfait) dans la même strophe 4. La strophe 5 revient au présent dans de vigoureuses hypotyposes (« Cà & là le vent la vire »), puis la strophe 6 passe de ce présent à l’imparfait alors qu’il s’agit toujours de la description de la tempête, et une nouvelle énallage, encore plus nette, fait revenir le présent dans la même phrase qui enjambe la strophe 7 (« entrelassoient », « effaçoient », puis « Se menaçent », « Crient »). Nouveau changement d’aspect avec la strophe 8, où Neptune est évoqué au passé simple passif sur fond d’imparfait (« i fut peint », « faisoit ranger ») puis au présent (« Sont leur prince environnants ». Et le présent se maintient à la strophe 9, qui achève d’évoquer la puissance majestueuse du dieu marin. La dixième strophe, qui clôt l’ekphrasis et la première pose en revenant au travail des Néréides et à l’annonce du récit de Naïs, opère encore un décalage en réinstaurant le système imparfait / passé simple (« Elles finoient de portraire […] Quand Naïs de sa parolle / Feit ainsi resonner l’air »).
La « seconde pose » débute logiquement au présent implicite que dessine l’impératif et l’optatif du discours direct de Naïs, puis le récit proprement dit s’enclenche au passé simple (strophe 12) ; mais la strophe 13 mêle le présent, pas forcément attendu (« elle s’allume »), et un imparfait qui s’était fait oublier (« elle alloit davant »). La strophe 14, qui garde l’imparfait au début, fait saillir sur celui-ci deux passés simples (« N’endura », « se mella »), avant que la strophe 15 ne revienne au présent de narration (« s’efforce ») ; mais deux vers plus loin, et dans la même phrase, c’est à nouveau un passé simple en système avec l’imparfait d’arrière-plan (« lui feit voir », « ne devoit pas », « elle vit »). Les strophes 16 et 17 contiennent le discours direct de lamentation de Céphale, avec présent, passé composé et impératif, mais la strophe 17 revient à un système présent / imparfait (« il se pasme […] De ses levres amassoit ») pour le dernier souffle de Procris – qui du reste, bizarrerie supplémentaire, n’est jamais nommée ainsi. La strophe 18 présente une nouvelle énallage, puisque la transcription des premières atteintes de l’amour sur l’Aurore est au présent (« perd sa couleur », « se sent etrainte ») puis au passé (« Entra », « se feit Roi de son cueur »), dans le même mouvement et sans aucune nécessité.
L’évocation très ovidienne et virgilienne à la fois des symptômes de sa maladie amoureuse s’étend sur de nombreuses strophes (19 à 26 incluse, soit un « carré » de huit huitains et 64 vers, ce qui concurrence l’ekphrasis par l’aspect de « tableau animé »), mais cette fois continûment au présent de narration, qui recouvre une période sentie comme assez longue (mais nulle datation ne vient la préciser). L’instabilité recommence avec la strophe 27 qui évoque la prise en pitié de l’Aurore par le dieu Amour, qui l’avait arbitrairement prise pour cible en lui faisant voir Céphale, car dans la même phrase les verbes dont il est le sujet sont d’abord au passé simple puis au présent, mais avec un arrière-plan d’imparfait (on passe de « En eut » à « La meine », puis à « regretoit »). Et le phénomène se poursuit, puisque dès la strophe suivante revient le passé simple (« pressa », « parla »), avant un discours direct parénétique de l’Aurore à Céphale qui peut inclure comme tel plusieurs temps et modes (« Pourquoi pers tu », « à la mort fut sugette », « reçoi moi ») : mais la réaction négative de Céphale est donnée à un temps indécidable (« Fuit » peut être passé simple ou présent, ce qui brouille l’image), mais avec peut-être un léger avantage cotextuel au passé [35], avant de laisser place à une nouvelle énallage fulgurant passé simple / présent (de « s’écarta » à « Volle »). Le présent se maintient sur la dernière strophe de la seconde pose, qui conclut le récit. La scène de la broderie du manteau reprend alors, pour la « tierce pose », selon un imparfait d’arrière-plan, mais sur lequel tranche maintenant un présent de narration (« demande », « s’abille »), qui se prolonge probablement, par défaut comme à la strophe 30, jusqu’au verbe introducteur du discours direct de Thémis (« lui dist » pourrait être aussi un passé simple). La suite et fin ne réserve en revanche plus de surprise, comme celle de la Defloration, puisqu’elle consiste dans le discours prophétique de Thèmis à Thétis, selon un présent articulé au futur des exploits d’Achille. En récapitulation schématique :
Structure temporelle du Ravissement de Céphale

Comment ne pas remarquer le nombre invraisemblable de changements de temps grammatical dans les propositions principales, et particulièrement le nombre d’énallages temporelles (si l’on réserve le terme rhétorique aux changements réellement surprenants et spectaculaires, notamment dans une seule et même phrase) ? Le tableau récapitulatif de chaque ode permet de les visualiser, les énallages temporelles stricto sensu étant signalées par un astérisque : douze pour la Defloration, neuf pour le Ravissement. C’est évidemment considérable, surtout si ces deux pièces sont mises en perspective avec deux autres odes que beaucoup de critiques rapprochent sur la base d’une communauté d’inspiration et de facture générale : la Complainte de Glauce à Scylle nymphe (III, 21), et Des peintures contenues dedans un tableau (II, 28) : celle-ci est une pure description d’œuvre d’art entièrement composée au présent, et celle-là, plus narrative, ne contient qu’un passage au passé, très logique et parfaitement homogène [36], lorsque Glaucus rappelle son innamoramento alors qu’il évoluait déjà parmi les dieux marins pour avoir mangé « l’herbe tant vertueuse ». Il revient ensuite, jusqu’à la fin du poème, au présent de son discours direct. Rien à voir donc avec cette « valse à mille temps » qui brouille sans arrêt les points de fuite d’une même scène, et qui ne peut s’expliquer par un simple désir de uarietas ou un caprice gratuit. Une telle fréquence autorise les commentaires suivants :
1. Il ne peut s’agir d’un hasard ou d’une inadvertance, car à pareille fréquence l’intentionnalité du procédé est évidente : Ronsard vise un effet, et s’il y a « valeur », comme on l’évoquait à propos de l’ekphrasis en tant que telle, il y aura certainement « fonction », paramétrage délibéré de l’effet.
2. Ces changements d’aspect dans l’évocation des scènes décrites sont à la fois (et c’est ce « à la fois » qui est capital) très sensibles comme décalages par rapport à un « avant », et tout à fait licites grammaticalement, car il ne s’agit pas de fautes de langue, ou même de légères incohérences comparables à des solécismes, des redondances ou des idiolectes un peu naïfs. Il s’agit de formes parfaitement recevables, mais qui surprennent par la soudaineté et l’arbitraire de leur apparition à l’oreille ou à l’œil.
3. L’essentiel des brusques changements constatés réside dans l’alternance, et donc la concurrence, de deux systèmes binaires de cadrage temporel et aspectuel : le système imparfait / passé simple, et le système imparfait / présent. Le premier, comme l’on sait, privilégie la distance et l’historicité, avec une saisie perfective et non-sécante, le second la proximité et la cursivité subjective, avec une saisie imperfective et sécante, nécessairement plus empathique. La différence n’est pas énorme, mais le fait que dans le premier système l’un des deux tiroirs soit non-sécant (le passé simple) alors que dans le second les deux soient sécants suffit à provoquer, lorsqu’il y a passage de l’un à l’autre, un déplacement du regard imaginaire que l’on porte sur la scène décrite, que celle-ci soit statique ou dynamique : dans le premier cas, le lecteur ou l’auditeur suit un récit de fable relevant du genre du conte immémorial et de tradition collective, comme si la voix qui le transmettait privilégiait l’exactitude événementielle, dans le second il suit un récit relevant davantage de la confidence familière et du témoignage personnel insistant sur un pathos digne d’être partagé.
La conséquence de ces trois remarques entre directement en rapport avec la présence des ekphraseis dans ces deux odes : comme ce ne sont pas les ekphraseis elles-mêmes qui sont le plus touchées par les énallages temporelles malgré leur étendue (un seul pour la tempête brodée sur le manteau de Neptune, deux pour le panier de Léda), Ronsard déplace l’irrégularité et le sentiment de rupture en le multipliant sur la globalité des pièces qui les contiennent, de sorte que la présence quasi continue de ces petits à-coups et changements de regard tend à araser les disparités dispositionnelles, à tout fondre dans une même souplesse discursive, et finit par suggérer, par un discret travail de sape, que tout ce qui est décrit et narré se situe sur le même plan, non isolable du reste. Il y a là un effet de brouillage qui, plus que l’art des raccords grammaticaux avec des connecteurs logiques, estompe en profondeur l’hétérogénéité des composants [37].
C’est d’autant plus sensible que l’on a remarqué la non-coïncidence absolue des limites des ekphraseis avec celles des « poses », et que la version ronsardienne prend des libertés avec l’intertexte mythologique : l’originalité des deux compositions passe par un savant travail de transitions et de gommages [38], d’atténuation des frontières et des spécificités canoniques du personnel (on peut ajouter qu’il n’est pas question de la mort d’Achille à la fin du Ravissement par exemple), comme si le but était d’aboutir à la sensation que rien n’est ekphrasis – ou que tout au contraire est ekphrasis, ce qui revient au même : les deux odes créent un univers en suspension, où chaque détail justifie les autres et où le mouvement se joue aussi bien dans les stases descriptives que dans les relations factuelles, en un « tableau animé » qui désamorce le caractère digressif de tel ou tel passage. C’est la lecture analytique, faite à tête reposée, qui établit des cloisonnements, mais si elle met tant de temps à dégager la structure de cette marqueterie, c’est que le tourniquet des temps grammaticaux « déspécialise » en même temps qu’il « spatialise » leurs visées habituelles, et finit par tout disposer sur le même plan, qui est simplement celui du chant de célébration des grandeurs et des mystères, à peu près indifférent à la véritable chronologie [39].
Dès lors, Ronsard ouvre d’autant plus grand les portes de l’interprétation, car les passerelles entre les diverses étapes bénéficient de cet estompage lancinant, fait précisément de petites coupures imprévisibles : le lecteur peut supposer par exemple – ce sera un mince écot personnel à la liste des lectures « paradigmatiques » – que les fleurs cueillies pour remplir le panier de Léda et de ses « piglardes » compagnes figurent symboliquement la cueillette littéralement « anthologique », par Ronsard lui-même, d’une grande variété de détails empruntés à d’illustres Anciens, Ovide, Virgile, Claudien, mais aussi Moschos de Syracuse, dont le récit du ravissement d’Europe adopte le même genre de structure et de notations concrètes [40] – et qui, soit dit en passant, est un modèle de réussite et d’expressivité dans les hypotyposes, notamment quand le taureau-Jupiter frôle l’écume des vagues à folle allure en conduisant la belle, dont le vent gonfle la robe, jusqu’au rivage de Crète. Mais surtout, si les quatre fonctions de l’ekphrasis ne sont guère contestables dans les deux odes (retardement, uarietas, compétition avec la peinture, maniérisme), les quatre valeurs (structurale, paradigmatique, mystique, publicitaire) mises en doute ensuite peuvent aussi bien être reconnues ici et promues au rang de « fonction », même la valeur « mystique », à condition toutefois de considérer que le « mystère voilé » délivré aux initiés n’est pas d’ordre religieux ou simplement métaphysique, mais métapoétique. Ayant en effet toutes les raisons de régaler le lecteur d’une ekphrasis qui serait très légèrement digressive – avec ce qu’il faut de transgression, de déviance, d’écart un peu complaisant, de reconnaissance implicite d’une infraction à la norme de pertinence –, le poète des Odes fond l’ensemble de sa composition dans un ouvrage replié sur lui-même, où rien n’est en réalité superflu, et où par conséquent, si la logique est suivie jusqu’au bout, l’ekphrasis en tant que telle attire à soi tout ce qui n’est pas elle, et se fait aussi évidente que mystérieusement nécessaire.