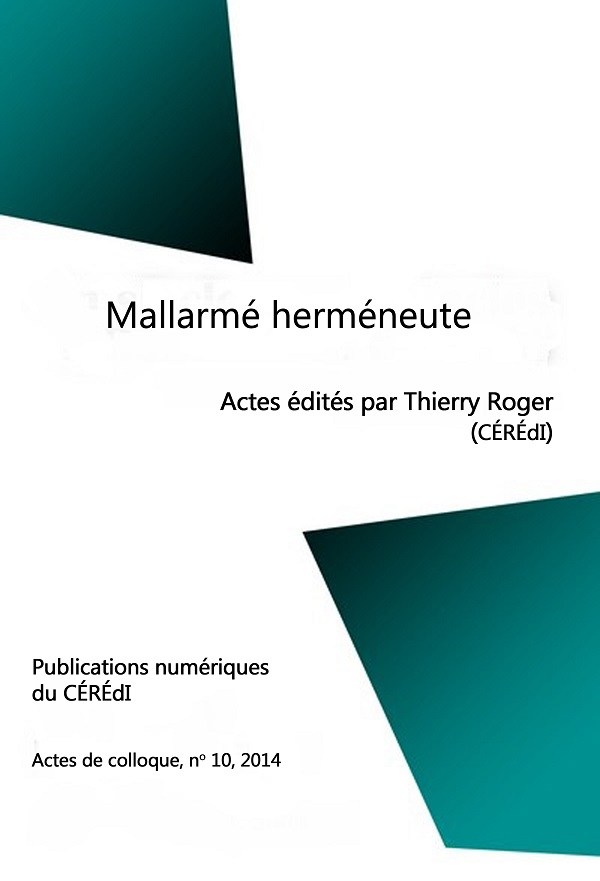Mallarmé, illisible ? Ce texte ne vise évidemment pas à réveiller le vieux débat, issu de la toute première réception du poète, opposant les herméneutes aux démissionnaires, dont les verdicts, souvent impitoyables, ont fait le piquant de plus d’une chronique, celles d’Anatole France, d’Adolphe Retté ou de Léon Tolstoï, pour ne citer que les plus connues. Leurs coups d’humeur ne nous font aujourd’hui plus guère que sourire ; nous les déplorons comme des erreurs de jugement dont regorge l’histoire littéraire, en particulier dans sa modernité. Mais en gratifiant d’un coup d’œil même rapide les documents rassemblés par Bertrand Marchal dans un volume de Mémoire de la critique, on tirera pourtant quelques leçons de cet anachronique scandale. Aux constats d’échec – « je n’ai pu prendre mon parti de ces séries de vocables [1] » –, aux aveux de lassitude – « le malheur est que tout le monde ne peut pas lire endormi [2] » – et aux jugements de valeur plus généraux – « il est impossible d’y comprendre quoi que ce soit [3] » –, s’ajoutent des tentatives d’explication – « il a une trop haute idée de l’intelligence de ses lecteurs, ou il ne tient pas assez à être compris [4] » –, mais surtout, des accusations de fumisterie – « vous en ferez autant, s’il vous prend fantaisie de mystifier votre prochain [5] ». L’œuvre de Mallarmé suscite alors l’« hostilité [6] » ou l’« impatience », et l’on « ferme le livre » avec « une vague inquiétude d’avoir été pris pour dupe [7] ». Parmi ceux qui se seront « contraints à essayer de lire [8] », peu seront récompensés, et le plus grand nombre préférera peut-être se contenter de connaître Mallarmé « sans avoir lu ses vers [9] », s’appuyant à moindre frais sur une légende que diffusent ses disciples tout comme ses détracteurs, et remplaçant la mystification par un mythe.
On sait que Mallarmé n’ignorait pas la critique que ressassaient ses contemporains. On sait également qu’il défendait volontiers, sinon l’obscurité littéraire, du moins « Le mystère dans les lettres », et qu’il s’amusait plutôt de ce qu’on le considérât comme illisible. Non seulement il n’a jamais cherché à faire de la lecture choses aisée, mais il a aussi imaginé, comme on va le voir, ce qui se passerait si le livre existait sans être lu. L’auteur pourrait-il ainsi faire l’économie d’une œuvre ? Et le public se laisser séduire, si ce n’est par un texte absent ou un livre brûlé, par un « sens indifférent [10] », une « pièce principale ou rien [11] », un objet qui comme dans les fantasmes inquiets d’Edgar Poe, lasst sich nicht lesen, « ne se laisse pas lire [12] » ?
Que Mallarmé nous recommande de ne pas lire ? Cet article visera à montrer qu’en certains cas, dans quelques textes en prose auxquels j’accorderai une attention particulière, le poète juge que la non-lecture est préférable ; il remplace alors le mystère par un mythe, dont je tâcherai de préciser la fonction. Que l’auteur de La Musique et les Lettres, pour qui « la littérature existe […] à l’exception de tout [13] », reconnaisse des vertus à la non-lecture ? J’espère montrer qu’au-delà de son apparente ironie, cette proposition pour le moins risquée, si on l’osait, nous permettrait de saisir chez Mallarmé une insolite défense de l’action littéraire, assurément paradoxale, qui passe par la double valorisation de l’objet-livre et des légendes auctoriales. Bien avant sa postérité, le poète aurait accompli une mythification – et dire cela ne revient évidemment pas à le traiter de mystificateur. À la suite des travaux de Pascal Durand et Patrick Thériault [14], eux-mêmes influencés par la géniale découverte de Pierre Bourdieu, qui dans Les Règles de l’art attribuait à Mallarmé un « fétichisme décisoire [15] », je m’intéresserai ici non seulement au « double discours » du poète, mais plus spécifiquement, par un choix décidément partial, au côté positif de son « (dé)montage » – à une sorte de « remontage » utopiste. La fiction littéraire, Mallarmé n’en dévoile pas seulement les mécanismes déceptifs, mais il la célèbre, l’investit, en fait le synonyme de la poésie [16] et se voue à faire valoir son rôle dans la cité [17]. L’œuvre et l’auteur sont peut-être des fictions, mais ce sont des fictions utiles, dont on peut vouloir en tant que telles réaffirmer la valeur.
Éloge de l’illisible
À n’en pas douter, l’œuvre de Mallarmé présente une « figuralité » étonnamment sensible, pour reprendre la notion forgée en 1990 par le critique Laurent Jenny [18]. La langue s’y donne à voir dans toute son étrangeté, elle s’y met en scène et confronte le lecteur d’une manière ambiguë, lui refusant tout accès direct à la signification, mais ne cessant par ailleurs de le convoquer en l’invitant à émettre d’infinies hypothèses herméneutiques. La langue si particulière de Mallarmé s’appuie sur un style que l’on perçoit et reconnaît immédiatement, en deçà de tout effort au sens, et bien que le poète évoque fréquemment un idéal d’« impersonnalité [19] ». L’illisibilité de l’œuvre, son surplus de « figural » jouent également comme surconvocation à lire.
Le poème par excellence, dès lors, sera à première vue illisible, ce qu’indique notamment le poème en prose « La Déclaration foraine », publié en août 1887, au terme d’une période que Mallarmé consacre presque exclusivement à la rédaction de « Notes sur le théâtre » qui paraissent dans La Revue indépendante de novembre 1886 à juillet 1887 ; de ces notes critiques, le poème en prose pourrait constituer le versant à la fois théorique et imaginaire. Il est en effet encore question de théâtre dans « La Déclaration foraine », qui décrit une performance insolite, mise en scène par un « je » poète et sa compagne à l’identité incertaine. Les deux personnages y répondent à l’appel d’une scène vide, minimale, dans laquelle il leur revient d’injecter la dose nécessaire de fiction qui contenterait un public improvisé, afin qu’il se trouve quitte de la dépense qu’on a exigée de lui. Le spectacle est composé de deux parties, d’abord l’exhibition muette de la femme, vêtue selon la mode de l’époque, exposée sur des tréteaux, puis la profération, par le « je », d’un poème que le lecteur de Mallarmé pourra lire à son tour, soit dans le poème en prose lui-même, soit dans le recueil des Poésies : on y trouvera « La chevelure vol d’une flamme à l’extrême » placé juste après deux autres poèmes-performances, Hérodiade et L’Après-midi d’un faune [20]. Dans « La Déclaration foraine », le spectacle de la femme en tant que telle, sans costume ni décor particuliers, « sans supplément de danse ou de chant », « à défaut de tout » en somme, ne peut pas se dispenser d’un complément, que le « je » lui adjoint en recourant à « la puissance absolue […] d’une Métaphore [21] ». Le poème gagne alors un usage performatif [22] : se donnant à entendre comme poème, il confère au spectacle la quantité de spectaculaire dont il a besoin pour gagner les faveurs de son public. Le poème incompréhensible ne sert pas à berner un spectateur auquel le poète voudrait retirer sa menue monnaie, ou plus tard le lecteur, mais il joue le rôle, devant un dispositif scénique minimal et pour compenser la déception induite par un « tableau vivant » très peu piquant, d’un puissant générateur de fiction. Remplissant un devoir de mystification, il ne relève pourtant pas de l’imposture ni du leurre.
Ceci ne revient pas à dire que « La chevelure vol d’une flamme… » n’a pas de sens, et les commentateurs veilleront à nous prouver le contraire. Mais pour le badaud qui fréquente la foire et tombe par hasard sur un spectacle aussi insolite, le poème a bien des chances de rester lettre morte. Le public profane se limitera à comprendre qu’il s’agit d’un poème – dont la forme régulière et l’hermétisme mystérieux font un spécimen exemplaire – et qu’il parle d’une chevelure féminine – son attaque le rattache ainsi à une tradition poétique dominante, celle du Parnasse. Il éprouvera à son égard un « ébahissement [23] » ; et grâce à lui, le poète aura prouvé son hypothèse de départ, à savoir que le spectacle de la beauté féminine peut se passer de costume – tout aussi bien que de grivoiserie. Le « tableau vivant » qu’elle constitue, en effet, ne répond pas aux règles d’un genre courant dans les foires de la fin du siècle, et ne flatte guère l’œil masculin, habitué à de moins chastes performances. En le complétant, le poème sert ainsi à établir, non par son contenu mais par sa seule présence, la validité d’un tel spectacle – une femme tout habillée, dressée simplement au centre d’une scène de fortune.
C’est grâce à un poème illisible que dans « La Déclaration foraine », le poète transforme la foule en un public. Avant de s’adresser aux « scoliastes futurs [24] », qui y percevront des significations qu’on ne leur contestera pas, la lecture sert à rassembler des sujets plus modestes, jouant à leur égard le rôle d’un ciment communautaire. Comme la religion avec laquelle elle partage une racine étymologique, la lecture permet dans un premier temps de produire du lien. On connaît depuis quelques années, en particulier avec les travaux de Jacques Rancière, l’investissement de Mallarmé en faveur de la « foule [25] ». On sait toutefois également qu’il introduisait entre celle-ci et le poète un « interrègne » séparateur, qui différait sa conquête [26]. Bon nombre des écrits de Mallarmé témoignent d’un intérêt pour le lecteur commun, auquel s’adresse une poésie conçue comme religion ; et pourtant le poète n’ignore pas que son œuvre, comme toute littérature, lui demeurera au mieux étrange, au pire inutile, exprimant devant le « conflit » qui l’oppose à l’ouvrier la « tristesse que [sa] production reste […] vaine [27] ».
Comment séduire, dès lors, ce public privilégié, cette « foule » qui reste largement insensible aux charmes du poème, pour la bonne raison que majoritairement, elle ne lit pas ? Comment « inventer » cette « majorité lisante » à laquelle aspire le poète moderne [28], et comment l’introduire aux merveilles de la littérature, à une époque où le tout-venant ne parle certainement pas son langage ? L’auteur de « Crise de vers », qui prenait acte de la séparation de la parole en deux états, « brut ou immédiat ici, là essentiel [29] », peut-il envisager cependant de réconcilier le peuple avec la poésie, et d’introduire le livre à la fois chez le bourgeois et chez le prolétaire ? Bien qu’il en reconnaisse les limites, Mallarmé se préoccupe de définir les enjeux d’une « Action » littéraire, même « restreinte ». Au-delà des effets que la lecture, au sens courant du terme, exerce assurément sur l’esprit des sujets, outre le « frisson familier » qu’elle leur procure [30] et sans négliger l’élévation spirituelle dans laquelle elle les entraîne, la non-lecture de Mallarmé accomplit une action plus controversée, mais qui n’en est pas moins décisive.
Une fiction à l’usage du bourgeois : le livre-objet
Dans sa conférence sur Villiers de l’Isle-Adam, Mallarmé expose le peu conventionnel « usage d’un livre », qui ne consisterait pas à le lire, ni même à le feuilleter, mais simplement à le « poser » « avec intention » sur quelque guéridon, à côté de « quelque beau vase [31] ». À peine entrouvert, par sa seule présence muette, le livre « propage [pourtant] le rêve » et joue son rôle, qui consiste à mettre « l’intérieure qualité de quiconque habite ces milieux, autrement banals […] en rapport avec ce délicieux entourage, qui sinon ment » – réactivant de fait la dimension symbolique d’un lieu bourgeois dont les bibelots ne viseraient pas seulement à assurer le confort, mais à refléter les grands mythes de l’humanité, donnant un sens plus profond aux détails dont sont faites des existences apparemment toutes mondaines. Nul besoin que « le volume […] anime incessamment [des] lèvres » dont la « jolie inoccupation » peut être plaisamment comparée à celle d’un « bouquet de roses » ; le livre se contente d’« [être] là ». S’il est certain que la préoccupation d’une « décoratrice » pour son intérieur est traitée ici avec quelque ironie, et qu’il faut bien admettre que les fêtes « retirées » auxquelles elle se consacre possèdent une dimension politique discutable, telle « appropriation du décor » n’en constitue pas moins, à l’échelle du sujet bourgeois, une activité symbolique fondamentale que Mallarmé compare d’ailleurs sans équivoque à celle du poète. Les « bibelots abolis » de la femme d’intérieur, à leur tour, génèrent une « atmosphère mentale » et établissent, entre les objets et les idées, des correspondances et des relations qui permettent de donner du sens au monde.
Le livre entre alors dans le quotidien de sujets urbains et mondains, soit dans le salon bourgeois de la conférence sur Villiers, soit dans le nécessaire de voyage d’une « acheteuse » élégante, qu’évoque « Étalages [32] ». Dans cet article de juin 1892, au prétexte de rebondir sur l’annonce d’un « krach » littéraire dont Mallarmé constate malicieusement qu’il n’aura pas eu lieu [33], il s’agit d’évaluer les différentes utilisations d’un objet consommable, dont on ne conteste plus la valeur marchande. Le chroniqueur forme le « dessein, de discerner, en le volume, dont la consommation s’impose au public, le motif de son usage », et conclut qu’il ne faut pas à ce sujet « bannir » « le vague ou le commun et le fruste », mais au contraire « se les appliquer en tant qu’un état ». « Du moment que la très simple chose appelée âme » ne se laisse pas saisir « selon la récitation de quelques vers [34] », on reviendra en effet à d’autres moyens moins sophistiqués : le recueil de poésie sera alors placé « entre [les] yeux [d’une vacancière] et la mer », et fonctionnera littéralement, s’appuyant avec ironie sur une métaphore chère au poète, à la manière d’un « éventail [35] ». Lorsqu’il est réduit, d’un geste qui n’est qu’apparemment cynique, à une « aile de papier » seulement un peu moins « vive », le poème permet néanmoins d’« approcher » la « songerie », se profilant comme un simulacre de pensée. Un peu plus loin, les « feuillets » pourtant paresseusement « entrebâillés » du roman engageront le sujet à confronter son identité [36]. Ainsi le livre-objet, ce « coffret spirituel aux cent pages, entr’ouvert [37] », jouit d’une présence paradoxale, organisée comme une représentation, avec théâtralité. Il est posé « avec intention » et se donne « un air de compagnon feuilleté », mais attribue pourtant au « décor » son « authenticité », et amende le mensonge d’un tel « milieu » bourgeois – « qui sinon ment [38] » ; la fiction du livre-objet est porteuse d’une vérité paradoxale et inattendue.
Au livre-coffret de la conférence sur Villiers, dont la métaphore apparaît aussi dans « Le Genre ou des modernes [39] », succèdent dans Quant au livre les mouvements de feuillets qui s’ouvrent et se plient, dans « Étalages », ou battent des ailes comme « quelque papillon blanc » dans « Le Livre, instrument spirituel [40] ». Dans cet article de 1895 sont longuement exposés les effets de la matérialité du livre, plus que jamais un objet, dont le format est opposé en premier lieu à celui du journal. Plutôt que de les distinguer sur le plan du contenu, Mallarmé observe d’abord leurs différentes manières de réagir au passage de l’air, si bien que le livre ne s’ouvre dans un premier temps que sous l’action du vent qui « anime, d’aspects, [son] extérieur [41] ». Plus tard, le poète oppose les plis de l’un aux colonnes de l’autre, constatant avec une feinte ingénuité que les phrases disposées avec monotonie dans le journal s’étoffent d’un séduisant mystère lorsqu’elles s’enfouissent dans « le reploiement du papier et les dessous » du livre [42]. Dans cet article au propos essentiellement « industriel », l’acte de lecture ne s’illustre à vrai dire que par « l’introduction d’une arme, ou coupe-papier, pour établir [sa] possession », et n’est envisagé que dans sa dimension physique. Non seulement le livre est un objet, mais c’est un objet qu’on envisage de l’extérieur, pour son aspect et sa matérialité. On ne lit pas mentalement, mais à travers des gestes précis, qui sont tributaires de la disposition des pages, et l’on n’aborde donc pas vraiment, malgré le titre de la chronique, l’enjeu « spirituel » de la lecture : les « songes » qui lui sont propres paraissent d’ailleurs, paradoxalement, « avant » qu’elle n’ait eu lieu, et le livre ouvert ne capte l’attention que furtivement, à la manière d’un « papillon blanc ». Pourtant, grâce à lui et à la réflexion qu’il suscite, « un rien d’aigu et d’ingénu » s’impose à l’esprit, « pass[ant] et repass[ant], avec insistance, devant l’étonnement [43] ». La fréquentation physique du livre conduit ainsi, au bout du compte, à une activité aussi spirituelle que sa fréquentation mentale : « son tassement, en épaisseur, offrant le minuscule tombeau, certes, de l’âme [44] ».
Un mythe littéraire efficace : le « poète maudit »
Si le livre-objet est doté d’une puissance évocatoire qui affecte le bourgeois, son action sur la « foule » ne va pas encore de soi. Le prolétaire ne possède pas de bibliothèque : le mythe littéraire devra donc se déployer pour lui d’une façon différente, en passant non par l’œuvre, serait-elle réduite à un objet qui la représente, mais par l’auteur. On ne sera donc pas étonné de constater que c’est dans les portraits littéraires de Mallarmé qu’il est fait le plus fréquemment allusion à la non-lecture. Évoquer l’auteur revient à susciter sa légende, et par là à vivifier le mythe de la littérature. Dans ses Quelques médaillons et portraits en pied, quels que soient l’événement qui motive l’écriture et le lieu qui accueille l’article, la préface d’une publication inédite pour Beckford, une chronique d’hommage pour Tennyson, le rassemblement de plusieurs poètes sur la tombe de Verlaine, ou un recueil collectif pour Whistler, Mallarmé revendique le droit de s’écarter de la biographie exacte, pour esquisser une figure de l’ordre du fantasme, une fiction d’auteur – et ceci, bien avant que la critique ne s’intéresse à cette notion, qui faisait l’originalité des travaux de Daniel Oster dans les années 1980-1990 [45] et occupe plus massivement la critique depuis quelques années [46]. Quand le portraitiste doit s’appuyer sur des sources tierces, faute d’avoir fréquenté lui-même son sujet, il admet ne leur accorder qu’une importance relative : « rien n’a lieu que choisir un volume, puis demander : Qu’y a-t-il sans vraiment le feuilleter [47] », pour renseigner l’existence de Beckford, et pour décrire l’influence de Tennyson, « à quoi bon rappeler désormais d’immédiates appréciations singulières [48] ». Quitte à biaiser le portrait, Mallarmé préfère alimenter un mythe, qui répondrait aux attentes d’un public large et populaire, auquel s’adresseront de préférence, dans le portrait de Verlaine, les journaux plutôt que telles « intervention[s] littéraire[s] [49] ». Dans « Tennyson vu d’ici », le portraitiste est « prêt à satisfaire le défaut public qui est de percevoir à la faveur d’équations aisées, ou dont un terme est d’avance su », lorsqu’il sacrifie au vice d’une comparaison qu’il regrette aussitôt – « mais que c’est faux [50] ! ». Quant au portrait de Whistler, il « présente, à des contemporains devant l’exception d’art souveraine, ce que juste, de l’auteur, eux doivent connaître [51] » ; et pas plus.
Comme le livre-objet, le mythe de l’auteur n’est qu’un pis-aller ; il n’a de sens que dans le cas où une réception plus sérieuse ou plus profonde échouerait. La non-lecture n’a d’intérêt qu’à une époque où la poésie ne se lit de toute façon pas, ce que suggère le portrait de Verlaine :
Oui, les Fêtes galantes, la Bonne Chanson, Sagesse, Amour, Jadis et Naguère, Parallèlement ne verseraient-ils pas, de génération en génération, quand s’ouvrent, pour une heure, les juvéniles lèvres, un ruisseau mélodieux qui les désaltérera d’onde suave, éternelle et française – conditions, un peu, à tant de noblesse visible : que nous aurions profondément à pleurer et à vénérer, spectateurs d’un drame sans le pouvoir de gêner même par de la sympathie rien à l’attitude que quelqu’un se fit en face du sort [52].
Mallarmé admet donc que le mythe de l’auteur puisse fonctionner indépendamment de la lecture de l’œuvre. Même si les recueils de Verlaine n’atteignaient pas les lecteurs et qu’ils n’animaient pas leurs « juvéniles lèvres », on aurait malgré tout à « pleurer et à vénérer » le poète, ramené à une figure d’artiste maudit. L’effet de l’œuvre ne dépend pas complètement de son incarnation à l’écrit, et pourrait fonctionner sans elle. Dans « L’Action littéraire », par exemple, l’« immédiat évanouissement » du livre s’accomplit à la faveur d’une « représentation » plus efficace : « parjure ton vers », recommande-t-on alors, au prétexte qu’« il n’est doué que de faible pouvoir dehors [53] ». On comprend donc que la non-lecture relève paradoxalement d’une stratégie promotionnelle. Elle accomplit à sa manière la « sauvegarde » de la poésie sur laquelle se terminent les Divagations, son « salut » qu’inaugurent les Poésies, en lui attribuant enfin, à l’heure où l’on en interroge plus que jamais la légitimité, un rôle social. L’auteur et sa biographie romancée, constituée en légende, suscitent en effet un engouement que la poésie échoue à obtenir d’elle-même.
À la mort de Verlaine, « le sanglot des vers abandonnés ne suivra jusqu’à ce lieu de discrétion celui qui s’y dissimule pour ne pas offusquer, d’une présence, sa gloire [54] » ; car cette gloire sera beaucoup mieux entretenue, à en croire notamment le portrait de Tennyson, par « le nom du poëte ». Pour établir la renommée d’un auteur auprès de la « foule », parmi les « passants », il faut bien admettre que la lecture de l’œuvre n’est pas requise :
Le nom du poëte mystérieusement se refait avec le texte entier qui, de l’union des mots entre eux, arrive à n’en former qu’un, celui-là, significatif, résumé de toute l’âme, la communiquant au passant ; il vole des pages grande ouvertes au livre désormais vain : car, enfin, il faut bien que le génie ait lieu en dépit de tout et que le connaisse chacun, malgré les empêchements, et sans avoir lu, au besoin [55].
Ce nom de Tennyson qui relayera auprès du grand public l’œuvre non-lue de son auteur, Mallarmé note qu’il est à même de susciter une figure parfaitement conforme à l’idéologie romantique, reprise par le Parnasse et les symbolistes, largement répandue sur tout le XIXe siècle : l’artiste marginal. Dans ses portraits en particulier, Mallarmé montre un intérêt constant pour les mythes auctoriaux ; mais il retient surtout l’un d’entre eux, celui du maudit. « Je sais que déjà [le nom] somme et éveille, à travers le malentendu d’idiome à idiome ou des lacunes ou l’inintelligence, et de plus en plus le fera – la pensée d’une hautaine tendre figure, volontaire mais surtout retirée et avare aussi de tout dû [56] », écrit Mallarmé en anticipant sur la récupération abusive de Tennyson parmi les poètes aristocrates, cousins privilégiés des artistes maudits.
C’est bien sûr l’auteur de la série Les Poètes maudits, Verlaine, qui représente le mieux la catégorie, et incarne avec le plus d’efficacité son mythe. Le portrait qui lui est consacré se destine paradoxalement « au passant, à quiconque, absent, certes, ici, par incompétence et vaine vision se trompa sur le sens extérieur de notre ami [57] », c’est-à-dire au public profane, soumis aux erreurs de jugement, mais que Mallarmé se gardera bien de détromper tout à fait, et qui de toute façon a bien des chances de ne pas entendre les mots que le poète lui adresse. Le lecteur commun sera tenté de se souvenir de Verlaine comme d’un homme au destin mouvementé, marqué par le vice et l’immoralité. Mais son jugement à première vue défavorable possède pourtant une certaine pertinence, selon Mallarmé : c’est à vrai dire la seule réponse adéquate à d’autres vices, « la solitude, le froid, l’inélégance et la pénurie » infligés au poète de la fin du siècle. La « foule » n’est pas la seule à faire de Verlaine un marginal ; le poète lui-même, qui tire le meilleur de ce qu’une époque décidément peu clémente lui impose de toute façon, « accepte » et « cherche » un tel malheur. Verlaine, en effet, endosse « jusqu’au bout, douloureusement et impudiquement », « superbement » selon l’une des variantes du manuscrit, « l’état du chanteur et du rêveur », ou avant correction, « le destin du poëte [58] » : cette misère qui est son lot, il ne l’assume pas seulement, mais la montre, et en donne à son lecteur la plus éclatante des représentations. Dans le portrait que Mallarmé lui consacre, il ne s’agit pas tant de célébrer un poète, Verlaine, que d’exalter le mythe du poète maudit, qui lui survivra. Corrigeant sur le manuscrit le temps auquel il conjugue pour finir le verbe « saluer », à la fin du portrait, Mallarmé en fait un hommage au futur : « nous saluerons […] dignement votre dépouille [59] », anticipe-t-il, réalisant ici le programme formulé dans « Tennyson vu d’ici ». Il s’agit bien en effet, en récrivant perpétuellement le mythe du poète, d’« induire [les sentiments] qu’établira le temps [60] », et de projeter l’auteur, dès sa mort, vers son idéale postérité. On pense bien sûr à Edgar Poe, changé enfin « tel qu’en Lui-même » par « l’éternité [61] ».
Entre mystification et démystification, Mallarmé ne choisit pas, il pratique les deux simultanément et au sein des mêmes textes. « Tennyson vu d’ici » dévoile et encourage à la fois, par exemple, l’imposture dont la réception du poète se rend coupable, en faisant d’un nom où sonne un chiffre anglais – « Ten-y-sonne » – l’un des symboles de l’autonomie qu’acquièrent les écrivains du XIXe siècle, corollaire de leur rupture d’avec le monde marchand. En d’autres termes, c’est « à travers le malentendu même d’idiome à idiome ou des lacunes ou l’inintelligence [62] » que Mallarmé transforme l’auteur en sa légende. La littérature repose sur des mythes qui assurent son rayonnement et la rendent disponible au plus grand nombre. Participer à leur formation n’est pas tromper la « foule », la duper ou la mystifier, mais rétablir le sens d’une activité dont Mallarmé est convaincu qu’elle reste indispensable à la société moderne. Mythifier, pour le poète, c’est à la fois renforcer le mythe littéraire et le désigner comme tel, à la faveur du « double discours » sur lequel Bourdieu, dans Les Règles de l’art, avait attiré brièvement notre attention.
Avant Stanley Fish [63] aux États-Unis, ou Pierre Bayard [64] en France, Mallarmé pourrait-il être ainsi l’un des premiers théoriciens de la croyance littéraire d’une part, et de la non-lecture d’autre part ? Son mythe littéraire possède en tous les cas des vertus pragmatistes et une importance sociale que soulignent les deux théoriciens. En m’y intéressant, je me suis contentée ici de faire saillir l’un des versants, ironique et polémique, des propos de Mallarmé sur la lecture ; il ne fait aucun doute qu’à mon apologie de la non-lecture pourraient s’opposer allégrement d’autres réflexions, qui mettraient en avant, à l’inverse, de convaincants éloges de la lecture. Seulement, il est possible qu’entre le livre et son mythe, ou entre l’auteur et sa légende, ce soit pour les seconds qu’il est le plus sage d’opter ; il n’est pas sûr qu’on puisse compter sur la littérature, mais on peut assurément se fier au mythe littéraire. Quand bien même un coup de dés jamais n’abolirait le hasard, et même si la littérature ne devait pas se libérer de la contingence, à l’issue de son inexorable naufrage, une chose demeurera – cette « constellation [65] » dans laquelle j’aimerais voir la présence toute physique des lettres dispersées sur la page, en deçà du sens qu’elles composent et qu’on s’efforcera peut-être de lire, la marque noire des mots qui sont là avant même qu’on les comprenne. Ou dans les termes que j’ai choisi d’employer ici, la trace mythique de l’œuvre, dont la littérature à jamais resplendit.