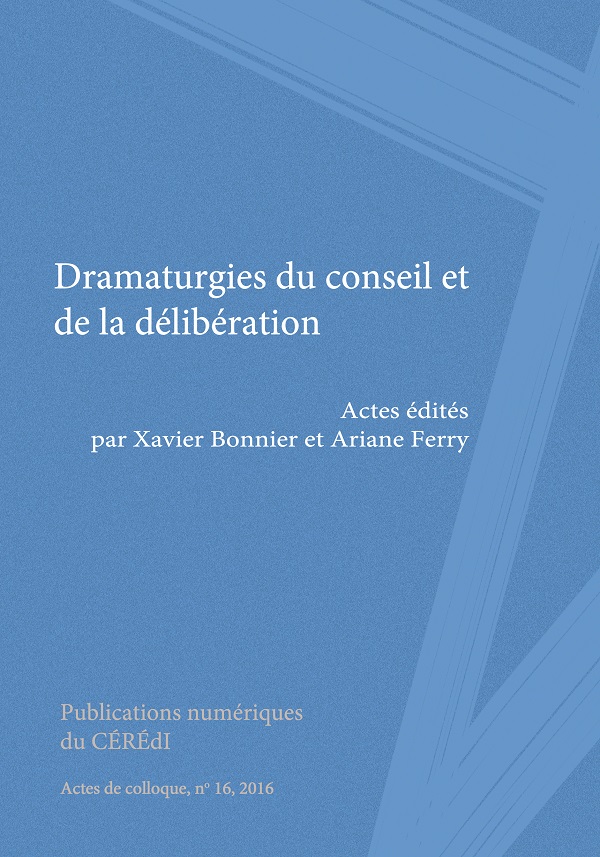Rarement personnage de théâtre aura suscité des jugements plus contradictoires qu’Horace : sa vertu constitue-t-elle un modèle à imiter, et à donner en exemple de patriotisme à la jeunesse ? Au contraire, son excès de virtus, qui le mène du duel livré contre son presque beau-frère à l’assassinat de sa sœur désarmée, ne suscite-t-elle que la terreur épouvantée du spectateur ? Marc Escola distingue ainsi, parmi les critiques, les tenants d’une « interprétation albaine », qui préfèrent l’humanité de Curiace et jugent son rival comme une brute sanguinaire, et les partisans d’une « interprétation romaine », qui célèbrent l’héroïsme inégalé d’un soldat dévoué à la cause de sa nation [1] ; ces derniers reconnaissent en Horace le « caractère » du Romain tel que Guez de Balzac le définissait dans son opuscule du Prince [2] ; plus près de nous, Marc Fumaroli voit dans ce personnage le prototype du « magnanime » désintéressé, « héros exemplaire » capable d’un « don total de soi à une cause supérieure [3] », conforme à l’archétype aristotélicien du héros tel que le définit l’Éthique à Nicomaque, fait de courage impétueux et d’un sens pointilleux de l’honneur [4]. Qu’on se représente Horace comme un stoïcien solaire ou, comme ce « jeune nazi » évoqué par Brasillach [5], lecteurs et spectateurs tombent d’accord pour reconnaître que le Romain est tout d’une pièce, tendu vers ce qu’il pense être son devoir. Ce Fils de la Louve, orienté vers le seul honneur de la patrie, sans hésitation ni scrupules, ne connaît pas le tragique de la déchirure ni du déchirement. Sa singularité fait de lui, pour le meilleur et pour le pire, un héros hors du commun refusant les compromissions. Contrairement à Rodrigue, Auguste ou Polyeucte, Horace ignore le doute, et plus encore ce « conflit de valeurs » dont on fait souvent un élément constitutif du tragique. Son patriotisme le détermine entièrement.
Pourtant, Marc Fumaroli nous a aussi appris à considérer les personnages de Corneille non seulement comme des héros, mais aussi et surtout comme des orateurs qui n’existent que dans la parole qu’ils profèrent, au sein d’un théâtre dont la dramaturgie est fondée sur la rhétorique. L’évidence de la vertu horatienne résistera-t-elle à une étude qui privilégierait cet angle strictement oratoire plutôt que l’approche morale ou psychologique traditionnelle ? Qu’advient-il de l’héroïsme prétendu du soldat romain dès lors qu’on voit en lui, plus encore que cette « machine à tuer » dont parlait Jean-Pierre Landry, une « machine à parler », et en particulier à persuader [6] ?
Le dénouement d’Horace constitue un laboratoire de choix pour évaluer cette dimension rhétorique dans son rapport à l’héroïsme. On ne rappellera pas ici l’intrigue, bien connue : pour dénouer le conflit entre Rome et sa cité-mère, Albe, sans faire couler trop de sang parmi les soldats souvent unis par les liens du sang ou des unions matrimoniales, les souverains de chaque camp nomment des champions dont le combat à mort décidera de l’issue de la guerre. Horace, désigné par Rome, vient à bout des trois frères Curiace, dont l’un d’entre eux est fiancé à sa sœur Camille. Celle-ci, au retour de son frère triomphant, laisse éclater sa fureur d’avoir perdu son amant, et Horace la transperce de son épée.
Sur ces entrefaites, le roi, venu adresser ses félicitations au vainqueur, découvre le drame qui vient de se dérouler ; il se trouve mis en demeure par Valère, amant éconduit de la défunte, de rendre justice aussitôt. Visiblement à contre-cœur (« Et c’est dont je vous plains, qu’après un tel service / On puisse contre lui me demander justice », V, 2, v. 1479-1480), Tulle se sent tenu d’improviser un procès, dans la demeure même de la victime et de son bourreau. Les rôles se répartissent aisément : Valère tient lieu de procureur, le père d’Horace fait figure d’avocat, le roi lui-même se réservant la fonction de juge. Sabine, sœur de Curiace et épouse d’Horace, s’offre à subir la mort à la place de son mari. Réquisitoire, plaidoiries et jugement se succèdent, en de longues tirades qui donnèrent des scrupules au dramaturge lorsqu’il entreprit en 1660 l’examen de sa pièce : Le Ve acte est « tout en plaidoyers », explique-t-il.
Tout ce cinquième [acte] est encore une des causes du peu de satisfaction que laisse cette tragédie : il est tout en plaidoyers, et ce n’est pas là la place des harangues ni des longs discours ; ils peuvent être supportés en un commencement de pièce, où l’action n’est pas encore échauffée ; mais le cinquième acte doit plus agir que discourir. L’attention de l’auditeur, déjà lassée, se rebute de ces conclusions qui traînent et tirent la fin en longueur.
Ce jugement du vieux Corneille adressé à son double d’autrefois est bien sévère, d’autant que « discourir », au théâtre, n’est pas différent d’« agir ». Valère, l’accusateur, intervient d’abord pour réclamer la peine de mort en châtiment du fratricide doublé d’un sacrilège, en avançant comme argument la sécurité du royaume ; il convient de préserver le peuple, au nom duquel il prétend parler, de la « fureur » d’un héros barbare : « Sauvez-nous de sa main, et redoutez les dieux » (V, 2, v. 1534). Comme le soulignait Jean-Yves Vialleton [7], Valère est un procureur d’une habileté redoutable, maniant tous les artifices du style judiciaire. Le roi somme Horace de se défendre mais, par un coup de théâtre dont le dramaturge est coutumier, le héros esquive et évite l’affrontement : « à quoi bon me défendre ? » (V, 2, v. 1535). Nous voudrions montrer qu’Horace ne cherche pas en fait à éviter le combat, mais réagit en duelliste consommé, maniant la feinte et la parade pour contrer les coups de son adversaire, avant de riposter à son tour.
Feinte
Une stichomythie cinglante ouvre sa longue tirade : on ne tirera pas de lui le plaidoyer attendu. Horace refuse de s’expliquer (v. 1535-1536) ; bien loin de se défendre, il abonde dans le sens de son accusateur et « demande la mort » dont on le menace (v. 1550). À aucun moment on ne l’entend alléguer son innocence, ni avancer d’éventuelles circonstances atténuantes, encore moins réclamer la pitié de son juge. À tout prendre, cette attitude paraît conforme au caractère du protagoniste, et à ce qu’on attend de lui : soldat obéissant et discipliné (« je suis prêt d’obéir », v. 1545), il a déjà fait la preuve de sa vaillance et de sa soumission ; quoi d’étonnant à le voir affronter avec détermination la perspective du trépas ? Il est aussi aristocrate hautain et trop orgueilleux pour s’embourber dans la chicane des tribunaux : défiant jusqu’au bout la médiocrité, quand bien même elle viendrait du roi qui pourrait d’un signe de tête le détruire, campé dans une intransigeance hautaine et dédaigneuse à l’égard de tous, enfermé dans sa « gloire » égoïste et amère, silencieux jusqu’à la fin de la pièce, Horace reste fidèle au personnage rigide qui, à l’acte II, avait durement blâmé Curiace. Horace incarne aussi ce néo-stoïcisme qui fut prisé au cours du premier XVIIe siècle, et dont Corneille est un des derniers représentants. Doué de la force d’âme qui convient aux tenants de cette pensée, il acquiesce à l’ordre du monde au point d’accepter le sort qui lui est promis ; le soldat philosophe embrasse l’« amor fati », et prend pour sienne la devise « sustine et abstine », ne manifestant ni regrets ni remords. Son aspiration à mourir (« je la veux [la mort] comme lui », v. 1550 ; « je m’immole », v. 1594) peut de même renvoyer au suicide stoïcien, moyen toujours à disposition pour conserver la liberté menacée ; on songe à la fin exemplaire de Sénèque, ou de Caton d’Utique, qui préféra s’infliger le trépas plutôt que de tomber indignement aux mains de ses ennemis.
L’indifférence d’Horace face à la promesse de l’exécution peut aussi s’expliquer par des raisons plus métaphysiques que morales, à en croire en particulier Serge Doubrovsky : le soldat vainqueur puis criminel découvre ici le drame de tout héros qui, après avoir réussi son acte d’héroïsme, peine à subsister longtemps dans ces hauteurs inaccessibles :
L’honneur des premiers faits se perd par les seconds ;
Et quand la renommée a passé l’ordinaire,
Si l’on n’en veut déchoir, il faut ne plus rien faire. (v. 1569-1572)
Pour survivre à jamais dans la mémoire des hommes, pour s’immortaliser dans cette réputation extraordinaire qu’il s’est acquise, pour garder à tout jamais sa « Renommée » pourvue d’une majuscule, il n’est pour lui d’autre issue qu’une mort qui seule pourra le figer dans son identité héroïque, et le préserver d’un retour à la médiocrité d’autant plus inévitable que l’occasion qui lui a permis de se distinguer risque de ne jamais se reproduire (« L’occasion est moindre, et la vertu pareille », v. 1568). Un instant suffit désormais pour ternir sa gloire aux yeux d’un peuple qu’il méprise (« qui voit tout seulement par l’écorce », v. 1559). S’il demande « comme Valère » que la mort lui soit accordée, c’est pour vivre à jamais dans la mémoire des hommes, non pour être couvert d’opprobre : Horace découvre avec douleur que « la mort seule aujourd’hui peut conserver [sa] gloire » (v. 1585).
Ainsi, au sommet de sa carrière héroïque, le héros rencontre la solitude tragique absolue ; il envisage […] dans cette aspiration à mourir, « l’appel du néant » […]. Pour échapper au temps et à autrui, pour s’immortaliser, il ne reste donc au héros, qu’à mourir […]. Cette mort ne saurait être qu’un suicide [8].
Quelles que puissent être les raisons alléguées par les commentateurs, aucun ne doute de la sincérité du personnage, et beaucoup emboîtent le pas à l’auteur de la Dialectique du héros. « Horace lui-même demande à être mis à mort », déclare Isabelle Lejault dans une paraphrase qui résume l’opinion de la plupart des critiques [9]. John Lyons est du même sentiment : selon lui, le « vouloir-être héroïque » détermine Horace à esquisser une « théorie du héros caractérisée par un solipsisme volontaire », qui le conduit à adopter les conséquences de l’adage solonique selon lequel nul ne peut se dire heureux avant sa mort. Pour être un héros, il ne lui reste qu’à périr après son coup d’éclat impossible à reproduire. « Horace fait écho à Solon, Montaigne et Sophocle ». Il a « déjà trop vécu », ne peut que déchoir encore, et sa mort préserverait au moins partiellement sa gloire [10]. Minel envisage bien une « défense d’Horace », mais prend pour argent comptant son intention affichée de se laisser mettre à mort : « Pour effacer les conséquences de son acte meurtrier privé, Horace va être amené à non seulement accepter mais désirer les conséquences de son crime [11] ». Les propos d’Horace seraient donc à entendre « au premier degré », c’est-à-dire selon un sens littéral qui ne souffre pas la complexité. On n’imagine pas que le rude soldat enveloppe sa parole d’oripeaux sophistiques : on s’attend à ce qu’il dise clairement ce qu’il veut dire.
Or, Horace est peut-être plus subtil qu’il ne conviendrait à un brave guerrier. L’interprétation générale et unanime ne manque pas en effet de se heurter à quelques éléments dissonants qui invitent à réinterroger cette tirade sous l’angle de la stratégie rhétorique qui s’y déploie. Horace, refusant d’être l’avocat de sa propre cause, pourrait se contenter de se taire. Or, il parle, et longuement. Au fond, est-il vrai qu’il souhaite le trépas, ou même seulement consente à mourir ?
Parade
Le ton, tout d’abord, apparaît en décalage avec le contenu du discours. Sous couleur de soumission, transparaît l’orgueil hautain, l’arrogance du soldat blessé dans son amour-propre, vexé d’être traîné dans la boue des cours de justice par un souverain qui lui doit son trône. Horace à aucun moment ne plaide coupable, ni n’assume son crime : qu’on le laisse s’immoler, mais « pas à sa sœur », dont il confirme par là la culpabilité – pour Horace et son père, pas de doute en effet, Camille méritait la mort, et Horace n’a pas l’intention de discuter d’un point pour lui si évident, mais dont il ne convaincra pas son roi. En déclarant qu’on « [l]’immole à [s]a gloire, et non pas à [s]a sœur », il suggère qu’il ne mérite pas d’être châtié pour un crime qui, à ses yeux, n’en est pas un : c’est la « raison » (IV, 5, v. 1319) qui l’a poussé à protéger Rome des imprécations furieuses de Camille. De même, l’orgueil aristocratique peut être entendu comme un blâme adressé à son prince, qui, en acceptant l’incrimination de Valère, légitime l’exigence indue d’un peuple volage pour un héroïsme continu. Loin de donner au monarque des raisons de le tuer, il rappelle sans cesse son exploit, à la faveur d’une métonymie (« bras vainqueur », v. 1593) ou d’une prétérition (« Je ne vanterai point les exploits de mon bras », v. 1573). Sous couvert de respecter son accusateur, il multiplie les insinuations, et reproche à Valère de tenter de le salir (v. 1554) sous l’effet de la rancune et de l’amour déçu, et poussé par son ressentiment (v. 1547-1548), attitude qui doit suffire à le discréditer aux yeux du juge [12]. Horace suggère que Valère n’est pas neutre, qu’il est mû par la mesquinerie d’une revanche ; son dévouement affiché pour la cause du peuple cache mal son intérêt personnel, c’est-à-dire l’amour non partagé qui le liait à Camille. Horace montre que son procureur manque d’objectivité, et n’est pas le mieux placé pour jouer le rôle d’accusateur public : il reproche en effet à son adversaire de l’attaquer en tant « qu’amant de la sœur » (v. 1548), c’est-à-dire au titre d’une vengeance privée et donc d’un intérêt particulier, bien plus que pour défendre ceux de la cité.
Horace élabore ainsi une stratégie conforme aux critères de la « fonction défensive » du langage cornélien mise en évidence par Gilles Siouffi [13]. L’emphase, le vocabulaire semé d’images convenues (comme les « lauriers », v. 1590), le vocabulaire de l’honneur, de la renommée, de la gloire, autant de traits stylistiques caractéristiques de cette fonction défensive, et qui constituent une phraséologie apparentant Horace à Matamore : le Romain fanfaronne, remémore ses prouesses, provoque le roi, le mettant au défi de le châtier pour complaire au peuple et à Valère, usant et abusant d’une première personne omniprésente : « mon bras », « mes trois combats », « ma gloire », « mon honneur », « ma main », « mon sang », « un homme tel que moi », « ce que j’ai fait ». La « bravade » identitaire, ressort « peu glorieux » du comique dans la bouche du fanfaron espagnol, sert ici une stratégie défensive concertée. Au demeurant, la tactique consistant à ne point se défendre pour mieux « s’autojustifier » avait déjà été employée par Rodrigue devant Chimène, note encore Gilles Siouffi [14].
Horace, certain de son bon droit, se présente, pour qui sait lire ou entendre, comme innocent, « le plus innocent » (v. 1539), que le seul regard déréglé du roi, ou pour mieux dire son imagination dépravée, transforme en coupable : si Tulle le croit fautif, qu’il en soit ainsi, mais cette opinion n’est alors qu’une croyance erronée et non un jugement fondé sur la raison et sur les faits. « Ce que vous en croyez me doit être une loi » (v. 1537) n’est qu’une marque d’allégeance pour le moins relative envers l’arbitraire du pouvoir, à laquelle le héros n’adhère que de bouche et non de cœur, par simple « devoir » à l’égard de l’autorité qu’il respecte. Drapé dans son orgueil de héros tout-puissant, grisé par son discours, sûr de son innocence, c’est une « récompense méritée » pour sa prouesse qu’il finit par solliciter (v. 1592).
Pourquoi, dès lors qu’il apparaît si sûr de sa cause, renonce-t-il à se justifier directement, et adopte-t-il de pareils détours ? Nous voudrions proposer ici l’hypothèse selon laquelle il opte en fait pour une autre stratégie, bien plus efficace que l’affrontement direct, et comparable à celle qu’il avait choisie pour combattre les Curiaces.
Riposte
L’essentiel du discours d’Horace n’est pas constitué par un plaidoyer, mais par un consilium, un « conseil ». Son discours vise à toucher non le vrai et le faux, objets du discours judiciaire, mais l’opportun et l’inopportun, l’utile et l’inutile, caractères du discours délibératif. Son discours orgueilleux suggère en tout point de ses propos que son « bras » est un rempart dont le souverain ne saurait se passer. Il lui remet sous les yeux sa prouesse (de « l’exploit » du v. 1573 à la litote périphrastique « ce que j’ai fait » du v. 1592) et souligne à demi-mot qu’une autre occasion, comparable à celle qui a permis à Tulle de soumettre Albe, peut se représenter ; Horace laisse entendre que, le cas échéant, le monarque aura besoin de lui : « c’est rarement » (v. 1556) ; « il est bien malaisé » (v. 1575 sqq.) qu’une situation équivalente reparaisse : le cas est peu probable, mais pas impossible. Que fera alors le souverain, sans son fidèle soutien ?
Horace ne refuse de situer son discours sur le terrain judiciaire que pour mieux occuper celui de la délibération. S’il se croirait déshonoré de devoir justifier, devant un peuple méprisable, un meurtre qu’il considère comme aussi héroïque que son combat – par son prétendu crime, il a en fait sauvé Rome de la malédiction de sa sœur, comme l’expliquera son père dans la tirade qui suivra –, il ne lui paraît pas indigne de lui de parler en conseiller du roi. Affectant de négliger son propre intérêt, il fonde l’efficacité de son discours sur le bien de son juge qui est aussi son roi. Il s’agit pour lui de faire comprendre à Tulle que, dépossédé de son « bras vainqueur », sa sécurité sera menacée. Au monarque donc de mesurer les effets de son verdict (v. 1543). En suggérant que sa mort éventuelle « priverait » le roi, Horace laisse entendre que son élimination, pour un motif aussi futile que le meurtre d’une sœur, serait pour Tulle une erreur politique. Horace persifle : « Rome ne manque pas de généreux guerriers » (v. 1589). L’ironie laisse assez entendre qu’il ne s’en trouve guère d’aussi braves que lui, et le roi sait bien que, si tous les cœurs sont pour lui, il ne dispose pas d’aussi vaillants soldats. Horace n’est pas loin ici de brandir la menace, dans une tirade qui peut être lue tout entière comme une antiphrase : le héros meurtrier ne propose au roi son sacrifice que pour mieux lui démontrer à quel point sa survie est indispensable à la sûreté de la jeune cité du Latium.
Si Horace feint la résignation, c’est ainsi pour donner plus de force à son plaidoyer ; les arguments qu’il emploie sont à double entente : le roi est invité à les comprendre comme autant de raisons de conserver la vie à son fidèle capitaine. Le discours d’Horace est réversible – et à ce titre baroque, à en croire les analyses de Gérard Genette [15]. La maladresse apparente du Romain masque en fait une suprême habileté oratoire. C’est en rusé conseiller, plus qu’en stoïcien consentant à mourir, que parle le personnage éponyme. L’usage des temps verbaux manifeste cette dérive d’un genre rhétorique à un autre : Aristote avait expliqué [16] que le judiciaire regarde vers le passé, tandis que le délibératif est tourné vers l’avenir car il envisage, selon le Stagirite, les conséquences de la décision. Or, c’est bien le sort du royaume qu’Horace ne cesse de mettre sous les yeux de Tulle, lorsqu’il évoque les guerres futures et les soldats hypothétiques qui « soutiendront » (v. 1590) au besoin les lauriers du monarque. La tirade d’Horace constitue ainsi une « vraie-fausse » défense : s’il est exact que, techniquement, il n’endosse pas la robe d’avocat de sa propre cause, c’est pour mieux jouer les mentors auprès du souverain. Cette stratégie d’éloquence, propre à miner la « construction héroïque » chère à Doubrovsky, invite à regarder le personnage d’Horace d’un œil différent de celui qu’on jette habituellement sur ce prétendu monolithe de vertu romaine patriotique.
Vertu, virtus, virtù ?
Le glissement du judiciaire vers le délibératif écorne en effet l’image d’Horace et invite à considérer sous un autre jour la question, déjà longuement débattue et rebattue par la critique, de l’héroïsme cornélien. Sophiste opportuniste, attaché à sauver sa vie en flattant l’intérêt du roi au détriment de toute morale… Horace serait-il un « politique » au sens de Prusias, égoïste et n’ayant en vue que sa propre sauvegarde [17] ? Nous serions loin alors de la figure du « magnanime » décrite par Marc Fumaroli. La « vertu » dont le Romain se gargarise (v. 1556) tiendrait davantage de la virtù machiavélienne, définie comme cette habileté à s’adapter aux circonstances et à soumettre les moyens aux fins, plus que de la virtus, cette droiture obstinée des vieux Romains. Il ne saurait être indifférent que la « vertu » réponde ici à « l’occasion » (v. 1557), couple dont on connaît l’importance chez le penseur politique italien : Horace se flatte d’avoir habilement saisi l’instant favorable, le « kairos » que la Fortune a placé devant lui ; il répond à la description de ces hommes d’État opportunistes que nous donne à voir le philosophe des Médicis :
Ce qu’il y a de singulier dans tous ces héros, c’est que la Fortune ne leur a point fait d’autre faveur que de leur présenter l’occasion qui leur donna lieu de former leur matière comme ils le jugèrent à propos : sans l’occasion, leur vertu se fût anéantie, et sans leur vertu, l’occasion eût été inutile [18].
Horace fait sienne cette thèse, qu’il avait déjà développée face son adversaire Curiace avant le combat : leur désignation comme champions de leur cité est, expliquait-il, un heureux coup de la « Fortune », et le moteur de cette « haute vertu » à laquelle les deux soldats sont promis :
Le sort qui de l’honneur nous ouvre la barrière
Offre à notre constance une illustre matière […]
Et comme il voit en nous des âmes peu communes,
Hors de l’ordre commun il nous fait des fortunes. (II, 3, v. 431-436)
Curiace, choqué de percevoir dans ces propos l’application de la méthode de Machiavel, ne se fait pas faute de persifler son futur beau-frère : « L’occasion est belle, il nous faut la saisir », ironise-t-il alors en reprenant les concepts chers au Florentin (v. 454).
Héros machiavélien, Horace apparaît aussi à la faveur de ce non-plaidoyer comme un être de fuite. La tactique qu’il emploie à l’acte V invite en effet à regarder rétroactivement son comportement pendant la pièce. Horace, qu’on considère volontiers comme un héros paradigmatique, entre en fait dans la catégorie des « héros de fuite », mentionnée par Lyons [19], même s’il ne figure pas dans la liste des personnages recensés par ce critique. Sa méthode favorite consiste en effet à simuler l’esquive, quitte à passer publiquement pour un lâche, afin de mieux asséner sa riposte. Ce procédé peu orthodoxe, et même peu honorable, peu digne au fond de l’éthique aristocratique, lui avait si bien réussi sur le champ clos de l’acte III, qu’il la mobilise à nouveau au moment de son procès. Il ne feint d’abandonner le terrain que pour mieux l’occuper. Il fait mine de fuir la parole pour mieux prendre ses adversaires au dépourvu. On aurait d’autres exemples de cette curieuse propension à la reculade, ou du moins à la dérobade, chez ce personnage de bronze, ainsi lorsque, à l’acte II, on le voit suivre les recommandations de son père et éviter l’affrontement avec Sabine : « ce n’est qu’en fuyant qu’on pare de tels coups [20] » (v. 685).
Horace, humain et trop humain, rejoindrait donc la galerie des médiocres, calculateur et mesquin, abrité derrière une vertu qui n’est faite que d’oripeaux mensongers ? Nous ne pousserons pas peut-être aussi loin le goût du paradoxe, quand bien même le texte n’interdirait pas totalement une pareille lecture. Au fond, que sait-on du vainqueur des Curiaces ? De l’aveu même de Louis Herland, « nous ne savons rien d’Horace [21] ».
Mais une raison plus noble que l’instinct de conservation peut l’avoir poussé à adopter cette défense aussi efficace que biaisée. Au fond, sauver sa vie revient pour lui à sauvegarder sa gloire. Sa sœur voulait, en couvrant Rome de ses malédictions, pousser son frère à la faute, le forcer à commettre l’irrémédiable, et finalement se venger de lui par la mort même qu’il lui infligerait [22]. Un verdict royal de condamnation donnerait raison à Valère et salirait Horace pour toujours. Il mourrait déshonoré et déchu de son piédestal héroïque. En optant pour l’apologie pour le moins originale qu’il déploie ici, Horace tâche avant tout d’échapper à l’ignominie d’un châtiment qui entacherait sa gloire. Au moment de son procès, nous dit Corneille, Horace court « un péril infâme dont il ne peut sortir sans tache » (Examen). Peu importe à Horace la vie ou la mort, seule compte la pérennité de sa gloire [23], que lui garantit l’exemption de peine. C’est bien parce qu’il « v[eut] être héros [24] », et plus encore le rester, qu’Horace prononce ce discours labile et réversible.
Enfin, un dernier motif, d’ordre collectif, peut également être invoqué pour expliquer la persistance du vouloir-vivre chez le soldat romain : sincèrement patriote, il sait qu’il lui faut survivre dans l’intérêt de la Rome naissante. C’est non seulement le souci de son honneur individuel, mais aussi son engagement pour la cité, qui le détermine à vouloir rester en vie. Sa tirade, qui est un manifeste d’allégeance envers le roi (v. 1542 ; v. 1586-1587), garantit son souverain qu’il n’a rien à craindre de lui, mais qu’au contraire le monarque et le serviteur sont les deux piliers de ce patriotisme sur lequel s’édifiera la gloire de Rome. L’équilibre du royaume naissant sera fondé, suggère Horace, sur la réciprocité du lien qui unit le roi et le héros. S’il y a machiavélisme dans Horace, c’est un machiavélisme du bien ; la parole biaisée du soldat n’a en vue que le salut de sa jeune patrie.
Conclusion
La pièce ne s’achève pas avec les propos d’Horace : son père doit encore se charger de la plaidoirie que le soldat vainqueur ne se résout pas à prononcer vraiment. Le Vieil Horace, en contrepoint, mobilise tous les lieux, toutes les ressources, tous les artifices d’une rhétorique parfaitement maîtrisée : apostrophe feinte, justification du meurtre, ou encore circonstances atténuantes que réclame la nature passionnelle du crime. Le plaidoyer du vieux Romain est un modèle de cette éloquence judiciaire dont son fils n’a pas pu, ou voulu, se donner la peine. À bien des égards, cet avocat improvisé se contente d’expliciter les sous-entendus des paroles de son fils, d’en déplier l’implicite ; il confirme ainsi la culpabilité de Camille :
Aimer nos ennemis avec idolâtrie,
De rage en leur trépas maudire la patrie,
Souhaiter à l’état un malheur infini,
C’est ce qu’on nomme crime, et ce qu’il a puni. (v. 1651-1654)
Il fait également valoir l’utilité politique que représente la conservation de son fils : « Ce qu’il a fait pour elle, il peut encor le faire » (v. 1703), « N’ôtez pas à ces murs un si puissant appui » (v. 1709). Mais, à lire la réponse et le verdict du roi, on mesure l’inefficacité de la défense du Vieil Horace : « Cette énorme action faite presque à nos yeux / Outrage la nature, et blesse jusqu’aux dieux » (v. 1733-1734), répond le souverain. Malgré la pertinence des raisonnements développés par le Vieil Horace, le roi persiste à juger le crime de son soldat impardonnable. Il refusera de disculper Horace d’un crime « hors-norme », contre-nature, qui attente au sacré des liens du sang.
Et pourtant, Tulle décidera de ne pas châtier Horace. Si ce dernier échappe à la condamnation, ce n’est pas à la plaidoirie brillante mais conventionnelle du Vieil Horace qu’il le doit, mais à son propre discours. On se risque à suggérer, au rebours de la plupart des commentateurs, qu’Horace ne désire pas mourir, mais vivre, pour défendre son honneur, Rome, et son roi : Tulle va très bien saisir la vraie portée et l’enjeu de l’oraison délibérative de son soldat. Le monarque perçoit que la mort de Curiace, et d’une certaine façon celle de Camille, lui ont été utiles (v. 1741-1753). Le guerrier héroïque rend à son souverain des services bien plus importants que les vœux impuissants formés par les autres sujets. Ce n’est pas au nom d’une évaluation éthique du juste et de l’injuste que Tulle rend son verdict, mais bien en fonction de l’opportunité politique de sa décision : par-delà les règles morales, qui ne valent que pour les médiocres, le héros reçoit à cette occasion un « permis de tuer » à condition qu’il serve la patrie : « De pareils serviteurs […] sont au-dessus des lois » (v. 1754-1755). C’est en cela qu’Horace est pleinement tragique : il évolue par-delà les frontières du bien et du mal, de l’innocence et de la culpabilité. La morale de la raison d’État n’est pas celle des individus. Aussi Horace ne connaîtra-t-il pas d’autre punition que de devoir faire la paix avec Valère (v. 1763).
Pourquoi, alors qu’ils sont à peu près dans la même situation, Horace est-il sauvé, et Suréna condamné ? L’on s’est avisé depuis longtemps des points communs entre le flamboyant Romain et le Parthe plus mélancolique, qui s’est rendu suspect aux yeux de son roi pour l’avoir trop bien servi au cours de campagnes militaires victorieuses : Horace « envisage, bien avant Suréna, la fragilité, l’échec peut-être de l’héroïsme », estime Serge Doubrovsky. Harriet Stone, plus récemment [25], relève aussi les points communs entre les deux héros, et considère que tous deux acceptent la mort inévitable, sanction de leur idéal héroïque trop grand pour être compris par les médiocres. L’un comme l’autre savent que le maintien du roi sur son trône dépend non de leur allégeance, qui n’est jamais remise en cause, mais de leur survie :
Que tout meure avec moi, madame : que m’importe
Qui foule après ma mort la terre qui me porte ?
Sentiront-ils percer par un éclat nouveau,
Ces illustres aïeux, la nuit de leur tombeau ?
Respireront-ils l’air où les feront revivre
Ces neveux qui peut-être auront peine à les suivre,
Peut-être ne feront que les déshonorer,
Et n’en auront le sang que pour dégénérer ?
Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire,
Cette sorte de vie est bien imaginaire,
Et le moindre moment d’un bonheur souhaité
Vaut mieux qu’une si froide et vaine éternité. (Suréna, I, 3)
D’où vient alors, s’ils sont si semblables, que Tulle pardonne à Horace, et qu’Orode élimine Suréna, quitte à périr lui-même comme dans la fable africaine du scorpion et de la grenouille ? Doubrovsky privilégiait une explication d’ordre historique et politique : Horace incarne, au temps de Richelieu, l’espoir d’une alliance possible entre l’aristocratie et le pouvoir royal ; trente ans plus tard, Suréna appartient à une autre époque, désenchantée, sans illusion : le général des Parthes représente la mélancolie d’une noblesse exclue du pouvoir après l’échec de la Fronde. Se pourrait-il que l’explication de ce contraste soit moins idéologique, et plus rhétorique ? Suréna, plus las qu’Horace, baisse les bras. Horace, plus soucieux de sa gloire et de sa renommée, feint l’indifférence pour mieux assurer une défense paradoxale, mais efficace, car fondée sur le seul intérêt du royaume, auquel sa survie importe. Cedant arma togæ : si Horace est sauvé, c’est parce qu’il est, plus encore que vaillant héros, habile orateur.