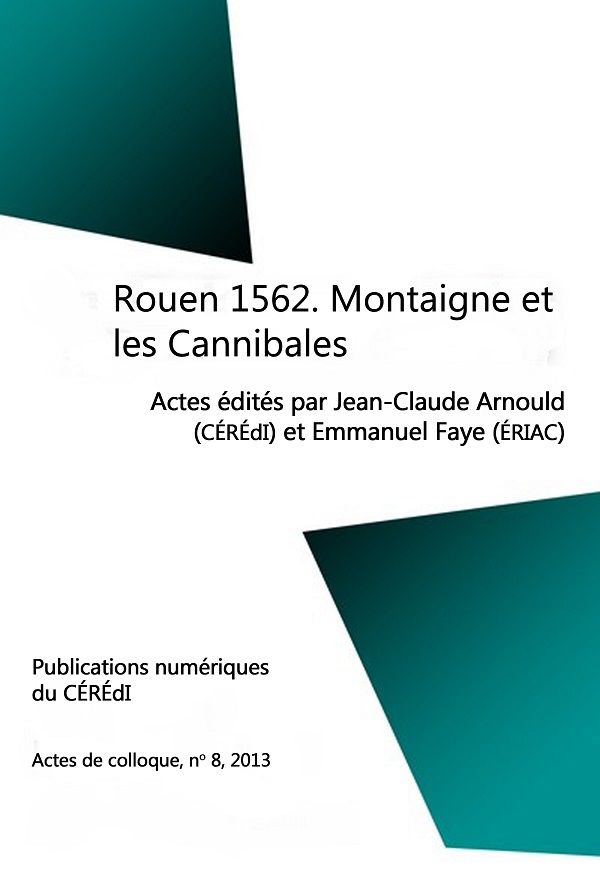Cet article gravite autour d’une constellation de thèmes et problèmes qui permettent de mieux apprécier et déchiffrer l’intelligence et les énigmes contenus dans le chapitre des Essais consacré aux cannibales. Voici une liste sommaire de ces questions : dans les différentes manières dont a été interprétée la relation complexe, intense et tourmentée entre Michel de Montaigne et Étienne de La Boétie, n’y en a-t-il pas une qui se révèle plus fonctionnelle et féconde pour la compréhension des pages dédiées aux cannibales ? ou qui, au contraire, serait éclairée autrement par le contenu de ce chapitre ? Est-il possible, en général, d’établir un lien plausible entre l’essai qui au centre de cet article et l’œuvre la plus importante de La Boétie, le Discours de la servitude volontaire, un livre qui a joué un rôle capital dans la vie et la réflexion de Montaigne ? Peut-on isoler, enfin, à l’intérieur des éléments qui constituent ce lien, une série d’arguments qui ne reposent pas seulement sur des nœuds biographiques, psychologiques et historiques, mais aussi sur une dimension philosophique : le contact entre les enjeux et les apories conceptuels contenus dans le Discours et ce qu’on pourrait appeler la « personnalité théorique » de Montaigne ? Une dimension qui permettrait de saisir et contourner la logique du déplacement et de l’inversion qui structure le texte sur les cannibales, une économie du sens qui a tant suscité de difficultés parmi les interprètes de cet essai magnifique ?
Les coups de foudre sont toujours dangereux
Il est difficile d’imaginer un lecteur du Discours de la servitude volontaire capable d’une complète indifférence ou d’une confortable nonchalance, une fois lue la dernière page de ce texte qui aurait dû rester inédit, donc inaccessible au large public ; un lecteur qui ne soit d’une quelconque manière foudroyé, dans le sens d’une fascination troublée, par le regard nouveau et original que La Boétie a su jeter sur un phénomène psycho-politique d’importance décisive pour tout diagnostic critique d’une époque, une pathologie de sa propre forme de vie, un des traits les plus absurdes et invisibles dans les mœurs de la tribu occidentale, la formation culturelle à laquelle il ne cesse d’appartenir, tout en devenant une sorte d’ethnologue : le mystère, à la fois joyeux et douloureux, de la soumission servile à un tyran qui ne la mérite pas ; et qui, en même temps, n’est pas à craindre, car il n’a d’autre force et pouvoir que ceux que le « peuple » s’obstine à lui donner.
Le regard de La Boétie saisit l’envie d’assujettissement comme désir dominant dans la réalisation collective de soi ; la lutte pour la subordination – selon une intuition qui sera ensuite valorisée par Spinoza − comme moment crucial d’une recherche du salut politique ; l’engagement dans la complicité, au lieu de la rébellion, comme la véritable action politique de masse. Il s’agit d’une découverte qui d’un côté bouleverse la perspective établie sur le problème : l’anthropologie politique de l’« homme révolté » qui exclut a priori et catégoriquement la possibilité des serfs volontaires comme le « matériel humain » le plus répandu dans la société. De l’autre, elle ouvre la possibilité de concevoir une alternative à la version main stream (la constellation Humanisme–Lumières-Marxisme) de la critique sociale. La Boétie inaugure en effet une autre façon de penser la transformation émancipatrice, sinon la révolution [1].
Il faut reconnaître la puissance de ce regard à la fois impliqué et étranger face à un scandale « innommable », à une anomalie paradigmatique de la pensée politique moderne, uni au charme troublant du paysage psycho-politique qu’il décrit. Cette puissance se trouve à l’origine d’un coup de foudre qui a justement séduit une élite d’esprits libres et forts. Il existe en effet une longue liste d’amis de la « liberté volontaire » qui, de la moitié du XVIe siècle jusqu’à nos jours, ont fait du texte de La Boétie leur trésor secret, leur obsession, leur cadeau empoisonné, leur livre de chevet, leur manifeste pour une vraie auto-émancipation, une vraie anarchie, un vrai communisme.
On peut, sans grande difficulté, placer le nom de Montaigne en tête, au premier rang de cette liste. Et – tout en flirtant avec le célèbre jugement de Nietzsche, formulé dans Ecce Homo, sur Pascal et le christianisme – le considérer comme la « victime la plus instructive » de La Boétie ; comme l’incarnation des impasses et des compromis nécessairement liés à un traitement correct du contenu et des aspirations du Discours de la servitude volontaire. Difficultés qu’il a été le premier à repérer et à tenter de résoudre.
Pour mieux comprendre cet aspect il faut retourner sur le lieu où tout a commencé : il faut revisiter la scène de douleur qui conclut la vie de La Boétie, sa relation d’extraordinaire proximité avec Montaigne ; la scène d’une passion dans laquelle, selon de nombreux interprètes, commence l’existence de ce dernier en tant que écrivain et philosophe [2]. Au comble d’un calvaire minutieusement rapporté par Montaigne dans la lettre à son père, l’ami « intime et impénétrable » lui demande par deux fois, avec ses derniers mots de prière, tout en craignant vraisemblablement de ne pas l’obtenir, la création d’un lieu dans une région difficile à préciser : « Mon frère, mon frère, me refusez vous donc une place [3] ? ».
Une supplication qui, presque à l’unanimité, a été reçue comme signe d’effondrement et de faiblesse chez quelqu’un qui, ayant « vécu en Caton », n’aurait pas été à la hauteur de mourir en Socrate. Implorer une place, dans ce contexte, constituerait seulement le symptôme d’une débâcle capable de rendre vaine l’existence du « plus grand homme de son siècle » (une qualité et une grandeur que Montaigne, son ami vivant, était le seul à avoir reconnue).
Mais si la place invoquée ne regardait pas – ou pas exclusivement – le personnage de La Boétie ? Si ses derniers mots ne révélaient pas seulement une victime de la présomption face à la mort, une quête de gloire et de mémoire pour soi-même, mais aussi un souci concernant le destin du Discours, le message politique et théorique qu’il aurait voulu confier à son œuvre principale ?
Dans ce cas, il ne faudrait alors pas interpréter cette prière comme une faiblesse d’ordre seulement psychologique, touchant l’histoire privée de Montaigne : sa désillusion, sa déception face à la chute finale, humaine trop humaine, de son ami ; ni même comme un souci réductible exclusivement à des questions d’opportunité de publication dans un contexte historique troublé, aux abus qui notamment avaient été faits de certaines thèses contenues dans le Discours, au moment où en France les querelles religieuses explosaient d’une façon violente, et que Montaigne devait prendre ses décisions à l’égard du destin de l’œuvre de son ami [4].
Il faudrait plutôt la considérer comme une question qui présente aussi un aspect technique, structurellement dépendant des modalités suivant lesquelles le Discours articule et transmet son message. Un aspect, donc, qui n’est lié ni au champ de bataille intime, dans lequel la passion pour La Boétie avait jeté un Montaigne déchiré entre fidélité et trahison, entre admiration et rivalité presque œdipienne, ni au champ de bataille historique, dans lequel les guerres de religion avaient précipité son intention de rendre public le livre de son ami. Un élément donc plus imputable à la nature même de cet écrit, au delà de toute psychologie et de tout contexte, aux problèmes et aux apories que la logique de la critique sociale à l’œuvre dans ses pages auraient créés une fois en contact avec ce que, dans la suite de cet article, on appellera la « personnalité théorique » de son « intermédiaire du premier degré » ; de son interprète, de son médiateur auprès du destinataire, mais encore plus de son exécuteur ; de celui qui avait été supplié d’administrer un héritage si fascinant et problématique.
Confirmant cette conjecture − car les documents disponibles ne suffisent pas à la démontrer complètement ; ce qui est le cas, du reste, pour toute conjecture alternative −, on peut souligner la circonstance suivante : la prière de La Boétie s’est révélée une prophétie qui, depuis Montaigne, n’a pas encore fini de s’accomplir. Les interprétations principales de sa relation avec son grand ami, ou du rapport Essais/Discours, convergent dans l’idée que les Essais sont d’un côté le temple érigé par Montaigne en son honneur [5], de l’autre que « le plus bel endroit », le cœur de ce chef-d’œuvre, qui aurait dû accueillir et mettre en évidence un chef-d’œuvre encore plus précieux – le texte du Discours − malgré un travail de deuil extrêmement long et créatif, était destiné à rester une place vide : niée, manquée, prévue, volée au dernier moment, impossible, « ailleurs ». Mais, en dernière instance, toujours vide.
Le même chiffre, la même difficulté à fixer un lieu correct de valorisation, marque cependant toute l’histoire de la réception du Discours après Montaigne. Dès son apparition, ce texte s’est avéré en effet − et il l’est dans une certaine mesure encore aujourd’hui – toujours difficile à situer. À la fois élitaire et minoritaire (caractéristique étrange pour un appel révolutionnaire au « peuple »), exalté ou refoulé avec bonne ou mauvaise foi, il a été refusé par le main stream de la pensée socio-politique moderne [6]. Mais aussi par les soi-disant « amis du peuple », par la position officiellement alternative au statu quo théorique et pratique dominant : à partir des Chaînes de l’esclavage de Marat, la série des banalisations et des instrumentalisations intéressées du Discours est en effet impressionnante [7].
Un texte donc qui ne trouve jamais sa place, qui reste utopique au sens le plus étymologique et propre du terme. Un écrit vagabond qui presse l’« intermédiaire du premier degré » d’accomplir une tache difficile sinon impossible : « trouver le lieu et la formule », pour citer un vers tiré des Vagabonds de Rimbaud [8]. Pourquoi ce destin, pourrait-on se demander à ce point de l’exposé ?
Avançons comme réponse la conjecture esquissée auparavant, qui valorise une dimension jusqu’ici négligée par la critique : ce destin utopique est pour une part significative déterminé par le genre de contact qui s’établit entre le contenu et la logique de l’argumentation critique à l’œuvre dans le Discours, d’un côté, et la personnalité théorique de l’intermédiaire du premier degré, de l’autre. Ce point de contact – un des moments les plus exquisément philosophiques du problème − constitue à la fois le lieu d’origine des possibles impasses qui ont caractérisé l’histoire des effets du texte de La Boétie, la cause de son perpétuelle absence de domicile fixe ; mais aussi un espace de responsabilité intellectuelle, et donc un endroit d’acclimatation possible de son message, sous condition d’une intervention active, sinon innovatrice, de la part de l’intermédiaire (comme on le verra d’ici peu, dans le cas de Montaigne il s’agit d’un coup de génie théorique : le déplacement et la partielle inversion du contenu du Discours dans la figure du cannibale).
Essayons de mieux comprendre ce qu’on vient d’affirmer d’une façon si dense et catégorique. Pour ce qui concerne le contenu, les difficultés posées par le Discours – difficultés qui expliquent au moins au niveau philosophique son destin utopique et vagabond − ne sont pas avant tout liées au moment de sa « vérité » (à la question de savoir si les hypothèses formulées par La Boétie sont plus ou moins « vraies », ou si le phénomène de la servitude volontaire existe réellement dans la forme où il le décrit dans les pages de son texte). Mais – pour reprendre une distinction articulée par Michel Foucault − aux « effets de vérité » que le texte et les intuitions qu’il contient visent à produire.
Pour l’intermédiaire ou l’exécuteur de l’héritage intellectuel de La Boétie, cela se traduit en première instance dans une question de responsabilité intellectuelle et politique face aux conséquences prévisibles et imprévisibles du théorème de la servitude volontaire : être utilisée pour des finalités différentes, sinon antithétiques, par rapport à celles souhaitées par son auteur (c’est-à-dire au service de la conservation, et pas de l’émancipation) ; le risque de ne trouver jamais un destinataire à la hauteur de la transformation critique de soi-même et de la réalité postulée par cette théorie afin qu’elle puisse produire ses meilleurs effets de vérité.
En d’autres termes, il est déjà difficile de saisir le phénomène de la servitude volontaire, de voir complicité et consentement là où le regard habituel n’aperçoit que de l’oppression et de l’innocence de la part des hommes assujettis au pouvoir. Mais une fois qu’on a démasqué et dénoncé cette connivence, comment administre-t-on les effets de vérité de ce scandale ? Comment avoir le courage de poser – avant tout à soi-même − la question capitale implicite dans la démarche de La Boétie : combien d’êtres humains seront effectivement capables d’accueillir une nouvelle de ce genre ? de penser et de vivre selon la devise : « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres ! » ? La seule indication pratique, terrible dans sa simplicité, donnée par le Discours.
Voilà donc le problème lié aux effets de vérité du texte de La Boétie, avec lequel Montaigne se trouve confronté en premier : que faire d’une innovation théorique qui risque de produire des conséquences indésirables et de ne pas trouver son destinataire prévu [9] ? Mais ce n’était pas son unique problème ! Pour ce qui concerne sa personnalité théorique – celle d’un sceptique prodigieusement mûr, qui ne renonce pas à une forme sui generis d’engagement politique, centré sur le moment de la « liberté volontaire » et sur une certaine conception de l’amitié –, il faut en effet registrer une difficulté supplémentaire : ses soucis face au « style critique » du texte que son meilleur ami lui a confié. Des doutes qui, cette fois, ne concernaient pas les effets de vérité du contenu de la théorie, mais les effets paradoxaux sur le destinataire qu’une certaine manière de décliner et jouer le rôle du critique social auraient pu engendrer.
Dans les pages du Discours Montaigne voit en effet se cristalliser toute une constellation de problèmes qui possèdent une marque commune : l’excès de radicalité et de distance par rapport au sens commun et à l’opinion moyenne − à la « coutume » − d’une dénonciation qui se voudrait cependant interne, pas externe, à son contexte ou à sa forme de vie. Et, surtout, d’une critique qui se conçoit comme un vecteur et un instrument d’auto-émancipation, pas comme la révélation d’un prophète qui fait cadeau d’une nouvelle liberté à la masse aveugle des assujettis. C’est une des questions les plus difficiles à traiter au niveau de la logique de la critique sociale : celle de la justification de la perspective ou du point de vue à partir duquel on formule un jugement, un verdict, un diagnostic sur les pathologies d’une société [10].
L’éloignement nécessaire de la sphère socio-politique et des autres êtres humains de la part du critique peut en effet varier entre les années-lumière et les millimètres, entre étrangeté sidérale et adhésion empathique. Les options structurelles du regard critique oscillent entre a « view from nowhere » jeté depuis un astre lointain et une coïncidence mimétique avec les mœurs de sa propre communauté. Les conséquences pratiques de ces options sont remarquables : une distance excessive, comme celle adoptée parfois par La Boétie dans son Discours, risque de le transformer – malgré lui – en un des nombreux « amis du peuple » qui de l’extérieur imposent à la masse une émancipation qui tombe d’en haut. Une conséquence que Montaigne – on peut facilement l’imaginer, connaissant son style théorique − n’était sûrement pas disposé à accepter : pour son allure sceptique et pour le lien d’amitié – de libre servitude volontaire − avec La Boétie.
Le syndrome de Montaigne, ou à quoi servent les cannibales ?
Après avoir esquissé l’arrière-plan théorique du rapport Montaigne-La Boétie, on peut passer à la deuxième étape de cet article, celle directement consacrée à l’essai sur les cannibales. En analysant ces pages, qu’est-ce qu’on peut apprendre de l’attitude de Montaigne face aux difficultés à trouver le lieu et la formule, à fixer la place que son grand ami a peut-être implorée pour le Discours ? Est-ce que le chapitre sur les cannibales constitue par hasard un des lieux où ces difficultés, ou une tentative de les résoudre, se manifeste avec une évidence plus marquée et intéressante qu’ailleurs ?
On affrontera ces questions en prenant comme point de départ une phrase dense de promesses contenue dans l’introduction de Miguel Abensour et Marcel Gauchet à l’édition Payot du Discours de la servitude volontaire : « Montaigne le savait d’un savoir resté secret : il existe un lien indissoluble entre La Boétie et son frère d’exil, le cannibale [11] ». L’affirmation entraîne des interrogations : quel est ce « savoir resté secret » ? Sous quelle forme et dans quelle mesure La Boétie serait-il lié aux cannibales ? Pourquoi seraient des « frères d’exil » ? Et, finalement, cette conviction occulte a-t-elle quelque chose à voir avec les difficultés illustrées jusqu’ici ?
Le « savoir secret » auquel font allusion les mots que nous venons de citer pourrait être décrit comme le « syndrome de Montaigne ». Cette formule vise à saisir l’impasse, la potentielle situation de double bind entre vérité et responsabilité, intelligence et fidélité, radicalité et modération dans laquelle l’auteur des Essais se retrouve face à l’héritage public de son ami.
C’est une formule qui exploite deux analogies faciles : d’un côté celle avec le syndrome de Stendhal. La différence est qu’ici ne sont pas les conséquences imprévues ou indésirables d’une exposition excessive à la beauté, mais à la vérité qui est à l’origine des symptômes. De l’autre, le syndrome de Syracuse, autrement descriptible comme syndrome de Platon-Heidegger, la maladie professionnelle peut-être la plus courante chez un certain type d’intellectuels visant à conquérir – à occuper ou à séduire – le pouvoir politique [12]. Dans ce cas, c’est la résistible tyrannophilie des intellectuels qui est en question, l’excessive vanité dans la tentative de démontrer que la discipline à laquelle ils consacrent leur passion n’est pas vaine. Une attitude qui n’était pas complètement étrangère même à La Boétie.
Du syndrome de Montaigne peut être victime un intellectuel modéré (dans le cas d’un sceptique, la maladie suivra un cours encore plus compliqué), qui pour des raisons extra-théoriques ne peut pas se soustraire à un excès de vérité, tout en étant bien conscient des difficultés de le gérer philosophiquement et politiquement. Quelqu’un comme Montaigne face au Discours de son ami. Voici son étiologie :
1. Il se voit élu − mais il s’élit aussi lui-même avec grande énergie [13] − comme intermédiaire et exécuteur privilégié, sinon unique, d’un message qui n’a pas été rendu public par son auteur [14]. Un message pour lequel l’auteur prétend cependant, voire supplie qu’on lui donne une place qui ne peut pas être refusée à cause d’un lien d’amitié extraordinaire.
2. Il accepte d’administrer le destin d’un texte qui véhicule une radicalité politique qu’il ne partage pas. Le Discours vise en effet à un bouleversement du sens commun dans une direction émancipatrice, à une transformation, même à une révolution, du comportement et de la mentalité de la plupart des hommes. Une intention que Montaigne conteste durement dans la lettre à De Mesmes, auteur d’un Contre La Boétie : « c’est une des plus notables folies que les hommes facent, d’employer la force de leur entendement à ruiner et choquer les opinions communes et reçues, qui nous portent de la satisfaction et du contentement [15] ».
3. Il s’engage à rendre publique une découverte, un dévoilement dont la portée, à son avis, dépasse largement la capacité d’assimilation : à coup sûr de la plupart des destinataires potentiels − sujet collectif que le Discours définit comme « peuple », et que Montaigne décrit avec ses mots : « lors même qu’ils se sont avec grande difficultés défaits de l’importunité d’un maitre, ils courent à en replanter un nouveau avec pareils difficultés pour ne se pouvoir résoudre de prendre en haine la maitrise » (I, 21) ; et peut-être même de l’exécuteur élu et privilégié, de Montaigne donc, qui se découvre ainsi − malgré tout le travail de l’amitié – inapte ou inadéquat à la tache qu’il s’était fixée.
De ce cadre clinique naît l’impasse dans laquelle se trouve l’intermédiaire de premier niveau : il se voit obligé de transmettre un message qu’il ne veut pas envoyer et qui, à son avis, ne peut et ne doit pas être reçu. Il peut même reconnaître une partie, pas nécessairement négligeable, de vérité dans la théorie qu’il doit administrer. Mais il nourrit en même temps une attitude de scepticisme radical face aux capacités moyennes, statistiquement normales, de gérer les effets de vérité (morales et éthiques) de cette découverte, c’est-à-dire de les retraduire en sens commun, en habitude et « coutume ». Et donc un scepticisme radical face aux conséquences politiques indésirables qui pourraient rejaillir sur sa position de critique social, en le transformant en une sorte de tyran de l’émancipation, une figure paradoxale qui pourrait articuler l’impératif : « tu n’auras pas d’autre libérateur que moi ! ».
Voilà donc le syndrome de Montaigne : un conflit difficile à résoudre entre la servitude volontaire comme théorie (le contenu du Discours) et la libre servitude volontaire envers La Boétie (le contenu de la vraie amitié). Un combat qui n’est pas nécessairement stérile ou paralysant, car il ouvre un champ d’intervention et de lutte très délicat mais décisif : celui de la responsabilité intellectuelle pour une théorie. Un domaine qui s’articule chaque fois de façon différente selon la personnalité théorique de l’intermédiaire en question.
Dans le cas spécifique de Montaigne, une guérison plus ou moins exemplaire de ce syndrome a lieu dans les pages consacrées aux cannibales, lues sur l’arrière-fond de l’autre essai qui entoure la place vide du Discours, c’est-à-dire « De l’amitié », à la fois éloge et congé de La Boétie. Dans ces chapitres, Montaigne trouve la solution au problème technique, à la possible aporie au niveau de la logique de la critique, qui lui créa tant de difficultés dans la gestion des effets de vérité du texte de son compagnon. Elle se produit grâce à une sorte de division du travail critique, à une attribution de rôles, à une répartition de masques ou de regards sur la tribu occidentale.
Dans l’essai sur l’amitié Montaigne s’occupe, pour ainsi dire, du front intérieur, de la France de son époque ; un objet sur lequel l’impact de la théorie de la servitude volontaire résultait, pour un ensemble de raisons, trop problématique et violent. Il s’émancipe de la théorie de l’émancipation de son ami, mais il reste d’une certaine façon sous son regard [16], en devenant son « frère d’exil » ; quelqu’un qui – comme La Boétie, qui « s’il eut à choisir, il eut mieux aimé estre nay à Venise qu’à Sarlac » − manifeste son engagement critique envers son propre pays dans la forme sceptique et indirecte d’une doctrine de l’amitié qui le détache – au moins dans les années qui suivent la mort de son compagnon − de la vie politique de son temps.
Le point de radicale authenticité de cette attitude est apolitique. Il propose en effet une idée de l’amitié très différente de celle célébrée dans le Discours ; une conception restreinte – exclusive, élitaire, à deux – qui illustre et incarne le paradigme d’une émancipation élitaire, d’une « liberté volontaire » ou d’une « inservitude volontaire » (Foucault) pour happy few : un but atteint par des chemins et proposé à des destinataires différents de ceux de son grand ami. Mais aussi une attitude intellectuelle face à la réalité socio-politique beaucoup plus mûre, nuancée et complexe que celle de La Boétie ; une allure qui lui permet d’articuler tout un art de la dissimulation, de la dispersion, de l’écriture sous la tyrannie [17].
Pour ce qui concerne le front extérieur de la critique, la difficile fidélité de Montaigne à La Boétie se manifeste d’une façon plus inventive. Ici la sortie du syndrome n’a pas lieu grâce à une réduction de la portée critique de la théorie, mais à travers son contraire, une radicalisation de son horizon normatif et émancipateur. Avec un geste qui représente en même temps un fruit du génie littéraire, un hommage caché, une nécessité et un coup de génie de la théorie, Montaigne « invente » ses cannibales. Grâce à une logique du déplacement et de l’inversion – qui affecte les lieux (Rouen pour Bordeaux), les personnages (les Français et les « sauvages »), l’ordre même du discours qui sort de la bouche des protagonistes et qui gère la narration du chapitre −, il crée l’instance qui peut satisfaire le désir de la quête d’une place pour le Discours de la servitude volontaire : un intermédiaire de deuxième degré, le cannibale, le masque critique qui lui permet de sortir du syndrome dont il est victime.
Dans ce processus de fiction exotique, dans l’invention de ce personnage, Montaigne trouve finalement la solution au problème de la juste distance critique. La figure des cannibales offre en effet la perspective, le point de vue sur la réalité à partir duquel le Discours peut finalement saisir sa cible. « Mes cannibales » − ce sont les mots de l’auteur des Essais – n’incarnent pas avant tout une vérité historique, mais en première instance « ce qui peut advenir » (I, 21) : la finalité authentique de toute critique sociale. Comme dans le cas de la grandeur de La Boétie et de ses œuvres, Montaigne est le seul à en comprendre la langue et le message, sans l’aide inutile « d’un truchement qui me suivait si mal, et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise ».
Le cannibale est donc La Boétie métamorphosé, déplacé, posé à une distance des pathologies de sa propre tribu qui, pour l’époque, était finalement appropriée. Mais il incarne aussi le destinataire à la hauteur de sa théorie. Pas l’habitant d’une société parfaite, d’une utopie réalisée sans apories, mais – pour respecter une perfection sur laquelle Montaigne insiste avec emphase – un homme avec lequel on pourrait bien bâtir un ordre politique meilleur. Le « suffisant lecteur » le voit très clairement : à la différence du « peuple » critiqué dans le Discours, les cannibales n’ont jamais expérimenté la « malencontre [18] », la trahison de soi-même ; mais ils ne sont même pas, pour cette raison, de bons sauvages ou des victimes entièrement innocentes du pouvoir.
Plutôt, ils incarnent les « gens tout-à-fait neufs », pas « accoutumés à la sujétion », pas dénaturés, dont parle le Discours. Des êtres humains qui possèdent le courage, loué par Plutarque et Montaigne [19], de prononcer la parole magique pour résister à l’ensorcellement violent et barbare de la tribu occidentale et de son roi « sauvage ». Cette parole est « non », le mot d’ordre pour tout « frère d’exil », le début obligé d’une constellation de phrases qui sortent implicitement de leur bouche – à côté du contenu explicite de leurs affirmations, qui coïncide en bonne partie avec la paraphrase de quelques passages de La Boétie : non, nous ne désirons pas ce que désire votre tyran, car nous ne désirons pas ce que vous désirez, car nous ne désirons pas être comme vous.
Sur la base de cette métamorphose, de cette translation, de cette dissémination, de ce déplacement et de cette inversion ; sur la base de la définition de la juste distance entre la critique et sa cible, le message du Discours peut ainsi être diffusé et même radicalisé par Montaigne à travers ses cannibales. Pour quelqu’un qui connaît l’arrière-fond de leur amitié, la lecture du chapitre 31 du premier livre donne en effet un plaisir supplémentaire : les deux amis dans ces pages frappent dur et, chose encore plus belle et émouvante, ils frappent ensemble. Comme l’a écrit Carlo Montaleone, dans un livre très beau, en commentant ces passages : « Montaigne érafle, mais les griffes sont à La Boétie [20] ».
Son « dégoût pour la maîtrise, et active et passive » trouve finalement dans la bouche des cannibales un lieu et une formule, une des places possibles que La Boétie avait supplié qu’on lui donnât. Il faut remarquer comment les phrases de ces « frères d’exil » déguisés en sauvages sont plus radicales et excessives que les mots contenus dans le Discours. Elles n’expriment pas seulement l’étonnement face au mystère d’une obéissance insensée à un « tyranneau » sauvage et ridicule. Mais aussi une critique qu’on peut tranquillement considérer bien plus « communiste » que celle de La Boétie qui, quand même, pensait que la nature nous avait faits « tous compagnons ou plutôt frères ».
Un acte d’accusation virulent contre une société barbare et sauvage, où les riches mangent vifs les pauvres et où les pauvres se laissent décharner sans se révolter, tout en se contentant de quelques miettes de pain et d’un bonheur qui tombe d’en haut. Une image qui sera reprise, pas au hasard, par Wilhelm Reich, dans son livre sur les origines psychologiques du nazisme ; et par Deleuze et Guattari dans les délires parfois prophétiques de l’Anti-Œdipe ; une image qui ne condamne pas seulement l’absurdité des mœurs de la tribu occidentale, mais aussi – chose bien plus grave – son injustice structurelle :
…le problème fondamental de la philosophie politique reste celui que Spinoza sut poser (et que Reich a redécouvert) : « Pourquoi les hommes combattent-ils pour leur servitude comme s’il s’agissait de leur salut ? » Comment arrive-t-on à crier : encore plus d’impôts ! moins de pain ! Comme dit Reich, l’étonnant n’est pas que des gens volent, que d’autres fassent grève, mais plutôt que les affamés ne volent pas toujours et que les exploités ne fassent pas toujours grève : pourquoi des hommes supportent-ils depuis des siècles l’exploitation, l’humiliation, l’esclavage, au point de les vouloir non seulement pour les autres, mais pour eux-mêmes [21] ?
Comme l’a écrit Carlo Ginzburg dans un essai sur Montaigne et ses cannibales « ce sont des mots qui nous blessent encore [22] ». Et qui confirment, comme le soutient Adriano Prosperi, que la guérison du syndrome, que la sortie de l’impasse, a eu lieu et que le Discours n’a peut-être pas trouvé sa place définitive, mais il a finalement reçu une place possible, à l’intérieur des Essais et dans le régime critique de son époque :
On a besoin d’un regard étranger pour saisir l’absurdité de nos formes de vie civique et politique. Ce n’est pas un hasard si l’accusation de servitude volontaire n’est devenue réellement célèbre dans la culture européenne que lorsque La Boétie eut l’intuition de la mettre dans la bouche de qui seul avait le droit de poser sur notre société avec un regard éloigné : les sauvages brésiliens qu’il rencontra à Rouen [23].
Le Discours était donc trop étranger pour la tribu occidentale. Il fallait inventer, à côté de l’exécuteur de son héritage, un intermédiaire de deuxième degré ; cannibaliser La Boétie, le déplacer à Rouen-Bordeaux, pour trouver une place au contenu sauvage de son texte. Un contenu qui nécessite un véritable traducteur : Michel de Montaigne, le libre serf volontaire de son ami. Une « intuition » littéraire géniale qu’accompagne une intuition théorique également géniale, une façon de résoudre avec élégance un problème de logique de la critique sociale très complexe : déplacer le contenu du Discours pour lui trouver une place à l’abri de ses conséquences.
Une opération possible pour Montaigne, à son époque, avec « ses cannibales ». Les difficultés de trouver une place, l’existence clandestinement utopique et sans domicile fixe que ce texte a continué à mener jusqu’à nos jours après la solution ici conjecturée, témoigne de la difficulté à repérer des intermédiaires de deuxième degré crédibles, des figures de l’altérité critique effective comme l’ont été les cannibales.
On peut donc conclure avec une question rhétorique, mais capitale pour les urgences au fond des arguments ici développés : y a-t-il encore aujourd’hui, au moment où la tribu occidentale semble devenir de plus en plus globale, des cannibales qui ne désirent pas être comme nous ? des gens qui ont encore le courage de nous dire non ? Et – question qui va nécessairement avec − existe-t-il encore quelqu’un comme Montaigne capable de les écouter, de les traduire, de les prendre au sérieux ? avec le même courage qu’il a démontré lorsqu’il a écrit, à quelques lignes du « plus bel endroit » de son chef-d’œuvre, une phrase que très peu d’adultes – et encore moins d’intellectuels − auraient le courage de prononcer face aux fine young cannibals qui nous entourent, muets et désespérés : « Mais oyons un peu parler ce garçon de seize ans ».