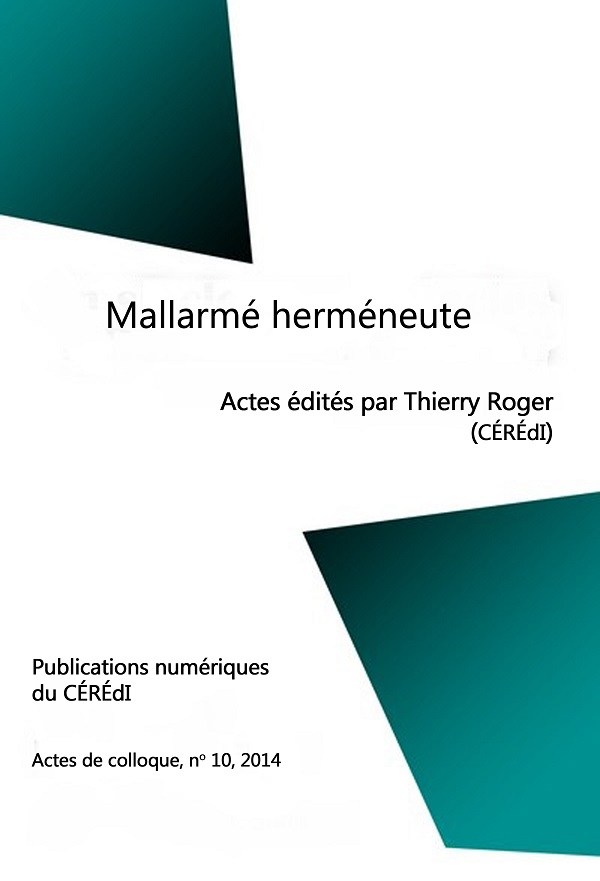On connaît bien un Mallarmé lecteur, qui a lu, commenté et louangé une part de l’écriture contemporaine et historique, dont il fut un témoin privilégié. Ce lecteur qu’il est d’abord privément, avec toujours l’intention de montrer l’originalité des concernés, se risque de plus en plus à commenter ses pairs dans des critiques où pointe un art de la lecture telle qu’il l’entend. Il procède constamment à ce que Ricœur nommerait une « refiguration [1] », qui reporte l’œuvre dans le monde en l’inscrivant dans une entreprise globale de la poésie elle-même. C’est en quoi cette critique se mue si aisément en poème, mais aussi en poétique et, sans doute, en herméneutique, en art de la compréhension et de l’interprétation. Mais si Mallarmé peut ainsi récupérer l’œuvre d’autrui dans le continuum d’une écriture propre, qui cherche et poursuit son but peu importe le matériau qu’elle se donne, si Mallarmé, donc, fait toujours œuvre mallarméenne même en critique, il devient possible dès lors d’apporter ce même regard à la fois engagé et dégagé devant sa propre œuvre, qui n’est elle-même encore qu’une critique détournée. Mallarmé fut critique, mais il fut aussi rhapsode, au sens où l’entend Platon et selon la relecture qu’en donne Michel Charles dans son ouvrage Rhétorique de la lecture, soit celui qui à la fois récite le poème et le commente. « La déclaration foraine [2] » présente ce rhapsode, qui lit le sonnet élisabéthain « La chevelure vol d’une flamme à l’extrême » avant d’en proposer un commentaire bref mais précis. Je vais me demander plus loin pourquoi Mallarmé a-t-il choisi de mettre dans la bouche de son personnage ses propres vers, inédits lorsque paraît le poème en prose. Il est à remarquer d’abord que le poème en vers connaît une double publication : il est dans un premier temps intégré à « La déclaration foraine », publiée dans L’Art et la Mode en 1887, dans La Jeune Belgique en 1890 puis, en livre, dans Pages en 1891 et dans Divagations en 1897 ; ensuite il est publié comme vingtième poème des Poésies posthumes, chez Deman, en 1899, soit douze ans après sa publication initiale. Il ne fut publié seul que dans Le Faune du 20 mars 1889, selon Bénichou [3]. Cela donne au poème une double origine et originalité et indique l’idée d’une transformation du texte selon le contexte qu’il reçoit, et semble donner une priorité, au moins chronologique, à la version en prose. Celle-ci est forcément plus complète que la version en vers seuls, ce qui sous-entend que cette complétude peut apparaître plus originale, parce que plus près temporellement d’une origine d’écriture ; le sonnet apparaît dès lors comme la version tronquée et subséquente d’un poème (« La déclaration… ») plus complet et plus « ancien ». Le sonnet est d’abord accompagné d’un contexte fictif et d’un commentaire, avant d’être donné seul à la lecture ; une lecture qui doit d’emblée s’inscrire en regard d’un exemple que le poète lui-même offre – qui positionnait ce sonnet dans un cadre forain, galant, joueur et généreux, par exemple. C’est ce contexte de la rhapsodie mallarméenne que j’aimerais maintenant observer plus en détails, avant de tenter d’établir les règles d’une herméneutique du recouvrement et du dévoilement que convoque le geste mallarméen de la réception.
« La déclaration foraine »
On insiste souvent, lorsqu’on commente « La déclaration foraine », sur la posture passive que se donne Mallarmé, victime tout autant des décisions impérieuses de sa dame que de la cohue de la foule ; et nous sommes bien sûr aidés en cela de tout un vocabulaire dépréciatif qu’utilise le sujet pour se désigner lui-même, « pitre coi » qui n’a que son « boniment » à offrir. Pourtant il faudrait aussi mettre en lumière un vocabulaire de la décision et de la volonté, de ce récitant qui, malgré tout, va de bon cœur proposer sa propre exhibition à la foire et son propre travestissement : « Le nimbe en paillasson dans le remerciement joignant deux paumes séniles vidé, j’en agitai les couleurs, en signal, de loin, et me coiffai, prêt à fendre la masse debout en le secret de ce qu’avait su faire avec ce lieu de rêve l’initiative d’une contemporaine de nos soirs. » (Df, p. 425) Je retiens d’abord que le récitant est « prêt », qu’il agite son paillasson de couleurs et se coiffe, ce qui peut certes faire sourire, mais n’en montre pas moins une forme d’engagement dans ce théâtre improvisé. Plus loin, il nomme certes le « péril » dans lequel le place la dame entreprenante, mais pour aussitôt le prendre à parti, ce risque, et l’intégrer à son entreprise propre : « […] et du même trait je comprends mon devoir en le péril de la subtile exhibition, ou qu’il n’y avait au monde pour conjurer la défection dans les curiosités que de recourir à quelque puissance absolue, comme d’une Métaphore. » (Df, p. 426), ce dernier terme étant introduit par une majuscule, comme on le remarque. L’objectif de ce boniment se précise ici, par rapport au « rêve » que nommait le premier extrait, car ce qui motive la geste du récitant est la « puissance absolue » d’une « Métaphore ». Cette Métaphore instaure le régime fictif du poème en vers qui suivra, mais tout autant du poème en prose lui-même, qui jouent l’un et l’autre sur deux plans simultanés, suspendus (et relevés) l’un par l’autre. Bertrand Marchal insiste beaucoup dans son édition, avec raison, sur le caractère fictif de la dame qui accompagne le poète, tout comme de celle dont on vante la « chevelure » dans le poème en vers, qui sont probablement la même. Mais partant de là, il faudrait voir la même transposition dans les autres éléments, tant dans cette foire qui forme comme un « univers » à soi, tant dans ce « landau » qui fournit une vitre et un espace d’échange intime, tant dans ce vieillard et dans le « matelas décousu » qui semble lui appartenir, pour former le décor d’un théâtre imaginaire. Et il faudrait, surtout, poser la question de la fictionnalité du sujet lui-même, de celui qui parle dans ce poème et qui n’est pas identifiable aussi facilement qu’on pourrait le croire. Il faudrait d’abord distinguer l’auteur et le sujet énonciateur du texte, celui qui dit « je » et qui, donc, ne recouvre pas nécessairement le premier. Mais il faudrait alors redoubler cette nuance, car le poème en vers qui est récité dit lui aussi un « je », dans une parenthèse : « (je dirais mourir un diadème) » (Df, p. 426). Deux « je » donc, transposés tous deux dans un régime fictionnel qui les fait devenir narrateurs, ou « poètes » si l’on préfère. Mais ce n’est pas tout, car rien n’indique que ces deux « je » sont le même, en termes simples Mallarmé lui-même. Le personnage qui récite le poème en vers parle bien de « son charme » dans son commentaire qui suit le poème, mais il peut alors désigner tout aussi bien le poème que l’exhibition qu’il vient d’en proposer et qu’il poursuit privément dans son dialogue avec la dame. Et dans ce dialogue, tout ce qu’il dit explique tout aussi bien le poème que sa récitation, mais n’implique jamais qu’il en soit lui-même l’auteur, mais seulement qu’il peut en expliquer le sens, brièvement. On peut donc songer que Mallarmé a hésité avant d’attribuer à ce sonnet anglais un auteur, fût-il lui-même.
Je me pencherai plus loin sur le mythe solaire, qui est certainement la pièce principale de ces deux fictions, comme l’ont montré notamment Bertrand Marchal, Patrick Thériault et Barbara Bohac, après Davies [4]. J’aimerais pour l’instant poursuivre la piste que je viens de tracer, pour marquer la superposition des voix dans l’ensemble du texte. Je remarque tout d’abord deux autres superpositions de sujets énonciateurs. Il y a d’abord celle que nous révélait la fiction de la femme, relevée à la toute fin par « notre pensée » (Df, p. 428), qui intériorise le dialogue à deux voix qui précède au sein même du « je » énonciateur, qui comprendrait à tout le moins une voix féminine et une voix masculine. Puis il y a également une superposition du récitant et du commentateur, qui sont le même ; superposition qui révèle un jeu d’ipséité et d’altérité, un jeu qu’on peut d’ailleurs transposer dans les deux autres superpositions, et qui fonde de même le jeu métaphorique, mariage du semblable et du différent. Cela fait beaucoup de voix dédoublées, ce que confirme encore une analogie entre les voix discordantes de la cohue et celle, polymorphe, du poème. En effet, j’abonderais dans le sens de Barbara Bohac, qui considère que « [le] poème en vers semble à première vue redoubler le poème en prose [5] », mais en considérant un autre aspect, qui touche à la réception. Je note ainsi un fort parallélisme entre deux extraits, l’un au tout début et l’autre à la toute fin du poème en prose. Dans le premier, le sujet dans son landau caractérise la cohue de la foire comme une « vocifération […] avec orage, dans tous les sens à la fois et sans motif », comme une « cacophonie, à l’ouïe de quiconque » qui « reste à vif devant la hantise de l’existence » (Df, p. 424). À la toute fin, dans l’avant-dernière réplique du poème, le bonimenteur affirme à sa dame qu’elle n’aurait pas compris « si irréfutablement » le poème : « je le gage, si chaque terme ne s’en était répercuté jusqu’à vous par de variés tympans, pour charmer un esprit ouvert à la compréhension multiple. » (Df, p. 428) Entre ces deux extraits, il y a non seulement une analogie à faire entre les voix qui vont « dans tous les sens à la fois », ce qui rappelle la formule de Rimbaud, et la « compréhension multiple » ; il y a de plus le fait que cette compréhension multiple trouve sa cause dans les « variés tympans » de la foule, celle-là même qui produisait vociférations et cacophonie, mais qui ici est considérée sous l’angle de la réception. Ainsi, la foule qui produit une multiplicité de voix, lorsqu’on lui impose « Silence », comme il est indiqué en tête du poème, devient celle qui permet l’entendement multiple, ce qui nous ramène encore à la Métaphore. Et ce qui superpose, à rebours, l’émission de la voix et l’écoute comme on les retrouve chez le récitant et chez le commentateur ; car la foule, comme le poète, contient ceux qui émettent plusieurs sens, et entendent la compréhension multiple.
Se met ainsi en place un échange économique entre les parties du poème, que symbolise bien le dialogue final, comme échange de paroles. Une parole qui se monnaie lorsqu’elle devient poésie, selon une formule proposée par la dame qui est assez subtile : « Entrez, tout le monde, ce n’est qu’un sou, on le rend à qui n’est pas satisfait de la représentation. » (Df, p. 425) C’est donc bien plus un pacte de sincérité qu’un contrat économique qu’on demande à la foule, qui peut se déclarer satisfaite ou non mais qui devrait, à tout le moins, être sincère dans ce jugement. Or ce pacte est lui-même garanti par l’autre parti, celui que compose la dame et le poète, puisque tout indique que le profit du spectacle ira à ce vieillard au « matelas décousu » qui fut le premier à répondre à l’appel de la dame ; en effet le poète souligne que « l’aumône exigée » sera donnée « en faveur d’un quelconque », ce qui semble justement le motiver à se prêter à cette exhibition. C’est ici que je cite ce qui fait suite à la mention de la « Métaphore », en soulignant l’aspect volontaire du geste du poète et l’échange qu’il prévoit fructueux pour la foule :
Vite, dégoiser jusqu’à éclaircissement, sur maintes physionomies, de leur sécurité qui, ne saisissant tout du coup, se rend à l’évidence, même ardue, impliquée en la parole et consent à échanger son billon contre des présomptions exactes et supérieures, bref, la certitude pour chacun de n’être pas refait. (Df, p. 426)
Tout indique ici la disproportion et le régime généreux qui engage le poète et la foule, celle-ci troquant son « billon », qui est peut-être une fausse monnaie, donc un signe trouble et douteux, contre un « éclaircissement », une « sécurité », une « évidence », « des présomptions exactes et supérieures », une « certitude », celle même de n’être pas joué ni floué. Mais les artistes ne sont pas en reste, en ce qu’ils reçoivent les exclamations de la foule « comme plusieurs bravos prêtés par des paires de mains généreuses » (Df, p. 427), et profitent de ces tympans variés pour transmettre tous les sens du poème, celui-là même qui est chargé de transmettre « l’évidence ». Il y a donc un cercle ici, qui n’a rien de vicieux : la foule permet la clarification du poème, et c’est cette clarté qu’on offre à la foule ; et ce processus est d’une clarté évidente, c’est une présomption sur laquelle on peut « gager » puisque foule il y a ― donc le poème sera clair.
Il est temps maintenant de revenir au mythe solaire que manifeste « La chevelure vol d’une flamme à l’extrême » ; mythe solaire qui s’associe bien sûr à l’« or » de la chevelure, à son flamboiement, comme à ces symboles qui désignent un centre, comme la royauté du « diadème », le « foyer », le « feu […] intérieur » ou le « joyau de l’œil », ou encore le « rubis » final. C’est plutôt comme symbole de la lumière que j’aimerais considérer le mythe solaire, comme ce qui éclaire la femme, au même titre que le « jet » qui la « [darde] électriquement » dans le poème en prose, et comme ce qui clarifie la parole du poème, pour lui donner son évidence. Ces éclaircissements sont donnés par le poète en deux temps : d’une part à l’adresse de la foule entière, et d’autre part à la dame, avant qu’on la désigne par « notre pensée ». La première de ces occurrences est fortement ambiguë : le poète, qui s’est coiffé pour réciter le poème, affirme qu’il « ne requiert pour […] communiquer le sens de son charme, un costume ou aucun accessoire usuel de théâtre. » Je souligne ce point, qui me semble capital. Le poète s’est coiffé pour réciter le poème ; il a modifié son apparence sans pour autant user d’un artifice. Ici il fait appel aux accessoires du théâtre mais ce n’est pas, comme on pourrait le penser, pour réciter avec emphase le poème ; c’est, plus simplement, pour l’expliquer, pour en « communiquer le sens ». Le récitant devient le commentateur et sent le besoin de préciser qu’il n’a pas besoin de se déguiser pour produire ce commentaire, ce qui peut sembler étrange. Ce qui l’est encore davantage est que ce commentaire, ici annoncé, ne se résumera qu’à une seule phrase, qui semble en fait développer cette idée d’une absence d’accessoire, plutôt que d’expliquer le poème : « Ce naturel s’accommode de l’allusion parfaite que fournit la toilette toujours à l’un des motifs principaux de la femme, et suffit, ainsi que votre sympathique approbation m’en convainc. » (Df, p. 427) N’eût été de la mention de la « femme », qui elle aussi n’a choisi qu’un apparat « naturel », on ne croirait pas qu’il est fait mention ici du poème récité. Or je n’entre pas dans le détail d’une argumentation qui montrerait que toute cette réplique commente bel et bien, selon moi, le poème en vers ; mais je ne retiendrai pour mon propos que le terme de « toilette », qui me semble résumer l’ensemble des vecteurs qui se rencontrent ici. Le commentateur, comme la femme du poème, n’a que sa « toilette » pour le parer ; le récitant n’a que sa voix, qu’il module en vue de l’entendement de la foule ; la femme du poème n’a que sa « chevelure », dont l’éclat se poursuit dans son « œil véridique ou rieur », sa « nudité » et le « rubis » déjà mentionné, qui est métaphorique et sera lui-même comparé à « une joyeuse et tutélaire torche », ce qui nous renvoie bien sûr au symbole solaire. Mais plus encore : que s’apprête à faire le commentateur devant le poème récité, sinon que le « toiletter » ? C’est-à-dire au fond deux choses, qui trouvent leur pendant exact dans la toilette de la femme : d’une part une clarification, un « nettoyage » du texte que procure la lumière qu’on lui applique ; mais d’autre part une forme de déguisement, de superposition des motifs, lorsqu’on déplie les superpositions métaphoriques de ses multiples sens et qu’on perçoit les relations possibles entre ces différentes couches de sens. Or le poète, on l’a vu plus tôt, perçoit une économie fiduciaire dans la réception de son texte, puisque les sens multiples sont cela même qui offrent au poème son évidence et sa clarté ; en ce sens, toiletter au sens de nettoyer ou au sens de déguiser, revient au même ; en d’autres mots, la clarté du texte s’obtient par son « obscurité », par la superposition des sens qu’il convoque.
Il est temps maintenant de s’attarder au deuxième commentaire, celui adressé à la dame, et qui est aussi bref. Après s’être défendu de n’avoir présenté que le « lieu commun d’une esthétique » (Df, p. 427), le commentateur mêle à ses développements sur la « compréhension multiple » déjà cités, cette remarque : « […] malgré sa réduplication sur une rime du trait final, mon boniment d’après un mode primitif du sonnet […] », ce qu’une note de l’auteur précise comme étant « usité à la Renaissance anglaise », soit le sonnet élisabéthain. « La chevelure vol… » est le premier sonnet élisabéthain que publie Mallarmé, parmi la dizaine qu’il composera, et le seul à être écrit en alexandrins ; ce qui peut expliquer en partie la nécessité de présenter la forme, sinon même d’accompagner le poème d’un commentaire. Ce commentaire, certes, est bref ; mais il invite, à tout le moins, à regarder les rimes du sonnet, et d’abord à comprendre ce que signifie la « réduplication sur une rime du trait final ». Il faut d’abord noter que l’antécédent de « sa » (sa réduplication) semble être la « rêverie » qui termine la réplique de la dame [6]. On peut dans un premier temps songer qu’il désigne ainsi la forme du sonnet élisabéthain qui, comme on le sait, se termine par un distique, après trois quatrains. Mais cette interprétation me semble basée sur deux tautologies au moins. D’abord parce que le sonnet anglais est déjà cette forme qui détache un distique final, avec une rime suivie et qu’il est superflu de le répéter. Surtout, il faut se souvenir que la rime est déjà la réduplication d’une sonorité et qu’elle joue de la même combinaison du semblable et du différent que la métaphore, ou toute figure. J’ajouterai par ailleurs que s’il faut entendre que la « rêverie », « qui s’ignore et se lance nue », se double dans la rime finale, on devra donc l’entendre dans les mots « écorche » et « torche », deux mots qui semblent plutôt vouloir décourager la rêverie. Je proposerai donc une autre interprétation possible, et je devrai, pour ce faire, considérer les rimes dans l’ensemble du poème, et éventuellement quelques autres également.
Ces rimes sont croisées, outre le distique final, et font consonner les mots « extrême » et « diadème », puis « déployer » et « foyer » dans la première strophe ; « nue » et « continue », puis « intérieur » et « rieur » dans la deuxième ; « diffame » et « femme », puis « doigt » et « exploit » dans la troisième ; et enfin, comme déjà noté, « écorche » et « torche » à la fin. Un examen de ces rimes montre bien comment la première strophe se relie à la troisième et isole ainsi la seconde strophe. La troisième strophe ne reprend pas à l’identique les rimes de la première ― ce qui serait alors, au sens propre, une « réduplication » de la rime, dans des couples de vers différents. Mais elle en reprend des sonorités d’une manière suffisamment explicite et concertée pour qu’elle soit signifiante ; ainsi le son -ɛm devient le son -am, et la diphtongue (ou semi-consonne) -waje se retrouve, tronquée, dans la rime en -wa. Difficile alors de ne pas entendre le verbe « aimer » dans la première rime, surtout lorsqu’on le met en relation avec la « femme » de la troisième strophe ; et de ne pas entendre dans la rime qui l’accompagne le « oyez ! » qui est lancé à la foule, geste qui s’accompagne du « doigt » montré au vers 10. J’ajouterai que, si le sonnet élisabéthain n’a pas la même finale que les sonnets dits italiens ou français, l’un et l’autre vont quand même présenter des rimes suivies à la fin ; et Baudelaire par exemple va se permettre d’introduire des rimes plates à la fin du dernier tercet. Autrement dit, la rime finale du sonnet anglais n’est pas son élément le plus étranger à cette époque, mais c’est plutôt la suite quatrains-distique, qui reste irréductible aux autres formes. Or rien n’indique que le sonnet anglais ne peut pas respecter la transition qu’on reconnaît par ailleurs après le deuxième quatrain, ce qui découperait ainsi le poème : quatrains 1 et 2 (huit vers), puis quatrain et distique (six vers). En ce sens les quatrains 1 et 3 se trouveraient en position initiale de chacun de leur ensemble, en parallélisme donc. Or cette transition est aisément décelable ici, par l’introduction du « héros tendre » dans la strophe 3, personnage qui répond métaphoriquement au « je » introduit entre parenthèses dans la strophe 1. Et ainsi se renforce la correspondance des rimes des strophes 1 et 3, la strophe 3 pouvant dès lors apparaître à la « fin » du poème, soit dans sa seconde et dernière partie.
La forme du sonnet élisabéthain permet par ailleurs une plus grande liberté dans le schéma des rimes des quatrains ; plusieurs cas de figures sont possibles, qui vont de l’addition de rimes différentes, à des reprises, surtout dans les deux strophes centrales. Mallarmé joue souvent de ces possibilités dans ses sonnets anglais, notamment en répétant des consonnes ou voyelles, comme s’il cherchait ainsi à redoubler des sonorités, ce que permettent les formes plus courantes. Mais aucun de ces poèmes ne rappelle celui qui nous intéresse, comme le sonnet de circonstance dédié « À Méry [7] ». Je note d’abord que tous les sonnets de circonstance sont des sonnets anglais. Ensuite, que je n’entends pas par ce détour défendre que la femme de « La chevelure » serait Méry Laurent ; à tout prendre il faudrait plutôt dire l’inverse puisque, comme l’indique le vers final du second, celui-ci a été composé en 1894 alors que « La chevelure » date de 1887. Nous aurions donc un modèle de femme idéalisé, qui a trouvé par la suite à s’incarner en Méry, ce qui situe la fiction (et la Métaphore) en-deçà de la réalité. Cela dit, il faut maintenant souligner que, non seulement le schéma des rimes est ici très semblable, mais que ces rimes elles-mêmes sont presque identiques. Les voici : « fond », « nues », « plafond », « éternues » / « jouait », « gymnastique », « fouet », « élastique » / « reconnais », « t’aime », « bonnets », « thème » / « gorze » (pour gorge), « quatorze ». Les rimes en -ny et en -ɛm, les plus explicites pour le sens amoureux, reviennent dans les deux poèmes, et cette dernière rime se décompose en rimes en -wɛ et en -ɔnɛ dans les vers de circonstance. Sans entrer dans le détail des différents croisements que suggèrent ces relations, je noterai simplement que cette simple remarque sur la rime peut entraîner des éclairages divers ; qu’on peut par exemple faire consonner « diffame » et « écorche », comme premières rimes des strophes finales du sonnet ; ou encore superposer le « diadème » et la « femme » et en déduire un amour qui donne de la royauté à la femme, si on accepte de placer les strophes 1 et 3 en parallèle, etc. Je retiendrai seulement de ces éléments que l’interprétation n’a ici qu’à faire jouer ce qui est déjà là pour en dégager des sens multiples, et que c’est au fond le propos du poème, tant en vers qu’en prose. Je paraphraserais très simplement en disant que c’est la lumière qui est projetée sur elle, qu’elle soit flamme, foyer, feu, ou torche, qui habille la femme, qui lui donne son ornement naturel et en constitue la « toilette » ; et que toute la fable du poème en prose dit la même chose, à savoir qu’un spectacle peut s’offrir à partir de rien, à condition de prêter du pouvoir au langage métaphorique, qui seul peut s’accommoder de ce rien, de ce matériau absent.
Herméneutique
Je laisse ici ce commentaire inachevé pour mieux y revenir par d’autres voies. J’aimerais maintenant faire résonner le poème mallarméen avec quelques propositions théoriques qui se positionnent dans les environs d’une herméneutique, même si c’est souvent pour la récuser ; des propositions qui questionnent la lecture du texte et du poème et la compréhension qu’on peut en donner. J’aimerais d’abord reprendre les deux mots clés que j’ai relevés chez Mallarmé, à savoir la « Métaphore » qui prête ses pouvoirs au poème et la « toilette » produite, à rebours, par le commentateur, qui pare et dévoile le texte tout à la fois. C’est bien dans ces termes que Michel Charles commente le discours sur la figure chez Fontanier, qui, « [p]our décrire ce supplément, ce surplus produit par la figure, […] utilise le vocabulaire de la sensibilité : rendre plus vif ou vivifier, faire respirer, rendre sensible, habiller ou revêtir, peindre [8]. » Or Charles insère une note après le mot « revêtir », pour expliquer un paradoxe tout à fait de notre propos ; cette note dit : « Avec des raffinements remarquables : voiler (pour les tropes), mais d’un voile transparent [9]. » Autrement dit, la figure serait comme un vêtement posé sur un corps, mais un vêtement qui paradoxalement le dévoilerait, le rendrait à « vif » ou à nu comme dirait Mallarmé. Et pour Charles, c’est précisément cette action de la figure qui justifie la nécessité d’une herméneutique : « […] mécanismes du “déguisement” et du “détour”, les figures d’expression engagent toujours une herméneutique, dans la mesure même où, ne supposant pas de changement de sens de leurs éléments, elles impliquent un code qui permette de les déchiffrer [10]. » Je ne pense pas qu’il faille pour autant revenir à un type de « déguisement » que Christian Doumet, pour sa part, réprouve [11], comme à une façon artificielle et forcément infidèle de cacher le propos du poème dans des formules plus conciliantes, plus accessibles ou plus séduisantes. Ce qui est changé ici est précisément le paradoxe que nous avons reconnu, d’un voile qui dévoilerait ce qu’il recouvre. Car l’exposé de Charles commence par une évocation du « rhapsode » tel que le présente l’Ion de Platon, rhapsode qu’on félicite d’avoir « par[é] Homère [12] », un terme qui à mon sens se couple ici aussi d’une « préparation », d’un « toilettage » comme je le disais plus tôt.
Il est frappant de voir que le personnage de « La déclaration foraine » accomplit en tous points l’action du rhapsode, celui qui produit l’« hermeneuein » : « Ion est un rhapsode, “interprète” d’Homère aux deux sens du mot : il le récite et il le commente, il en est l’acteur et l’exégète [13]. » Commentant le dialogue socratique, Charles note qu’il manque au rhapsode un équilibre entre le « désir critique » et la « distance critique » ; que puisqu’il prête sa voix et son corps aux mots du poème, et que par suite il en fait apprécier les subtilités avec chaleur, dans son commentaire, il se trouve trop proche de son objet pour en avoir une vue complète. Or c’est ce que permet la « toilette » au sens où je la vois chez Mallarmé, car elle est une action qui révèle ce qu’elle met à distance. Et à mon sens c’est encore le même mouvement qui permet à Charles de dégager un art de la lecture d’une rhétorique, lorsqu’il affirme que l’effet se déduit de l’origine : « La rhétorique est en effet une théorie du discours, mais, si je puis dire, du discours en tant qu’il est reçu, ou à recevoir, de telle ou telle manière. Disons une théorie du discours comme “effet”. Or c’est la lecture que nous en pratiquons qui fait qu’il y a quelque chose de tel que la littérature [14]. » C’est encore une double distance qui est maintenue pour le texte, en amont vers l’origine et en aval vers son effet, d’un côté vers l’unicité d’une intention et de l’autre, vers la multiplicité des sens que différents lecteurs lui reconnaissent. Le geste du rhapsode tel que le présente Mallarmé prend la mesure de ce paradoxe et le démarque pleinement, plutôt que de l’esquiver : la récitation du poème est pour une part une présentation à nue, débarrassée de toutes les scolies environnantes, à laquelle s’ajoute un commentaire qui ne doit pas embrouiller davantage le propos, mais qui au contraire l’éclairerait. C’est pourquoi cet éclairage touche à sa conception, aux règles rhétoriques qui ont servi à son élaboration. Comme l’indique Michel Charles, la rhétorique « est en fait une pré-analyse : il s’agirait d’abord de définir le statut d’un mot (problématique de la figure), d’un fragment discursif (problématique du registre de parole), d’un livre (problématique du type de discours) [15]. » En insistant sur la « Métaphore » et la « rime », le poète de « La déclaration foraine » définit le statut de certains mots de son poème ; cette même rime et l’évocation du « mode primitif du sonnet » définissent le registre de parole adopté ; et rien n’empêche de voir dans l’ensemble du poème en prose un « livre », livre du monde actuel, dans la mesure où la foire renferme « pour un temps l’univers » (Df, p. 424). Plusieurs commentateurs ont noté l’espèce de religion moderne que représente la foire, avec ses « temples » et son « arcane » dédiés à la communion du peuple. Lire et commenter ce monde transposé, c’est ce que fait le poème, qui se veut également « anecdote ».
« La lecture d’un texte est marquée dans ce texte, l’écriture se double d’une réflexion critique. Mais que cette lecture et que cette réflexion critique viennent à se formuler, à s’expliciter, à s’inscrire “noir sur blanc”, elles seront-elles-mêmes à lire car elles feront dès lors partie de la fiction [16]. », nous dit encore Michel Charles. En effet la lecture, comme du reste l’écriture, sont elles-mêmes des actions à part entière qui peuvent être transposées dans un univers fictif et il devient périlleux de vouloir les en séparer. Commentant le poème « Le voyage » de Baudelaire, qui présente en son centre un système complexe de renvois, où la parole s’échange et revient sur elle-même, Charles y décèle comme un art de la lecture réflexif, à reporter donc sur la fiction générale. Ce sont les voyageurs qui parlent ici et commentent tout ensemble, le monde qu’ils ont vu mais aussi les mots du poème, en se fondant incidemment sur la métaphore solaire : « — La jouissance ajoute au désir de la force. / Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d’engrais, / Cependant que grossit et durcit ton écorce, / Tes branches veulent voir le soleil de plus près [17] ! » Pour Charles, cet extrait se démarque de l’ensemble par certains indices tout en se solidarisant du propos général, dans une dynamique de suspens paradoxale :
[…] il ne s’agit pas, avec le soleil du vers central, d’un indicible, mais d’un jamais dit. En toute rigueur, rien ne permet d’affirmer que l’on ne saura jamais de quoi le soleil est métaphore. Il reste que si je tente de substituer à « soleil » un autre nom – si j’interprète la métaphore – je détruis la dynamique du poème. Il faut imaginer l’interprétation comme possible, mais la réserver [18].
C’est pourquoi selon lui la fin du poème rétablit « le doute et la suspicion [19] », en présentant la fin du voyage comme un nouveau départ, ce qui présente le chemin parcouru comme une progression autant que comme une régression. De la même façon, « le nous » du poème « associe le poète et son lecteur [20] » en ce qu’il place l’un et l’autre face au même doute ; pour Charles, le poème « invite à un discours critique indispensable et dérisoire [21] ».
Charles nous parlait à l’instant d’un sens « possible » mais « réservé », ce qui me semble une formule forte. J’en trouve un écho chez Christian Doumet, lorsqu’il aborde la question de la traduction et de « l’étrangèreté » de la langue poétique. La langue étrangère apparaît comme le symptôme d’un énoncé qui « pourrait être compris [22] » si le lecteur changeait son point de vue ; c’est encore de la possibilité du sens qu’il est question ici, de façon toute pratique devant la langue étrangère, mais aussi devant la langue poétique, qui offre cette possibilité au travail de la lecture. Et je rappelle que, dans le seul poème où Mallarmé présente une lecture poétique en acte, à la fois comme récitation et comme commentaire, c’est pour réciter la forme « anglaise » du sonnet, qu’il tente pour la première fois. Abordant plus largement la question de la difficulté poétique, Doumet présente celle-ci comme un « événement » qui dépasse la simple intellection : « Il n’est en somme de difficulté poétique qu’en devenir. C’est dire qu’elle s’inscrit dans une histoire : l’histoire même de notre approche de la poésie. L’histoire du poétique en nous [23]. » Puis il va expliciter ce « nous » dans le même sens que Baudelaire parce que la difficulté poétique permet tout particulièrement, non seulement d’inscrire le texte dans le vécu individuel, mais aussi de positionner le poète et son lecteur dans la même situation :
Ce parallélisme des deux situations, pourtant dissymétriques à tant d’autres égards, nous aide à nous représenter l’expérience si particulière et si frustrante de la difficulté en poésie. Et à comprendre notamment ceci : qu’il n’y a de résistance, entre un lecteur et un poème, qu’à partir de cette expérience préalable de maintes résistances intériorisées qui, entre admission et refus, entre reconnaissances et étrangetés, constituent la mémoire du poétique, comme ailleurs, dans de semblables conditions sans doute, la mémoire du pictural ou du musical se constitue d’une somme de désarrois [24].
Cette dernière remarque nous aide je crois à mieux saisir un des enjeux fondamentaux du poème « La déclaration foraine ». On est en effet involontairement frappé par l’écart qui sépare un contexte très populiste, et un poème qui « se présente comme un des moins immédiatement compréhensibles », selon Bénichou [25]. Il est vrai que le poème en vers est fortement contextualisé, ce qui entretient l’attente d’un texte qui pourra être entendu aisément par la foule. Mais il est vrai également que la surprise et le surgissement sont une des pièces maîtresses du poème : on est surpris de découvrir une baraque vide, de même que par l’allure d’un vieillard dont on ne connaît pas le « rôle » ; la dame prend tout le monde par surprise en convoquant la foule, foule qui elle-même afflue sans crier gare ; le poète doit « vite, dégoiser » son poème et ce dernier est bien fait pour laisser pantois un peu tout le monde. C’est une stupeur généralisée qu’on rencontre ici et qui provient tout autant des paroles obscures du poète que des gestes sauvages des badauds. Une stupeur que la fin ne fait qu’entretenir, dans ce « Peut-être » énigmatique. Lorsque le rhapsode termine un dialogue où il commente le poème en vers en révélant ses procédés originaux, il affirme : « ― Peut-être ! accepta notre pensée dans un enjouement de souffle nocturne la même. » (Df, p. 428) À mon sens il affirme ainsi que le véritable sens est un pouvoir être, une possibilité de sens, qui est à la fois voilé et dévoilé ; que cette possibilité est la difficulté construite par le texte, difficulté qui solidarise les démarches du créateur et du récepteur ; et que la « toilette », par exemple, peut bien symboliser ce jeu de préparation et de parure, d’approche et d’éloignement, où deux êtres trouvent à se réunir en ce qu’ils font tous deux l’expérience d’un même suspens, d’un « désir » et d’une « distance » qui s’entretiennent réciproquement.