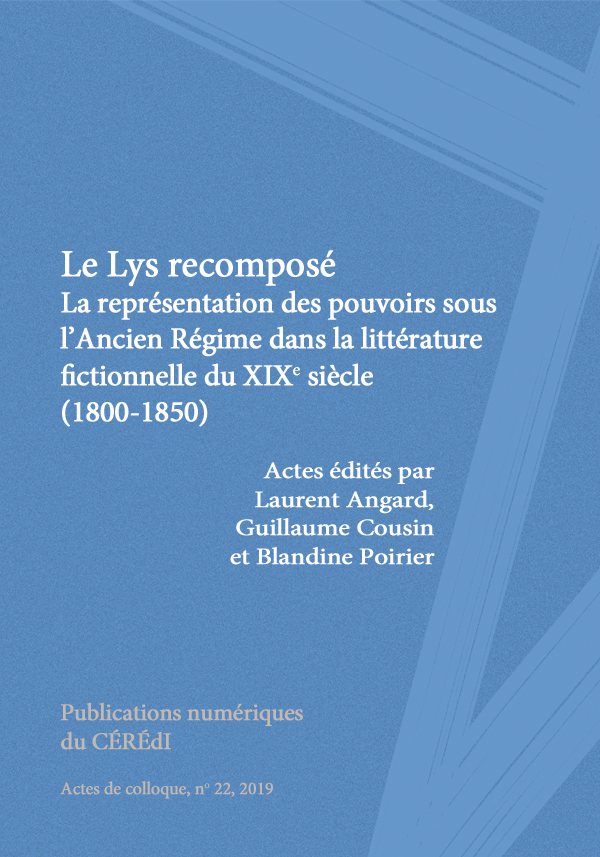« Entre La Comtesse de Salisbury et Le Comte de Monte Cristo », romans qui selon lui délimitent la vaste chronologie historique dont il traite, Alexandre Dumas revendique d’avoir « appris à la France […] cinq siècles et demi » d’histoire [1]. Dans ce parcours du Moyen Âge à la période contemporaine, les crises politiques sont la toile de fond de la plupart des intrigues : guerres de succession ou de religion, Fronde, fermentation révolutionnaire… Les figures de souverain occupent donc une place importante dans le récit dumasien, qui se donne pour projet explicite d’éclairer le devenir historique de la France pour un peuple appelé à progressivement le prendre en charge [2].
Henri III, Louis XIII, Louis XIV ou le régent Philippe d’Orléans qui seront principalement évoqués ici, ne gouvernent cependant pas seuls, mais avec un conseiller. Historiquement attestés pour la plupart d’entre eux, ces conseillers ont des statuts et occupent des rôles divers : Chicot est fou du roi – quoiqu’il figure sur les registres officiels comme « capitaine » de la maison du roi [3], Richelieu et Mazarin sont premiers ministres et Colbert, un grand commis d’État. S’il faut les distinguer de la figure du favori [4], Dumas en fait à l’occasion des confidents ou des espions, comme le ministre Dubois [5], à la police duquel le régent essaye en vain de se soustraire.
Le conseiller et le prince occupent traditionnellement deux fonctions a priori distinctes : choisi pour sa compétence, le conseiller ne dispense pas une morale ; il met en œuvre une expertise au service de l’action politique. Mais il reste dans l’ombre du prince, qui incarne seul la prise de décision. Sa position résulte exclusivement du bon vouloir du prince, tandis que ce dernier a toute légitimité et, en principe, tout pouvoir sur lui. En choisissant de représenter le pouvoir à travers ce couple complémentaire ou concurrent mais souvent dysfonctionnel, Dumas pose la question de la légitimité du pouvoir monarchique et celle de son incarnation problématique. Dans ses romans historiques, la répartition des fonctions entre le prince et son conseiller est en effet mise à mal ou du moins remise en question dans un jeu de miroirs où le réel détenteur du pouvoir, ou du moins celui qui l’exerce à bon escient, n’est pas toujours assis sur le trône ; la valorisation de la figure du conseiller par Dumas contribue ainsi à la représentation romanesque de l’Ancien régime comme une succession de crises qui interrogent, à intervalles réguliers, la capacité du souverain à gouverner.
Dans l’économie romanesque, le conseiller du prince peut exercer le pouvoir dans ce qu’il a de plus implacable, contrairement au souverain débonnaire qui a la sympathie du lecteur. Cette fonction coexiste pourtant, dans la plupart des romans, avec une représentation du conseiller comme un véritable serviteur de l’État, dont le dévouement et l’ingéniosité révèlent par contraste l’incapacité du souverain et interrogent les critères de sélection de ce dernier. La figure du conseiller du prince, sous ses différents avatars, éclaire ainsi une reconstitution historique de l’Ancien Régime entre idéalisation romanesque et pragmatisme machiavélien. Outre sa fonction dynamique dans l’économie romanesque, le conseiller se voit en effet attribuer par Dumas – qui en cela ne s’écarte pas toujours de la vérité historique, mais la réarrange néanmoins – un rôle politique essentiel dont il s’agira, in fine, d’interroger les implications idéologiques.
Éminences grises et coulisses du pouvoir : une poétique romanesque de l’Histoire
Au début du XIXe siècle, le roman historique français illustre la conception romantique de l’histoire comme continuité interprétable, organisée en fonction d’un devenir dont les mécanismes sont à mettre au jour [6]. Avec pour conséquence une narration dramatisée dans laquelle les acteurs historiques occupent des emplois et des fonctions romanesques bien définis.
À l’exception de Chicot dans La Dame de Monsoreau, le conseiller du prince est d’abord l’antagoniste décrié du héros, leur affrontement polarisant l’intrigue et les valeurs dont elle est porteuse : Richelieu, Mazarin, Colbert ou Dubois sont – souvent en contradiction avec le prince qu’ils servent – respectivement les ennemis des mousquetaires, du surintendant Fouquet et des conspirateurs idéalistes qui veulent renverser ou supprimer le duc d’Orléans. C’est donc en contrecarrant leurs plans et en s’opposant à eux que les héros se révèlent et expriment les valeurs chevaleresques qui sont celles du roman historique ou du roman de cape et d’épée : bravoure, panache, noblesse d’âme. D’Artagnan et ses amis risquent leur vie pour ramener de Londres les ferrets imprudemment offerts par Anne d’Autriche à Buckingham afin de sauver l’honneur de la jeune reine, menacée par Richelieu ; vingt ans plus tard, d’Artagnan désobéit aux ordres de Mazarin pour tenter de sauver Charles Ier d’Angleterre que le cardinal a abandonné à Cromwell, avec lequel il signé un traité. À la mort du cardinal, Colbert lui succède dans « l’emploi du vilain ministre [7] » et s’acharne contre le généreux Fouquet dont il finit par provoquer la chute. Le dédoublement du couple exécutif rend lisible le « clivage entre l’action politique et historique et la conduite morale et individuelle [8] ». L’Ancien Régime apparaît ainsi, à travers cet antagonisme, comme un temps dans lequel des individualités héroïques et énergiques pouvaient se distinguer face à un conseiller du prince incarnant la part mauvaise du pouvoir.
Le romancier met donc en scène une complémentarité des rôles entre le prince et son conseiller, dont l’exemple le plus emblématique est celui du duc d’Orléans et de son ministre Dubois :
[…] Le régent, peu rigoriste de sa nature, aimait cet homme qui avait fait son éducation, et dont il avait fait la fortune. Le régent appréciait dans Dubois les qualités qu’il avait, et n’osait blâmer trop fort quelques vices dont il n’était pas exempt. Cependant, il y avait entre le régent et Dubois un abîme ; les vices et les vertus du régent étaient ceux d’un grand seigneur, les qualités et les défauts de Dubois étaient ceux d’un laquais. (Le Chevalier d’Harmental, XXIII, Phébus, 2006, p. 234).
Dumas joue du contraste entre les deux figures dans un réemploi explicite du couple maître-valet de la comédie classique : « Dubois précédait Figaro, auquel il a peut-être servi de type » (CH, XXIII, p. 233). C’est d’ailleurs en valet de comédie qu’il « cour[t] chez le régent […] lui faire une scène » en apprenant qu’il a gracié le conspirateur, ce qui, d’après le romancier, oblige Philippe d’Orléans à le faire nommer cardinal pour apaiser sa colère. À l’inverse, le conseiller n’hésite pas à moquer le prince et ridiculiser la majesté royale en présentant l’exercice du pouvoir comme une pantalonnade. Chicot, qui joue à plein son rôle de bouffon quoi qu’il ne le soit que par intermittence (il est réputé gentilhomme), propose au roi d’échanger leurs places : « C’est dit : je suis Henri […] ; je vais trôner, tu vas danser ; je ferai pour toi toutes les singeries de la couronne, et toi, pendant ce temps, tu t’amuseras un peu, pauvre roi ! » Henri III obtempère et laisse « Chicot, [jouer] son rôle de roi avec un entrain et une majesté des plus risibles » (DM, Gallimard, coll. « Folio », 2010, I, p. 36). On est tenté de parler d’hybridation générique [9] dans la mesure où les grands dialogues héroïques – Dumas romancier réinvestit son savoir-faire d’auteur dramatique – sérieux, alternent avec de véritables scènes de comédie, dans lesquelles sont mobilisés explicitement les intertextes moliéresque et beaumarchaisien. Mazarin, qui cabotine jusque sur son lit de mort, gesticule comme « Pantalon » avant de crier « comme plus tard devait le faire Scapin dans cette sublime plaisanterie que […] Boileau osa reprocher à Molière […] » (VB, t. I, XLVIII, p. 470 et 475). La représentation contrastée du couple exécutif s’inscrit aussi dans l’esthétique romantique de mélange des genres [10] quand Dumas reprend le motif du roi mélancolique en proie à l’ennui, auquel le conseiller du prince, Richelieu excepté, offre un contrepoint comique, voire bouffon. Henri III se plaint à son favori Saint-Luc : « je m’ennuie » (La Dame de Monsoreau, II, X, p. 315) ; Louis XIII apostrophe un courtisan au hasard : « ennuyons-nous ensemble » (Les Trois Mousquetaires, VI, Gallimard, coll. « Folio », 2001, p. 78) ; quant au régent, il « ne craignait rien tant que l’ennui, […] sans jamais parvenir à le vaincre entièrement » (CH, XXII, p. 220).
C’est donc le conseiller du prince qui, en œuvrant en coulisses, fait avancer l’action. Il agit le souverain, au risque que celui-ci apparaisse comme une marionnette dont il tire discrètement les ficelles : « Je viens vous proposer, à vous aussi, un déguisement » (Une fille du Régent, XVI, Éditions Gérard et Cie, coll. « Gerfaut », p. 193) annonce Dubois qui orchestre une entrevue entre le régent et le jeune conspirateur désigné pour l’assassiner. Le régent et son ministre, déguisés, s’y font passer pour d’autres conjurés, mais c’est Dubois qui fait avancer le dialogue en soufflant au régent ce qu’il doit dire et en toussant pour le contenir quand celui-ci risque de se trahir (FR, XVII, p. 205-207). Il recycle le procédé dans La Dame de Monsoreau où Henri III, sur le point de céder à une requête du duc d’Anjou, est empêché de commettre une faute politique grave par Chicot dissimulé, qui lui fait « les gestes les plus négatifs qu’on pût inventer et exécuter sans se disloquer les os » (vol. IV, chap. VII, p. 560). Au risque de forcer le trait, Dumas introduit régulièrement dans ces échanges un commentaire métalinguistique : « Je n’aime pas jouer un rôle dans tes comédies » se plaint le régent, qui s’entend répliquer : « mais peut-être ne feriez-vous pas mal, Monseigneur, de me donner à moi un rôle dans les vôtres […] elles réussiraient mieux, et les dénouements en seraient meilleurs » (FR, XXII, p. 269). Cette influence s’exerce également sur un mode plus sombre et avec des conséquences tragiques, comme en témoigne le brutal dénouement d’Une fille du régent, à l’opposé de celui du Chevalier d’Harmental : anticipant la clémence du régent à l’égard des conjurés bretons, Dubois expédie à son insu l’ordre d’exécution et ne le prévient que lorsqu’il est sûr qu’il est trop tard.
Outre le fait que Dumas dévoile ainsi les ressorts de l’exercice du pouvoir, il met en évidence l’empiètement du conseiller sur les prérogatives du prince. Quand le régent s’en émeut, Dubois rétorque bien cavalièrement : « Mais, dis donc, l’abbé, […] il me semble que c’est toi qui ordonnes maintenant ici ? – C’est pour votre bien, monseigneur ; laissez-moi faire » (CH, XXIII, p. 238). Dans La Dame de Monsoreau, Chicot reconnaît lui aussi détenir le pouvoir avec une désinvolture comique : « au bout du compte, c’est moi qui règne [11] » (DM, vol. IV, II, p. 518). Tandis que Henri III s’abandonne à la mélancolie, son bouffon agit dans l’ombre pour défendre le trône menacé par les ligueurs ; on comprend dès lors qu’il puisse se proclamer « le véritable roi de France » (DM, vol. IV, VII, p. 560). C’est précisément cette substitution qui lui permet de sauver le roi quand, se faisant passer pour Henri III, il signe « Chicot 1er » au bas de l’acte d’abdication que les Guise pensent extorquer, sous la menace, au roi de France (DM, vol. V, XXX, p. 901). Dans Le Vicomte de Bragelonne, la relégation de Louis XIV par Mazarin semble surtout motivée par l’ambition personnelle de ce dernier. Le jeune roi en fait le constat amer : « Je suis un trône visible […] » puis montrant les appartements de Mazarin : « là est le véritable roi de France » (VB, t. I, IX, p. 133). Le roi convient néanmoins qu’il est « bien assis sur [s]on trône », et se voit léguer par Mazarin un précieux conseiller en la personne de Colbert. Mais cette usurpation est presque toujours le corollaire de l’incapacité, momentanée ou permanente, du prince à exercer son rôle. Dumas le montre souvent faible et irrésolu : soit qu’il apprend encore l’exercice du pouvoir comme le jeune Louis XIV, soit qu’il a été gâté comme Louis XV, dépeint dans Joseph Balsamo comme un vieil érotomane à la merci de sa favorite. Quant à Henri III, il se montre plus préoccupé par ses mignons que par l’avenir de l’État : à la fin du roman, au lieu de faire justice – prérogative royale – de la grave accusation portée par un de ses favoris contre le duc d’Anjou, il s’enfuit « en poussant des cris lamentables » pour pleurer ses mignons tombés en duel.
En face d’un souverain faillible au statut héroïque incertain, le conseiller, bien que souvent cantonné dans un registre bas, s’avère indispensable : il orchestre efficacement l’action du prince, il la commente intelligemment, enfin il lui oppose un contrepoint comique susceptible de brouiller ou suspendre le jugement moral que l’on peut porter sur ses propres agissements. Cette complémentarité qui dynamise l’écriture romanesque reflète également la lecture dumasienne de l’histoire.
Machiavélique ou machiavélien ?
En effet les cycles historiques de Dumas illustrent, à travers la figure du conseiller, l’efficacité d’une forme de pragmatisme machiavélien. Si l’auteur du Prince n’est mentionné explicitement qu’une seule fois, à propos de dissimulation, dans les romans évoqués [12], le débat autour de son œuvre irrigue la pensée politique de la première moitié du XIXe siècle [13] et la représentation dumasienne de l’exercice du pouvoir. Le conseiller, contrairement au prince, assume cet exercice avec ce qu’il suppose de compromission, de cynisme, voire d’infamie. Il lui prouve ainsi que l’on ne peut gouverner avec de bons sentiments, déployant, de la ruse à la violence, et parfois jusqu’à la caricature, tout le répertoire du machiavélisme.
Quand l’espionnage est regardé, sinon comme un procédé indigne, du moins comme une fonction subalterne, Colbert et Dubois, avertis que savoir, c’est pouvoir, se sont constitué leur propre police. Ainsi Colbert parvient-il à faire intercepter, copier et remettre à Louis XIV les lettres envoyées par Aramis à d’Artagnan, « huit heures avant » que ce dernier les reçoive (VB, t. III, CCLX, p. 767) ; quant à Dubois, il décachète la correspondance des conjurés après l’avoir lui-même subtilisée à l’un d’entre eux à la faveur d’une rixe qu’il a provoquée à cet effet ; puis il la rend intacte après l’avoir lue et recachetée comme un faussaire ordinaire (FR, IX, p. 117). Il est ainsi mieux renseigné sur les menaces à l’encontre du souverain que son propre lieutenant de police : bien qu’étant à Londres, Dubois sait que le régent a fait l’objet d’une tentative d’enlèvement qui a complètement échappé à la vigilance de Voyer d’Argenson. C’est également lui qui identifie la conjuration de Cellamare ainsi que son origine : « C’est une belle et bonne conspiration […] et qui part de l’ambassade d’Espagne » (CH, XXIII, p. 240). Chicot se montre aussi efficace, qui parvient à faire échouer un complot dangereux pour le roi, quand la police de Henri III débourse une somme considérable pour obtenir seulement les noms des instigateurs.
Au rebours des valeurs aristocratiques et héroïques – le conseiller, du reste, est rarement un noble –, le mensonge et la dissimulation sont également encouragés comme des moyens de prendre l’avantage sur un adversaire : Dubois doit forcer le régent, qui répugne à mentir (FR, XVIII, p. 211), à accepter de se faire passer pour un des conjurés afin de le convaincre du péril qui le menace. « Ainsi tu veux qu’avec un faux nom je surprenne les secrets… [il l’interrompt] – De vos ennemis […]. Pardieu ! Le beau crime » (ibid., p. 194). Richelieu qui veut empêcher Buckingham d’aider militairement les protestants insurgés de la Rochelle lui dépêche Milady en ambassade, non sans avoir donné à cette redoutable émissaire des instructions prudemment formulées à double sens : « se présenter franchement et loyalement à lui comme négociatrice. – Franchement et loyalement, répéta Milady avec une indicible expression de duplicité. – Oui, franchement et loyalement, reprit le cardinal du même ton, toute cette négociation doit être faite à découvert. » (TM, XLIV, p. 476) Le grand cardinal énumère alors les différents moyens de pression dont il dispose, avant d’envisager l’éventualité d’un échec de la négociation.
Lorsque la ruse ne suffit plus, c’est encore le conseiller du prince qui endosse la responsabilité – régalienne – de la violence d’État. Si Buckingham persiste, Richelieu affirme à Milady qu’il « espérer[a] dans un de ces événements qui changent la face des États » et évoque le destin de Henri IV. Milady montre qu’elle comprend précisément ce qui lui est demandé en mentionnant « le couteau de Ravaillac ». Mais elle réclame en échange un sauf-conduit et la vie de d’Artagnan, que Richelieu, bien qu’avec une certaine répugnance, lui accorde : « C’est par mon ordre et pour le bien de l’État que le porteur du présent a fait ce qu’il a fait. 3 décembre 1627 » (TM, XLV, p. 488). Les romans multiplient les situations dans lesquelles le souverain s’effraye de ces procédés et recule devant une mesure énergique qu’il n’a pas le courage d’assumer. Ainsi Henri III faiblit-il lorsque son frère, qu’il constitue prisonnier au Louvre pour sa complicité avec les Guise, crie à l’assassinat : « il lui passa un vertige » en pensant « que ce meurtre eût été un fratricide » (DM, vol. IV, VII, p. 557). Chicot, à l’inverse, croyant un instant que le roi a réellement fait tuer son frère, le félicite cyniquement : « je devine : ton malheureux prisonnier se sera étranglé dans sa prison. Ventre-de-biche ! Henri, je te fais mon compliment, tu es un plus grand politique que je ne croyais. » (DM, vol. IV, p. 693). Ces violences sont souvent représentées comme un moindre mal : à Louis XIV qui répugne à « commencer [s]on règne par des exécutions », Colbert affirme la nécessité d’être ferme « afin de ne pas le finir par des supplices » (VB, t. I, L, p. 490).
Le romancier oscille entre diabolisation et admiration à l’égard de ce réalisme politique, qui confine par moments au génie – une catégorie romantique par-delà bien et mal. Ainsi, à propos de Dubois, le romancier écrit-il : « on a dit de lui tout le mal qu’il méritait, et l’on n’a pas dit tout le bien qu’on pouvait en dire. […] Mais, il faut le dire, le génie était pour Dubois […] » (CH, XXIII, p. 233). Régulièrement comparé à un « démon », le conseiller fait preuve d’un cynisme qui rejoint le pessimisme anthropologique de Machiavel : au régent qui lui demande pourquoi c’est « parmi ses ennemis, et jamais parmi ses serviteurs, qu’un prince rencontre des âmes de cette trempe », il répond : « […] que la haine est une passion et que le dévouement n’est souvent qu’une bassesse » (FR, XX, p. 230). Ces procédés, pour vils ou immoraux qu’ils sont considérés, se révèlent en effet d’une grande hauteur de vue lorsqu’ils sont envisagés à la lueur de l’Histoire. Son jugement est régulièrement convoqué par le conseiller pour démontrer au souverain la justesse politique de ses vues, dans les grandes scènes dialoguées qu’affectionne Dumas et dans lesquelles il dramatise l’Histoire pour la rendre plus lisible. Chaque fois, le conseiller parle vrai, même si son discours heurte un prince encore pétri de valeurs chevaleresques et héroïques : dans Le Vicomte de Bragelonne, deux chapitres titrés respectivement « l’arithmétique » et « la politique de M. de Mazarin » mettent en scène l’humiliation du jeune Louis XIV contraint de demander au cardinal de l’argent et des hommes pour aider son cousin Charles II d’Angleterre. Mazarin démontre au roi qu’il n’en a non seulement pas les moyens financiers, mais qu’il est dangereux politiquement de se compromettre dans une restauration hasardeuse. Il lui rappelle au passage l’adresse politique dont il a dû faire preuve lui-même pour sauvegarder le trône français au milieu des troubles de la Fronde, n’hésitant pas pour cela à signer un traité avec le républicain Cromwell : « Cette politique n’a pas toujours été très honnête, il faut l’avouer ; mais elle n’a jamais été maladroite. Or, celle que l’on propose en ce moment à Votre Majesté est malhonnête et maladroite à la fois ». On comprend que la diplomatie doit servir les intérêts de la France, et non une solidarité de caste, s’exerçât-elle entre têtes couronnées : à Louis XIV, piqué, qualifiant l’exposé de « pauvre et mesquin », Mazarin rétorque « oui, mais comme c’est vrai, sire, avouez-le », avant de lui exposer à quelle condition il est permis d’être « malhonnête » en politique : « cela se voit souvent, qu’on manque à sa parole et qu’on élude un traité, mais c’est quand on a quelque grand intérêt à le faire […] » (VB, t. I, XI, p. 147-148).
Dans Une fille du régent, Dubois reprend vertement le duc d’Orléans, tenté de pardonner au conspirateur qu’il admire
« […] quand on a entre les mains le gouvernement d’un royaume, il faut, avant toutes choses, gouverner. […]
– Alors, dit le régent avec d’autant plus d’impatience qu’il se sentait défendre une noble, mais mauvaise cause, si tu voulais que je fusse sévère, […] il fallait me laisser croire que c’était un conspirateur vulgaire.
– Oui ; et maintenant, parce qu’il s’est présenté à Votre Altesse sous une enveloppe romanesque, voilà votre imagination d’artiste qui bat la campagne […]. Faites de la chimie avec Humbert, faites de la gravure avec Audran, faites de la musique avec La Fare, faites l’amour avec le monde entier ; mais, avec moi, faites de la politique. (FR, XX, p. 233)
C’est encore par une leçon d’histoire que le ministre rappelle au duc d’Orléans, dont il a été le précepteur, ses devoirs en tant que régent. Après récapitulé les ambitions des principales puissances européennes, il conclut :
Ce n’est pas votre vie que vous défendez, monseigneur. […] Vous tué, […] c’est le pilier qui soutenait l’édifice qui s’écroule ; alors l’œuvre laborieuse de nos quatre années de veilles et de luttes est détruite ! […] la France n’est plus la France, mais la vassale de Philippe V ; […] Ainsi, de tous côtés, meurtre, désolation, ruine et incendie, guerre civile et guerre étrangère. Et pourquoi cela ? Parce qu’il plaît à monseigneur Philippe d’Orléans de se croire toujours major de la maison du roi ou commandant de l’armée d’Espagne, et d’oublier qu’il a cessé d’être tout cela le jour où il est devenu régent de France !
Le régent en convient : « […] il a dit vrai, et ma vie, […] a cessé de m’appartenir. […] Il fallut un siècle tout entier, un ministre qui s’appelât Richelieu et un roi qui s’appelât Louis XIV, pour cicatriser au flanc de la France la blessure qu’y avait faite le couteau de Ravaillac… » (FR, XX, p. 232-237)
La démonstration souligne en outre que gouverner implique l’oubli de soi au service de la France. Dès la fin des Trois Mousquetaires cette abnégation est reconnue à Richelieu, qualifié de « ministre national par excellence » (TM, XLIII, p. 468). Vingt ans plus tard, Athos avoue avoir, « tant sont aveugles les contemporains, [...] quelquefois traversé en face les desseins de ce grand homme qui tenait la France dans ses mains » (VA, XXIV, p. 257). L’action du conseiller est donc validée par la postérité.
Le roman dumasien consacre-t-il, avec le triomphe de la raison d’État, une vision machiavélienne de l’histoire ? Le conseiller, on l’a vu, sert moins la personne du prince ou un régime politique particulier que la nation. Plusieurs exemples prouvent du reste que l’on peut se passer du souverain en montrant que la légitimité se fabrique et recouvre toujours un rapport de forces violent. Maître Nicolas David présentant aux Guise le fruit de son travail de falsification généalogique pour les inscrire dans la succession au trône affirme ainsi « c’est gagner tout que gagner la légitimité » (DM, vol. II, IX, p. 306), démontrant pièces en main comment elle peut être fabriquée et que seul compte le résultat. Même réalisme politique de la part d’Anne d’Autriche rappelant à sa bru que « le roi ne peut avoir de dauphin sans [elle], et [qu’elle peut] en avoir sans lui » (VB, t. II, CLXII, p. 723). Le motif du fratricide apparaît d’ailleurs dans les deux romans : les Valois sont régulièrement qualifiés d’« Atrides » et Louis XIV condamne son frère jumeau parce qu’il a les mêmes droits au trône que lui.
À travers la figure du conseiller, le romancier interroge donc les conditions auxquelles un État peut durer et expose les moyens nécessaires à sa conservation. Non que Dumas s’en réjouisse : la raison d’État s’affirme au détriment d’un idéal héroïque. Dubois reproche ainsi au régent un sens moral mal placé : « voilà comme vous êtes, vous autres rois ou princes régnants. Une raison, stupide comme toutes les raisons d’honneur, […] vous persuade et vous clôt la bouche ; mais vous ne voulez pas comprendre les grandes, les vraies, les bonnes raisons d’État. » Il lui expose ensuite que pour épargner un chagrin à sa fille, en graciant l’homme qu’elle aime, il risque la guerre et le malheur de « Dix mille mères, dix mille femmes, dix mille filles » qui « pleureront […] leurs fils, leurs époux, leurs pères, tués au service de Votre Altesse par l’Espagnol qui prend votre bonté pour de l’impuissance [...] » (FR, XXII, p. 290). Mais l’histoire démontre l’efficacité de cette politique : à la fin du Vicomte de Bragelonne, d’Artagnan est subjugué par l’évolution de Louis XIV : « Ce n’était plus de la ruse, c’était du calcul ; ce n’était plus de la violence, c’était de la force ; ce n’était plus de la colère, c’était de la volonté ; ce n’était plus de la jactance, c’était du conseil. » (VB, t. III, CCLIX, p. 762) Le jeune roi a achevé son éducation politique et retenu les leçons de Mazarin et Colbert. Le mousquetaire reconnaît alors, non sans mélancolie, que Louis XIV est à l’aube d’un grand règne.
Au XIXe siècle, Machiavel fait l’objet d’une relecture « caractérisée par l’affirmation d’une conception nationale et patriotique [14] » de sa pensée. Dumas s’inscrit dans cette relecture par des allusions – Dubois reprend à son compte la distinction machiavélienne du renard et du lion [15] – comme par des hommages explicites :
Il fut un écrivain longtemps calomnié, avec le nom duquel on a fait un synonyme de traîtrise, de cruauté, de tous les mots enfin qui veulent dire infamie, et il a fallu le dix-neuvième siècle, le plus impartial des siècles qu’a vécus l’humanité, pour réhabiliter cet écrivain, grand patriote et homme de cœur ! Et pourtant, le seul tort de Nicolas Machiavel est d’avoir appartenu à une époque où la force et le succès étaient tout […]. (Ascanio, III, édition Christian de Bartillat, 1995, p. 54.)
C’est surtout le personnage de l’abbé Faria dans Le Comte de Monte Cristo qui accrédite la lecture par Dumas d’un Machiavel patriote, que Faria associe à la concrétisation de l’unité et l’indépendance italiennes : « […] comme Machiavel, au milieu de tous ces principicules qui faisaient de l’Italie un nid de petits royaumes tyranniques et faibles, j’ai voulu un seul empire, compact et fort » (CM, XVI, éd. Gilbert Signaux, Gallimard, coll. « Folio », 1998, t. I, p. 163). En déconstruisant les rouages du pouvoir, Dumas ne se contente pas d’enregistrer le triomphe de la raison d’État : il montre qu’elle ne dépend ni de la personne du roi, ni même la forme monarchique du régime, mais d’hommes compétents, capables et dévoués à leur pays : la lecture de Machiavel patriote n’est donc pas incompatible avec la république.
La reconnaissance, dans les romans, de l’efficacité de cette politique n’est pas, on l’a dit, sans nostalgie à l’égard des valeurs romanesques : les exemples d’héroïsme évoqués sont d’autant plus beaux que voués à l’échec par l’Histoire. Dumas associe ces valeurs à une monarchie idéale, que le fils de Louis-Philippe, mort en 1842, aurait peut-être pu, selon lui, incarner [16]. Le romancier affirme ainsi distinguer, pour lui-même, « l’historien [et] l’homme privé. Les sympathies de l’homme privé seraient un retour vers une grande ère monarchique, quelle qu’elle soit. Les convictions de l’historien […] sont que le retour à la monarchie est impossible et que l’ère de la République est arrivée [17]. » Cette conviction explique la validation donnée, dans les romans, à une action politique qui privilégie, sur le temps long, la raison d’État, même si elle n’est pas toujours morale ou romanesque. La représentation du conseiller du prince reflète l’oscillation dumasienne entre une reconnaissance de l’efficacité politique et une certaine répugnance pour les moyens employés. Le pragmatisme se voit ainsi condamné sur le plan romanesque, mais réhabilité dans une lecture dumasienne de l’Histoire vectorisée par l’idée de Progrès.