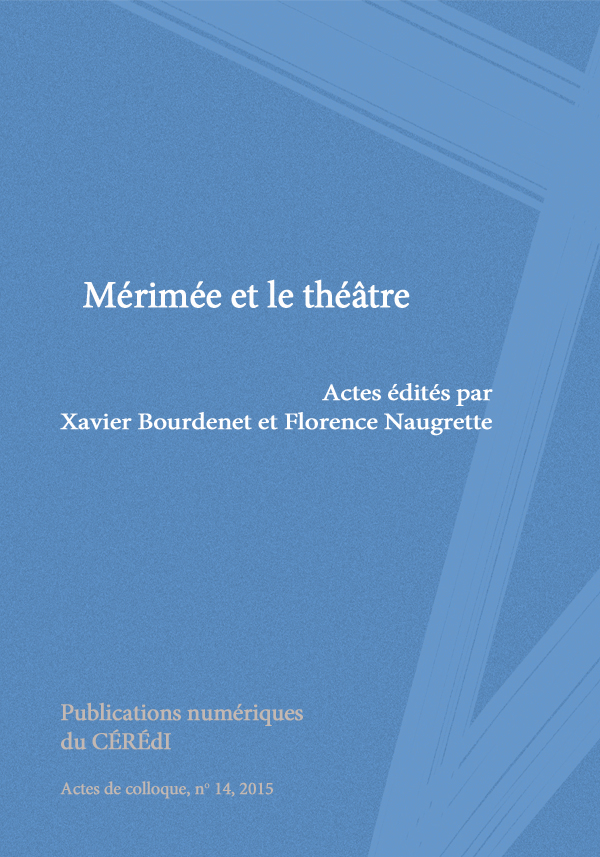Examiner le rapport que Mérimée a entretenu avec le théâtre espagnol du Siècle d’or [1] revient à soulever trois questions intimement liées. En premier lieu, quelle connaissance Mérimée a-t-il eue d’un des trois grands théâtres – avec le drame élisabéthain et la tragédie française classique – qu’a inventés l’Europe moderne ? Ensuite, quelle opinion s’en est-il faite ? Enfin, dans quelle mesure son œuvre personnelle en porte-t-elle l’empreinte ? Ce sont les deux premières de ces trois questions que je me propose d’aborder aujourd’hui. La troisième, la plus complexe et la plus riche de signification, fait actuellement l’objet de l’enquête que j’ai entreprise, il y a quelques mois, dans le cadre d’une étude d’ensemble sur Les Espagnes de Mérimée. À défaut de pouvoir en donner dès maintenant les résultats, je traiterai essentiellement des deux premiers points qui en sont le préalable obligé, sans pour autant m’abstenir de proposer, in fine, quelques pistes de réflexion concernant le dernier d’entre eux.
Compte tenu de l’ampleur du corpus constitué par le théâtre du Siècle d’or – 10 000 pièces environ conservées, soit le tiers d’une production largement victime du naufrage des ans – il est impossible de se faire une idée précise du nombre de celles que Mérimée a lues au cours de sa vie d’écrivain [2]. Il a d’abord découvert en traduction les comedias éditées dans cinq des 23 volumes de la collection des Chefs d’œuvre des théâtres étrangers, publiée par Ladvocat à partir de 1821 et qui font la part belle à celles de Lope de Vega et de Calderón [3] ; mais il les a aussi lues dans le texte [4], et c’est vers la Correspondance générale qu’il convient de se tourner pour trouver les premiers signes de l’intérêt qu’il a porté à ce théâtre et de la connaissance qu’il en acquise. En novembre 1826, s’il faut en croire Maurice Parturier, soit dix-huit mois après la publication de l’édition originale du Théâtre de Clara Gazul, il demande à Sautelet de lui faire parvenir une autre édition des pièces de Calderón que celle que ce dernier lui a envoyée [5]. Près de vingt ans plus tard, en avril 1845, il excipe de sa qualité d’académicien pour obtenir de la bibliothèque de l’Institut qu’elle commande en Espagne une édition des comedias de Lope de Vega [6]. Or, à en juger par ce que le libraire Salvá venait de lui apprendre, il n’existait pas alors d’édition digne de ce nom, si bien que la commande souhaitée s’avéra impossible [7]. Mérimée, après s’être adressé une première fois à ce sujet à Mme de Montijo, le 26 avril 1845, revient à deux reprises – les 9 et 16 mai – sur l’importance d’une telle entreprise [8]. Cette édition, lui déclare-t-il, est d’autant plus nécessaire que les scènes madrilènes se détournent désormais de l’esthétique néo-classique imposée à l’époque des Lumières par le goût français. Or, d’une part, l’édition originale des pièces de Lope de Vega, en 25 volumes, ou plutôt le recueil des pièces imprimées séparément, « est d’une excessive rareté et d’un prix fou ». D’autre part, il n’est plus possible de se contenter de l’édition allemande devenue rarissime. Et de conclure à l’adresse de sa correspondante : « Vous devriez bien donner cette bonne idée à quelques-uns de vos beaux esprits [9]. » Il était donc vivement souhaitable que la Real Academia Española remédiât à cette lacune, ce qu’elle ne se résoudra à faire que dans la dernière décennie du siècle [10].
Mérimée a également glissé dans ses lettres quelques allusions, souvent indirectes, à différentes pièces du Siècle d’or, en particulier à partir de proverbes espagnols qu’il insère dans ses lettres et qui ont donné leur titre à ces pièces [11]. En 1843, il écrit à Mme de Montijo que les événements que connaît alors Madrid justifieraient qu’on leur applique le proverbe En esta vida todo es mentira, qui a inspiré à Calderón le titre de l’une de ses comedias [12]. La même année, ses recherches sur le roi Don Pedro le conduisent à demander à la comtesse d’où sont tirées les anecdotes dont se sont inspirés les auteurs dramatiques qui ont porté ce personnage à la scène ; il s’agit, en particulier, de Lope de Vega (La desdichada Estefanía o El rey don Pedro en Madrid, El infanzón de Illescas, Audiencias del rey Don Pedro), de Calderón (El médico de su honra) et de Moreto (El valiente justiciero) [13]. En 1846, se référant à un poète ami de la comtesse qui, tel Mucius Scévola, se serait brûlé la main, il cite à son intention un autre proverbe, Porfiar hasta morir, qui se trouve être aussi le titre d’une pièce de Lope de Vega [14]. En 1846, il apprend à sa correspondante qu’il fait pour sa fille Eugénie un dessin dont le sujet est tiré de El valiente justiciero, de Moreto, qui met en scène le roi Don Pedro [15]. Autre clin d’œil en 1850, dans une lettre à Francisque-Michel : en affirmant que, pour le pessimiste qu’il dit être, rien n’est plus vrai que l’axiome espagnol Siempre lo peor es cierto, il lui remet en mémoire, en manière d’antiphrase, No siempre lo peor es cierto, le titre d’une autre comedia de Calderón [16]. En 1860, s’adressant à Gobineau à propos de la question romaine, il cite encore un proverbe, Las manos blancas no ofenden. Il faut savoir que, près de trente ans plus tôt, le ministre Calomarde avait salué par ces mots le soufflet que lui avait donné l’infante María Carlota de Bourbon, lorsqu’il avait tenté de lui arracher des mains le décret que Ferdinand VII venait de signer sur son lit d’agonie et par lequel le roi instituait sa fille Isabelle comme son unique héritière, au détriment de son frère Don Carlos. Mais il se trouve aussi que Calderón, bien auparavant, en avait tiré le titre d’une autre de ses pièces [17]. En 1862, toujours à l’intention de Mme de Montijo, Mérimée lui dit souhaiter que le haut clergé français sache prendre un « parti moyen » dans l’attitude à adopter vis-à-vis du Saint-Siège ; et de mentionner cette fois un nouveau proverbe Con quien vengo, vengo, qui a donné son titre à une quatrième pièce de Calderón [18]. En 1867, enfin, dans une lettre à Panizzi, il cite un dernier proverbe, Mujer llora y vencerás, dont procède le titre d’une cinquième et dernière comedia du même auteur [19].
Ce jeu auquel il se livre reflète un goût de la citation dont on retrouve les traces dans le Théâtre de Clara Gazul. À en croire Patrick Berthier, Pierre Trahard, dans son édition, aurait relevé « par centaines » les emprunts de Mérimée aux comedias du Siècle d’or [20] ; toutefois, si l’on prend pour référence le nombre de pièces d’où sont issus ces emprunts, on aboutit à une petite vingtaine de titres dont le même Trahard dresse la liste en appendice à l’étude qu’il a consacrée à La Jeunesse de Prosper Mérimée : cinq de Lope de Vega (Fuenteovejuna, Amar sin saber a quién, La prueba de los ingenios, La moza de cántaro et Ganar amigos) ; un de La Estrella de Sevilla, naguère attribuée à ce même auteur ; trois de Tirso de Molina (El burlador de Sevilla, Don Gil de las calzas verdes et La villana de Vallecas) ; dix, enfin, de Calderón (El alcalde de Zalamea, El pintor de su deshonra, El secreto a voces, Amar después de la muerte, Cuál es mayor perfección, Dar tiempo al tiempo, Mejor está que estaba, Guárdate del agua mansa, La dama duende et El galán fantasma) [21].
Une telle pratique est-elle née d’un commerce exclusivement livresque ? On aimerait savoir si elle ne s’est pas également nourrie des représentations auxquelles Mérimée a pu assister lors de ses différents séjours en Espagne. Or, sur ce point, la Correspondance est avare de détails. La seule confidence qui s’y trouve ressort d’une lettre du 11 mai 1844 à Mme de Montijo : « Je me rappelle avoir vu à Madrid une comédie de Tirso de Molina, Lo que son las mujeres. Pour un ecclésiastique, il me paraît avoir assez bien connu ce sujet difficile [22]. » Maurice Parturier nous apprend que le véritable auteur de cette pièce n’est pas Tirso de Molina, par ailleurs moine mercédaire, mais Rojas Zorrilla, un poète de la génération de Calderón [23]. Cela dit, il se peut fort bien qu’elle ait été mise à l’affiche sous le nom de Tirso et il pourrait tout aussi bien se faire que le texte original ait été défiguré par des remaniements, voire des refontes, conformément à l’usage qui s’était instauré à cette époque en Espagne. En tout état de cause, il ne semble pas que Mérimée ait été, outre-Pyrénées, un spectateur assidu. En septembre 1830, il évoque à l’intention d’Albert Stapfer les déboires des directeurs des théâtres madrilènes, qui sont encore moins suivis qu’à Paris et où seules les pièces de Scribe répondent à l’attente du public [24]. Cinq ans plus tard, il apprend à Henri Beyle, qui songeait à se faire nommer consul à Valence, où lui-même avait passé naguère trois semaines, que c’est une ville où il y a à peine un théâtre [25]. En 1846, alors qu’il dépouille les archives de la couronne d’Aragon afin de compléter sa documentation sur don Pèdre de Castille, il déclare à Mme de Montijo que les théâtres de Barcelone sont fort mauvais [26]. Même son de cloche en ce qui concerne Madrid, dans une lettre du 2 novembre 1853 à Léon de Laborde : il y a dans cette ville un très beau théâtre, mais il y a vu jouer un Rigoletto dans une adaptation dictée par la censure [sup].
Ce premier sondage ne nous donne donc qu’une idée très imparfaite de la connaissance qu’a pu avoir Mérimée du théâtre du Siècle d’or. Il ne nous en livre qu’un échantillonnage, quelques membra disjecta d’un vaste répertoire qu’il a peu à peu découvert au fil de ses lectures. Cela étant, quelle opinion s’en est-il faite ? Pierre Trahard avait cru trouver sous sa plume une formule qui aurait admirablement résumé l’idée qu’il s’en était formée : au terme de l’étude que Le Globe avait fait paraître en 1826 sur Leandro Fernández de Moratín, Mérimée aurait écrit qu’on chercherait en vain, dans les ouvrages de cet écrivain du XVIIIe siècle, « ces beautés hardies, ces diamants bruts, si communs chez Calderon et chez Lope [27] ». Le malheur est qu’il est impossible, dans l’état actuel de nos connaissances, de lui attribuer à coup sûr, comme on a parfois cherché à le faire, la paternité des quatre articles du Globe consacrés au théâtre espagnol [28]. Force est donc de s’appuyer sur trois études sans doute mineures, mais dont l’authenticité ne fait aucun doute et qui, de surcroît, offrent l’avantage d’être échelonnées sur l’ensemble de sa carrière : la Notice historique sur la vie et les ouvrages de Cervantès, publiée en 1826 en avant-propos à une réédition de la vieille traduction de Don Quichotte qu’avait donnée au XVIIe siècle Filleau de Saint-Martin ; le compte rendu de l’Histoire de la littérature espagnole, de l’hispaniste américain George Ticknor, parue dans la Revue des Deux Mondes en 1851 ; enfin la Préface à une autre traduction de Don Quichotte, celle de Lucien Biart, un texte que Mérimée a achevé quelques semaines avant sa mort et qui paraîtra posthume en 1878.
Nous n’avons guère d’indications sur les circonstances dans lesquelles il accepta, à l’âge de vingt-trois ans, de rédiger sa Notice. La traduction de Filleau de Saint-Martin, parue en 1678 [29], avait été rééditée plusieurs dizaines de fois au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Plus récemment, elle avait fait l’objet, pour les seules années 1824 et 1825, de cinq rééditions [30]. Cette abondance ne dissuada pas pour autant les éditeurs Lefèvre et Sautelet, qui firent paraître au début du mois de janvier 1826 un prospectus apparemment dû à la plume du préfacier [31]. Quelques jours plus tard, ils publiaient l’ouvrage [32]. À cette date, Mérimée – qui connaissait bien Sautelet, rencontré par lui chez Delécluze, et à qui, l’année précédente, il avait confié la publication du Théâtre de Clara Gazul –, avait commencé à manifester son intérêt pour une Espagne qu’il allait découvrir quatre ans plus tard, à l’occasion du premier de ses voyages outre-Pyrénées. Son étude, qui fut jugée sévèrement par Gustave Planche [33], fut, semble-t-il, rééditée, mais non recueillie par son auteur [34]. Dix ans plus tard, la version de Filleau de Saint-Martin, ne tarda pas à être éclipsée par la traduction de Louis Viardot, parue en 1836-1837, bien préférable et mieux accordée au goût des lecteurs [35].
Si Mérimée, comme il se doit, accorde l’essentiel de son attention à la vie de Cervantès ainsi qu’à Don Quichotte, il n’ignore ni ses autres œuvres en prose, ni la production dramatique d’un écrivain qui eut le théâtre pour vocation première, dont les débuts précédèrent de plusieurs années l’avènement de Lope de Vega et le triomphe de la Comedia nueva, et qui, à la fin de sa vie, se résigna à faire éditer ses dernières pièces faute de convaincre les comédiens de les jouer. Avant de s’intéresser à lui, Mérimée commence par brosser une brève histoire des origines et de l’évolution de l’art dramatique en Espagne, en s’appuyant sur la rétrospective toute personnelle qu’en donne Cervantès dans la préface des Comédies et Intermèdes, parues en 1615, un an avant sa disparition. À cette fin, il traduit cette préface au prix de quelques inexactitudes, puis il évoque les pièces dites de la première époque, jouées à Madrid dans les années 1580, peu après le retour de captivité de leur auteur, mais, depuis lors, perdues pour la plupart. À l’exemple des romantiques allemands, qui portèrent Numance aux nues, il fait l’éloge de cette tragédie, dont le texte original, retrouvé en 1784, avait été traduit par Esménard et publié en 1823 dans les Chefs d’œuvre des théâtres étrangers [36]. En revanche, il n’est guère indulgent pour celles qui forment le recueil de 1615, qu’il estime mal construites et mal écrites, parce que, dit-il, l’auteur y multiplie les imbroglios et les coups de théâtre qui ne laissent pas de place au développement des caractères [37]. Il est vrai que ce théâtre illustre les aléas d’un art expérimental qui, faute d’avoir pu être expérimenté, a oscillé entre plusieurs formules. Mais les critiques qui lui sont faites par Mérimée n’épargnent pas non plus celui de Lope de Vega : sans doute ce dernier a-t-il fait triompher la Comedia nueva sur la scène espagnole, mais il y est parvenu en abusant de motifs tirés de l’histoire nationale – sérénades, vengeances, jalousies, assassinats – dont il s’est fait, et ses disciples avec lui, une mine inépuisable, mais au fond de peu de valeur.
La violation des unités, écrit Mérimée, est la conséquence obligée de ce système ; c’est un petit mal que je leur pardonnerais volontiers, s’ils savaient généralement en profiter. Mais agiter violemment ces personnages pour que de ce grand mouvement il ne résulte rien de vrai, de beau, de plaisant, c’est une faute qui n’a plus d’excuse. Sans doute il vaut mieux faire agir les acteurs que de les faire parler par tirades, comme sur notre scène, mais que chacune de leurs actions explique leurs caractères, peigne leurs mœurs et celles de leur temps, autrement la multiplicité des aventures devient aussi fatigante que les tirades. Rarement les Espagnols se sont attachés à peindre des caractères : en général ils cherchent à frapper par la singularité des événements, plutôt que par les passions qui les ont causés [38].
Ce jugement est d’autant plus sévère que tous ces poètes, à commencer par Cervantès, ont contrevenu selon lui à la vérité en composant leurs dialogues en vers et en s’abandonnant aux outrances du style culto. Il est cependant tempéré in fine par les qualités que Mérimée reconnaît à Lope de Vega et à Calderón : ils ont en effet prouvé, dit-il, qu’ils savaient unir, quand ils le voulaient, une intrigue attachante à des caractères fortement tranchés. Et de citer en note, pour illustrer cette affirmation par des exemples, les trois chefs d’œuvre que sont Fuenteovejuna, El alcalde de Zalamea et El mágico prodigioso.
La deuxième étude, postérieure d’un quart de siècle, aurait pu n’être qu’un écrit de circonstance ; mais, outre qu’elle nous permet d’apprécier la culture de l’hispanisant distingué qu’était devenu l’auteur de Carmen, elle nous révèle tout ce qui sépare son point de vue de celui d’un homme à qui l’on doit la première histoire de la littérature espagnole qui mérite ce nom [39]. Son auteur, George Ticknor, était originaire de Boston et avait enseigné à Harvard les littératures espagnole et française, avant de mettre à profit deux longs séjours en Europe pour rassembler d’importants matériaux et de se constituer une riche bibliothèque. De retour aux États-Unis, il s’était consacré à la rédaction de l’ouvrage qui allait faire sa réputation, une History of Spanish Literature, en 3 volumes, qui paraîtra simultanément à Londres et à New York en 1849 [40]. Ce livre connut un succès immédiat, car ceux qui avaient précédé Ticknor dans cette voie – Friedrich Bouterweck et Simonde de Sismondi – n’étaient que des vulgarisateurs de talent dont les synthèses respectives, insuffisamment documentées, comportaient erreurs et lacunes [41]. Ticknor, en revanche, s’appuyait sur une connaissance de première main des auteurs et de leurs œuvres, ce qui lui valut un accueil favorable, tant des spécialistes que du public anglo-saxon.
Comment Mérimée en est-il venu à rendre compte de ce livre dans une revue dont il était le collaborateur régulier ? À la vérité, ses curiosités, mais aussi ses titres et ses travaux l’y prédisposaient. Dix ans plus tôt, en 1837-1838, il avait eu l’occasion, chez Mary Clarke, de rencontrer Ticknor à deux reprises, lors du séjour de celui-ci à Paris [42] ; cela dit, bien qu’à des époques différentes ils eussent tous deux fréquenté à Madrid le salon de la comtesse de Montijo, l’auteur de Carmen ne semble pas avoir produit sur l’hispaniste américain une impression très favorable, comme il ressort de ces lignes tirées de son journal : « Mérimée […] disappointed me. He is affected and makes pretentions to exclusiveness [43]. » Lorsque Mérimée prit connaissance de son gros ouvrage, il constata qu’il n’y était pas question de son Histoire de don Pèdre, récemment parue. Omission délibérée ? Probablement pas. Néanmoins, on peut penser, avec Marcel Bataillon, qu’il en fut piqué et ne voulut pas en rester là [44]. Dans une lettre à Francisque-Michel, datée du 17 juillet 1850, il indique à son correspondant que le compte rendu qu’il prépare est dû à sa propre initiative, sans pour autant se montrer enthousiaste devant le pensum qui l’attend :
Si j’avais quelque chose de vous à lire, je n’aurais pu accomplir une tâche que je me suis imposée, c’est-à-dire lire l’ouvrage de Ticknor sur la littérature espagnole, ouvrage d’une digestion très difficile. Il n’y a pas de gâteau de plomb qui soit si lourd. C’est un Yankee très érudit et fort bête qui a lu tout ce qui s’est écrit en espagnol, mais qui n’y a pas compris grand’chose. Quand vous serez de loisir, veuillez m’expliquer pourquoi un américain n’est qu’un anglais manqué [45].
Voilà qui semblait annoncer un éreintement. En fait, sans aller aussi loin, Mérimée ne va pas se priver de critiquer un livre dont la conception et l’organisation ne laissent pas de déconcerter le lecteur. Divisée en trois périodes d’inégale importance, cette Histoire couvre successivement le Moyen Âge, les Siècles d’or et l’Espagne des Bourbons pour s’achever en 1833, avec la mort de Ferdinand VII. Chacune de ces périodes est découpée en chapitres dont le nombre entraîne inévitablement un émiettement de la matière : vingt-quatre pour la première, trente-neuf pour la seconde, sept seulement pour la dernière. Bien que quelques individualités – Cervantès, Lope de Vega, Calderón – aient droit à un traitement d’exception, l’impression que l’on retire est celle d’un fourmillement de noms d’écrivains et de titres d’œuvres, sans que l’on soit en mesure de les replacer dans un cadre historique clairement défini, de dégager des lignes de force, de distinguer, dans cette mise à plat, continuités et ruptures. Ce défaut majeur n’a pas échappé à notre recenseur. Il tient, selon lui, au fait que le livre se ressent d’avoir été à l’origine un cours public, une série de leçons d’égale longueur, devenues autant de chapitres d’étendue uniforme et parfois assez mal liés.
Plutôt que de rendre compte en détail du contenu de l’ouvrage, Mérimée a préféré faire des choix et c’est précisément sur le théâtre du Siècle d’or qu’il s’étend le plus volontiers. S’il approuve Ticknor d’en avoir indiqué le caractère romanesque et les principaux ressorts, il lui reproche de n’avoir pas expliqué « pourquoi un peuple dont les romans ont peint avec tant de facilité la nature et les mœurs nationales, n’a, dans ses drames, que des tableaux de fantaisie [46] ». Les passions – amour, jalousie et point d’honneur – y sont toujours les mêmes, les personnages aussi, que ces passions entraînent et qui agissent toujours d’après des règles et des conventions invariables. « L’intrigue change, grâce à l’inépuisable fécondité des auteurs, mais le fond demeure immuable [47]. » Quant au style culto, encore plus étrange que le fond, il déconcerte nos contemporains : entendons par là – précise Mérimée, plus explicite qu’en 1826 – une tendance du baroque espagnol, contemporaine de la préciosité française, de l’euphuisme anglais et du marinisme italien, et qui a trouvé en Gongora et en Calderón deux de ses représentants les plus éminents. Les exemples qu’il donne en note, tirés de El mágico prodigioso et de El alcalde de Zalamea, visent à montrer que ce style va à l’encontre des goûts de notre peuple. Cela dit, les Espagnols n’ont pas été les seuls à tomber dans un tel travers : Shakespeare et, avant lui, Eschyle les ont précédés dans cette voie. Toutefois, ce que ne dit pas Mérimée, c’est que cette tendance ne s’épanouira qu’après 1610 et que ni Cervantès, ni même Lope de Vega n’ont sacrifié à cette mode. Retenons en revanche l’ingénieuse théorie du « plaisir double » qu’il propose pour rendre compte de l’extraordinaire succès rencontré par la Comedia nueva auprès des spectateurs du XVIIe siècle : entraînés tout d’abord par les péripéties d’une action mouvementée, ils cédaient ensuite aux prestiges d’un lyrisme raffiné qui leur donnait une jouissance presque musicale [48].
Mérimée s’emploie ainsi à caractériser, sans pour autant la réhabiliter, une esthétique différente de celle qu’il avait mise en œuvre dans ses premiers essais dramatiques, mais qui n’en a pas moins retenu son attention et qu’il cherche moins à condamner qu’à comprendre : selon lui, au lieu de faire de l’imitation de la nature le premier but de l’art, les Espagnols, tout comme les Grecs, ont voulu transporter les spectateurs dans un monde idéal, parce qu’ils demandaient au drame un autre plaisir que celui qu’on y cherche aujourd’hui. Le public ne cherchait pas encore l’illusion théâtrale, mais goûtait à la fois le plaisir de la fable et l’expression poétique dans une langue sonore et harmonieuse. Ce n’est plus le cas de nos jours et il n’y a pas lieu de s’en réjouir : la tyrannie du naturel risque de réduire le théâtre à « une espèce de pantomime sans développements, où toute la gloire appartiendra aux acteurs et aux machinistes [49] ».
Quant au retour de Mérimée à Cervantès, au soir de sa vie, il allait naître d’une requête d’un pharmacien amateur de belles-lettres, Lucien Biart, qui avait entrepris de retraduire Don Quichotte. Consulté par l’auteur de Carmen sur « des points obscurs de la philologie espagnole » avec laquelle l’avait familiarisé un séjour de vingt ans au Mexique, il se vit encouragé par son interlocuteur, fort réservé à l’égard des précédentes traductions. Un mois plus tard, à l’en croire, soit en juillet 1869, Mérimée aurait proposé à Hetzel « d’écrire une notice complète sur la vie et l’œuvre de Cervantès et de la placer en tête de ma traduction ; c’était associer son nom à mon travail ; je ne pouvais souhaiter une plus complète et plus flatteuse approbation [50] ». En réalité, Mérimée ne s’y résolut qu’au terme de maintes hésitations dont l’évocation serait ici hors de propos, et il employa le plus clair des mois qui suivirent, au cours de son séjour à Cannes, à rédiger son texte.
La dernière mise au point ne put être faite qu’à Paris, que Mérimée regagna au tout début de juin 1870. Le 19 juillet, il renvoie à Hetzel un dernier jeu d’épreuves le jour même où la France déclarait la guerre à la Prusse. Ses dernières lettres, entre la fin du mois de juillet et les premiers jours de septembre, le montrent préoccupé par les premiers revers, frappé par le désastre de Sedan, accablé par la chute de l’Empire et le départ de l’Impératrice pour l’exil. Lorsqu’il retourne pour la dernière fois à Cannes, le 10 septembre, il n’est plus question de Cervantès ni de Don Quichotte dans sa correspondance : il ne lui reste plus qu’à mourir. Il faudra attendre plusieurs années pour que Hetzel fasse enfin paraître, au début de 1878, la traduction de L. Biart précédée de la fameuse notice [51]. Quelques semaines auparavant, toutefois, la Revue des Deux Mondes, dans son numéro du 15 décembre 1877, avait publié ce texte que Mérimée, dix ans plus tôt, avait accepté de rédiger [52].
En 1826, Mérimée avait intitulé sa préface Notice historique sur la vie et les ouvrages de Cervantès ; en 1878, Hetzel reprend le titre que son correspondant lui avait peut-être indiqué : Notice inédite sur la vie et l’œuvre de Cervantès. Il ajoute la précision suivante : « écrite tout spécialement pour la traduction de Don Quichotte de Lucien Biart ». Cette adjonction, même si elle n’est probablement pas de Mérimée, est conforme à une lettre du 3 août 1869, dans laquelle Mérimée disait à son éditeur ne pas vouloir, à plus de quarante ans de distance, reprendre tel quel son premier texte. De fait, celui qu’il allait lui donner, quelques semaines avant sa mort, mérite d’être qualifié de refonte : trois fois plus long que le précédent, il est aussi différemment construit. Mérimée dans les deux cas, a suivi le déroulement de la vie de Cervantès, analysant ses ouvrages au fur et à mesure de leur publication ; mais, dans la première étude, il s’était montré plus soucieux de marquer les grandes étapes d’une existence riche en événements. En revanche, la notice inédite est plus segmentée, car le récit de cette existence y alterne avec l’examen des œuvres. Les hypothèses consécutives aux lacunes de notre information, les controverses auxquelles ces hypothèses ont donné lieu reçoivent désormais une attention particulière, cependant que la dernière séquence est consacrée tout entière aux interprétations dont a fait l’objet Don Quichotte et à la signification qu’il convient de lui accorder.
Toujours aussi réservé à l’égard de la production dramatique de Cervantès, Mérimée s’appuie à nouveau sur la préface de 1615, dont il ne cite cette fois qu’une partie, après en avoir rectifié la traduction. Il s’attache davantage aux deux pièces inspirées par la captivité de leur auteur à Alger, dont il a pu se procurer des extraits, encore qu’il confonde leurs intrigues respectives. Il passe un peu plus loin en revue trois pièces de la deuxième époque, dont il traduit à sa façon deux des titres : La Entretenida (« Poisson d’avril »), El Rufián dichoso (« L’Heureux Libertin ») et Pedro de Urdemalas. Les intermèdes, que critiques et comédiens tiennent aujourd’hui en très haute estime, ne sont pour lui que des scènes décousues, pimentées qui plus est de bouffonneries grossières et assez comparables à celles que l’on peut improviser dans un château entre deux paravents.
Quant à Lope de Vega, Mérimée lui adresse les mêmes critiques que celles qu’il avait émises en rendant compte de l’ouvrage de Ticknor.
Sans vouloir attaquer la gloire de Lope – écrit-il – nous lui reprocherons d’avoir engagé le théâtre espagnol dans une voie déplorable, et cela de gaîté de cœur, sans système et sans conviction arrêtée. Lui-même écrit dans L’Art nouveau de faire des comédies : « Nul plus que moi ne mérite d’être taxé de barbarie. J’ose donner des préceptes contraires à l’art et me laisse entraîner par le courant vulgaire […]. Je poursuis cependant la voie où je suis entré, et je sais que, bien qu’elles fussent meilleures dans un autre système, mes pièces n’auraient pas eu le succès qu’elles ont obtenu. Souvent ce qui est contraire à la loi n’en plaît que davantage au goût [53].
En interprétant à la lettre les propos de Lope, Mérimée, qui passe ici sous silence le début de son épître, un exposé savant des préceptes de l’« art ancien », n’a apparemment perçu ni la fausse humilité de son auteur, ni l’ironie d’un discours destiné aux doctes et aux beaux esprits de l’Académie de Madrid, un auditoire partagé entre l’hostilité et la connivence [54]. Il s’en est pris à la fois à la théorie et à la pratique d’un poète dont la fécondité n’était à ses yeux que la marque d’un habile improvisateur. Caractères, situations, dialogues, tout est faux, estime-t-il, pour ne rien dire d’un style qui présente toutes les outrances du cultismo. La seule passion qui anime ce théâtre, concède-t-il, est celle du point d’honneur, mais on n’y trouve pas la profonde analyse des passions qu’offre Shakespeare, pourtant réputé « barbare ». Pourtant, comme l’a justement observé Marcel Bataillon, au-delà de la recherche de sources parfois incertaines, les chefs-d’œuvre de Lope et de Calderón ont éveillé en lui la sympathie avec laquelle il a su « capter une âme, en se laissant gagner par certain accent de fierté, par certaine veine picaresque dont vibrent les répliques du vieux théâtre castillan [55] ».
Mérimée a donc eu un réel plaisir à lire les chefs d’œuvre du théâtre du Siècle d’or. Il n’a pas ménagé les critiques qu’il adresse à leurs auteurs, mais il n’en a pas moins éprouvé à l’endroit de ces pièces une admiration rendue plus vive encore par le contraste qu’elles offraient à ses yeux avec l’ensemble du répertoire espagnol, production de masse née de la demande constante d’un public avide de nouveauté. Peut-être l’eût-on aimé plus explicite, plus disert aussi, sur les raisons précises de cette admiration, mais il reste qu’elle est indiscutable. Cela étant, qu’en a-t-il retenu dans le creuset de sa propre création ? Telle est la question qui se pose désormais et à laquelle j’espère pouvoir répondre dans un avenir que je voudrais proche.
Certains contemporains de Mérimée semblent avoir été frappés par la ressemblance des pièces qui composent le Théâtre de Clara Gazul avec celles des poètes dramatiques du Siècle d’or. En témoigneraient notamment deux vers de Musset que citent Jean Mallion et Pierre Salomon dans leur édition de la Pléiade :
L’un, comme Calderón et comme Mérimée,
Incruste un plomb brûlant sur la réalité [56].
Mais quelle valeur accorder à un tel rapprochement ? Certes, ainsi que l’a noté Pierre Trahard, dans les sept pièces qui composent le recueil, « Mérimée utilise les œuvres des poètes dramatiques espagnols, depuis Guillén de Castro et Tirso de Molina, jusqu’à Ramón de la Cruz et Moratín [57] ». Mais jusqu’où faut-il suivre cet éditeur quand il affirme qu’« il est aisé de dire et de prouver [qu’il] imite le théâtre espagnol [58] » ? Assurément, dans l’avertissement d’Inès Mendo ou le préjugé vaincu, il est dit que « l’auteur, qui s’est étudié à imiter les anciens comiques espagnols, n’a nullement cherché à éviter leurs défauts, tels que le trop de rapidité dans l’action, le manque de développements, etc. Il faut lui savoir gré de n’avoir pas copié aussi le style culto, si fatigant pour les lecteurs de ce siècle [59] ». Mais c’est là une façon bien étrange d’avouer une dette. De plus, outre que la connaissance qu’il a alors de ces œuvres repose essentiellement sur celles qui ont été traduites en français et que, d’autre part, ses emprunts ne se limitent pas, tant s’en faut, aux écrivains d’outre-Pyrénées, il s’agit, de l’aveu de Trahard, d’« une imitation plus ou moins fantaisiste [60] ». Que faut-il entendre par là ? Avant toute chose, qu’on ne saurait s’exagérer la portée des réminiscences textuelles relevées par l’éditeur, dès lors qu’aucune de ces pièces ne relève d’une formule assimilable à celle qu’avaient mise en œuvre Lope de Vega et ses épigones [61]. Certes, à l’instar de ses prédécesseurs espagnols, auxquels il emprunte ses épigraphes, Mérimée n’hésite ni à mélanger les tonalités, ni à contrevenir aux unités de temps et de lieu, ni à recourir à de fréquents récits et à de longs monologues. Certes, il use et abuse des rebondissements et des coups de théâtre, sans se priver d’exploiter, dans le décor d’une Espagne de fantaisie, quelques-unes des situations que la Comedia nueva avait déjà multipliées en jouant de ses ressorts de prédilection : l’amour, la jalousie, le point d’honneur. Certes, dans la quasi-totalité des œuvres rassemblées dans ce recueil, l’appel final à l’indulgence du public procède d’une convention courante dans le théâtre du Siècle d’or [62]. Cependant, en dépit du découpage de deux d’entre elles en trois journées, ni leurs dimensions, ni leur construction dramatique, ni leur rythme ne sont comparables, et le choix de la prose au lieu du vers contribue à creuser l`écart entre deux dramaturgies nettement distinctes. Aussi s’explique-t-on qu’on ait pu tenir les pièces qui forment ce recueil comme un pastiche au second degré ou, si l’on préfère, le fruit d’une distorsion systématique du cadre, des personnages, des conventions et des thèmes de la Comedia espagnole [63]. Dans ces conditions, ce qui confère au théâtre de Mérimée son originalité majeure par rapport à ses références hispaniques, ce n’est pas seulement une pratique ironique de la paraphrase, c’est, aussi et surtout, une mise à distance des modèles de conduite que le théâtre espagnol, deux siècles auparavant, avait proposés à son public : en d’autres termes, ce que Patrick Berthier appelle leur « transsubstantiation narquoise et ardente [64] ». Tel est, me semble-t-il – et pour reprendre une autre de ses formules –, le secret de la « modernité de ton et de style » de ces comédies, « que l’on peut aussi bien appeler plus traditionnellement leur accent éternel [65] ».