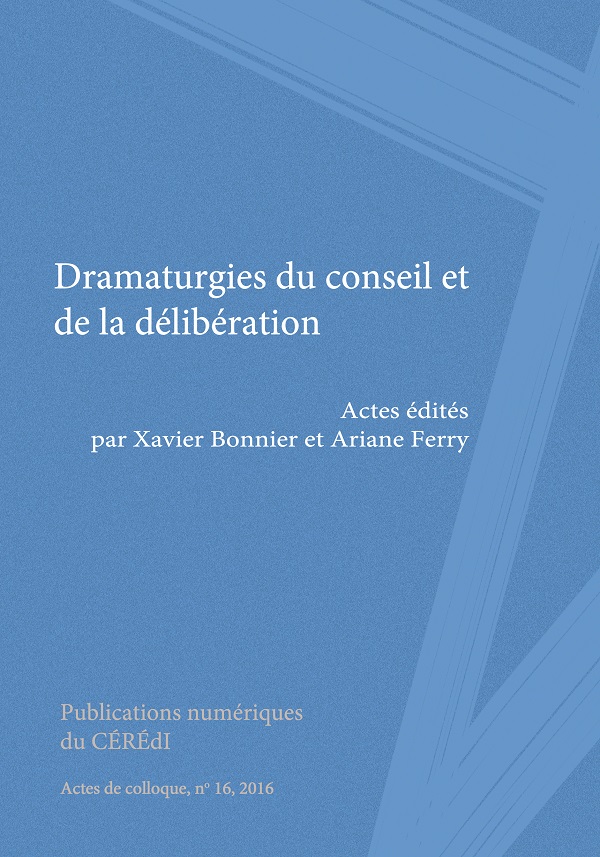Hanté par la figure de son père Claude, qui fut le favori de Louis XIII, Saint-Simon ne peut que constater la déchéance de la parole à la cour de Louis XIV : on parle pour obtenir quand on est en mesure de demander, à l’image d’un M. de La Rochefoucauld et de M. Le Grand qui bâtissent ainsi des fortunes, ou bien on regarde en silence le spectacle qui se joue sans vous. Dans l’impossibilité d’endosser un de ces rôles sans se renier, lui et le passé familial, Saint-Simon cherche une autre voie. Les Mémoires se lisent alors comme le récit d’une reconquête de la parole politique et sont émaillés d’entretiens, de conversations, de tête-à-tête dans lesquels le mémorialiste se met en scène, non sans quelques paradoxes : comment légitimer ce discours « hors-scène », potentiellement subversif et qui ressemble à s’y méprendre à celui des grands « ténébreux [1] » ? Comment expliquer l’échec quasi systématique de ces discussions, où l’interlocuteur est perpétuellement convaincu par l’argumentation de Saint-Simon, mais n’agit jamais ? Plus étonnant encore, quelle fonction dans l’économie des Mémoires ont ces très longs discours qui échouent ?
Pratiques du secret
La scène de Versailles ne pouvant accueillir le discours politique, Saint-Simon se retire « dans les marges [2] », afin de mieux pouvoir parler et les entretiens sont souvent encadrés par le récit de la mise à l’écart des devisants dans un hors-lieu [3]. En 1710, Saint-Simon raconte les circonstances qui ont précédé la rédaction du « Discours sur Monseigneur le duc de Bourgogne ». Étant allé à Vaucresson, la « retraite » du duc de Beauvillier, « inaccessible à tout le monde, excepté à sa plus intime famille et à quatre ou cinq amis au plus qui avaient la liberté d’y aller », Saint-Simon cause « tête à tête avec lui dans son jardin » et révèle au duc tout ce qu’il pense de la conduite du jeune prince. La délicatesse du sujet appelle une discrétion absolue qui amène les deux hommes à s’éloigner à plusieurs reprises de la société :
Nous ne sortîmes du jardin et de ce long tête-à-tête que lorsque le dîner fut servi. En sortant de table le duc de Beauvillier, qui avait réfléchi sur notre conversation, me pria de faire encore un tour de jardin avec lui, de lui redire encore sur Mgr le duc de Bourgogne les mêmes choses dont je l’avais entretenu avant le repas […] La conversation fut fort longue et peu contredite. Lorsqu’elle fut épuisée, il me proposa de mettre par écrit ce qu’il me semblait de la conduite de ce prince, et ce que j’estimais qu’il y dût corriger et ajouter […]. Nous nous séparâmes de la sorte pour rejoindre la compagnie dans la maison. (III, 796-797)
On retrouve une mise en scène semblable lors de la discussion avec Du Mont en 1710. La conversation ne peut commencer que lorsque Saint-Simon a attiré son interlocuteur au plus profond des jardins de Marly, « contre la palissade la plus épaisse, et dans l’éloignement des ouvertures, pour être encore plus cachés sous ces berceaux » (III, 1025-1026). La mise en scène est à la hauteur du secret révélé, puisque Du Mont apprend à Saint-Simon l’ampleur de la haine que Monseigneur, fils de Louis XIV, lui voue…
Le cabinet est un autre lieu pour discuter : Saint-Simon retrouve en 1711 le duc de Bourgogne dans le cabinet de celui-ci en passant « à la dérobée par la garde-robe » (IV, 273), en 1713, il accueille le Père Tellier dans la nuit de sa « boutique » (IV, 706), c’est-à-dire l’arrière-cabinet en entresol sans fenêtres de son appartement à Versailles. Il s’agit de ne pas être vu, ni dérangé. Le jardin comme le cabinet appellent autant l’image de la forteresse imprenable que l’imaginaire du crime. Ainsi, l’épisode de la discussion surprise par la Dauphine en 1712, raconté comme une parodie d’adultère, est fortement dramatisé par l’emploi du discours direct et par la description des signes physiques de gêne ; ce récit est également émaillé de mots renvoyant au vol : Saint-Simon s’estime « pris […] le larcin à la main » (IV, 286-287). Parce qu’elle recourt au secret, la parole politique de Saint-Simon apparaît subversive, voire criminelle, et on ne peut que songer aux analyses de Georg Simmel sur la société secrète [4].
La légitimation du discours par la mise en scène de soi
Afin de se démarquer des grands mauvais, avec qui il partage l’art des « machines », – en témoigne l’épisode de l’Intrigue du Mariage du duc de Berry –, Saint-Simon se forge un ethos de bon conseiller en employant deux subterfuges.
Le premier est de commenter sa propre énonciation. Bien souvent, les conversations débutent par une justification, ainsi la conversation avec le duc de Beauvillier au sujet du duc de Bourgogne, citée précédemment, est introduite par cette phrase : « je raisonnais souvent avec les ministres de mes amis, et des courtisans principaux qui en étaient, du triste état des affaires » (III, 796), et on retrouve le même phénomène lors de conversations avec le duc de Chevreuse dans les notices « Anecdote sur l’abbé depuis cardinal de Polignac » (II, 666-667) et « Rencontre en même pensée fort singulière entre le duc de Chevreuse et moi » (III, 380). Ces phrases introductives construisent un ethos dit [5] qui fait du mémorialiste un homme de bien, uniquement concerné par le sort du royaume : au loin les passions personnelles et les intérêts sordides qui font mouvoir ses ennemis ! Saint-Simon leur oppose un idéal de désintéressement et de charité.
Le second subterfuge employé est la multiplication des scènes de première rencontre qui créent un ethos montré. En effet, au début des Mémoires, Saint-Simon raconte comment des Grands, hommes de bien, ont eu des « coups de foudre » amicaux pour lui. Toutes ces rencontres fonctionnent de la même manière et mettent en place les mêmes motifs, comme on peut le voir avec M. le duc de Beauvillier et le chancelier Pontchartrain [6] :
Qu’il y avait vu que j’étais grand seigneur en bien comme dans le reste, mais qu’aussi je ne pouvais différer à me marier ; me renouvela ses regrets et me conjura de croire que Dieu seul qui voulait sa fille pour son épouse avait la préférence sur moi, et l’aurait sur le Dauphin même, s’il était possible qu’il la voulût épouser ; que si, dans les suites, sa fille venait à changer et que je fusse libre, j’aurais la préférence sur quiconque, et lui se trouverait au comble de ses désirs. […] La fin de l’entretien ne fut que protestations les plus tendres d’un intérêt et d’une amitié intime et éternelle, et de me servir en tout et pour tout de son conseil et de son crédit en petites et en grandes choses, et de nous regarder désormais pour toujours l’un et l’autre comme un beau-père et un gendre dans la plus indissoluble union. (I, 114)
Après un entretien fort court et fort ordinaire, il me dit qu’il avait une grâce à me demander, mais qui lui tenait au cœur de façon à n’en vouloir pas être refusé. Je répondis comme je devais à un ministre alors dans le premier crédit et dans les premières places de son état. Il redoubla, avec cette vivacité et cette grâce pleine d’esprit et de feu qu’il mettait à tout quand il voulait, que tout ce que je lui répondais était des compliments, que ce n’était point cela qu’il lui fallait, c’était parler franchement, et nettement lui accorder ce qu’il désirait passionnément et qu’il me demandait instamment ; et tout de suite il ajouta : « l’honneur de votre amitié, et que j’y puisse compter comme je vous prie de compter sur la mienne, car vous êtes très vrai, et si vous me l’accordez, je sais que j’en puis être assuré. » Ma surprise fut extrême à mon âge, et je me rabattis sur l’honneur et la disproportion d’âge et d’emplois. Il m’interrompit, et me serrant de plus en plus près, il me dit que je voyais avec quelle franchise il me parlait, que c’était tout de bon et de tout son cœur qu’il désirait et me demandait mon amitié, et qu’il me demandait réponse précise. (I, 547)
Ces deux récits montrent avec quelle insistance et quelle passion l’amitié de Saint-Simon est demandée par le duc de Beauvillier et le chancelier Pontchartrain : en rapportant les paroles du chancelier qui affirme que le jeune Saint-Simon est un homme « très vrai », Saint-Simon se construit un ethos d’homme véritable, or l’aretè, la vertu, est une des qualités du bon conseiller. De fait, le lecteur sera toujours amené par la suite à considérer que la vérité est du côté de Saint-Simon, dans une sorte de conditionnement du lecteur, déjà remarqué par Marie-Paule de Weerdt-Pilorge [7].
Entouré d’hommes puissants, Saint-Simon endosse petit à petit le rôle de conseiller du prince et la variété des thèmes abordés montre l’étendue de ses connaissances [8] : stratégie politique quand il s’agit de sauver des ministres en péril, cérémonial, politique intérieure et politique étrangère… Il n’est point question ici de commenter les vues du mémorialiste : ces dernières ont été pendant longtemps sujettes à moqueries, mais les travaux de Corrado Fatta et de Christophe Blanquie ont montré que la « politique » de Saint-Simon n’était pas si extravagante ni si décalée des grandes réflexions de son temps [9]. Pourvu du savoir, motivé par le bien, Saint-Simon ne peut être considéré comme un « mauvais conseiller » et pourtant, il est toujours écouté mais jamais entendu…
Scènes de violences délibératives
Saint-Simon, notamment à la fin des scènes de première rencontre, ne cesse de souligner le paradoxe de sa situation : il n’est de rien, mais ses puissants amis l’initient à tout ; évoquant le duc de Beauvillier, il note l’aspect « incompréhensible » de leur « confiance si intime » alors que l’« extrême différence d’âge » et le « caractère secret, isolé, particulier et si mesuré, ou plutôt resserré » (III, 121) du duc la rendait impossible ; de même à propos de Pontchartrain, il indique que c’est « une chose singulière » que « l’amitié intime entre deux hommes si inégaux en tout » (I, 547-548). Saint-Simon devient à la fois l’ami et le conseiller secret de ces hommes puissants, et on peut se demander à quel point ce double rôle parasite les interactions, puisque les scènes de conseil sont marquées par une profonde violence.
Si la figure du conseiller sage est une topique du discours des mémorialistes depuis Commynes [10], Saint-Simon peine néanmoins à s’inscrire dans cet éthos catégoriel [11] qui se caractériserait par la prudence et la déférence, dans la mesure où la relation de conseil est asymétrique, le conseiller étant au service du Grand ; or, Saint-Simon, si soucieux des convenances et des cérémonies, semble oublier la hiérarchie sociale dans ces scènes de conseil : mieux, il le justifie au nom de la « confiance », de la « liberté » et de la « tendresse » qu’il a inspirées au duc de Beauvillier ou au chancelier Pontchartrain. Ainsi le conseil politique prend les accents de la conversation privée, créant l’illusion de la parrhèsia, de la liberté de tout dire.
Deux conversations avec le duc de Beauvillier montrent le décalage grandissant entre Saint-Simon et les attendus de son rôle. La première conversation a lieu en 1698 et présente une situation de conseil que l’on pourrait qualifier de normale :
Il ignorait ce dernier et extrême danger ; personne n’avait osé lui en montrer le détail ; il ne le voyait qu’en gros. Je me résolus donc à le lui faire toucher, et à ne lui rien cacher de tout ce que j’avais découvert et que je viens d’écrire. J’allai donc le trouver, j’exécutai mon dessein dans toute son étendue, et j’ajoutai, comme il était vrai, que le roi était fort ébranlé. Il m’écouta sans m’interrompre et avec beaucoup d’attention. Après m’avoir remercié avec tendresse, il m’avoua que lui, son beau-frère et leurs femmes s’apercevaient depuis longtemps de l’entier changement de Mme de Maintenon, de celui de la cour, et même de l’entraînement du roi. [Beauvillier déclare ensuite à Saint-Simon vouloir laisser son destin entre les mains de Dieu] Il m’embrassa avec tendresse, et je m’en allai si pénétré de ces sentiments si chrétiens, si élevés et si rares, que je n’en ai jamais oublié les paroles, tant elles me frappèrent, et que si je les racontais à cent fois différentes, je crois que je les redirais toutes et dans le même arrangement que je les entendis. (I, 486-487)
Saint-Simon se présente dans ce passage comme un bon conseiller dans la mesure où, dans un moment de crise, il est le seul à avoir le courage de parler. La conformité de pensée des deux interlocuteurs autorise la liberté de parole, qui plus est cette dernière trouve pour réponse la « tendresse » : cela montre que la conversation est perçue comme plus amicale que politique. La décision du duc de Beauvillier de s’en remettre à Dieu étonne Saint-Simon. Le savoir mondain du conseiller ne peut alors que s’effacer devant un savoir plus haut et la scène de conseil se transforme en expérience du sublime chrétien. Le ton change en 1708. À nouveau menacé, le duc de Beauvillier va être averti par Saint-Simon de ce qui le guette :
Tandis que nous raisonnions de la sorte, le duc de Beauvillier courait un grand et imminent danger. Il n’en avait pas le plus léger soupçon. Ce fut merveille comme je l’appris et comment il fut paré si à propos qu’il n’y avait pas une heure à perdre. […] Je ne perdis par un instant, les moments étaient chers. [Saint-Simon fait chercher partout le duc de Beauvillier et le convoque dans sa chambre] En moins de demi-heure M. de Beauvillier arriva, assez inquiet de mon message. Je lui demandai s’il ne savait rien, je le tournai, moins pour le pomper, car je n’en avais pas besoin avec lui, que pour lui faire honte de son ignorance, qui si souvent l’avait jeté dans des panneaux et des périls, et pour le persuader mieux après de ce que je voulais qu’il fît. Quand je l’eus bien promené sur son ignorance, je lui appris ce que je venais de savoir. Mon homme fut interdit. Il ne s’attendait à rien moins. […] Je pris la liberté de le gronder de sa profonde ignorance de tout ce qui se passait à la cour, et de cette charité malentendue qui tenait ses yeux et ses oreilles de si court, et lui si renfermé dans une bouteille. […] Enfin, j’osai lui dire qu’il s’était mis en tel état avec le roi, par ne vouloir s’avantager de rien, qu’il ne tenait plus à lui que par l’habitude de ses entrées comme un garçon bleu, mais que, puisqu’il y tenait encore par-là, il fallait du moins qu’il en tirât les avantages dans la situation pressante où il se trouvait. Il me laissa tout dire, ne se fâcha point, rêva un peu quand j’eus fini, puis sourit et me dit avec confiance : « Eh bien ! Que pensez-vous donc qu’il y eût à faire ? » C’était où je le voulais. Alors je lui répondis que je ne voyais qu’une chose unique à faire, laquelle était entre ses mains, et du succès de laquelle je répondrais bien, au moins pour lui, s’il voulait prendre sur lui de la bien faire, si même elle n’empêchait Harcourt d’entrer au conseil. (III, 383-386)
Cette scène nous montre un conseiller manipulateur qui, pour mieux mettre en avant son savoir, souligne cruellement l’ignorance de son interlocuteur : il s’agit de « lui faire honte », de « prendre la liberté de le gronder de sa profonde ignorance » et de « sa charité malentendue », voire d’oser le comparer à un « garçon bleu », c’est-à-dire à un domestique, tout en suggérant son incapacité à « bien faire ». L’attitude de Saint-Simon est particulièrement transgressive : le conseiller abandonne toute déférence [12] pour son interlocuteur qui perd littéralement la face [13]. Sûr de son savoir, Saint-Simon domine l’autre, s’empare de la décision et donne ses ordres pour l’action à exécuter : la relation de conseil a clairement disparu, il s’agit moins de délibérer, de trouver en commun l’action juste à entreprendre que de contraindre l’autre à s’en remettre complètement au « conseiller ». Le dialogue devient alors un monologue où se déploie un imaginaire de la force : la parole politique est d’abord une violence faite à autrui et on ne peut être que sensible à l’emploi de nombreuses métaphores militaires [14] ou de verbes comme « presser », « serrer la mesure », « tonneler » ou « réduire » dans les divers entretiens.
La conséquence fréquente du manque de déférence est la perte de tenue [15] des interlocuteurs : si Saint-Simon s’étonne que le duc de Beauvillier « ne se fâcha point », c’est que d’ordinaire la conversation de Saint-Simon aboutit à des manifestations violentes de malaise, qui sont d’autant plus spectaculaires que la société du XVIIe siècle exige une totale maîtrise de son corps. On en trouve de nombreux exemples lors des conversations avec le duc d’Orléans, notamment au moment des Argentonnes, ces trois grands entretiens pendant lesquels Saint-Simon veut le convaincre d’abandonner sa maîtresse [16] ou, pendant la régence, lors de cet entretien au sujet de Dubois :
L’impression de ce vif et trop vrai raccourci de la conduite de l’abbé Dubois, si pourpensée et si bien suivie, frappa le régent au-delà de ce que je l’ai jamais vu. Il s’appuya les coudes sur la table qui était entre lui et moi, se prit la tête entre ses deux mains et y demeura quelque peu en silence, le nez presque sur la table. C’était sa façon quand il était assis et fort agité. Enfin il se leva tout à coup, fit quelques pas sans parler, puis se prit à se dire à soi-même : « Il faut chasser ce coquin. – Mieux tard que jamais, repris-je ; mais vous n’en ferez rien. » Il se promena un peu en silence avec moi. Je l’examinais cependant, et je lisais sur son visage et dans toute sa contenance la vive persuasion de son esprit, même de sa volonté, combattue par le sentiment de sa faiblesse, et de l’empire absolu qu’il avait laissé prendre sur lui. Il répéta ensuite deux ou trois fois : « Il faut l’ôter » et comme l’habitude me le faisait connaître très distinctement [17], je croyais à son ton et à son maintien entendre tout à la fois l’expression la plus forte d’une nécessité instante et de l’insurmontable embarras d’avoir la force de l’exécuter. (VII, 756)
Les silences, les plaintes, les mimiques du visage et les gesticulations, c’est-à-dire tout ce qui montre que le « maintien » et la « contenance » de l’autre ont disparu, sont scrutés, analysés, guettés. Néanmoins, tous ces signes chez l’interlocuteur ne sont jamais interprétés comme la conséquence de la mauvaise tenue du rôle de conseiller par Saint-Simon, bien au contraire : le mémorialiste, certain de bien tenir son rôle, les rapporte comme les preuves évidentes du progrès de la Vérité dans l’esprit de son destinataire. Figurant le duc d’Orléans dans « les douleurs de l’accouchement » (VI, 233), Saint-Simon renoue avec la tradition antique du conseil comme pharmakon [18], tout aussi bien poison que médicament, et il est notable qu’une des premières anecdotes du portrait du duc d’Orléans en 1715 montre Saint-Simon rétorquant au prince : « Je suis ravi de vous voir en colère, c’est le signe que j’ai mis le doigt sur l’apostume ; quand on la presse, le malade crie. Je voudrais en faire sortir tout le pus, et après cela, vous seriez tout un autre homme et tout autrement compté. » (V, 235-236) Le conseil politique est un violent purgatif dans l’imaginaire de Saint-Simon, une cure de choc qui contrevient néanmoins à l’idéal de discrétion du conseiller prudent que l’on peut trouver par exemple chez Balthasar Gracián :
Elle [la vérité] est dangereuse, mais pourtant l’homme de bien ne peut se laisser de la dire ; et c’est là qu’il est besoin d’artifice. Les habiles médecins de l’âme ont essayé tous les moyens de l’adoucir, car lorsqu’elle touche au vif, c’est la quintessence de l’amertume. La discrétion développe là toute son adresse : avec une même vérité elle flatte l’un et assomme l’autre. […] Les Princes ne se guérissent pas avec des remèdes amers ; il est de la prudence de leur dorer la pilule [19].
Les conseils de Régence ou le spectacle de la vérité
À la mort de Louis XIV, la parole de Saint-Simon est libérée. Les tête-à-tête secrets se font plus rares et sont beaucoup moins dramatisés. La notice « Je propose au Chancelier la réforme de quelques troupes distinguées » en 1717 en est un parfait exemple. Il s’agit d’un mémoire de six pages, encadré par des verbes introducteurs de parole : « j’allai voir le Chancelier en particulier. Je lui dis que je venais lui communiquer une pensée » (VI, 421) et « Le Chancelier goûta infiniment toutes ces raisons » (VI, 425) ; entre ces deux lignes, pas de discours direct, pas de tour de parole, pas d’observation du comportement de l’interlocuteur : la discussion n’est plus que l’habillage d’un exposé politique assez austère.
Les entretiens avec le duc d’Orléans, devenu le régent, conservent une partie des caractéristiques scénographiques de la période précédente : Saint-Simon se montre toujours aussi offensif et le régent toujours aussi accablé, mais les entretiens ont perdu leur dimension secrète et ils relèvent de la routine [20]. Durant cette période, il n’y a guère que l’entretien à l’opéra en 1717 ou les conversations précédant le lit de justice en 1718 qui conservent le décorum du secret.
En revanche, l’instauration de la polysynodie offre une nouvelle scène à la parole de Saint-Simon qui regagne ainsi l’espace public. Un des premiers conseils fait l’objet d’un long récit en 1715, alors que l’objet même de ce conseil peut paraître anecdotique puisqu’il s’agit d’attribuer les « dépouilles » de la Petite Écurie, soit à M. le Grand, soit à M. le Premier. Fait notable, Saint-Simon inaugure ce conseil en déposant au milieu de la table un mémoire écrit par son père, le duc Claude, parangon du conseiller juste et « l’homme de confiance du roi » (I, 71) [21]. Par ce geste, Saint-Simon signifie aux autres conseillers que cette délibération sera une recherche du vrai. Or, les différents conseillers présents manifestent leur incapacité à prendre une décision juste par l’impossibilité de donner une tenue à leur discours : Bezons « barbouilla et proposa une cote mal taillée » (V, 710), Estrées « parla longtemps sans rien dire », le maréchal de Villeroi « barbouilla encore je ne sais quoi d’indécis », d’Antin « bégaya plus qu’à l’ordinaire » (V, 711), Harcourt « s’énonçait avec difficulté », Villars « pouffa », Noailles, paraissant comme « chat sur braise », « produisit un long verbiage », « tenta un avis équivoque de cote mal taillée », tout comme le Chancelier. La parole mal maîtrisée des autres conseillers montre qu’ils ne sont pas capables de « parler en conscience », ce qui oblige Saint-Simon à leur dire, au discours direct : « cela n’est pas avoir un avis », et à reprendre toute l’affaire :
Je discutai tous les points de prétention […] ; j’exposai plusieurs changements arrivés […] ; je m’étendis sur la séparation et l’indépendance des deux écuries […]. Enfin je montrai toute la force que la cause de Monsieur le Premier tirait du compte rendu à mon père de la dépouille de la Petite Écurie, et je conclus distinctement après sur tous les points. (V, 711)
Vérité, clarté et exhaustivité sont les principes fondamentaux de la parole du bon conseiller mais également le courage : en effet, le régent tendant lui-même « à une cote mal taillée », Saint-Simon lui fait une remontrance publique en lui rappelant l’existence du mémoire de son père. Saint-Simon note ensuite : « ce mot, dit un peu ferme, frappa tout le monde. Les balbutieurs ne surent qu’y opposer. Ils haussèrent les épaules, et d’une voix assez basse convinrent que la dépouille devait appartenir au premier écuyer » (V, 713). L’avis oral est alors immédiatement porté à l’écrit qui conservera « le fond inaltérable de l’arrêt » ; si le conseil aboutit à une décision juste, Saint-Simon se méfie des falsifications [22] qui peuvent être entreprises, ainsi le conseil est écrit et relu avec attention :
Il [Torcy] se mit donc à écrire ; puis il dit tout haut chaque chef comme il l’allait écrire avant de le mettre sur le papier. J’eus soin sur chacun de dire tout haut comme il avait passé, quand Torcy paraissait douter, comme il lui arriva souvent, apparemment pour être plus assuré de ce qu’il écrirait. Personne ne dit mot, même le Régent, tellement que plusieurs du Conseil dirent que j’avais fait et dicté l’arrêt. Torcy, après avoir achevé, lut tout haut ce qu’il venait d’écrire, qui fut approuvé de tous à la fois sans ordre d’opinion, et cependant La Vrillière, ami intime du Premier écuyer, écrivait aussi sur le registre du Conseil, qui leva aussitôt après que Torcy eut achevé de lire et eut signé ce qu’il avait écrit. (V, 714)
La décision prise, certifiée par plusieurs lectures à voix haute et par deux versions écrites, Saint-Simon met en scène la diffusion publique de l’avis. En effet, à la sortie de ce conseil se tient un familier du Premier Écuyer, des Épinais, dépeint « plus mort que vif » et « comme un homme à demi-mort », attendant d’apprendre « le sort de l’affaire » :
Le comte de Toulouse avec son froid lui répondit que M. de Torcy le lui apprendrait. Des Épinay insista comme un mendiant. La pitié m’en prit, et du premier écuyer qui l’avait envoyé. Je dis au comte de Toulouse : « Pourquoi le faire languir pour un secret qui va être public dans quatre ou cinq minutes ? » Tout de suite je me tournai à des Épinay et lui dis : « Allez, monsieur des Épinay, M. le Premier a gagné en plein : indépendance, dépouille, en un mot, tout sans exception. » Cet homme, qui était vieux, et le même qui du temps du roi était attaché au carrosse de Mme de Maintenon, se jeta à mes genoux, me dit d’une voix faible et entrecoupée que je lui rendais la vie, qu’il l’allait rendre à M. le Premier, et vola à l’instant par le degré, que nous le perdîmes de vue que nous n’étions qu’à la troisième marche. (V, 714)
Le passage joue avec le pathétique : l’état de peine du personnage, son grand âge et sa fidélité au Premier écuyer, sa posture de suppliant mettent en valeur la dimension salvatrice de la parole de Saint-Simon avec le motif de la résurrection. La décision juste est ensuite diffusée de manière indirecte, aux intéressés d’abord puis au grand public. Des Épinais part prévenir le Premier écuyer ainsi que ses amis et avec un peu de coquetterie, Saint-Simon écrit :
Le premier écuyer ne tarda pas à me venir remercier dès que je fus à Paris. Je ne sais par qui il avait su jusqu’au dernier détail de tout ce qui s’était passé au jugement de son affaire ; j’imaginai que ce fut par La Vrillière. Beringhen en transissait encore, et me répéta bien des fois que je lui avais sauvé sa charge et sa fortune, et plus que cela, l’honneur et la vie ; qu’il me devait tout cela, et que lui et les siens ne l’oublieraient jamais. Je dois cette justice à M. le Grand, et à M. le prince Charles, son fils, qu’ils ne me surent pas le moindre mauvais gré ; qu’il ne leur est jamais depuis rien échappé à mon égard ; et qu’ils ne m’ont jamais donné le plus léger soupçon qu’ils n’aient pas été satisfaits de toute ma conduite ; et que tout ce qui tenait à eux les a imités en cela. (V, 715)
La bonne délibération apaise les conflits, puisque les perdants n’éprouvent ni haine ni colère contre le conseiller, tandis qu’elle lui attire la reconnaissance des gagnants et l’approbation du public. Un peu plus tard dans la chronique, l’affaire de l’intendant Courson en 1717 (VI, 406-410) reprendra exactement la même mise en scène de la parole juste.
La plupart des scènes de conseils de Régence suivent donc ce schéma avec parfois quelques variantes ; ce n’est pas toujours avec un discours construit que Saint-Simon gagne son procès, mais parfois avec un bon mot, la vérité et la justice étant du côté des rieurs. En 1720, le bruit public contre l’entrée du duc de Berwick au conseil de Régence semble annulé par le bon mot de Saint-Simon à propos du chat de Louis XV, qui avait suivi son maître : « Eh ! Monsieur, laissez ce petit chat, il fera le dix-septième » (VII, 610) ; en effet, « pour ce qui se passait alors au Conseil de régence, n’importait plus qui en fût » ; le jeune roi goûte la plaisanterie, « qui courut Paris aussitôt », et il n’est plus question dans le récit des plaintes du public. Cette attitude de Saint-Simon est particulièrement fréquente face au duc de Noailles et la notice « Conduite du duc de Noailles avec moi et moi avec lui » (V, 868-872) est un florilège de ces scènes de délibérations qui se transforment en « spectacle » comique.
Quel sens donner à des délibérations inutiles ?
Saint-Simon ne cesse d’affirmer qu’il convainc ses interlocuteurs, néanmoins peu d’entre eux agissent selon ses vœux. Si le duc de Beauvillier accepte de suivre les conseils de Saint-Simon en 1709, en dépit de la manière particulièrement humiliante avec laquelle ils ont été prodigués, Saint-Simon émet un doute quant à la nécessité et à l’efficacité exacte de cette démarche : « De savoir si, sans cela, il était chassé ou non, c’est ce que je n’ai pu découvrir ; mais par le peu qui me fut dit, […] j’en suis presque persuadé. » (III, 387-388) Le caractère essentiellement préventif des entretiens de Saint-Simon ont la fâcheuse tendance à faire basculer l’efficacité du discours dans le domaine de l’imaginaire : le conseil permet a priori de maintenir un statu quo dans la réalité, mais le danger comme les conséquences possibles relèvent de la fiction, la parole de Saint-Simon n’est efficace que parce que des événements ne se réalisent pas…
À partir de la Régence, on assiste à une interminable déconfiture de la parole politique, d’où une mise en scène du conseiller en prophète, comme on peut le voir par exemple dans la notice « Je prédis en plein Conseil de régence que la Constitution deviendra règle et article de foi » en 1717 :
Je ne fus pas de l’avis de M. de Troyes ; il s’anima ; nous disputâmes tous deux ; il s’abandonna tellement à ses idées que je lui répondis brusquement que dans peu la constitution ferait une belle fortune, parce que je voyais que de proche en proche elle parviendrait bientôt à devenir dogme et article de foi : là-dessus voilà M. de Troyes à s’exclamer à la calomnie, et que je passais toujours le but […]. Quand il eut bien crié, je regardai tout le conseil, et je dis : « Messieurs, trouvez bon que je vous prenne tous ensemble et chacun en particulier à témoin de tout ce que je viens de prédire sur la fortune de la constitution, de tout ce que M. de Troyes a répondu, combien il s’est étendu à prouver qu’il est impossible par sa nature qu’elle puisse jamais être proposée en article, dogme, ou règle de foi, et qu’on s’en moque à Rome, et de me permettre de vous faire souvenir de ce qui se passe ici aujourd’hui quand la constitution aura fait enfin cette fortune comme je vous répète que cela ne tardera point à arriver. » M. de Troyes cria de nouveau à l’absurdité : pour n’en pas faire à deux fois, au bout de six mois, et même moins, je fus prophète. (VI, 138-140)
Incapable de faire voir à ses interlocuteurs le vrai et le bon, Saint-Simon prend acte du décalage qui s’est instauré entre sa parole et le cours des événements par la prophétie. En effet, la prédiction est un acte de langage qui engage à la fois le locuteur, qui revendique un discours véridique, et l’interlocuteur, qui est témoin et en quelque sorte garant du désaccord exprimé. Ici, le projet de la Constitution est jugé tellement monstrueux que la prédiction est rappelée devant le Conseil, pris à nouveau comme témoin ; et comme le public que constitue le Conseil ne suffit pas, il faut répandre dans le monde ce refus et Saint-Simon en organise lui-même la propagation dans le public :
Dès que cette opinion commença à se montrer à découvert avec autorité, je ne manquai pas de faire souvenir en plein conseil de régence de ma prophétie, et des exclamations de M. de Troyes ; puis, me tournant vers lui, je lui dis avec un souris amer : « Vous m’en croirez, monsieur, une autre fois ! Oh bien, ajoutai-je, nous en verrons bien d’autres. » Personne ne dit mot, ni le régent non plus. Je ne vis jamais homme si piqué ni si embarrassé que M. de Troyes, qui rougit furieusement, et qui la tête basse ne répondit pas un seul mot. Ces deux scènes firent chacune quelque bruit en leur temps ; elles ne tenaient en rien au secret du conseil, je ne me contraignis pas de les rendre, ni plusieurs du conseil de régence non plus. M. le duc d’Orléans ne le trouva point mauvais : il fit semblant, ou crut en effet que j’allais trop loin comme M. de Troyes, et fut ou fit le semblant d’être fort surpris quand ma prophétie se vérifia. (VI, 139)
La posture prophétique figure la défaite du conseiller puisque la délibération a pour but de modifier le futur, or la prophétie est par essence l’affirmation d’un avenir qui ne peut être changé. Le mémorialiste nous offre alors une vision pessimiste de l’action politique, perpétuellement dérangée par le cours de l’Histoire : le duc de Bourgogne est censé être le prince qui relèvera la monarchie, mais il meurt trop tôt, emporté par la maladie ; le mariage du duc de Berry, si nécessaire, ne servira à rien et sera source de nombre de dégoûts pour le couple Saint-Simon comme pour le prince ; la Régence apparaît comme une suite d’iniquités, avec l’affaire de la bulle Unigenitus et la banqueroute de Law… Dans ces conditions, l’action politique devient presque inutile. Dès 1718, Saint-Simon semble désabusé, et voyant son projet de suppression de la gabelle « avorter », il note : « Cette occasion m’arrache une vérité que j’ai reconnue pendant que j’ai été dans le Conseil, et que je n’aurais pu croire si une triste expérience ne me l’avait apprise : c’est que tout bien à faire est impossible. » (VI, 582)
De fait, les Mémoires de Saint-Simon accumulent des entretiens qui n’aboutiront qu’à des échecs, qui ne sont pas cachés mais au contraire exhibés. Il est frappant de voir que ces scènes de conseil sont un élément caractéristique de l’écriture des Mémoires. Quand, en 1739, Saint-Simon commence leur rédaction, il n’en est pas à son coup d’essai « autobiographique ». Auparavant, il a annoté le Journal de Dangeau de 1729 à 1738, puis il a rédigé la Note « Saint-Simon » des Duchés-pairies entre 1735-1737 : or, aucun de ces textes ne présente des scènes de conseil aussi dramatisées et aussi longues que celles des Mémoires. Par exemple, les « Argentonnes », qui occupent presque soixante pages dans les Mémoires, se condensent en une page dans la Note : Saint-Simon n’a pas jugé bon d’écrire l’intégralité de son raisonnement et tous les éléments de mise en scène abondamment commentés dans les Mémoires sont résumés en une seule phrase : « le combat fut étrangement violent, et Bezons a souvent dit à ses amis qu’il en perdait quelquefois connaissance, et qu’il croyait quelquefois que le plancher allait fondre sous eux aux fortes attaques du duc de Saint-Simon [23]. » De la même manière, la plupart des conseils de Régence n’apparaissent pas dans la Note.
Il faut donc considérer que ces scènes de délibération ont une place importante dans l’économie des Mémoires. Pour la plupart des critiques, ces scènes permettent à Saint-Simon d’exprimer sa vision catastrophiste de l’Histoire, conçue comme une longue « débâcle [24] » : la mise en scène de l’échec de la parole politique permet à l’écriture historique de justifier a posteriori la vérité détenue par Saint-Simon et la fin des Mémoires en 1723, qui coïncide avec son retrait de la vie politique, favorise cette lecture des Mémoires comme compensation, pansement narcissique en attendant l’ultime reconnaissance de la postérité [25]. Cette interprétation des Mémoires, juste au demeurant, occulte néanmoins le fait que Saint-Simon a eu la possibilité de quitter le rôle de conseiller pour être dans l’action : il déclare à Noailles en 1715 qu’il pourrait être premier ministre s’il le demandait au régent et il refuse en 1719 d’être gouverneur du jeune Louis XV, puis d’être garde des sceaux en 1720 pour conserver son rôle de conseiller du Prince. Saint-Simon fait donc le choix de l’influence contre celui de la puissance comme le fait remarquer Christophe Blanquie [26].
Les Mémoires ne sont donc pas uniquement écrits dans une optique compensatoire mais peuvent aussi être lus comme une réflexion sur le rôle du conseiller, en particulier dans des temps où il n’a plus de place. En effet, « si tout bien est impossible », « cette affligeante vérité » n’est telle que « dans un gouvernement comme le nôtre depuis le cardinal Mazarin » (VI, 583), c’est-à-dire dans un gouvernement dénaturé, soit parce que le Prince n’est accessible à personne (Louis XIV), soit parce que il est accessible à tous (le régent). Les Mémoires de Saint-Simon sont un « miroir des conseillers ». Saint-Simon nous montre sans fards les sacrifices et les dégoûts auxquels il s’est exposé dans cette fonction. En premier lieu, le malheur de n’être pas cru, ni suivi : le conseiller n’obtient que des « promesses de décisions [27] » et l’accomplissement de l’action est laissé à la discrétion de l’interlocuteur ; le conseil ou l’avis peut alors être détourné ou perverti [28]. Face à cette possibilité, Saint-Simon prône une forme de retrait, d’abstention, comme au moment de la bulle Unigenitus :
Je me contentai d’avoir convaincu, et puis je laissai faire, sans courir ni recommencer à raisonner avec un prince que je savais circonvenu de façon que sa facilité et sa faiblesse serait incapable de résistance. (VI, 234)
La responsabilité de l’action incombe au Prince, l’important pour le conseiller est de dire la vérité car il répond de ses paroles à d’autres, comme Saint-Simon le déclare crûment au régent en 1717 :
Quelque attaché que je vous sois, sitôt que je suis en place assis au Conseil, j’y dois ma voix à Dieu et à l’État, à mon honneur et à ma conscience, c’est-à-dire à ce que je crois de plus sage, de plus utile, de plus nécessaire en matières d’État et de gouvernement, ou de plus juste en autres matières, sur quoi ni respect, ni attachement, ni vue d’aucune sorte ne doit l’emporter. (VI, 157)
Cette phrase fait écho à la description du duc de Noailles, le mauvais conseiller par excellence, quelques pages plus loin, « un homme qui n’a ni religion, ni honneur, et qui jusqu’à toute pudeur l’a perdue, quand il croit y trouver le plus petit avantage » (VI, 225). Avant même d’être en relation avec le Prince, le conseiller se place sous la triple garde de Dieu, du public et de sa propre conscience, ce qui garantit son désintéressement, l’une des valeurs cardinales du conseiller. Si Saint-Simon craint parfois de fléchir, de céder à ses passions personnelles [29], il se présente comme un homme impartial, sachant au besoin faire taire ses haines, en soutenant parfois les projets de certains ennemis [30].
C’est dans ces scènes de conversation qu’un trait d’écriture particulier aux Mémoires de Saint-Simon se fait sentir, et que Marc Hersant décrit ainsi :
L’opposition pour nous si fondamentale entre le temps de l’énonciation et le temps des événements racontés fait plus que vaciller. Le temps qui s’est écoulé entre ce qui s’est autrefois produit et le moment où Saint-Simon le raconte est à la fois l’objet principal du récit, et ce que le discours nie le plus profondément [31].
Il est particulièrement frappant de voir que si les scènes de conversation sont racontées au temps du récit, les manchettes qui les présentent sont dans un présent à la valeur ambiguë, historique ou d’énonciation [32] : ce télescopage des temps donne effectivement l’impression que Saint-Simon revit ces scènes de conseil, alors que tout est déjà joué depuis longtemps, phénomène renforcé par l’usage du discours direct de plus en plus fréquent et plus étendu pendant la Régence. Les scènes de délibération ont une autre vocation que de simplement exposer les opinions politiques du mémorialiste, elles servent également à affirmer la permanence des valeurs de Saint-Simon, « immuable comme Dieu » (VI, 587). En se mettant en scène en conseiller véritable, pourvu d’une parole libre, courageuse et authentique, Saint-Simon appelle le lecteur à le considérer aussi de fait comme un historien véridique : l’ethos du conseiller nourrit l’ethos de l’historien qui, dans l’introduction, est celui d’« un homme droit, vrai, franc, plein d’honneur et de probité, et fort en garde contre les pièges du sentiment, du goût et de l’imagination » (I, 7). Les scènes de délibération et de conseil ont donc pour fonction de souligner la parenté éthique entre le conseiller du prince et l’historien, ce qui fait que le combat politique pour le bien rejoint l’écriture du vrai dans un même élan de lutte contre la tragédie des temps.