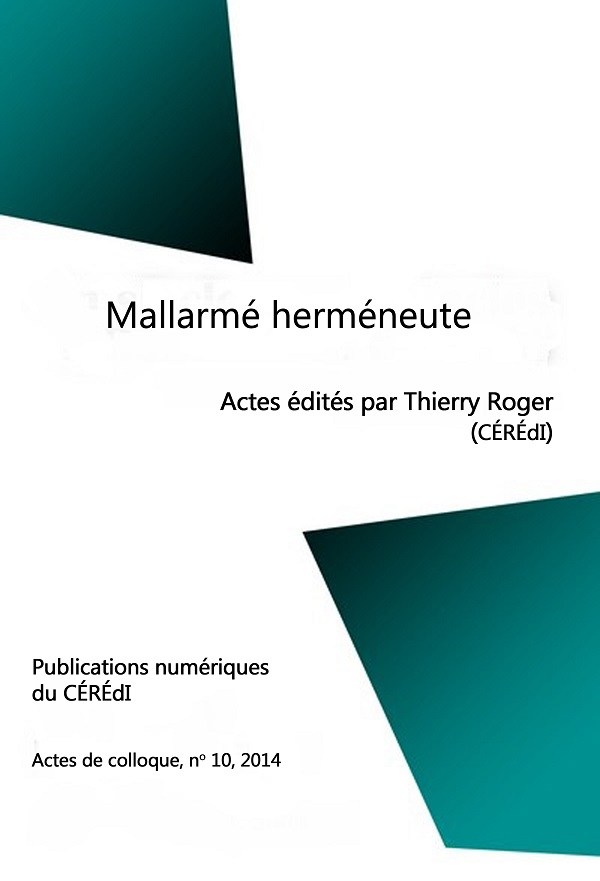L’expression adoptée ci-dessus en guise de titre fait signe – c’est bien le cas de le dire – en direction du compte rendu de l’édition originale d’Igitur que Paul Claudel rédige à Tokyo en avril 1926 pour la Nouvelle Revue Française, quelques semaines après la parution de cet ensemble de fragments au sujet duquel il a cette comparaison si forte et si juste d’y voir quelque chose comme « le talon qui reste d’un livre de chèques, quand toutes les feuilles, dûment enrichies de chiffres et de noms, ont été portées à la banque [1] ». On sait que dans cet article très riche, et magnifiquement intitulé « La catastrophe d’Igitur », Claudel campe son vieux maître, parmi d’autres figures, en « Parisien ironique et rusé à la Degas » doublé, insiste-t-il, d’« un professeur d’attention [2] ». Par une sorte de mimétisme avec la syntaxe et la typographie des Divagations, Claudel fait de cette dernière expression le contenu entier et tout nominal d’un abrupt paragraphe servant de jointure entre deux longs développements. La signification que cette expression se déduit du contexte où elle intervient, mais se trouve plus explicitement clarifiée par d’autres interventions de Claudel au sujet du maître d’école de la rue de Rome. Ainsi, déclarera-t-il en 1951, « quand on me demande mes souvenirs sur Stéphane Mallarmé, ma réponse est toujours celle-ci : c’est l’homme qui m’a appris à me placer devant tout objet offert à mon imagination avec cette question : Qu’est-ce que cela veut dire ? Il ne s’agit pas de peindre, il s’agit d’interpréter [3]. » Nous voici de plain pied avec la problématique d’une herméneutique littéraire généralisée. Je réserve pourtant à ma conclusion la question de savoir si cette leçon dispensée par son « professeur d’attention », Claudel l’a bien entendue, ou s’il ne lui pas donné la direction qui lui convenait. Car c’est par une autre entrée du même article que je voudrais embrayer véritablement mon propos et, plus précisément, par cette autre image que « La catastrophe d’Igitur » livre de l’auteur des Poésies et des Divagations : celle d’un « homme d’intérieur ».
Aux yeux de Claudel, si « Arthur Rimbaud fut un mystique à l’état sauvage, une source perdue qui ressort d’un sol saturé [4] », ainsi qu’il l’avait écrit en 1912, Mallarmé apparaît, quant à lui, comme une sorte de mystique en chambre. Un mystique athée en son cas, dont la sève symbolique se serait retirée dans ce même sol saturé, mais sans espoir aucun de remontée. « Au-dehors, écrit magnifiquement Claudel, il n’y a que la nuit sans espérance. Ce n’est même pas la peine de soulever les rideaux et de regarder par la fenêtre. Mais, comme le commandant du navire dans son blockhaus tout garni d’organes de renseignements et de direction, le suprême Hamlet au sommet de sa tour, succédant à deux générations d’engloutis, tandis que l’inexorable nuit au dehors fait de lui pour toujours un homme d’intérieur, s’aperçoit qu’il n’est entouré que d’objets dont la fonction est de signifier qu’il est enfermé dans une prison de signes [5]. » Voici donc l’expression qui nous intéresse, bien que Claudel la modifie une page plus loin en troquant le mot de « prison » pour celui de « cabinet » et en ornant d’une majuscule la seconde occurrence desdits « signes », Mallarmé devenant ainsi, en un second temps, « le reclus du cabinet des Signes [6] ». De cette « prison » à ce « cabinet » et de ces « signes » aux « Signes », y a-t-il simple synonymie ou solution de continuité ? Je laisse aux spécialistes de Claudel le soin d’en débattre. Prison ou cabinet, signes avec ou sans majuscule importent moins de toute façon que l’interprétation historique et métaphysique que Claudel livre de la posture interprétative ou d’interrogation herméneutique adoptée à ses yeux par son maître. « Le drame de la vie de Mallarmé », écrivait-il treize ans plus tôt pour saluer la parution des Poésies complètes à la NRF, « est celui de toute la poésie du XIXe siècle qui, séparée de Dieu, ne trouve plus que l’absence réelle. Elle n’a plus rien à dire. Elle aboutit à ce blanc, à ce vide qu’emplissent mal les énormes émissions gazeuses d’un Hugo, à ce miroir nu aminci jusqu’à la transparence illusoire d’une vitre et qu’elle ne peut rompre [7]. » Au moment de rendre compte d’Igitur, Claudel met en ce même sens notre poète en série avec Poe et Baudelaire parmi les « hommes de la nuit » paralysés par leur propre lucidité : « chez eux, écrit-il, l’illusion une fois pour toute paralysée en même temps que l’espérance, l’intelligence seule dans une spéculation désintéressée conservait une ressource d’évasion [8]. »
Ce qui pour Claudel a fait le grand drame de Mallarmé – soit encore, avec les mots qu’il employait en 1908 dans une lettre à André Suarès, cette « immense “catastrophe de l’imagination” qui laisse le pur artiste sans force [9] » – est, dans une large mesure, ce qui pour nous pourrait bien avoir fait son triomphe : d’être parvenu à retourner le matérialisme comme un gant, autrement dit d’avoir su en conserver la forme irrémédiable tout en en retirant une force propre à exhausser fictivement ce matérialisme au dessus de lui-même. C’est bien là en effet ce que Claudel, aveuglé par la lumière de sa foi, ne veut pas ou ne peut pas envisager : le désespoir de Mallarmé, ou ce qu’on pourrait appeler son illusion perdue, peut tout aussi bien nous apparaître au contraire – et il ne cesse pas lui-même d’y insister – comme le vecteur paradoxal de l’enchantement poétique ou, pour le dire de façon plus précise, comme ce qui, à défaut d’un Sens et de toute transcendance effective, anime le jeu de la signification à travers une méditation sur les conditions transcendantales de l’expérience poétique. Encore Mallarmé fait-il bien plus qu’insister à maintes reprises sur cet aspect crucial de son esthétique. C’est sur ce socle apparemment vide et instable que le poète a en effet très solidement édifié, par degrés de complexité croissante, non seulement sa poétique et sa rhétorique propres, mais aussi toute une métaphysique originale, conjuguant à une herméneutique très particulière une sémiotique qui ne l’est guère moins.
Vers une transcendance fictive
On peut classiquement fixer pour moment inducteur de cette construction graduelle le basculement qui se produit dans les années 1864-1866. Ces années correspondent d’un côté à une grande pièce exaltée telle que « L’Azur », symbolisant assez bien le vacillement du poète entre une croyance qui se délite et une incrédulité qui s’affermit. « Les grands trous bleus que font méchamment les oiseaux [10] », en déchirant par endroits le plafond des nuages bas, y satisfont encore au postulat d’un au-delà du monde et d’un idéal extérieur au réel, exerçant leur « sereine ironie » sur un sujet « hanté » par un « Ciel » que les satisfactions données par la « Matière » se montrent impuissantes à exorciser. Deux ans plus tard, d’un autre côté, le « Ciel » est bien plus que « mort » : il est vide, et la « matière » n’a plus même à triompher : elle n’est pas seulement constitutive du monde, elle en est de toutes parts l’horizon indépassable. Tel est bien en tout cas, pour une part, la conclusion livrée dans la fameuse lettre au sujet du « Glorieux Mensonge », mais tel est bien aussi, d’autre part, le point d’induction de la conséquence esthétique que Mallarmé va en tirer. L’affirmation ici est double. Elle est affirmation de la perte de toute illusion (« Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière [11] ») et aussitôt d’une volonté de sauvegarder l’illusion en l’assumant comme telle, c’est-à-dire comme une fiction régulatrice (« je veux me donner ce spectacle de la matière ayant conscience d’elle, et, cependant, s’élançant forcenément dans le Rêve qu’elle sait n’être pas […] et proclamant, devant le Rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges [12] »). En conclusion, déclare-t-il à Cazalis : « Je chanterai en désespéré [13] ». Ce désespoir, qui n’a rien de sinistre, place dorénavant la pensée poétique de Mallarmé sous le signe d’un matérialisme enchanté, voulant aussi que l’homme – qui n’est rien d’autre au fond, et ce n’est pas rien, que « la nature se pensant [14] », ainsi qu’il l’explique un an plus tard à Lefébure – soit en quelque sorte le mensonge que la matière se raconte à elle-même. L’homme lui apparaîtra désormais comme la matière prenant conscience réflexivement d’elle-même et le poète, incarnation suprême de cette réflexivité de la matière, comme celui qui, par les moyens de la fiction, introduit dans un monde aussi dépourvu d’extériorité que de sens l’horizon d’une signification qui, sans lui, resterait lettre morte ou hypothèse informulée. Mallarmé eût très certainement approuvé, sous ce rapport, l’observation du médecin Jean Hamburger qui, dans sa biographie d’Émile Littré, écrivait ceci : « Croire que le monde a en soi une signification, c’est supposer que, si les hommes disparaissaient, le concept de signification aurait encore un sens [15]. »
On sait quelle ressource et quel ressort notre poète entendra tirer de ce matérialisme enchanté, à savoir que le « mécanisme littéraire », tel qu’il l’exposera à mots très couverts à Oxford et Cambridge, prend élan selon lui à partir d’un vide fondamental en direction d’un « au-delà » de pure fiction, par là « agent » et « moteur » de l’expérience esthétique autant que de l’expression poétique [16]. Cette tension vers un tel « au-delà », tirant sa puissance d’essor d’une énergie accumulée dans l’intériorité formelle de l’œuvre, sera la constante paradoxale de son art et de sa pensée, qu’il s’agisse par exemple de la conception qu’il fera sienne de la double « visée » constitutive du poème comme « Transposition » sous-tendue par une « Structure [17] », du « vers » dont l’existence dépend du « défaut » même « des langues » qu’il « rémunère [18] », de l’assomption du langage vers la « Notion » qui depuis toujours fait défaut et toujours échappe, de l’allégement du poids de réalité effectué sur les « mots de la tribu [19] », et jusqu’à la fascination qu’exercera sur lui telle danseuse italienne : « La Cornalba me ravit, qui danse comme dévêtue ; c’est-à-dire que sans le semblant d’aide offert à un enlèvement ou à la chute par une présence volante et assoupie de gazes, elle paraît, appelée par l’air, s’y soutenir, du fait italien d’une moelleuse tension de sa personne [20]. » Et l’on pourrait faire valoir encore qu’à cette verticalité qui oriente toute la pensée de l’œuvre et alimente la plupart de ses thématiques correspond en un même esprit l’horizontalité du « Livre », « authenticité glorieuse » scintillant par places, selon les mots de la lettre autobiographique à Verlaine, au travers de différentes « portions faites » à dimension toute indicative [21]. Cette tension génératrice et le matérialisme enchanté dont elle relève ont bien évidemment pour contrepartie déclarée une herméneutique désespérée : « Strictement j’envisage, écartés vos folios d’études, rubriques, parchemin, la lecture comme une pratique désespérée [22] », professera-t-il devant les fellows et les dames d’Oxford puis Cambridge. Et que cette profession d’une insolente radicalité précède de quelques phrases, dans la conférence, l’exposition volontairement énigmatique du « mécanisme littéraire » que j’évoquais il y a un instant établit assez clairement que, de cette « lecture […] désespérée » au « leurre » réclamé par le fonctionnement de ce « mécanisme », il y a bien, dans l’esprit de Mallarmé, un rapport d’étroite implication réciproque.
Rétraction des formes et essor poétique
Il y va dans tout cela bien sûr d’une construction imaginaire qui, par un côté, épouse de très près la doxa esthétique d’un postromantisme voué en général à un culte du « Néant » ayant pour retombée un matérialisme de la forme travaillée pour elle-même. Mais cette construction témoigne aussi chez Mallarmé, par un autre côté, d’une radicalité et d’un effort de rationalisation systématique (aux deux sens du mot « rationalisation ») dont on ne voit pas d’équivalent dans toute sa génération. Pour autant, cette construction d’une cohérence impressionnante est chez lui au service d’une poétique mais aussi d’une théorie du sens et de son interprétation en poésie soutenue par toute une métaphorique d’autant plus significative, pour notre problématique générale, qu’elle emprunte de même au matérialisme enchanté dont il vient d’être question. La prison des signes dont parlera Claudel est celle du « salon vide » du sonnet en -yx [23], celle de la chambre au lit absent où « Tristement dort une mandore / Au creux néant musicien [24] », celle encore où, au début de « Crise de vers », le poète témoin à distance de l’explosion du vers libre laisse d’un geste las retomber la verroterie du rideau contre la vitre qui, obscurcie par l’orage, reflète le scintillement des reliures alignées sur les rayonnages de sa bibliothèque [25]. Cette prison est aussi bien, à l’évidence, celle du cosmos tout entier, comme suffirait à l’indiquer le même sonnet en -yx, dans le miroir duquel vient se fixer, à travers la fenêtre ouverte au Nord, le septuor scintillant de la Grande Ourse. Le ciel nocturne constellé, telle est, de 1868 à 1898, du « Sonnet allégorique de lui-même » au Coup de dés, la grande métaphore sous laquelle se condense, chez Mallarmé, le double emprisonnement de l’homme dans un univers qui, sans extériorité, se trouve aussi fermé sur lui-même. L’important, au stade où nous en sommes, est que cette métaphore globale trouve sa réplique en réduction dans les métaphores locales très récurrentes auxquelles le poète a recours pour établir sur un plan figuratif sa théorie du discours poétique (entendu à la fois comme production et comme réception interprétative du texte à dimension poétique). De la même façon que le grand dispositif typographique du Coup de dés sera censé reproduire noir sur blanc, à même la page, « l’alphabet des astres » qui s’écrit, lui, blanc sur noir, les constellations brillant sur fond d’opacité sans reste ont pour répondant inversé, à même la matérialité verbale organisée du poème, une surface laissant deviner, comme par « en dessous [26] », un mobile miroitement orchestré par des « mots », « prompts tous, avant extinction, à une réciprocité de feux [27] ». Nul besoin ici de gloser en termes de signifiants articulés les uns aux autres à distance par le système d’équivalences rythmiques, rhétoriques et syntaxiques avec lequel le poème se confond en tant que totalité en fonctionnement : la chose tombe désormais sous le sens et il n’est pas utile d’y insister après tant d’autres. Ce qui doit plutôt nous intéresser ici est la distinction que Mallarmé établit, plus explicitement dans « Le Mystère dans les lettres » que par ailleurs, entre deux modalités de ce qu’à défaut de mieux j’appellerai la signification : d’une part, ce qu’il appelle quant à lui le « sens », « couche suffisante d’intelligibilité [28] », établie à la surface du poème, bien qu’elle en soit en quelque sorte le support « indifférent », et d’autre part ce qu’il appelle le « trésor », vocable dont le symbolisme religieux ou la dimension sacrée s’imposent à l’évidence, mais qui au plus concret se confond, comme on sait, avec le produit métonymique du « miroitement » des mots dans le tissu verbal. Ce « sens », nous le savons, tient à la fois d’un dépôt à même le texte de la charge véhiculée par les « mots de la tribu », qu’il faut bien utiliser, et d’une opération visant à décourager l’intrusion du lecteur profane ; et le « trésor », de ces mêmes mots purifiés, allégés par la disposition, les agencements auxquels ils se trouvent soumis dans l’organisation du texte. Le « sens » n’est pas la visée du poème, il est même ce à quoi celui-ci entend se dérober, de la même façon, si l’on veut, que par ailleurs le poète désespéré porte le deuil sans remède de toute transcendance. Le « trésor » est établi, lui, sur un plan d’immanence ; sa mobilité, parfaitement interne, est aussi parfaitement verbale ; elle procède d’un système de « rapports » à plus ou moins grande distance, qui est ce que l’on pourrait appeler ici, en jouant cette fois de la valeur active du mot, la signification, en tant que productivité symbolique ordonnée à la sémiosis toute formelle du poème.
La prison des signes, ce pourrait être cela également : la distribution de ces signes dans l’espace hermétiquement clos du poème, enfermé lui-même (et protégé) par « l’isolement de la parole » au sein de « l’universel reportage [29] », mais aussi l’« ébat » de ces signes, leur mobilité, la dynamique qui les anime, à l’image verbalisée de l’essor par lequel la fiction des « Lettres », ajointée à la « Musique », fait comme si elle s’élançait vers « Autre chose [30].. » Ces rapports internes que les signes entretiennent, constitutifs de la signification proprement poétique telle que Mallarmé l’envisage, demandent, pour être reçus, à être eux-mêmes rapportés à une conscience qui leur soit ajustée. L’oraison funèbre à la mémoire de Villiers de L’Isle-Adam présentait, selon son auteur, un « préambule […] exagérant le ton grave […] pour permettre à qui se reconnaîtraient [sic] fourvoyé, de regagner la porte à temps [31] ». « Cave canem », précisait-il entre parenthèses. Dans le même esprit, « Le Mystère dans les lettres » installe l’image de murailles hérissées de tessons de bouteilles défendant l’accès du mystère à des profanes déjà découragés par le « sens » indifférent présenté à leur perception par la surface du texte. C’est qu’il s’agit en effet, d’une part, quant au « sens », de détourner le lecteur « oisif », avec la courtoisie requise des deux côtés (« Salut, exact, de part et d’autre [32] – »), mais aussi, d’autre part, quant au « trésor », d’appeler et d’accueillir le lecteur actif, disposé à appliquer au texte ainsi orchestré une « transparence du regard adéquat [33] », c’est-à-dire de le recevoir et de le faire jouer à travers des catégories de lecture et de compréhension pertinentes. De là que « Le Mystère dans les lettres », apparemment si opaque et si défensif, s’achève sur une scène de lecture idéale, mettant en regard réciproque « l’air ou chant sous le texte » et un « Lire » exercé comme une « pratique [34] », c’est-à-dire comme une démarche accordée au dispositif spécifique de ce texte (la transparence étant ici, non pas seulement ce dont s’éclaire l’obscur sous un œil clairvoyant, mais aussi la relation d’adéquation apparemment immédiate et spontanée, du fait qu’elle est l’expression d’un même habitus, entre un mode de lecture et un mode d’écriture [35]).
Rapports et signification
On estimera peut-être que c’est au prix d’une excessive sollicitation de textes difficiles et le plus souvent très ambigus que se trouve ici établi, entre ces différents plans de l’esthétique de Mallarmé entendue au sens le plus large, un rapport d’homologie placé sous le signe de la « Fiction », du matérialisme enchanté et de l’essor sans illusion vers une illusion perdue. Ce serait ignorer ou oublier que l’on trouve sous sa plume des formules qui procèdent très précisément à cette homologation même. Et d’abord dans la conférence sur La Musique et les Lettres, lieu d’obscure divulgation du secret littéraire, lorsque, juste après cette divulgation aussitôt déniée, Mallarmé, continuant de gloser la « formule absolue » de Parménide, énonce l’une de ses idées les plus saisissantes : « La Nature a lieu, on n’y ajoutera pas ; que des cités, les voies ferrées et plusieurs inventions formant notre matériel. / Tout l’acte disponible, à jamais et seulement, reste de saisir les rapports, entre temps, rares ou multipliés ; d’après quelque état intérieur et que l’on veuille à son gré étendre, simplifier le monde. / À l’égal de créer : la notion d’un objet, échappant qui fait défaut [36]. » La formulation de l’enjeu propre à cet « acte » est très ambiguë, puisque ces « rapports, entre temps, rares ou multipliés » laissent voir dans « entre temps » soit l’adverbe, en l’occurrence privé peut-être significativement du trait d’union qui en fait, à lui seul, un nœud de rapports, soit et plus vraisemblablement l’objet de ces « rapports » à « saisir ». L’on sait que, dans la lettre de 1885 à Verlaine ou dans « L’Action restreinte » par exemple, le poète a volontiers envisagé la question des failles introduites dans la continuité du Temps et, dans l’article mentionné, le rôle socialement imparti au faux présent perpétuel de la presse d’information de « masquer l’écart » entre un « passé » qui a « cessé » et un « futur » qui « tarde » à venir. Le principal réside, sous l’angle que j’adopte ici, dans le fait que cet « acte », le seul qui soit « disponible » dans une « Nature » bornant tous les horizons, touche bien à des « rapports » à établir et, si l’on se porte au paragraphe qui suit immédiatement, que la « totale arabesque » que le poète évoque s’y trouve une fois de plus associée en même temps à « de vertigineuses sautes » (donc encore à un fait d’élan fictif) et à « un effroi que reconnue » (comprenons notamment l’effroi que soit reconnu pour vide l’enjeu que cette arabesque se fixe) : « Semblable occupation suffit, explique-t-il ainsi aux deux publics très choisis d’Oxford et Cambridge, comparer les aspects et leur nombre tel qu’il frôle notre négligence : y éveillant, pour décor, l’ambiguïté de quelques figures belles, aux intersections. La totale arabesque, qui les relie, a de vertigineuses sautes en un effroi que reconnue ; et d’anxieux accords [37]. »
Une autre formule allant dans le même sens général, moins obscure, mais tout aussi forte, figure dans la lettre importante que le poète adresse en 1893 à Edmund Gosse : « Je fais de la Musique, lui écrit-il, et appelle ainsi non celle qu’on peut tirer du rapprochement euphonique des mots, cette première condition va de soi ; mais l’au-delà magiquement produit par certaines dispositions de la parole », en lui recommandant, plus loin, d’« [employer] Musique dans le sens grec, au fond signifiant Idée ou rythme entre des rapports [38] ». Tout est là résumé de sa poétique et de sa métaphysique : l’essor vers un au-delà fictif, « magiquement produit » ; les conditions d’un tel essor réunies par les agencements du discours poétique autant que par les potentialités de la parole que ces agencements libèrent (car « dispositions de la parole » a bien deux sens ici) ; l’expérience et l’expression esthétique, au total, comme établissement de « rapports » et « rythme entre [ces] rapports » (formule qui, si l’on suivait un Benveniste, tiendrait d’un puissant pléonasme, « rythme » ayant comme sens bien oublié, dans la langue de Démocrite, celui de « forme » ou de « configuration [39] »). Tout est là condensé du message et de la formule poétiques de Mallarmé, dans la visée, non d’un « sens », avec ou sans majuscule, qui serait antérieur ou supérieur au discours, mais d’un sens postulé sans illusion à travers un système de « rapports » de signification inséparablement verbaux et symboliques, au service d’une poésie vécue sous le signe, tout à la fois ironique et ré-enchanteur, d’un « comme si » généralisé – ce « COMME SI » qui figurera deux fois, symétriquement, sur la double page centrale du Coup de dés dans sa version définitive.
Tout ceci, indiqué à bien grands traits, ne livre pas, il s’en faut de beaucoup, une vérité de la littérature et de la poésie, ayant été miraculeusement atteinte ou retrouvée dans la seconde moitié du siècle par l’intermédiaire génial d’un poète qui confiait à Odilon Redon, en 1885, que « [son] admiration tout entière [allait] droit au grand Mage inconsolable et obstiné chercheur d’un mystère qu’il sait ne pas exister, et qu’il poursuivra, à jamais pour cela, du deuil de son lucide désespoir, car c’eût été la Vérité [40] ! » Il s’agit bien plutôt d’une construction imaginaire, qui, sous-tendant une athéologie poétique et une herméneutique en effet désespérée, relève aussi d’une sociologie en partie effective, en partie imaginée. Imaginée, lorsque Mallarmé transfère scolastiquement au « rapport social » la dimension de fiction qui, relevant des « belles-Lettres », fait de la société, « terme le plus creux », une prérogative relevant de jure sinon de facto de ces Lettres mêmes [41]. Sociologie effective, lorsqu’il voit bien que la société est faite d’un ensemble d’univers relativement autonomes, dans lesquels « ce à propos de quoi on s’entre-dévore compte [42] », et que le microcosme de la poésie ou la littérature constitue l’un de ces univers. Parmi les conditions transcendantales de l’expérience poétique, telle qu’il se la représente et telle que, à n’en pas douter, il l’a vécue, figurent en effet des conditions proprement historiques et sociales, qui demandent entre autres choses que l’espace social soit configuré – et maintenu – en telle sorte que la gratuité de l’acte esthétique puisse non seulement être assurée, mais admise et reconnue comme la forme la plus haute et la plus pure de cet acte. De là par exemple sa proposition touchant à une réforme du « Domaine public » et l’impression si forte qu’aura exercée sur lui le système des fellows, possibilité garantie par une institution de vivre la vie de l’esprit à son gré, à l’abri des besoins et des contraintes ordinaires.
De cette dimension proprement sociologique de sa réflexion beaucoup de ses écrits gardent les traces et sa poésie même la figure à certains moments. Ainsi, dans Salut, l’extériorité qui vient habiter le poème n’est plus seulement la grande extériorité enveloppante d’un cosmos dont ce poème apparaîtrait comme le modèle réduit, mais également l’espace tout aussi enveloppant – et serrant même les poètes de plus près – du monde social de la poésie moderne, avec ses rituels particuliers, ses sociabilités spécifiques et ses routines plus ou moins luxueuses. Sans doute le cosmos y reste-t-il fortement figuré (« Solitude, récif, étoile »), mais selon un principe d’homologation mutuelle de ce cosmos et de l’idéal qu’il symbolise avec l’ensemble des agents sociaux habités par ce même idéal [43]. Lorsque pour le rappeler à l’ordre Mallarmé objecte à son disciple égaré « Non, Ghil, l’on ne peut se passer d’Éden ! », ce n’est pas qu’il y croie, en l’existence de cet Éden, et encore moins qu’on puisse y atteindre ou y retourner, mais c’est qu’il considère que l’exercice de la poésie ne peut pas se passer en effet d’un idéal régulateur transversal à l’ensemble de la collectivité des poètes, si éclatée qu’elle soit, en contexte d’anomie et de crise du vers, entre tant de chapelles, de doctrines et de rationalisations diverses du libre jeu poétique individuel.
« La Nature a lieu, on n’y ajoutera pas » ; et « tout l’acte disponible reste de saisir [des] rapports », énonce Mallarmé. Paul Claudel, parce qu’il est sorti du « bagne matérialiste » dont il « [a] dû forcer les portes [44] », comme le lui dira Mauriac en 1947, se trompe. Tout à son propre jugement, qu’il croit dernier sur les choses, il postule chez son vieux « professeur d’attention » une interrogation du « Sens » et des « Signes » et une question – « Qu’est-ce que cela veut dire ? » – qui n’étaient pas les siennes (ou qui, en tout état de cause, n’étaient plus les siennes après 1865). « Qu’est-ce que cela veut dire ? » est la question de Claudel, dont il détient par avance la réponse, quelque obscurément chiffrée qu’elle soit dans la nature et dans l’édifice verbal des saintes Écritures. La question principale, la question principielle de Mallarmé aura été, bien plutôt, de se demander, comme tout cela ne veut rien dire et ne rime à rien, comment cela s’agence et comment agencer les choses, esthétiquement, pour qu’elles paraissent « vouloir » dire quelque chose. Et, plus concrètement, comment disposer la parole, ordonner les rythmes et les rimes, distribuer les constituants du discours – du blanc du papier au noir de l’encre, de la lettre au mot, du mot au vers ou à la phrase, de la phrase au texte, du texte au volume et de celui-ci dans une bibliothèque infinie – pour que tout cela paraisse viser « autre chose » au-delà, pour que les « signes » paraissent emporter « autre chose » au-delà d’eux-mêmes. Tel est sans doute, non le dernier mot de Mallarmé, mais le mot de l’énigme impénétrable que son esthétique présentait à Claudel : au monde, il n’y a pas à ajouter du « sens » ni même à lui en trouver ; il y a – et c’est là, définitivement, « le seul acte disponible » – à y mettre en jeu de la signification.