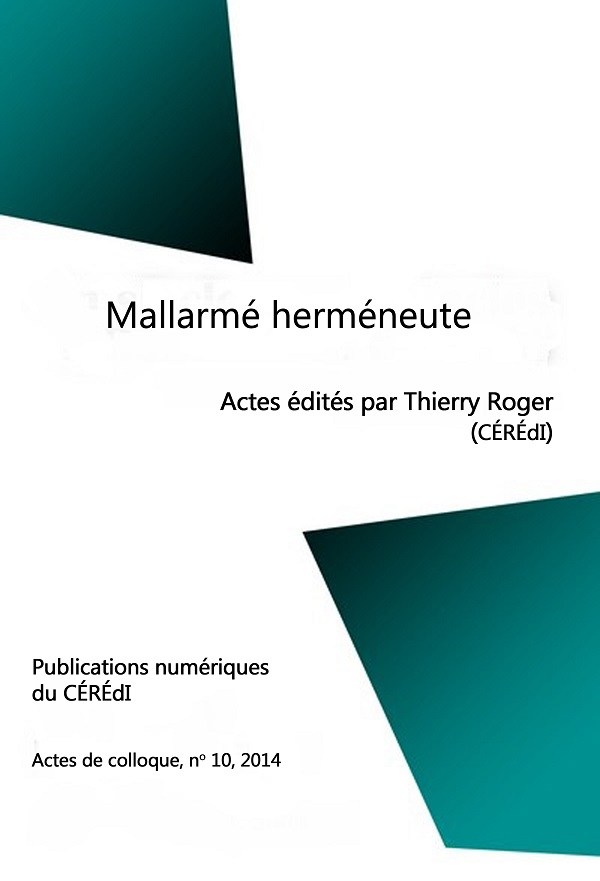De « Symphonie littéraire » en 1864, jusqu’à l’article de 1892 qui deviendra, dans les Divagations, le médaillon « Théodore de Banville », l’admiration de Mallarmé pour son aîné n’a pas faibli : Banville représente à ses yeux le poète lyrique par excellence auquel il a « voua » toute sa vie « un culte [1] ». En juin 1887, faute de pouvoir rendre compte de Lohengrin de Wagner, le chroniqueur de La Revue indépendante consacre à la pièce en vers de Banville Le Forgeron [2] son article, « la moins mauvaise des études [qu’il a] publiées [3] » dans la revue, dira-t-il à Dujardin. L’essentiel en sera intégré aux Divagations sous le titre de « Solennité ». Plus encore que les deux autres textes sur Banville, la chronique sur le Forgeron, parce qu’elle est centrée sur une œuvre précise dont Mallarmé livre une interprétation, permet de cerner la pratique mallarméenne de la lecture. La critique tend à faire de cette pratique une simple « divagation », une rêverie entraînant le lecteur loin de l’œuvre initiale, vers des préoccupations propres à Mallarmé. Bertrand Marchal remarque que dans des chroniques telles la future « Solennité », le poète « semble plus souvent se contenter de prolonger idéalement quelques-uns des fils qui font la trame consciente ou non de modèles réels – ici Le Forgeron de Banville – à partir du moment où le poète y retrouve quelque chose, si peu que ce soit, de son rêve [4] ». La justesse de la lecture de Mallarmé risque de se réduire à un presque « rien » ou un « si peu que ce soit » et l’œuvre de Banville à un pur prétexte. Yuko Matsumura, auteur d’une récente thèse sur la place de Banville dans la pensée et la poétique de Mallarmé, note quant à elle que ce dernier « interprète Le Forgeron d’une manière arbitraire pour le réintégrer dans son cadre de pensée [5] ». Et elle expose de manière assez détaillée à quoi tient l’arbitraire de son interprétation.
Nous voudrions montrer, non pas que Bertrand Marchal et Yuko Matsumura ont entièrement tort sur le fond, mais que Mallarmé s’appuie sur le texte de la pièce plus qu’il n’y paraît, en l’éclairant au besoin par ce qu’il sait de la poétique de Banville, et que les « mots à côté » de la divagation prolongent « les mots » de « l’œuvre d’art », ses « traits d’or vibratoire [6] », selon un jeu d’échos par lequel le « poëme critique » entre en résonance profonde avec le texte de Banville.
Une lecture allégorique qui dégage de la fable un art poétique
Contrairement à certains critiques de l’époque (Auguste Vacquerie dans Le Rappel [7] ou Pierre Véron dans Le Charivari [8]), qui se contentent de résumer la pièce sans se mettre en peine de l’interpréter, Mallarmé adopte d’emblée une lecture allégorique. La fable est là pour déployer, non une leçon morale comme chez Charles de Larivière, qui y voit « l’irrésistible puissance de l’amour et le déchaînement des mœurs du vieil Olympe [9] », mais un « spectacle intellectuel qui […] passionne » Mallarmé et tel que « l’autre, tiré de l’affabulation ou le prétexte, lui est comparable [10] ». Toute lecture allégorique repose sur un système de comparaison, ou plutôt de correspondance, entre les éléments concrets de la fable et les notions abstraites, intellectuelles, auxquelles elle renvoie. L’originalité de la lecture de Mallarmé est qu’elle ne se contente pas, comme celles de la majorité des commentateurs de l’époque, de faire de la pièce de Banville une allégorie globale de la création artistique, « de l’Art, victorieux de tout [11] » (Paul Ginisty et Auguste Dorchain [12]), du « Travail humain épousant l’Idéal qui le sollicite, et le rend fécond » et de « la rédemption de l’Humanité par la révélation du Beau » (Jules Lemaître), de « l’union de la Beauté avec le Travail et le Génie [13] » (Jules Tellier et Maurice Bouchor [14]). Cette lecture est d’entrée de jeu métapoétique : « Un soir vide de magnificence ou de joie, écrit Mallarmé, j’ouvrais, en compensation, le radieux écrit Le Forgeron pour y apprendre de solitaires vérités. / Que tout poëme composé autrement qu’en vue d’obéir au vieux génie du vers, n’en est pas un [15]. » Plus loin il note : « Chaque page de la brochure annonce et jette haut comme des traits d’or vibratoire ces saintes règles du premier et dernier des Arts [16]. » La lecture métapoétique, que Mallarmé expose dans les premiers paragraphes qu’il consacre à la pièce, est réaffirmée avant qu’il n’en vienne à résumer enfin très brièvement l’intrigue. Cette façon de ne pas s’attarder sur « l’affabulation ou le prétexte [17] » distingue là encore la démarche de Mallarmé ; le contraste est frappant avec les résumés souvent longs et émaillés de citations à la faveur desquels les autres commentateurs [18] déploient leur interprétation allégorique. Comme si le chroniqueur conviait le lecteur à dépasser la lecture littérale, à ne pas s’arrêter aux séductions concrètes de la fable pour aller tout de suite à l’essentiel, à ces « solitaires vérités » qui touchent à l’art de faire des vers et, au-delà, au sens de notre présence sur terre.
L’infléchissement du sens allégorique indiqué par Banville
En résumant « l’argument » de la pièce, Mallarmé semble suivre l’interprétation allégorique dont Banville a posé les jalons dans sa pièce. « Vénus, du sang de l’Amour issue, […] subira la chaîne de l’hymen avec Vulcain, ouvrier latent des chefs-d’œuvre, que la femme ou beauté humaine, les synthétisant, récompense par son choix [19] » (c’est nous qui soulignons). Le terme « chefs-d’œuvre » peut renvoyer aussi bien aux « chefs-d’œuvre » de l’artisan qu’est Vulcain (selon une lecture littérale) qu’aux chef-d’œuvre littéraires, conformément à la lecture métapoétique développée par Mallarmé et imposée par Banville lui-même à certains endroits de la pièce, notamment dans le discours que tient Vulcain à Vénus à la scène 5 :
Alors dans le feu pur sous mes mains sont écloses
Mystérieusement les œuvres et les choses.
Je les achève sous le jour de l’atelier ;
Je soumets l’ornement au rhythme régulier :
Avec tous les outils, esclaves de mon zèle,
Je repousse l’airain, je lime, je cisèle,
Je grave, curieux, ardent, inassouvi,
Seul avec mon cerveau plein d’images, servi
Par des figures d’or que j’ai faites moi-même.
Le métal fulgurant chante comme un poëme :
Il est devenu lyre où dort un chant divin [20]
Quant à l’expression « beauté humaine », qui figure dans le résumé de la pièce par Mallarmé, elle désigne à la fois la beauté féminine qu’incarne au suprême degré Vénus et la beauté artistique, celle des chefs-d’œuvre qu’en tant qu’allégorie elle « synthétis[e] ». Cette dernière interprétation semble s’accorder avec le sens allégorique suggéré par Banville, qui, à la scène 1 de la pièce, fait dire à la nature entière contemplant Vénus surgie des flots : « C’est elle ! / C’est la Beauté [21] ! »
Mais en réalité, comme l’a montré Yuko Matsumura, Mallarmé infléchit le sens allégorique indiqué par Banville : « l’adjectif “humaine” ne convient pas […] pour Vénus, qui, dans ce poème, protège l’homme du haut de la sphère céleste [22] », note la commentatrice. On pourrait ajouter qu’à la fin de sa pièce, Banville donne explicitement à Vénus une valeur allégorique plus générale que celle qu’évoque Mallarmé. Voici en effet comment Vulcain glose, dans sa tirade finale, son union avec Vénus :
Donc le Travail, qui montre une âpre cicatrice,
Épouse avec amour la Force créatrice.
Malgré la nuit qui dort en ses replis hideux,
Ils aviveront la lumière, et tous les deux
Ils sauront, avec une ardeur inassouvie,
Créer la vie et les images de la vie [23].
La « Force créatrice » s’étend, au-delà des « images de la vie » créées par l’art, à la vie en général, animant la nature entière : « L’épanouissement de toute la nature […] / Et tout ce qui fleurit sur la terre, c’est moi [24] ! » déclare Vénus à la scène 2 ; « Elle est le divin souffle et l’immortelle Cause [25] » s’émerveille Euphrosyne à la scène 5. De même, le « Travail », dont Vulcain est l’allégorie explicite, dépasse le seul travail poétique, englobant, dans l’esprit de Banville, les ouvrages de la civilisation qui visent au bien-être. Or le chroniqueur de La Revue indépendante non seulement restreint la valeur allégorique de Vulcain, mais il l’infléchit de manière décisive. « Quant à Vulcain, observe Yuko Matsumura, il devient, dans l’interprétation de Mallarmé, le principe même du vers [26]. » En effet, l’exposé des « solitaires vérités » et « saintes règles » qui précède l’argument de la pièce, fait du « Vers » un « dieu jaloux [27] » et le « numérateur divin de notre apothéose [28] ». C’est lui, et non l’ouvrier du vers, qui est chez Mallarmé le correspondant allégorique du forgeron : « il emprunte, écrit-il, pour y aviver un sceau tous gisements épars, ignorés et flottants selon quelque richesse, et les forger [29]. » Aux yeux de Mallarmé, « la seule dialectique du Vers [30] » opère la transfiguration poétique, et non quelque « enthousiasme » divin propre à l’âme du poète ou quelque « délire commun aux lyriques [31] » (comme c’était le cas dans « Symphonie littéraire ») : « Lui en dieu jaloux, auquel le songeur cède la maîtrise, il ressuscite au degré glorieux ce qui, tout sûr, philosophique, imaginatif et éclatant que ce fut, comme dans le cas présent, une vision céleste de l’humanité ! ne resterait, sans lui, que les plus beaux discours émanés de quelque bouche [32]. »
Mais si Mallarmé s’écarte sur ce point du sens allégorique qu’indique Banville, sa lecture reste fidèle aux structures de la fable, comme s’il travaillait à dégager un sens latent pressenti mais non formulé consciemment par son aîné. Dans le résumé de l’argument, il qualifie Vulcain d’« ouvrier latent des chefs-d’œuvre ». L’adjectif « latent » renvoie au motif de l’invisibilité du dieu forgeron, élément important de la pièce. Jusqu’à la scène 5 en effet, Vulcain est absent, exilé à Lemnos dans sa forge. Vénus, à la fin des stances de la scène 4, souligne l’absence du dieu ouvrier :
Quel est donc ce Vulcain farouche
Que nomme en vain ma bouche
Et qui me semble plutôt un ouvrier qu’un Dieu ?
Il façonna la coupe et la lyre invincible.
Pourquoi reste-t-il invisible ?
Quel est ce dieu hardi, maître et vainqueur du feu [33] ?
Dans la pièce, l’absence de Vulcain est due à son bannissement par Jupiter et à son « mépris de la stupidité du vulgaire odieux [34] », le dieu forgeron se définissant lui-même comme « l’exilé de la nuit et de l’ombre [35] ». Mais elle n’est pas qu’un symbole romantique du statut du poète dans la société bourgeoise fermée au beau. Puisque l’artisan divin représente explicitement le Travail, son invisibilité renvoie logiquement à celle du travail poétique, dont la trace ne doit pas être sensible dans le poème achevé. Or Mallarmé s’empare du motif de l’invisibilité pour en faire un symbole de ce qu’il appellera dans « Crise de vers » la « disparition élocutoire du poète [36] », notion plus spécifique que la simple disparition des traces du labeur poétique. La chronique de 1887 définit ainsi le principe du vers : « hors de tout souffle perçu grossier, virtuellement la juxtaposition entre eux des mots appareillés d’après une métrique absolue et ne réclamant de quelqu’un, le poëte dissimulé ou chaque lecteur, que la voix modifiée suivant une qualité de douceur ou d’éclat, pour chanter [37]. » (nous soulignons). Comme Vulcain retiré dans sa forge, le poète se dissimule aux regards ; mais s’il « cède l’initiative aux mots », selon la formule de « Crise de vers [38] », sa présence est nécessaire pour mettre en œuvre la « dialectique du Vers », pour « appareill[er] » les mots entre eux et faire jaillir le « chant sous le texte [39] » par un cratylisme secondaire fondé sur les propriétés articulatoires des mots [40].
Cette manière de récupérer un symbole parnassien de l’effacement des traces du labeur poétique pourrait sembler tout à fait subjective. Pourtant, à y regarder de plus près, la définition mallarméenne du « génie du vers » entre en résonance avec ce qu’écrit Banville dans son célèbre Petit Traité de poésie française en 1872, plusieurs fois réédité [41], que l’admirateur du maître parnassien connaissait inévitablement. Notre hypothèse est que Mallarmé, lorsqu’il formule les « saintes règles du premier et dernier des Arts [42] », n’invoque pas Le Forgeron comme un pur prétexte, mais tente de l’interpréter en se fondant sur ce que Banville a écrit dans le Petit Traité. L’expression « métrique absolue », employée par Mallarmé, est un indice de cette réminiscence. Dès l’ouverture du Petit Traité, Banville définit en effet « le Poëme » « comme une composition dont l’expression soit si absolue, si parfaite et si définitive qu’on n’y puisse faire aucun changement, quel qu’il soit, sans la rendre moins bonne et sans en atténuer le sens [43]. » Dans cet essai, il défend l’idée qu’on ne peut être un vrai poète qu’à la faveur d’« un don surnaturel et divin [44] », « un DON spécial, qui ne s’acquiert pas [45] ». Ce don consiste en une saisie spontanée de l’image mentale et de l’expression verbale : « les impressions et les images se présenteront à lui accompagnées des mots et des sons et des assemblages de sons qui doivent les faire naître dans l’esprit des autres [46] ». À chaque fois que Banville formule cette idée dans le Petit Traité, il donne le sentiment que les mots sont doués d’une vie propre : « si vous êtes poëte, note-t-il ailleurs, vous commencerez par voir distinctement dans la chambre noire de votre cerveau tout ce que vous voulez montrer à votre auditeur, et EN MÊME TEMPS que les visions, se présenteront SPONTANÉMENT à votre esprit les mots qui, placés à la fin des vers, auront le don d’évoquer ces mêmes visions pour vos auditeurs. Le reste ne sera plus qu’un travail de goût et de coordination, un travail d’art qui s’apprend par l’étude des maîtres et par la fréquentation assidue de leurs œuvres [47]. » (c’est l’auteur qui souligne). De là au Vers « dieu jaloux, auquel le songeur cède la maîtrise » il n’y a pas loin en apparence.
Toutefois, comme l’a montré Yuko Matsumura [48], l’écart entre les deux conceptions du vers est en réalité maximal. Il tient aux présupposés des deux poètes, spiritualistes dans un cas et athées dans l’autre. Pour Banville, le « don surnaturel et divin » du poète, qui fait du mot « un mot magique » capable de « faire apparaître devant nos yeux » « les visions [49] » du poète, lui vient de Dieu. Le lyrisme est défini dans le Petit traité comme « l’expression de ce qu’il y a en nous de surnaturel et de ce qui dépasse nos appétits matériels et terrestres […]. » Et Banville de proclamer : « Ainsi peut-on poser comme un axiome que l’athéisme, ou négation de notre essence divine, amène nécessairement la suppression de tout Lyrisme [50]. » Pour Mallarmé en revanche, depuis les années de crise, Dieu n’existe pas ; la seule chose qui puisse être dite « divine » est le « vieux génie du vers [51] » parce qu’il crée « un nouvel état, sublime », « glorieux » du langage qui nous projette vers un « au-delà [52] » fictif. S’il qualifie de « céleste » la « vision […] de l’humanité [53] » que présente Le Forgeron, c’est en raison de l’« appétit du ciel [54] » que nourrissent les hommes selon Vulcain dans la pièce, mais cet « appétit du ciel » – que Mallarmé lui-même appellera « l’instinct de ciel [55] » – surgit en l’absence de Dieu. Au contraire, pour Banville, cet « appétit du ciel » est ce qui relie les hommes aux dieux, ou plutôt au Dieu voué à se substituer à ces dieux conformément à la prédiction de Vénus elle-même.
Un écho des « traits d’or vibratoire » du Forgeron
Au-delà de la reprise d’un motif récurrent comme l’invisibilité du dieu, la chronique de Mallarmé entre en résonance avec certaines images du Forgeron, celles notamment figurant dans deux passages d’inspiration très parnassienne ayant une valeur métapoétique manifeste : la description de la ceinture de Vénus et l’évocation du moule qui a servi à fondre la coupe de Bacchus. Par ce travail sur les images, la chronique annonce la poétique du « poëme critique » pratiquée dans les Divagations. Certes, ces images (les feux des pierres précieuses, la fleur, le ciel, le vol de l’oiseau, le métal de l’objet d’art…) correspondent à des topoï dépassant les limites de l’esthétique parnassienne. Mais rien n’interdit de penser que Mallarmé, en les exploitant, a à l’esprit les passages du Forgeron mentionnés et qu’il infléchit délibérément ces topoï dans un sens symboliste. Là encore, nous défendrons l’idée que cet infléchissement n’est pas une trahison de la poétique banvillienne, qu’il est conforme à des principes que Banville avait entrevus dans son Petit Traité mais qui, au goût de Mallarmé, ne ressortent sans doute pas assez nettement de l’allégorie déployée dans le Forgeron.
La description de la ceinture de Vénus, chef-d’œuvre suprême forgé par Vulcain, atteste le souci plastique qui anime des poètes comme Banville. Elle est typique des emprunts aux arts décoratifs par lesquels les Parnassiens affirment l’importance du travail minutieux de la matière poétique :
EUPHROSYNE
La Ceinture, livrée à l’aile des zéphyrs,
Est comme un clair tissu de perles, de saphirs,
D’améthystes, sur un treillage d’or, qu’embrase
La calcédoine et la mourante chrysoprase.
AGLAÉ
Elle est l’enchantement et le signe.
THALIE
………………………………………Au milieu
De sa rosace d’or est un diamant bleu
Qui, pareil au grand ciel, fait baisser vos paupières.
AGLAÉ
Autour du diamant s’étagent les sept pierres.
THALIE
Sept pendeloques sur le flanc pur de Cypris
Mêlent l’aigue-marine et le fluide iris.
EUPHROSYNE
Et la rosace a pour soutiens, douce et fatale,
Deux oiseaux transparents, deux colombes d’opale
Dont les yeux enflammés sont des diamants noirs, –
THALIE
Pour montrer que Vénus est la reine des soirs.
VULCAIN
Et la riche ceinture est sa gloire éternelle [56].
Pour symboliser la poésie dans sa chronique, Mallarmé évoque, au lieu d’un « clair tissu » entrelacé d’un « treillage d’or », un ordonnancement plus abstrait : « la juxtaposition des mots appareillés d’après une métrique absolue [57] ». Les feux tantôt « embras[és] » tantôt « mourant[s] » des pierres précieuses se muent sous sa plume en « les mille éléments de beauté » du « Vers » qui « brillent et meurent dans une fleur rapide, sur quelque transparence d’éther [58] » (nous soulignons). À cette image lumineuse le chroniqueur entrelace l’image de la fleur, qui était présente chez Banville sous la forme de la « rosace » ornant la ceinture de Vénus, ainsi que l’image du ciel, désigné par le terme d’« éther » (Banville, lui, comparait le « diamant bleu » de la ceinture à un « grand ciel »). Mallarmé emploiera d’ailleurs le mot « ciel » plus loin en lui accolant l’adjectif « métaphorique » pour mieux réfuter, on l’a vu, toute interprétation spiritualiste : « Le ciel métaphorique qui se propage à l’entour de la foudre du vers, artifice par excellence [59] » est chez lui une création du langage humain. Enfin, les « [d]eux oiseaux transparents, deux colombes d’opale » enchâssés dans la ceinture font place dans le texte de Mallarmé à une image plus abstraite, celle de l’« équilibre momentané et double à la façon du vol, identité de deux fragments constitutifs [60] ».
En travaillant ces images, Mallarmé introduit deux éléments qui n’étaient guère présents dans la fable banvillienne : l’idée de fugacité (exprimée par des adjectifs comme « rapide », « momentané », ou des noms comme « l’instant ») et l’idée de dynamisme (traduite par des verbes tels « attire non moins que dégage [61] », « pressés d’accourir et de s’ordonner [62] », ou « qui se propage à l’entour »). Ce que le chroniqueur a en vue ici, et que l’image statique et très parnassienne des joyaux composant la ceinture ne suggérait pas, est ce qu’il nommera plus tard la « mobilité [63] » des mots, c’est-à-dire le jeu de relations à distance entre leurs différentes facettes selon la « dialectique du Vers [64] ». Or cette dialectique et cette mobilité avaient été entrevues par Banville dans le Petit Traité de poésie française, où il décrit la façon dont les mots se combinent et s’harmonisent dans le vers :
le poëte […] entend à la fois, vite, […], toutes les rimes d’une strophe ou d’un morceau, et après les rimes tous les mots caractéristiques et saillants qui feront image, et, après ces mots, tous ceux qui leur sont corrélatifs, longs si les premiers sont courts, sourds, brillants, muets, colorés de telle ou telle façon, tels enfin qu’ils doivent être pour compléter le sens et l’harmonie des premiers et pour former avec eux un tout énergique, gracieux, vivant et solide [65].
La seconde description à valeur métapoétique [66], dont un élément central se retrouve dans la chronique de La Revue indépendante, est celle de la coupe de Bacchus, forgée par Vulcain et emplie de vin. Tant la chronique que la pièce convoquent l’image du moule dans lequel est fondu le bel objet (décoratif ou poétique). Dans la pièce de Banville, c’est Bacchus lui-même qui décrit le moule de la coupe, rappelant son origine mythique :
[…] Pour guérir tous les maux, j’ai la Coupe !
La Coupe glorieuse est le moule d’un sein
De femme. Elle est sévère et d’un noble dessin,
Et le vin, dans son or qui l’éclaire, est un fleuve
De pourpre où la tremblante humanité s’abreuve.
Celui que le puissant Jupiter exila
Et qui modela, puis fondit et cisela
Divinement la Coupe à la courbe immortelle,
C’est le dieu de Lemnos, qui forge et qui martèle.
C’est lui, Vulcain, dont le grand cœur s’est réjoui
De parer sa corolle ouverte [67]. […]
Le sein de Vénus aurait donné sa forme « immortelle » au moule servant à fondre la première coupe [68], qui ressemble à une « corolle » de fleur. Or les deux images, moule et fleur, figurent dans la chronique de Mallarmé : après avoir fait du vers une « fleur » destinée à s’épanouir, le poète l’assimile à « quelque suprême moule n’ayant pas lieu en tant que d’aucun objet qui existe : mais il emprunte, pour y aviver un sceau tous gisements épars, ignorés et flottants selon quelque richesse, et les forger [69] ». Il s’agit d’un moule paradoxal, qui non seulement se forge lui-même, mais qui n’est façonné sur aucun objet. Alors que chez Banville, le moule conservait la « courbe immortelle » du corps de la déesse de la Beauté (c’est-à-dire qu’il portait l’empreinte d’une Beauté d’origine divine), chez Mallarmé le moule n’emprunte sa forme à aucun objet, même divin. Il ne contient que la matière fondue de « gisements épars, ignorés et flottants [70] », qui semblent le reflet lointain et plus abstrait du « fleuve de pourpre » emplissant chez Banville la coupe et procurant aux hommes l’ivresse. Cette transformation de l’image est significative d’une poétique placée chez Mallarmé sous le signe de la fiction (ce qui n’existe pas) et qui refuse la description directe et minutieuse des choses au profit de leur seule suggestion.
Pourtant, là aussi, Mallarmé a pu trouver la première formulation de la poétique de la suggestion dans le Petit Traité de poésie française de Banville, sur laquelle Paul Bourget attire l’attention en 1884 [71]. En effet, dans son traité Banville écrit : « La poésie a pour but de faire passer des impressions dans l’âme du lecteur et de susciter des images dans son esprit, – mais non pas en décrivant ces impressions et ces images. Un poëte qui se borne à écrire les choses comme elles sont ressemble à un peintre qui copierait toutes les feuilles d’un arbre, ce qui ne donnerait à personne l’idée d’un arbre. Il faut, non qu’il représente l’arbre, mais qu’il le fasse voir [72]. » Dès lors, la métamorphose par Mallarmé du moule de la coupe en moule ne portant l’empreinte d’aucun objet existant ne ferait que souligner fortement un principe déjà invoqué par Banville – et que fait oublier quelque peu la fable du Forgeron, où sont décrits à plusieurs reprises les objets forgés par Vulcain (coupe, sceptre, épée, foudre etc.). Ce principe n’est autre que le refus de la description minutieuse au profit d’une poétique reposant sur des « moyens beaucoup plus compliqués et mystérieux [73] » selon l’expression du Petit Traité, en particulier sur le « mot magique » « placé à la rime [74] » et tous ceux qui s’harmonisent avec lui, c’est-à-dire sur ce que Mallarmé appelle le « vieux génie du vers [75] ».
Dans sa chronique sur le Forgeron, Mallarmé se livre, non pas à une divagation sur le vers oublieuse de son point de départ, mais à une vraie interprétation de la pièce de Banville, que, contrairement aux critiques du temps, il lit d’emblée comme une allégorie de la poésie et non de l’art en général. Cette lecture est moins arbitraire qu’on ne pourrait le penser. Certes, elle restreint la valeur allégorique des personnages indiquée par l’auteur du Forgeron, et, refusant tout présupposé spiritualiste, infléchit le sens allégorique vers une poétique athée. Mais elle est attentive aux structures de la fable en soulignant notamment l’invisibilité de Vulcain, dont elle fait un symbole de l’effacement élocutoire du poète devant le jeu des mots au sein du vers. Surtout, tout en paraissant tirer dans une direction symboliste des images présentes à des endroits typiquement parnassiens de la pièce, cette lecture reste fidèle à des principes exposés par Banville dans le Petit Traité de poésie française. Pour Banville comme pour Mallarmé, les mots sont doués d’une vie propre. Ils surgissent et se combinent, s’harmonisent entre eux pour susciter des impressions, des images dans l’esprit du lecteur. S’il veut donner à son vers une puissance magique d’évocation, le poète doit laisser libre cours à cette vie ou cette « mobilité [76] » des mots, et non décrire minutieusement les choses. Ces principes ont pu sembler à Mallarmé parfois occultés dans Le Forgeron, où des symboles importants de la poésie (la ceinture de Vénus, la coupe de Bacchus) sont traités sur le mode descriptif et plastique cher aux Parnassiens. En composant des variations sur des topoï poétiques présents dans la pièce (la fleur, le joyau, le vol de l’oiseau ou le moule de l’objet d’art), Mallarmé réaffirme avec force ces « saintes règles du premier et dernier des Arts [77] » dont il goûte la mise en œuvre en « traits d’or vibratoires [78] » chez Banville. Il place ainsi sa propre poétique dans la continuité plutôt que dans la rupture avec celle de son aîné.