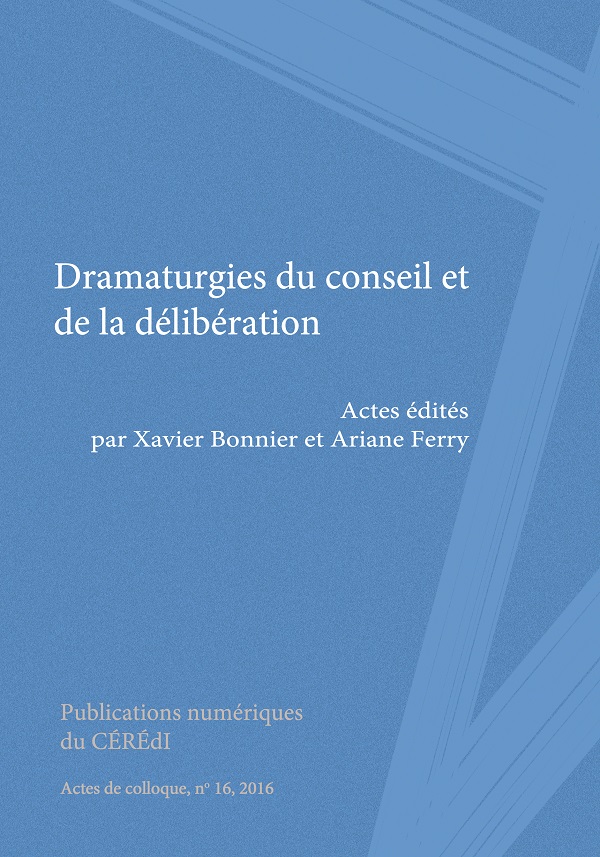« […] cette cervelle qui avait pensé tant de choses, inspiré tant d’hommes, construit tant d’édifices, conduit deux révolutions, trompé vingt rois, contenu le monde [1]. »
Exceptionnelle par sa durée de douze ans, la présidence de Franklin D. Roosevelt le fut surtout par les défis qu’il dut relever entre sa première investiture le 4 mars 1933 et sa mort dans l’exercice de ses fonctions le 12 avril 1945 : la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Elle fut aussi le moment d’une véritable mutation du rôle joué par l’État fédéral dans la vie politique, économique et sociale du pays – ce n’est pas un hasard si tous ses successeurs, démocrates ou républicains, se sont depuis réclamés de son héritage [2]. Pour mener à bien les profondes réformes institutionnelles qui ont modelé la présidence moderne, Roosevelt a dû être élu, et réélu : le moins contestable de ses succès, ce fut la série sans précédent de ses quatre victoires électorales.
La campagne de 1932 se déroula aux heures les plus dramatiques de la Grande Dépression. Les maladresses du président sortant, le républicain Herbert Hoover, l’avaient rendu extrêmement impopulaire, mais il ne manquait ni d’intelligence, ni de courage. Face à cet adversaire, Roosevelt devait faire la preuve de sa maîtrise des sujets les plus divers et les plus complexes, et apporter un démenti à tous ceux qui doutaient de sa capacité physique à exercer les fonctions de président. Depuis qu’il avait été frappé par la poliomyélite, en 1921, il avait en effet perdu l’usage de ses jambes : désireux de revenir à la vie politique, il avait alors déployé une énergie considérable et une grande capacité de dissimulation pour ne plus apparaître seulement comme un « homme blessé », mais comme un « combattant heureux » (« Happy Warrior ») prêt à relever tous les défis.
Sur l’arrière-fond crépusculaire d’une Amérique en proie au doute, cet acteur consommé improvisa une dramaturgie collective rassemblant autour de lui, sur la scène politique éclairée par la presse, une équipe jeune et dynamique. Grâce à son talent, mais aussi grâce à celui de conseillers qui étaient bien plus que de simples faire-valoir, il donna le spectacle d’un homme en mouvement, à la fois déterminé et souriant. Alors que le sombre Hoover, abandonné par ses partisans, s’isolait à la Maison Blanche, Roosevelt et ses partenaires multiplièrent les innovations : le candidat visita en personne plusieurs États, prononça de mémorables discours radiophoniques, commanda des études d’opinion et se rendit en avion à la convention du parti démocrate. À l’équipe qui l’entourait en permanence, les journalistes donnèrent un nom : le brain-trust. La décision de le mettre en scène plutôt que de dissimuler son existence n’était pas sans risques – pour Roosevelt, rien n’aurait été pire que d’apparaître comme un dilettante manipulé par des conseillers irresponsables. Mais le pari se révéla gagnant : l’improbable brain-trust de 1932, s’il n’a pas survécu à l’épreuve de l’exercice du pouvoir, s’est imposé dans l’imaginaire collectif et a donné naissance à une expression devenue courante dans plusieurs langues, dont le français [3].
Bien qu’il nous manque, sur ce point comme sur d’autres, le témoignage personnel de Roosevelt, les principaux membres du brain-trust ont publié des souvenirs, des mémoires ou des journaux [4]. Avec les articles de presse et leurs illustrations, ils constituent un corpus qui permet d’apprécier les circonstances dans lesquelles est apparu cet outil de réflexion et de communication au service du président, et de tenter de comprendre les raisons de son remarquable succès, aux États-Unis comme en Europe.
Pourquoi ne pas essayer les professeurs ?
Les contemporains n’étaient pas préparés intellectuellement à comprendre la crise économique qui suivit le krach boursier d’octobre 1929. Hoover parut vite dépassé par la gravité de la situation : alors qu’il devait son élection de 1928 à sa réputation de « grand ingénieur » et de « grand humanitaire », il ne sut pas mettre en valeur les décisions innovantes qu’il prit à la fin de son mandat.
Juriste de formation, businessman occasionnel, Roosevelt n’avait ni la culture, ni l’expérience de Hoover dans le domaine de l’économie. Mais alors que sa correspondance privée nous apprend qu’il avait réagi avec désinvolture à l’annonce du krach boursier, il ne tarda pas à prendre la mesure du caractère exceptionnel de la crise. Face à la montée rapide d’un chômage massif, le gouverneur de l’État de New York vit la nécessité de rassurer ses concitoyens en prenant des mesures exceptionnelles. Destinée à fournir une aide d’urgence aux chômeurs, la Temporary Emergency Relief Administration contribua à sa stature nationale, mais sa portée resta limitée. Pour emporter l’élection présidentielle, objectif qu’il s’était fixé dès le début de sa carrière politique, il comprit qu’il devait faire preuve de créativité dans tous les domaines de la vie économique et sociale.
Roosevelt n’était pas un homme seul : depuis leur rencontre en 1910, il s’appuyait sur son ami intime et confident, l’ancien journaliste Louis M. Howe. Or s’il avait entière confiance en son jugement politique, il n’ignorait pas que les connaissances économiques de Howe étaient très limitées – de surcroît, le machiavélisme et la silhouette inquiétante de celui qui s’était lui-même affublé du surnom de « gnome médiéval » ne correspondaient que trop bien au stéréotype de l’âme damnée dans un mauvais mélodrame.
En mars 1932, quelques semaines après que le gouverneur eut annoncé sa candidature à l’investiture de son parti pour l’élection présidentielle, un autre de ses proches, le juge Sam Rosenman, lui suggéra de constituer un groupe chargé de réfléchir aux problèmes d’actualité, de mettre en avant des idées nouvelles, de formuler des propositions et d’élaborer un programme [5] – délibérer et conseiller, telles seraient ses deux missions. À Roosevelt qui lui demandait s’il avait déjà des noms à l’esprit, Rosenman répondit :
Usually in a situation like this, […] a candidate gathers around him a group composed of some successful industrialists, some big financiers, and some national political leaders. I think we ought to steer clear of all those. They all seem to have failed to produce anything constructive to solve the mess we’re in today. Now my idea is this : why not go to the universities of the country ? You have been having some good experiences with college professors. I think they wouldn’t be afraid to strike out on new paths just because the paths are new.
« D’ordinaire, dans une situation comme celle-ci, […] un candidat rassemble autour de lui un groupe constitué de quelques industriels qui ont réussi, de quelques grands financiers, et de quelques leaders politiques nationaux. Je pense que nous devrions nous en tenir à l’écart. Tous semblent avoir échoué à produire quoi que ce soit de constructif pour nous tirer du pétrin dans lequel nous sommes aujourd’hui. Voici mon idée : pourquoi ne pas faire appel aux universités de notre pays ? Vous avez eu de bonnes expériences avec des professeurs d’université. Je pense qu’ils n’auraient pas peur de s’aventurer sur de nouveaux chemins simplement parce que ces chemins sont nouveaux [6]. »
Pour constituer cette équipe, Rosenman avança le nom d’un professeur de droit de l’université de Columbia, Raymond Moley [7]. Lors de la campagne qui avait conduit à son élection au poste de gouverneur de l’État de New York en 1928, Roosevelt avait sollicité l’expertise de ce dernier ; les éléments fournis par Moley avaient été intégrés dans un discours du candidat, à qui cette première collaboration avait donné entière satisfaction.
Doté d’une forte capacité de travail, d’une culture étendue et d’opinions bien arrêtées, Moley n’était pas un économiste. Il sollicita d’abord un de ses collègues de l’université, Rexford G. Tugwell, spécialiste des questions agricoles. C’était un penseur hétérodoxe qui croyait aux vertus de la planification. Adolf A. Berle enseignait lui aussi à Columbia ; il était le co-auteur, avec l’économiste Gardiner Means, d’un ouvrage remarqué sur la propriété et le management des grandes entreprises modernes, The Modern Corporation and Private Property. Les trois hommes constituèrent le noyau dur auquel s’associèrent d’autres universitaires, souvent issus de Columbia – par commodité, ils s’adressèrent d’abord à leurs collègues. Le jeune Robert K. Straus, fils d’un ami du gouverneur, assurait le secrétariat de ce groupe informel [8].
Moley et les membres du groupe apportèrent une contribution essentielle à la campagne du candidat : ils lui permirent de s’appuyer sur des statistiques solides – dans la mesure où elles étaient disponibles – et lui fournirent certaines des formules les plus frappantes de ses discours – ainsi « l’homme oublié », le 7 avril 1932, morceau de bravoure de rhétorique politique. Grâce à leurs compétences variées, Roosevelt était armé pour appréhender la crise dans toute sa complexité. Loin de se tenir à l’écart de leurs travaux, il y prenait d’ailleurs une part active. Composant ses souvenirs en 1939, alors que l’enthousiasme des débuts avait fait place à la désillusion, Moley devait décrire avec une émotion intacte les séances de travail avec le gouverneur, qui « était à la fois un étudiant, un interrogateur contradictoire et un juge [9] ».
Le groupe n’avait pas encore de nom officiel. Lorsque Roosevelt, qui s’apprêtait à prendre quelques jours de repos en Géorgie, donna instruction à Moley de continuer le travail avec « les gens » qu’il avait rassemblés autour de lui, ce dernier lui demanda de préciser qui étaient ces « gens » auxquels il pensait. Le gouverneur mentionna notamment les noms de Rosenman, Tugwell et Berle. Au sujet de Moley lui-même, à qui il revenait de faire la synthèse de leurs délibérations, Roosevelt ajouta : « Ce qui fait de vous le président, j’imagine, de mon conseil privé [10]. »
Si la référence au conseil privé (« privy council ») des souverains britanniques illustre la culture historique, éclectique mais bien réelle, de Roosevelt, elle témoigne hélas d’un sens de l’humour assez peu relevé : le « privy », c’est aussi « les cabinets ». On conçoit que Moley et ses comparses n’aient guère apprécié la plaisanterie ; de surcroît, ni la référence monarchique, ni l’allusion scatologique n’étaient susceptibles de séduire les électeurs américains.
De plus, les journalistes qui couvraient la campagne et rendaient compte de chacun de ses discours n’avaient pas tardé à s’aviser de la présence constante, auprès de Roosevelt, de ses conseillers. En dévoilant leur existence aux yeux du public, la presse allait abolir le caractère secret du « conseil privé » pour en faire un outil de communication au service du candidat. C’est à un journaliste du New York Times, James M. Kieran Jr., que la postérité attribue « l’invention » du brain-trust.
James M. Kieran, « inventeur » du brain-trust
Lorsque Kieran mourut à l’âge de cinquante ans, en janvier 1952, le New York Times publia une notice nécrologique rappelant, dans son sous-titre, qu’il avait « inventé » l’expression brain-trust [11]. C’était le plus grand titre de gloire d’un reporter dont la carrière témoignait d’un intérêt constant pour la politique. Ancien étudiant des universités de Fordham et de Columbia, Kieran fut embauché par le prestigieux quotidien new yorkais en 1923 et devait y effectuer l’essentiel de sa carrière de journaliste. En 1931, il fut affecté au bureau permanent du journal à Albany, capitale de l’État de New York. Pendant plusieurs années, il y couvrit l’actualité politique, ce qui le conduisit à rencontrer fréquemment le gouverneur [12].
Springwood, la maison de famille des Roosevelt, se trouve dans le village de Hyde Park, le long de l’Hudson, à mi-chemin entre New York et Albany. Le gouverneur effectuait de fréquents allers-retours entre Springwood, sa résidence new yorkaise de la 65e rue, et le logement officiel qui lui était réservé dans la capitale de l’État. Avec les journalistes qui le suivaient dans ses déplacements s’établit peu à peu une sorte d’intimité qui, de part et d’autre, n’était pas entièrement désintéressée : pour un candidat à l’élection présidentielle, il était essentiel de soigner son image dans les grands quotidiens de la côte Est, dont le rayonnement s’étendait à l’ensemble du territoire national.
Le 4 septembre 1932, le financier Bernard Baruch rendit visite à Roosevelt à Springwood [13]. Cet ancien collaborateur du président Wilson pendant la Première Guerre mondiale passait pour un représentant des milieux d’affaires au sein du parti démocrate. Aux journalistes présents, il affirma son soutien au candidat, dénonçant avec vigueur les adversaires qui l’accusaient d’être un « radical » ennemi des institutions américaines. Le 6 septembre, Kieran s’en fit l’écho dans un article du New York Times qui donnait à voir la familiarité entre les journalistes et la famille du gouverneur :
The interview with the financier was conducted under unusual circumstances. The correspondents were all in bathing suits at the side of the pool at the “cottage”, and Mrs. Roosevelt halted the little runabout in which she was driving Mr. Baruch back to the main house, on the road close by.
« L’entretien avec le financier a été réalisé dans des circonstances inhabituelles. Les correspondants étaient tous en maillots de bain, au bord de la piscine du “cottage”, et Mme Roosevelt a arrêté le petit runabout dans lequel elle ramenait M. Baruch à la maison principale, sur la route toute proche [14]. »
L’hospitalité des Roosevelt ne se limitait pas à Baruch et aux journalistes :
Professor Raymond Moley of Columbia, Adolph Berle and John William Taussig, who belong to a small group known as the “brains department”, which aids the Executive in gathering data for speeches, were guests at the picnic also.
« Le professeur Raymond Moley de Columbia, Adolph Berle et John William Taussig, qui font partie d’un petit groupe connu sous le nom de “brains department” et qui aide le chef de l’Exécutif de l’État à rassembler des données pour ses discours, étaient aussi invités au pique-nique [15]. »
La qualité d’universitaires de Moley, Berle et Taussig justifiait qu’ils fussent désignés, collectivement, comme le « département des cerveaux » (« brains department »). Ce dernier ne devint le brain-trust que deux jours plus tard. Daté d’Albany le 8 septembre 1932, un article du New York Times annonçait le départ imminent de Roosevelt pour un voyage dans l’Ouest des États-Unis [16]. Le gouverneur était décrit dans sa résidence familiale, au milieu de ses familiers et de ses collaborateurs :
While the Executive was motoring to and from his ancestral home on the banks of the Hudson […], his “brains trust” was laboring on data for the addresses he is to deliver in the West, starting Monday.
« Pendant que le chef de l’Exécutif de l’État allait et venait en voiture à sa résidence ancestrale sur les rives de l’Hudson […], son “brains trust” travaillait sur les données nécessaires aux discours qu’il doit prononcer dans l’Ouest, à partir de lundi [17]. »
Dans l’article, la première occurrence du mot « brain » était au pluriel, comme la seconde, qui présentait Raymond Moley comme « le chef du “brains trust” ».
Les États du Midwest, traditionnellement républicains, étaient susceptibles de basculer dans le camp démocrate. Mais la mise en scène du voyage de Roosevelt avait un autre objectif, comme l’indiquait une précision d’apparence anodine dans un article paru le 13 septembre :
It is hoped also that the twenty-one day swing will do much to discount stories that the Governor is not physically able to withstand the rigors of the Presidency.
« On espère aussi que cette tournée de vingt-et-un jours fera beaucoup pour dissiper les rumeurs selon lesquelles le gouverneur n’est pas capable, physiquement, de faire face aux rigueurs de la présidence [18]. »
À bord d’un train baptisé pour l’occasion le « Roosevelt special », le gouverneur n’était pas seul :
In addition, Professor Raymond Moley of Columbia, head of the so-called “brain trust” which gathers data for the Governor’s speeches, is travelling with him to help draft addresses for the rest of the trip.
« De plus, le professeur Raymond Moley, de Columbia, le chef de ce qu’on appelle le “brain trust”, qui rassemble des données pour les discours du gouverneur, voyage avec lui pour aider à les rédiger pendant le reste du voyage [19]. »
Sous la plume de Kieran, le rôle de Moley restait celui d’un simple collaborateur au service du gouverneur ; il aurait été particulièrement malvenu de suggérer que Roosevelt, dont on connaissait la paralysie sans en mesurer la gravité, était de surcroît affligé d’une déficience intellectuelle nécessitant la « greffe » d’un cerveau étranger.
Dans l’article du 13 septembre, le brain-trust était au singulier. La disparition du « s » final avait pour effet de substituer à la constellation de brillants cerveaux rassemblée par Moley une entité collective au service d’un cerveau unique, celui du candidat en campagne. L’usage, cependant, n’était pas figé : le 20 novembre, l’expression apparaissait à nouveau au pluriel [20]. Les deux versions devaient continuer à coexister, jusque dans les souvenirs des protagonistes [21].
Kieran fut-il réellement l’inventeur de l’expression ? Dans ses souvenirs, Rosenman affirme qu’elle aurait été prononcée pour la première fois par Howe, le confident de Roosevelt. Il entrait sans doute peu de bienveillance dans cette trouvaille de Howe, dont la causticité légendaire aurait ainsi trouvé à s’exercer au détriment d’hommes dont il redoutait qu’ils ne prissent trop d’importance aux yeux du « Boss ».
Quoi qu’il en soit, c’est bien Kieran qui popularisa le brain-trust. À Roosevelt, qui s’était lassé de sa mauvaise blague sur le « privy council », l’expression eut l’heur de plaire [22] – si cela n’avait pas été le cas, il aurait probablement demandé au journaliste de cesser de l’utiliser.
L’expression s’imposa rapidement dans la presse américaine, qui publia de nombreuses photographies du candidat, puis du président-élu, en pleine discussion avec ses conseillers. Mal avisés, les adversaires républicains du gouverneur y virent un angle d’attaque contre lui. Comme le relèverait plus tard Jim Farley, président du Democratic National Committee et vétéran des campagnes électorales :
It was good tactics for the opposition to picture Roosevelt as a President wholly surrounded by men inexperienced in national government ; and I have been too long in politics to find fault on that score.
« C’était de bonne guerre, pour l’opposition, de présenter Roosevelt comme un président entièrement entouré d’hommes inexpérimentés en matière de gouvernement ; et j’ai été en politique trop longtemps pour y trouver à redire [23]. »
Cependant, si le brain-trust attirait à lui des critiques prévisibles, il contribuait aussi à donner de Roosevelt l’image d’un leader dynamique, à la tête d’une équipe d’hommes jeunes et compétents. Grâce à eux, la campagne prit un tour épique, le candidat sillonnant le pays pour prononcer des discours traitant de tous les aspects de la crise économique : dans le Kansas, il s’adressa aux agriculteurs ; dans l’Iowa, il s’en prit au protectionnisme et à ses conséquences ; dans l’Ohio, il critiqua l’excessive concentration de l’industrie américaine ; il traita des chemins de fer dans l’Utah, de la production et de la distribution d’électricité dans l’Oregon, de justice sociale dans le Michigan, etc. Toujours en mouvement, jamais seul, le candidat montrait qu’il était capable de s’entourer, de dialoguer, de reconnaître les compétences là où elles se trouvaient. La diversité des opinions au sein du brain-trust n’était pas dissimulée, mais il était clair que la décision finale, en cas de désaccord, revenait au candidat. Le groupe, en tant qu’entité collective, paraissait moins menaçant que la figure du conseiller du prince, toujours susceptible de manipuler son maître à de sinistres fins – l’image du mystérieux colonel House, ami de longue date et conseiller diplomatique de Wilson pendant la Première Guerre mondiale, restait très ambivalente. Loin de gêner Roosevelt, le brain-trust contribua à sa victoire lors de l’élection du 8 novembre 1932. Comme devait le constater avec amertume, au soir de sa longue vie, son adversaire Hoover, cette innovation fit date dans l’histoire politique américaine :
Roosevelt’s campaign has historical importance, because the new techniques which he introduced have affected all campaigns since. […] He delivered a multitude of ghost-written speeches, some written by irresponsible or ignorant men.
« La campagne de Roosevelt a une importance historique, parce que les techniques qu’il a introduites ont affecté toutes les campagnes depuis lors. […] Il a prononcé une multitude de discours, écrits par d’autres, certains d’entre eux écrits par des hommes irresponsables et ignorants [24]. »
Hoover, avec sa rationalité un peu étroite, n’avait pas tout à fait tort lorsqu’il dénonçait les talents d’illusionniste de son adversaire, mais il était incapable de reconnaître que ce dernier avait insufflé un nouvel élan à l’Amérique en crise : un mythe était né, celui de « combattant heureux » terrassant l’hydre de la Grande Dépression avant de triompher, plus tard, du totalitarisme nazi.
« Trust du cerveau », « trust des intelligences » ?
Le caractère spectaculaire et novateur du brain-trust n’échappa pas aux observateurs étrangers, qui ne manquèrent pas d’y faire référence dans les ouvrages contemporains qu’ils consacrèrent au New Deal. Dans les pays d’Europe restés démocratiques, les responsables de l’Exécutif s’appuyaient sur des équipes peu nombreuses [25] ; les experts économiques étaient encore rares. Une autre caractéristique du brain-trust frappa les Européens : sa jeunesse. Pour ne citer que ses trois membres les plus « visibles », Moley était né en 1886, Tugwell en 1891, Berle en 1895. Anne O’Hare McCormick, la prestigieuse éditorialiste du New York Times, se fit l’écho de la surprise de l’économiste britannique John M. Keynes, observateur attentif – et parfois critique – du New Deal :
Washington is full of this strange type of intellectual and enthusiastic bureaucrat. They form the army of “fine young men” that so impressed John Maynard Keynes, in contrast to the scarcity of the young in the public life of England.
« Washington est plein de cette espèce étrange de bureaucrate intellectuel et enthousiaste. Ils constituent cette armée de “jeunes gens bien” qui ont tant impressionné John Maynard Keynes, offrant un contraste à la rareté des jeunes dans la vie publique de l’Angleterre [26]. »
Pour les Français, l’expression soulevait une difficulté supplémentaire, celle de sa traduction. Si le sens de « trust » paraissait acquis, ce n’était le cas ni de « brain », ni de l’association des deux mots.
Dès 1933, François de Tessan décrivait ainsi l’entourage du président qui venait d’entrer en fonction :
M. Franklin Roosevelt […] a composé le « Brain Trust » – le trust du cerveau, le trust des intelligences. Du moins, c’est ainsi que l’on nomme ce groupe de ministres et de conseillers, dont les principaux sont portés aux nues ou décriés à qui mieux mieux selon les goûts de chacun et les variations de l’atmosphère politique [27].
Dans la suite du passage, qui reprenait la critique formulée par les républicains et par certains journaux, Tessan restait attaché au singulier de « cerveau » :
Les adversaires du président l’accusent d’avoir substitué à son propre cerveau cette mixture de cerveaux hétérogènes, sans avoir pour cela créé le cerveau gouvernemental synthétique qui doit tirer les États-Unis d’embarras [28].
Plus loin, Tessan abandonnait la précision anatomique pour une terminologie plus abstraite, le « Trust de l’Intelligence » ; on voit bien, cependant, que ses tentatives de traduction ne le satisfaisaient pas, car il revenait à l’anglais, entre guillemets :
Le « Trust de l’Intelligence » n’est pas un trust strictement fermé. Le Président y fait entrer à son gré, selon les exigences du moment, les compétences qu’il estime les plus « efficientes ». […] Tel qu’il apparaissait au début, le « Brain Trust » réunissait un ensemble de collaborateurs attachés à M. Franklin D. Roosevelt, des serviteurs des idées nouvelles, des gens qui tous tendaient vers ce noble but : dégager leur pays de l’impasse cruelle dans laquelle il se débat, opposer aux méthodes inertes de l’administration républicaine leur foi dans le mouvement, dans la vie, dans la résurrection d’un grand peuple [29].
Georges Boris, qui publia en avril 1934 La Révolution Roosevelt, une analyse fouillée et argumentée du premier New Deal, soulignait la nature paradoxale du « trust du cerveau » :
C’est à tort qu’on a présenté le New Deal comme une construction imaginée par une poignée d’intellectuels, constitués en un trust du cerveau par le président. Si quelques-uns de ces conseillers font en Amérique figure de doctrinaires, comparés aux théoriciens européens de l’économie et de la sociologie, aux tenants des écoles libérales ou sociales, ce ne sont encore que des empiristes [30].
Collaborateur de Léon Blum, présent à Londres auprès du général de Gaulle, ami intime de Pierre Mendès France, Boris devait contribuer à diffuser en France les enseignements de l’expérience du New Deal – parmi elles, la nécessité, pour un homme d’État, de s’entourer des meilleurs esprits et de le faire savoir.
Écrivant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, Raymond Cartier n’oubliait pas les débuts dramatiques du premier mandat de Roosevelt :
La Maison-Blanche bruissait d’idées et de projets. […] Le président travaillait avec les intellectuels qu’il avait rassemblés autour de lui pendant ou après sa campagne électorale. Moley, Eisenmann [sic], Tugwell, ceux qu’on commençait d’appeler le Trust des Cerveaux – le Brain Trust [31].
Alors que s’achevait la présidence de Roosevelt – l’ouvrage de Cartier parut après sa mort le 12 avril – le brain-trust était devenu, aux yeux des Français, un élément constitutif du mythe de la victoire sur la Grande Dépression.
La disparition du brain-trust et l’institutionnalisation du groupe des conseillers présidentiels
Après sa victoire électorale du 8 novembre 1932, Roosevelt dut attendre le 4 mars de l’année suivante pour entrer en fonction. Traditionnellement, l’une des tâches les plus importantes de « l’interrègne » consistait à former un cabinet présidentiel et une équipe de conseillers. Pendant l’interminable attente du jour de l’investiture, Moley joua un rôle décisif – ce fut lui, notamment, qui accompagna le président-élu lors des entretiens de ce dernier avec son prédécesseur. Quant aux autres membres du brain-trust, ils travaillaient avec acharnement à la rédaction des grands textes législatifs qui seraient débattus et votés pendant les Cent Jours.
Au lendemain de l’investiture, Moley fut officiellement rattaché au secrétaire d’État Cordell Hull, qui prit ombrage de ses relations privilégiées avec le président. Ancien sénateur du Tennessee très respecté par ses collègues, Hull jouait un rôle essentiel dans le dispositif rooseveltien ; il finit par obtenir la démission de son subordonné. Bien que ce dernier continuât à participer à la rédaction des discours présidentiels, il fut désavoué sur deux sujets fondamentaux, la réorganisation de la production industrielle et la monnaie. La tentative infructueuse de Roosevelt de réformer la Cour Suprême au lendemain de sa réélection de novembre 1936 conduisit à la rupture définitive entre les deux hommes. Dans les colonnes du magazine Newsweek, Moley devint un éditorialiste conservateur très critique envers le New Deal.
Le brain-trust cessa de se réunir après que son champion eut été solennellement investi. Aucun de ses membres ne fut nommé à la tête des grands départements fédéraux. Tugwell seconda Henry A. Wallace à la tête du département de l’Agriculture, mais ses projets de réforme, présentés sans excès d’habileté, conduisirent à sa mise à l’écart. Berle conseilla le président de manière officieuse ; il ne rejoignit les rangs de l’administration qu’en 1938.
Si le noyau dur constitué par Moley au début de 1932 s’était dissous, l’expression continua paradoxalement à être utilisée ; elle était en concurrence avec celle de « New Dealers », plus générique, pour désigner la génération de jeunes talents qui se pressaient à Washington. C’était le cas des juristes de Harvard, disciples du professeur Felix Frankfurter – un satellite du brain-trust des origines et un ami du président, dont l’influence croissait avec le temps. Thomas G. Corcoran, Benjamin V. Cohen, ou James M. Landis – les « happy hot dogs » – contribuèrent à la rédaction des grands textes législatifs et à la mise en place des nouvelles agences fédérales. Comme leurs aînés, ils furent la cible d’attaques de la presse conservatrice, qui les accusait d’être des « radicaux », voire des communistes :
Some columnist wrote that we had a straight line to Moscow. Nothing could be farther from the truth. Not only were we not Communists, we had no sense of what Communists were. We were kids fresh out of law school.
« Un éditorialiste écrivit que nous avions une ligne directe avec Moscou. Rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Non seulement nous n’étions pas des communistes, mais nous n’avions aucune idée de ce qu’étaient les communistes. Nous étions des gamins juste sortis de la fac de droit [32]. »
Ce ne fut d’ailleurs qu’après la floraison législative des Cent Jours que devaient être prises les décisions les plus déterminantes de la présidence de Roosevelt. Ce ne furent donc pas les membres du brain-trust originel qui convainquirent le président d’adopter une politique keynésienne de relance de l’activité par la dépense publique ; quant aux personnalités les plus marquantes de l’administration, tels Harry Hopkins ou, pendant la Seconde Guerre mondiale, Henry Stimson, elles ne sortirent pas de ses rangs.
En 1932, le candidat s’était réclamé d’une « expérimentation audacieuse et persistante ». Vint le moment où l’expérimentation parut moins nécessaire : la tragédie du terrible hiver 1932-1933 avait perdu en intensité ; à l’effervescence créatrice des Cent Jours avait succédé la prose de la gestion quotidienne. De plus, le New Deal avait considérablement étendu le périmètre de l’Exécutif dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de la régulation bancaire et financière – plus de soixante agences fédérales avaient été créées entre mars 1933 et juillet 1934. Roosevelt perçut très vite le besoin de mieux coordonner et de rationaliser l’action du gouvernement fédéral, au moyen notamment de la production et de l’analyse de données statistiques fiables – c’était précisément l’une des vocations premières du groupe constitué par Moley au printemps de 1932. Pour ce faire, le président créa en juillet 1933 un Executive Council constitué principalement des titulaires des départements fédéraux et des grandes agences ; s’y ajouta en novembre un National Emergency Council. Ces entités, qui fusionnèrent {}à la fin de 1934, ne lui donnèrent pas entière satisfaction. En mars 1936, recourant à une méthode éprouvée, il créa un groupe d’experts présidé par le professeur de sciences politiques Louis Brownlow. Les recommandations du Brownlow Committee inspirèrent un ambitieux projet de réorganisation de l’Exécutif rendu public par le président au début de son deuxième mandat. Au printemps de 1938, le texte initial fut rejeté par les représentants. Roosevelt finit pourtant par obtenir du Congrès le vote d’un texte de compromis, le Reorganization Act, promulgué le 3 avril 1939. L’Executive Office of the President fut institué ; la structure des agences fédérales fut rationalisée et simplifiée ; les postes d’assistants administratifs du président furent pourvus. Selon une expression employée par le président et fréquemment reprise par les contemporains, ces derniers devaient être animés par une « passion de l’anonymat » – il n’était plus opportun, comme en 1932, de diriger sur eux la lumière. Les outils de la présidence moderne étaient désormais à la disposition des successeurs de Roosevelt ; quant à ce dernier, il ne devait pas manquer d’en faire un usage magistral pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 29 septembre 1946, le New York Times s’interrogeait, dans un article illustré de nombreuses photographies, sur ce qu’il était advenu des New Dealers [33]. À cette date, Harry S. Truman occupait la Maison Blanche depuis dix-huit mois ; il en avait entièrement renouvelé le personnel. Le journaliste Cabell Phillips, auteur de l’article, observait que Truman s’était adressé à « des banquiers, des industriels, des assureurs et [à] une poignée de juristes » plutôt qu’à des universitaires – c’était un peu comme s’il avait délibérément voulu prendre le contre-pied du conseil donné par Rosenman à Roosevelt. Dans l’ensemble des New Dealers, Phillips distinguait les anciens membres du brain-trust, rappelant au passage que l’expression avait été inventée par un collaborateur du journal. Même si Phillips citait par leur nom plusieurs collaborateurs de Truman, le portrait qu’il faisait d’eux avait bien moins d’éclat que celui des « hommes de Roosevelt ». La « passion de l’anonymat » n’était certes pas la caractéristique la plus saillante de personnalités aussi fortes que celles de Moley, Tugwell ou Berle. Comme le reconnaissait Hoover lui-même, le brain-trust de 1932 avait marqué les esprits et devait être imité par bien d’autres candidats à la présidence des États-Unis – et à celles d’autres pays.
Bibliographie
BERLE, Adolf A., Navigating the Rapids, 1918-1971. From the Papers of Adolf A. Berle, éd. Beatrice Bishop Berle et Travis Beal Jacobs, New York, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973.
BERSTEIN, Serge, Léon Blum, Paris, Fayard, 2006.
BORIS, Georges, La Révolution Roosevelt, Paris, Gallimard, 1934.
CARTIER, Raymond, Roosevelt, Lyon, Gutenberg, 1945.
DICKINSON, Matthew J., Bitter Harvest. FDR, Presidential Power and the Growth of the Presidential Branch, New York, Cambridge University Press, 1997.
FARLEY, James A., Behind the Ballots. The Personal History of a Politician, New York Harcourt, Brace and Company, 1938.
HOOVER, Herbert, The Memoirs of Herbert Hoover : The Great Depression, 1929-1941, New York, The MacMillan Company, 1952.
HUGO, Victor, Choses vues. 1830-1846, Paris, Gallimard, 1972.
LEUCHTENBURG, William E., In the Shadow of FDR. From Harry Truman to Barack Obama, Ithaca, Cornell University Press, 1983, 2009.
LOUCHHEIM, Katie (éd.), The Making of the New Deal. The Insiders Speak, Cambridge, Harvard University Press, 1983.
O’HARE MCCORMICK, Anne, The World at Home, éd. Marion Turner Sheehan, introduction par James B. Reston, New York, Books for Libraries Press, 1956, 1970.
MOLEY, Raymond, After Seven Years, New York, Harper & Brothers Publishers, 1939.
MOLEY, Raymond (collab. E. A. Rosen), The First New Deal, New York, Harcourt, Brace & World, 1966.
PÉRÉON, Yves-Marie, Franklin D. Roosevelt, Paris, Tallandier, 2012.
ROSENMAN, Samuel I., Working with Roosevelt, New York, Harper & Brothers, 1952.
TESSAN, François de, Franklin Roosevelt, Paris, Éditions Baudinière, 1933.
TUGWELL, Rexford Guy, The Brains Trust, New York, The Viking Press, 1968.