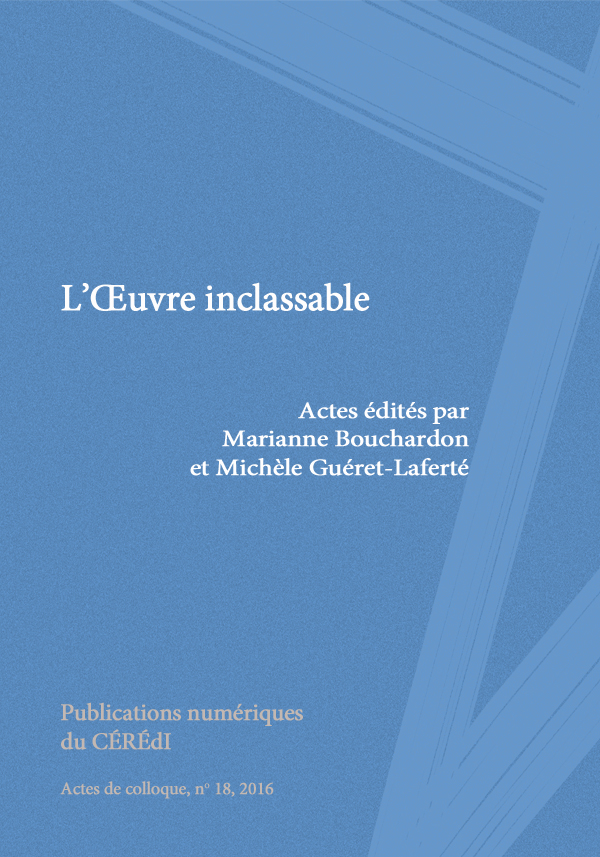Le symbolisme apparaît comme un moment décisif dans l’évolution des genres littéraires, amenant une remise en cause radicale du système traditionnel, en tant que système surtout, mais aussi pour chacun des genres qui le composaient, en eux-mêmes. Dominique Combe observe que le désir de synthèse des genres qui s’impose en cette fin du XIXe siècle suit de peu l’élaboration de nouvelles classifications et catégories, postulant par exemple l’opposition entre prose et poésie comme axe de lecture du paysage générique, ou décrétant l’exclusion du récit hors du cadre d’une poésie dite « pure ». L’auteur de Poésie et Récit en conclut que cette concomitance, loin d’être fortuite, « correspond à un état précis dans l’histoire de la poétique, où il est légitime de chercher à réunir ce que l’on a délié [1] ». Le grand mouvement de synthèse des genres qui prend naissance à ce moment-là va dès lors s’ingénier, notamment à travers le poème en prose ou le roman poétique, à créer des genres hybrides, composites. Le modèle wagnérien de la synthèse des arts et le rêve mallarméen d’un grand Œuvre total accompagneraient cette impulsion vers le décloisonnement des catégories génériques. Il n’est cependant sans doute pas inutile de revenir encore à ce moment fondamental pour en rappeler les principes essentiels et mettre en relation ses différentes perspectives : le bouleversement des genres a des causes multiples, variées, souvent convergentes mais que l’on tentera ici de distinguer et de mettre en évidence. Il s’agira par là d’observer quelles forces sont à l’œuvre dans ce double mouvement d’éclatement et de recristallisation.
Rappelons d’abord combien le symbolisme trouve dans le mysticisme et l’occultisme certaines de ses racines fondamentales. Figure qui sert d’étendard au mouvement, le symbole, quoiqu’il appartienne en droit à toute littérature, se comprend avant tout comme une figure de la synthèse : il doit autoriser et se faire le véhicule de la réunion entre les réalités terrestres et les entités célestes, le matériel et le spirituel, l’univers des apparences et le monde des Idées. En ce sens, il œuvre en faveur du grand fantasme symboliste de retour à une supposée unité originelle, qui se joue d’abord au niveau cosmique et que l’engouement pour le mythe de l’androgyne met notamment en lumière. Le symbolisme, en particulier dans ses premières années, se revendique hautement de ce fondement philosophique qui justifie ses orientations idéalistes et occultistes. Ainsi, Georges Vanor affirme sa conviction que « la littérature symboliste tâche à ramener les phénomènes intellectuels et sensoriels à la source initiale, cette essence unique perpétuellement féconde en ses modes [2] ». Comme les autres arts, elle participerait donc à ce retour à l’Unité primordiale du monde dont les poètes recherchent les linéaments à travers l’Universelle analogie.
Dès lors, la conjonction des arts mise en œuvre par Wagner s’intègre parfaitement à cette idée centrale. Pour les tenants du wagnérisme tel qu’il est défini par Fourcaud dans le premier numéro de la revue dédiée au musicien allemand et à son influence, « il faut donc, comme Wagner le demande, que le poème, la musique et le décor se complètent l’un l’autre, que l’un soit conçu pour l’autre et qu’ils constituent, en leur trinité, une œuvre une et parfaite [3] […] ». Il ne s’agit plus seulement des genres ni même des arts, mais d’un effacement de toutes les frontières pour revenir à l’harmonie indéterminée des origines. Se présentant comme le porte-parole du mouvement avec son ouvrage La Littérature de tout à l’heure, Charles Morice définit clairement cette théorie à la fois cosmique et artistique qui préside aux tentations de synthèses des modalités de la création, souhaitant la
[…] réunion de toutes les puissances humaines par un retour à l’originelle simplicité. Ce retour à la simplicité, c’est tout l’Art. LE Génie consiste – comme l’Amour et comme la Mort – à dégager des accidents, des habitudes, des préjugés, des conventions et de toutes les contingences l’élément d’éternité et d’unité qui luit, au-delà des apparences, au fond de toute essence humaine [4].
Les genres littéraires se trouvent donc tout naturellement entraînés dans ce grand courant de réunification pacifiée, s’effaçant au profit de l’harmonie retrouvée. Morice y insiste lui-même dans la suite de son ouvrage : « […] les vieux “genres” tendent de plus en plus à se fondre en l’unique et essentielle Œuvre-d’art-écrite [5] […] ». La notion même de genre se dissout alors dans le triomphe de l’Un.
Sur ces bases théoriques, les tentatives de synthèse vont se multiplier à : synthèse des phénomènes représentés, synthèse des réalités spirituelles, synthèse des genres et même de ces formes d’expression que sont le vers et la prose. Le genre littéraire est en réalité contesté comme ensemble de traits divers, organisés en réseau cohérent et indissoluble. Ces traits ou features dont Alastair Fowler, dans Kinds of literature [6], dressait la liste en la considérant comme un véritable répertoire, acquièrent dès lors une certaine autonomie. Ils peuvent désormais, dans l’esprit des symbolistes, circuler d’un genre à l’autre, donnant naissance à des phénomènes d’hybridation ou de transformation. Ainsi cette aspiration à l’Unité va paradoxalement libérer des traits des liens étroits qu’ils pouvaient entretenir avec des genres codifiés et, par-là, les disperser : la prose n’appartient plus nécessairement au roman, pas plus que le vers n’est consubstantiel au poème. Yves Stalloni note d’ailleurs que « la contestation la plus nette du classement et de la modélisation réside dans la contamination des formes et ce que l’on peut nommer le métissage générique [7] », mentionnant dès lors le roman en vers ou autres textes hybrides. Le symbolisme, qui peut s’appuyer dans cette perspective sur les conquêtes réalisées par les romantiques, qui avaient fait éclore le poème en prose, va aller plus loin encore en donnant naissance au vers libre. Celui-ci va notamment émerger d’un désir de souplesse de la langue poétique qui doit désormais s’adapter au plus près aux fluctuations des états d’âmes et des sensations, à l’heure où les écrivains sont de plus en plus sensibles aux impressions fugaces auxquelles le monde les soumet.
Mettant le subjectivisme à l’honneur pour rendre compte du fait que « le monde est ma représentation », axiome schopenhauerien dont beaucoup, tel Remy de Gourmont [8], feront leur mot d’ordre, les symbolistes émancipent ainsi le vers de son carcan de règles et de normes désuètes. Tancrède de Visan le proclame haut et fort : « La pensée ne doit plus s’astreindre à une forme poétique accomplie, mais créer son propre mouvement, son rythme exact, ses accents variés, ses temps forts et faibles qui dessinent sa grâce sinueuse et son dynamisme intérieur [9]. » L’exigence du travail du rythme s’est en effet substituée aux normes de la poésie versifiée. Par le rythme, le vers doit être surtout rendu à l’initiative individuelle du poète, comme tous l’ont souligné. Gustave Kahn, bien sûr, n’est pas le dernier à mettre en avant cette ouverture à l’expression de l’individu pour promouvoir ce qu’il présente comme son invention, à laquelle il serait parvenu dans ses Palais nomades (1887) par la recherche d’« un rythme personnel [10] ». L’écrivain développe cette idée un peu plus loin dans cette préface sur le vers libre publiée en 1897. Reprenant une déclaration formulée dès décembre 1888 [11], il affirme ainsi que cette forme nouvelle doit permettre à tout poète « de concevoir en lui son vers ou plutôt sa strophe originale, et d’écrire son rythme propre et individuel [12] […] » – une proclamation qui semble directement calquée sur le compliment que Mallarmé lui adressa suite à l’envoi par Kahn de ses Palais nomades : félicitant l’auteur, le Maître salue l’invention d’une forme qui doit permettre désormais à « quiconque musicalement organisé » de « se faire une métrique à part soi », « en face du rythme officiel de la langue, notre vieux Vers [13] ». Remy de Gourmont, pour lequel le symbolisme lui-même se définit comme « l’expression de l’individualisme dans l’art [14] », voit tout naturellement dans le vers libre une manifestation caractéristique de cette prérogative. À travers le vers libre, « les poètes l’ont enfin compris, […] ils doivent se fabriquer, ou avoir l’air de se fabriquer eux-mêmes, leur instrument [15] », comme il le souligne à nouveau dans la préface de son recueil publié en 1912, Divertissements.
Dès lors, cet instrument doit se montrer apte à endosser de multiples formes répondant aux myriades d’états d’âme dont ces artistes sont agités. Lorsqu’André Beaunier reviendra des années plus tard sur la conquête du vers libre, ce sera pour balayer d’un revers de la main toute tentative de répression et de régression, moquant de manière particulièrement acide les réactionnaires de la poésie :
Ils [les adversaires du vers libre] se désolent et s’indignent parce qu’on les a privés d’une distinction bien commode qu’ils étaient habitués à faire, avec le pion de M. Jourdain, entre la prose et les vers. Si la métrique nouvelle tend à faire disparaître cette absolue séparation entre deux modes opposés du langage, – deux et seulement deux, – elle sera bienfaisante encore, car entre le plus haut lyrisme et la prose d’affaire on peut concevoir bien des espèces intermédiaires de style, – et qu’on nous débarrasse donc de ce formalisme [16] !
Ainsi, le vers libre n’est pas seulement une forme d’expression de plus : il devient la manifestation d’un éclatement des carcans imposés et le viatique pour la libération totale de la créativité littéraire. Une telle invite se voit confortée par la promotion de l’originalité au rang de valeur dominante : Pierre Citti évoque ainsi la « garantie de l’originalité [17] » qui gouverne la littérature symboliste et guide son appréhension. L’époque semble enfin accéder aux vœux de Victor Hugo qui réclamait déjà, dans sa préface aux Odes et ballades, que la littérature puisse donner libre cours à son inventivité native :
La pensée est une terre vierge et féconde dont les productions veulent croître librement et, pour ainsi dire, au hasard, sans se classer, sans d’aligner en plates-bandes comme des bouquets dans un jardin classique de Le Nôtre, ou comme les fleurs du langage dans un traité de rhétorique [18].
Or, il est frappant de retrouver sous la plume de Remy de Gourmont, presque cinquante ans plus tard, la même métaphore végétale au service d’une même revendication :
[…] il importe qu’à côté des formes connues on tolère des formes inconnues et que de la serre chaude de la Littérature on n’expulse pas les plantes nées de graines de hasard, ignorées des catalogueurs et des jardiniers [19].
La création littéraire affirme ainsi son affranchissement vis-à-vis des classifications impératives : désormais, elle doit s’écrire en dehors de toute catégorie préétablie, loin des cloisonnements, fidèle seulement à l’inspiration personnelle et individuelle de l’auteur. Les genres et les formes qui leur étaient associées perdent alors toute valeur prescriptive et coercitive. Afin d’assumer cette ouverture nouvelle, des revues comme le Mercure de France ou La Revue blanche choisiront dans leur table des matières de ne plus classer les textes publiés – même si d’autres organes symbolistes comme La Plume persistent à les ordonner en « Poésies », « Romans », « Théâtre », etc. Le refus de classer est désormais dans l’air, répondant aussi au refus de la rationalité qui donne son dynamisme au mouvement. Rapprochant sous cet angle le symbolisme du Romantisme allemand, Tancrède de Visan déclare ainsi que les deux mouvements « luttent avec la même énergie contre un rationalisme étroit et un positivisme anti-poétique [20] ». Seules l’émotion spontanée, la sensation fugace et les libres jeux du langage et de ses symboles doivent désormais donner son essor à la création. C’est donc d’abord par son rejet de la tradition rhétorique que va s’exercer cette révolte contre le rationalisme en art, ainsi que Dominique Combe le souligne dans son étude des Genres littéraires [21]. Désormais, les notions même de convenance et de cohérence héritées d’Aristote sont battues en brèche par les expérimentations symbolistes qui refusent de s’assujettir à des logiques restrictives.
L’éclatement des genres qui se produit dans les années du Symbolisme a cependant encore bien d’autres causes, plus ou moins liées aux précédentes. Théâtre, poésie et roman tendent à se rapprocher autour de la domination de l’un d’entre eux, le genre placé au sommet de la hiérarchie littéraire pour son rapport intime à l’émotion et à la connaissance intuitive du monde – du moins selon l’image que s’en font les Symbolistes : la poésie. Genre suprême parmi tous, elle impose ses orientations, contamine tous les autres genres et tend à se les annexer. Selon Bertrand Marchal, d’ailleurs, de ce fait « la question des genres […] ne se pose pas, ou ne se pose plus [22] ». Un seul subsisterait désormais, rendant inopérante toute taxinomie : la poésie, déclinée sous toutes ses formes et à la définition suffisamment assouplie pour englober tous les autres.
En effet, comme cela a souvent été observé, l’on attendra désormais du roman et du théâtre les mêmes abstractions et généralités que celles qui caractérisent selon les auteurs symbolistes la poésie lyrique, devenue seule sur le champ poétique depuis l’exclusion du récit étudiée par Dominique Combe [23]. Dès son Manifeste de 1886, Jean Moréas annonce ainsi que « la prose, – romans, nouvelles, contes, fantaisies, – évolue dans un sens analogue à celui de la poésie [24] ». Dès lors, les personnages romanesques vont s’étioler jusqu’à devenir de simples silhouettes, ou l’incarnation d’Idées abstraites. Au théâtre même, l’on s’efforcera de faire disparaître la présence scénique de l’acteur et de dépouiller au maximum le décor. Une lecture radicale de Mallarmé par ses disciples conduit à produire un théâtre idéaliste vide de chair. Dans les deux cas, toutes les contingences de la fiction – lieux, époques, apparences concrètes et individualisées – seront le plus possible effacées et écartées, malgré le risque de désincarnation délétère que cela peut représenter pour les œuvres concernées. Pour le poème lui-même, le modèle qui s’érige est celui d’une poésie pure, délestée de ses supposées lourdeurs référentielles. Au sein du roman, du théâtre comme de la poésie, les œuvres s’appuient sur un dénominateur commun qui affiche la réduction du matériau en jeu – espace-temps, personnages, récit – à des abstractions visant l’absolu. C’est précisément dans ce qui en constituait les spécificités, les singularités, que les genres se trouvent « lissés », nivelés selon une même orientation.
Dans le même temps, les différents genres se rejoignent par un même emploi de la langue, a priori jusqu’ici rattaché avant tout à la poésie : l’accent porté sur la forme au détriment du fond, provoquant même parfois l’évanouissement de toute signification stable, délaissant l’ambition mimétique au profit de la polysémie et de la suggestion qui en libère l’accomplissement. De cette manière, la question du sens ne joue plus son rôle dans les identités génériques, provoquant l’effondrement des distinctions : pour Claude Abastado, « les Symbolistes, par leur indifférence au contenu, sapent dans son principe toute typologie [25] ». De la sorte, et si les mots ne renvoient plus à des réalités bien définies, les figures de la fiction ne peuvent plus prendre vie, leurs aventures se délitent comme les linéaments d’une toile infiniment ténue, et le texte lui-même flotte dans l’indétermination sémantique. La littérature se résout alors en un art de la rêverie vague et de la contemplation intérieure, ou dans l’autotélisme le plus radical.
C’est cette nouvelle proximité des trois principaux genres de l’époque – poésie, théâtre, roman – par l’étiolement de leurs différenciations qui conduit certains symbolistes à mêler et confondre sans scrupules leurs dénominations, même à propos d’auteurs extérieurs au mouvement. Ainsi, Édouard Dujardin fait l’éloge de Racine comme un « suprême romancier d’âme » puisque son théâtre serait « écrit sans indications scéniques, pour des diseurs de cour, sans décors », et deviendrait par-là « le drame non théâtral, et le drame d’âme [26] ». Dujardin peut alors l’invoquer comme modèle de son roman entièrement écrit en monologue intérieur, Les Lauriers sont coupés : lui-même, en supprimant l’intervention de tout narrateur extérieur, veut être l’équivalent du « monologue traditionnel [27] » au théâtre. De même, Teodor de Wyzewa désignera l’Axël de Villiers de l’Isle-Adam comme un « roman dialogué [28] ». Simultanément, le roman deviendra quant à lui fréquemment un « roman-poème », « roman poétique » ou même « roman lyrique », sous-titre que l’on trouvera accolé aussi bien à un recueil de poèmes en prose comme les Chansons de Bilitis [29] qu’à un récit comme le Lucienne de Paul Fort [30].
De telles étiquettes tendent en réalité de plus en plus à se désolidariser de tout contenu défini. Au contraire, on assiste alors à l’expansion de ce que Michel Murat a appelé un « usage ludique de l’étiquetage [31] » voué à engager un jeu avec le lecteur qui se chargera lui-même d’en saisir la teneur et de conférer une identité à ces ouvrages hybrides. On pense en l’occurrence au poème versifié que Mallarmé intitule « Prose pour des Esseintes », ou encore aux noms de genres oubliés, à la désuétude toute suggestive, et qui se voient ici réactualisés, telle l’églogue dont le poète baptise son Après-midi d’un faune, ou à la sotie chère à André Gide. Après les genres eux-mêmes, les noms de genres perdent également leur identité stable : d’outils identificatoires et classificatoires, ils deviennent suppléments de sens apportés à l’œuvre. Le sous-titre générique ou même simplement formel peut alors devenir un exemple de création littéraire à part entière, notamment lorsqu’il se complète d’une spécification thématique, comme le roman de la vie cérébrale qu’est Sixtine de Remy de Gourmont ou encore le roman matérialiste de Rachilde, Monsieur Vénus. De telles désignations, qui invitent à toutes sortes de conjectures et de divagations dépassant largement la question du genre, se montrent dès lors prêtes à endosser des fonctions diverses.
La première d’entre elles demeure quoi qu’il en soit communicationnelle voire commerciale. Elle peut dès lors, et au premier chef, répondre aux besoins financiers de ces écrivains déchirés entre leur élitisme et leurs nécessités vitales. Comme l’a montré Valérie Michelet-Jacquod [32], les symbolistes se tournent parfois vers le roman en espérant un plus grand succès commercial que celui que procure une poésie de plus en plus absconse. Plus généralement, le sous-titre fonctionne encore comme le support d’un horizon d’attente qui répondra aux interrogations du lecteur et pourra déclencher son choix en librairie, si ce n’est l’acte d’achat lui-même. C’est ce que porte au jour la réflexion d’Alfred Jarry dans un article intitulé « La Tiare écrite » :
[…] l’acheteur d’un livre veut savoir quel genre de livre c’est, avant de faire le geste d’acheteur. Nous employons à dessein le mot genre, car les « genres » subsistent toujours : on imprime toujours sur une couverture blanche, jaune ou illustrée : « roman » ou « poème ». Ou tout au moins on typographie ou on rythme différemment dans l’intérieur [33].
À cette époque où les noms de genres se rattachent à des catégories de plus en plus instables cependant, cette attente risque souvent d’être déçue. Mais peu importe :
L’acheteur d’un volume veut voir ce qu’il y a dedans, laquelle vision s’opère par la lecture ; mais s’il lisait avant, combien peu solderaient leur vision ? Il se contente, de par l’intervention du libraire, de vouloir prévoir [34].
Le sous-titre générique devient alors le lieu d’une tension entre les attentes et le contenu réel, aussi bien que d’un jeu entre la généricité auctoriale et la généricité lectoriale, pour reprendre la distinction de Jean-Marie Schaeffer [35] : le genre choisi ou déterminé par le créateur ne sera pas forcément celui que le lecteur pourra à son tour identifier. Mais pour un certain nombre des auteurs de ces romans qu’on a parfois pu nommer célibataires, tant ils ne répondent en rien à une classe connue du paysage générique, l’inclusion dans une famille littéraire reste rédhibitoire. L’œuvre demeure alors inclassable dans sa forme comme dans son contenu : roman sans véritable trame narrative, à la chronologie contrecarrée par une temporalité erratique, aux personnages inconsistants, à l’action abstraite et allusive. L’apposition d’un sous-titre le désignant malgré tout comme tel joue alors une fonction performative : c’est parce qu’il est dit roman, parce que selon son auteur, il se reconnaît dans ce genre, que le livre peut être admis comme roman et qu’il va pouvoir devenir roman. Ce baptême forcé œuvre alors en faveur du dynamisme du genre en le faisant évoluer, le rappelant à sa vocation originelle puisque selon Fowler « pour avoir une quelconque signification artistique, pour signifier quelque chose de distinctif en littérature, une œuvre doit moduler, varier ou s’écarter de ses conventions génériques, et en conséquence les altérer pour l’avenir [36] ». Le genre littéraire va alors pouvoir admettre de nouvelles acceptions et inclure de nouveaux représentants.
Cette inflexion est cependant d’autant plus possible qu’il s’agit ici du roman, genre sans règles par son origine même. Dans d’autres catégories, comme le théâtre, les créations bizarres ou monstrueuses des symbolistes invitent plutôt à forger de nouvelles appellations aptes à englober et à désigner le plus justement possible leur singularité : c’est ce qu’a réalisé par exemple Yves Vadé [37] en désignant César-Antechrist d’Alfred Jarry ou L’Enchanteur pourrissant d’Apollinaire comme des oratorios littéraires. Ces œuvres évitent alors la pleine exploitation de la dimension dramatique, actionnelle du théâtre pour lui préférer une texture poétique, plus onirique et littéraire, jouant sur une alternance de dialogues et de didascalies prolongées conçus comme autant de modalités d’expression du drame lyrique. On pourrait encore mentionner le monologue de cabaret qui prend naissance à cette même époque autour de Coquelin cadet ou Charles Cros, dans le sillon des Hydropathes, ou d’autres genres mineurs.
Les œuvres inclassables qui émergent aux temps du Symbolisme peuvent donc in fine s’ordonner par l’invention de nouvelles catégories génériques rassemblant ce qui se voyait disjoint, séparant ce qui semblait intrinsèquement lié et recomposant de nouveaux ensembles de traits à même de constituer de nouveaux genres. Ces derniers peinent ou peineront cependant sans doute encore longtemps à se compléter, à devenir de véritables familles de textes et à basculer réellement de la singularité à la collection qu’établit normalement toute catégorie générique. Même s’il reste possible de les nommer, de les baptiser en termes génériques, ces œuvres sont sans doute vouées à demeurer isolées voire célibataires, comme on a pu l’affirmer à propos de certains romans de l’époque [38].
Cet amenuisement du lien collectif ne signe cependant pas la mort du genre, bien au contraire. Les auteurs symbolistes, dans leur refus même de classer leurs œuvres, ne cessent cependant de renvoyer aux formes et aux catégories génériques connues pour présenter et penser leurs créations : Gustave Kahn doit l’admettre lui-même, les genres perdurent, ne serait-ce que comme points de repère permettant l’élaboration de la pensée. Il en fait l’aveu à l’ouverture de son article de 1897 sur « Les Tendances actuelles de la littérature » :
Quel est le chemin parcouru, quelles conquêtes faites ? On pourrait énumérer des noms de novateurs, en indiquant leur part personnelle et leur sillon. Il est sans doute plus logique de chercher dans les genres quelles modifications ceux-ci ont subies. Ces genres, quoique démantelés de leurs anciennes murailles de Chine, quoique secoués, fouillés, retournés par des mains fiévreuses, tiennent encore assez debout pour nous servir de points directeurs [39].
Sans le savoir, Kahn annonce ce qui constituera le cœur de la pensée sur les genres mais aussi sa réhabilitation comme notion. Une fois que l’on se sera écarté d’une compréhension essentialiste et fixiste de ces catégories, et que l’on sera passé « du genre à la généricité », pour reprendre une proposition de Jean-Michel Adam et Ute Heidmann [40], le genre retrouve une légitimité largement contestée : désormais, la recherche d’une assimilation de l’œuvre à de grands ensembles hérités de la tradition ou de décrets autoritaires laisse place à l’éclosion d’ensembles restreints et à une compréhension relative qui invitent à envisager le genre sous un nouveau jour.
Ainsi, les Symbolistes jouent un rôle décisif dans l’évolution de la notion de genre : ils y parviennent de manière plus ou moins consciente par le primat qu’ils accordent à l’originalité, mais aussi par leur recherche d’une littérature gouvernée seulement par la spontanéité créatrice, qu’elle soit quête d’une unité perdue ou, au contraire, dispersion en de multiples petites formes. Leur refus de classer aboutit donc en réalité à l’éclosion de nouveaux types de classements : plus libres et plus limités dans leur extension, ceux-ci se dessinent souvent dans l’écart vis-à-vis des grands modèles génériques et s’affirment en construction progressive et permanente.