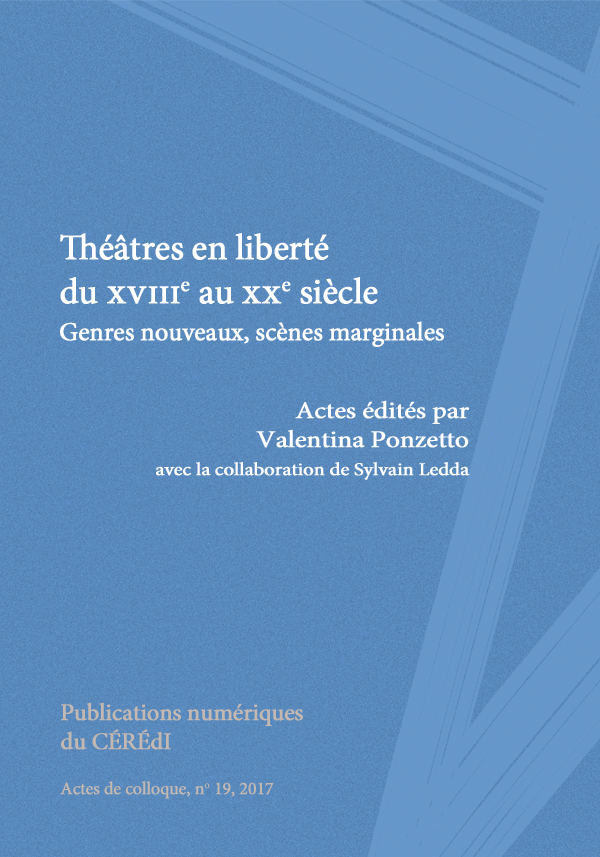« Quand on veut vraiment faire du théâtre, on en fait n’importe où, dans un grenier, dans une grange, dans une cave [1]. » confie Charles Dullin au Figaro en 1939. De la cave au cabaret, il n’y a qu’un pas, aisément franchi après la Seconde Guerre mondiale alors qu’à Paris de nombreux cabarets ouvrent leurs portes et leurs scènes au genre dramatique. À partir de 1946, à la Rose Rouge, à l’Amiral, Chez Gilles, à la Fontaine des Quatre Saisons et dans quelques autres petits lieux exigus souvent peu confortables, pour le prix d’une consommation, on peut, en fin de soirée, après avoir fréquenté les salles de théâtre officielles, applaudir un autre spectacle. La nouveauté de la formule étonne les contemporains. Avant la guerre, le cabaret, ou cabaret-dancing, était surtout un lieu de divertissement nocturne « pour boire, danser et flirter [2] ». Le « cabaret-théâtre » tel que le découvre l’après-guerre « s’est entièrement renouvelé [3] » et « a, peu à peu, supplanté le dancing, c’est-à-dire que les attractions (entendez, le spectacle), ont pris le pas sur la danse [4] » : « Une révolution complète, totale, absolue s’est effectuée [5]. » À la Libération, la position du cabaret change donc : il entre dans le champ théâtral et construit, en marge des scènes instituées, sa propre programmation dramatique. Quelle place ce « nouveau cabaret [6] » tient-il au sein de la création théâtrale contemporaine, qui voit au même moment se constituer un « nouveau théâtre » ? Il s’agira d’envisager ce qu’une réflexion sur un lieu marginal et peu considéré par l’histoire littéraire, ce qu’un regard décentré, peuvent précisément apporter, au-delà d’une simple curiosité anecdotique, à l’histoire de la création théâtrale.
Le cabaret-théâtre : un nouvel espace de création dramatique
À la différence des cabarets-dancings que l’entre-deux guerres avait relégués au rang de distraction mondaine, de divertissement sans prétention artistique, le chapelet de cabarets qui voit le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est rapidement intégré à un tissu théâtral dynamique alors en plein renouvellement. Georges Vitaly, l’un des animateurs de cette effervescence, évoque un « nouveau théâtre en pleine gestation depuis la Libération [7] », que perçoit également la critique : Jacques Lemarchand affirme que l’époque « est parfaitement dramatique [8] » et Jean Duvignaud est sensible à « la haute tension théâtrale [9] » qui nimbe les années d’après-guerre. Les spectacles de l’Occupation sont donc vite oubliés et paraissent « vieillir et s’enfoncer dans un passé déjà lointain » immédiatement après « l’insurrection parisienne [10] ». À la Libération, s’émancipe la création dramatique.
Ce printemps théâtral, dont la réalité est entérinée par le « Discours sur l’avant-garde » de Ionesco en juin 1959 [11], se manifeste d’abord par l’éclosion de nouvelles salles, principalement situées sur la rive gauche de la Seine, au Quartier Latin et à Saint-Germain-des-Prés, qui jouit d’après Boris Vian d’un « renom littéraire » propice aux innovations artistiques [12]. Ces lieux dramatiques neufs, qui « vont révolutionner la scène » d’après Marie-Claude Hubert [13], ont pour nom Théâtre de Poche, de la Huchette, des Noctambules, de Lutèce, du Quartier Latin, de Babylone ou de la Gaîté-Montparnasse. Ils ont pour points communs l’exiguïté de leur scène et l’inconfort de leurs installations – Albert Camus parlera de « pissotières [14] » –, que rien ne prédisposait à un quelconque avenir théâtral. C’est dans une ancienne salle paroissiale que s’installe ainsi le théâtre de Lutèce, dépourvu de coulisses et dont les loges sont situées sous la scène. Le théâtre de Babylone est quant à lui aménagé en 1952 dans les locaux d’une revue politique. Dès 1943, au théâtre de Poche,
en quatre pas, le spectateur qui vient de franchir la porte se trouve en contact avec la rampe. Ce qui n’est qu’une façon d’écrire (ou de parler) car de rampe il n’y a point, pas plus d’ailleurs que de herse, ni de dessous, ni de cintre, ni bien entendu de lointain [15].
Le plus remarquable reste sans doute le théâtre de la Huchette créé par Vitaly en 1948, dont André Reybaz raconte les débuts fort précaires :
On trouve un local, pas bien grand, mais pas bien cher, rue de la Huchette, une manière de soupe populaire arménienne avec dans l’arrière-cuisine une édition de brochures pornographiques. On achète [16].
Et Vitaly de complèter :
Avec le recul, je me suis souvent demandé si quatre-vingts fauteuils, dix tabourets – prévus en cas de succès, et toujours entassés dans la minuscule entrée –, douze mètres carrés de scène, qu’une gouttière longeait en guise de rampe, pouvaient, malgré des équipements plus que sommaires, prétendre être un vrai théâtre [17].
Les scrupules du metteur en scène, incertain de la nature du lieu qu’il fonde, facilitent le rapprochement entre ces « petits théâtres » et les cabarets qui voient le jour au même moment dans les mêmes quartiers, et révèlent leur insertion parallèle dans un espace théâtral repensé. Les lieux se ressemblent en effet, l’exiguïté étant aussi le propre du cabaret. Ces affinités spatiales n’ont rien de fortuit, sous-tendues par de fréquentes parentés. Notons ainsi avec Audiberti que « le théâtre des Noctambules est un ancien tréteau de chansonniers [18] » – un cabaret, donc, créé par Martial Boyer en 1894, transformé en théâtre en 1939. Le théâtre du Quartier Latin a connu un destin similaire [19], tandis qu’Agnès Capri, qui inventait le « cabaret-théâtre » en 1938, prend la direction de la Gaîté-Montparnasse en 1945 [20]. Du reste, cabarets et théâtres unissent volontiers leurs forces : Vitaly ouvre ainsi un cabaret au sous-sol de la Huchette en 1950 et c’est Michel de Ré, installé au théâtre du Quartier Latin, qui rebaptise le cabaret des Folies Furieuses après y avoir donné en 1950 une pièce éponyme [21]. Il n’est donc guère étonnant de voir les cabarets s’essayer au théâtre, prenant pour modèle l’établissement créé avant-guerre par Agnès Capri, rue Molière. La Rose Rouge ouvre la voie et programme L’Étranger au théâtre, une pièce d’André Roussin mise en scène par Yves Robert, lors de l’inauguration de son nouveau local, rue de Rennes, en septembre 1948. Suivront, deux mois plus tard, Une petite suite en noir et Terror of Oklahoma, de nouveau réglé par Yves Robert, sur un texte d’Albert Vidalie. Le succès étant au rendez-vous – la Rose Rouge devient bientôt « un mot de passe, un mot d’ordre et de ralliement [22] » –, Chez Gilles, puis la Fontaine des Quatre Saisons, mais aussi le Caveau de la Huchette et le Tabou, qui rajeunit alors sous de nouveaux auspices dramatiques, adoptent la formule et intègrent de petites pièces de théâtre à leurs spectacles [23]. Alors que les efforts d’Agnès Capri faisaient encore figure de curiosité insolite en 1939, on parle désormais communément de « cabaret-théâtre » : le trait d’union pointe l’intégration nouvelle du cabaret au monde du théâtre [24].
Les réseaux de sociabilité artistique auxquels les cabarets sont associés valent pour preuve de cette assimilation récente. Les jeunes animateurs (auteurs, acteurs et metteurs en scène) du « nouveau théâtre » tel qu’on ne tardera pas à le nommer – Ionesco parlera de « théâtre nouveau » en 1959 et Jacques Lemarchand de « Nouveau Théâtre » en 1961 [25] –, fréquentent en effet les cabarets et s’y produisent volontiers. Les acteurs circulent d’un lieu à l’autre. Jacques Fabbri, par exemple, qui fait ses armes au cabaret – il donne un sketch d’Alphonse Allais aux Folies Furieuses en 1950 et L’Amnésique à l’Écluse en 1952 –, joue aussi à la Huchette, dans Monsieur Bob’le de Georges Schéhadé, mis en scène par Vitaly en février 1951. Deux ans plus tard, il fonde sa propre troupe, et dirige Les Hussards de Pierre-Aristide Bréal aux Noctambules [26]. Jacques Grello, Raymond Devos et Jean Bellanger, qui font partie de l’aventure, sont tous des « transfuges du cabaret [27] ». De même, Yvonne Clech, qui tient le rôle de Madeleine dans Amédée ou comment s’en débarrasser de Ionesco au théâtre de Babylone en 1954, a été parmi les premières à jouer la comédie Chez Gilles en 1949, dans une parodie de La Tour de Nesle de Dumas.
Des dramaturges font aussi l’épreuve de ces « quasi-théâtres » que sont les cabarets. François Billetdoux, qui signe une partie des sketches de Treize pièces à louer au théâtre du Quartier Latin en 1951 [28] avant d’écrire Tchin-Tchin, seul cette fois, pour le théâtre de Poche en 1959, chemine entre temps de l’Écluse à l’Échelle de Jacob en passant chez Milord l’Arsouille, où il égrène ses « monologues à dire ». Jean Tardieu, dont le Théâtre de chambre sera honoré à plusieurs reprises à la Huchette par Jacques Polieri [29], n’intimide pas Agnès Capri : elle fait découvrir Un mot pour un autre rue Molière, que Jacques Lemarchand « aimerai[t] » voir « remplac[er] parfois Un Caprice à la Comédie-Française [30] ». Mais c’est à Boris Vian que l’on doit sûrement le plus impétueux va-et-vient du cabaret au théâtre. Il écrit tout à la fois pour le théâtre – le théâtre Verlaine donne une adaptation de J’irai cracher sur vos tombes en 1948 et L’Équarrissage pour tous est monté par André Reybaz aux Noctambules en avril 1950 –, et pour le cabaret. En 1951, le spectacle d’anticipation Ça vient, ça vient est présenté à la Rose Rouge. La même année, on peut applaudir Chez Gilles À chacun son serpent, un « mystère » burlesque. Cinémassacre ou les cinquante ans du septième art, surtout, créé à la Rose Rouge en avril 1952, retient l’attention de la critique.
Les metteurs en scène n’échappent pas à ces échanges suivis. Si Roger Blin, découvreur d’Adamov et de Beckett, fréquente le Bar Vert, Michel de Ré, quant à lui, « croit au cabaret-théâtre [31] ». Outre les spectacles qu’il règle au Caveau de la Huchette et aux Folies-Furieuses, il offre ses services à Agnès Capri pour Zig-Zag 50 : c’est donc lui qui fait applaudir Un mot pour un autre. C’est encore lui qui met en scène À chacun son serpent de Vian, sans pour autant jamais cesser de fréquenter les théâtres. Après avoir essayé La Tour Eiffel qui tue de Guillaume Hanoteau au Caveau de la Huchette, il présente en effet ce « roman feuilleton musical en douze tableau [32] » au théâtre du Vieux-Colombier, puis se consacre pleinement au théâtre du Quartier Latin, qui l’accapare à partir de 1951 [33].
Il n’est pas jusqu’aux décorateurs qui n’oscillent d’un lieu à l’autre : Jacques Noël conçoit les décors du Dîner de têtes de Prévert à la Fontaine des Quatre Saisons, mais aussi de Tous contre tous d’Adamov au théâtre de l’Œuvre et de La Cantatrice chauve de Ionesco à la Huchette.
Le « nouveau théâtre » hors les murs
Ces collaborations incessantes nous invitent à réparer l’oubli dans lequel l’histoire littéraire et théâtrale tient presque absolument le cabaret [34] et à envisager une possible communauté esthétique entre les spectacles de minuit créés entre 1948 et 1954 et le « théâtre nouveau » alors en pleine élaboration, « dont les frontières sont fort heureusement mal définies et mouvantes [35] », susceptibles, donc, d’inclure les pochades de cabaret. Exposant les débuts de ce nouveau théâtre, Marie-Claude Hubert effectue d’ailleurs un rapprochement discret mais significatif :
En février 1950, Michel de Ré fait connaître Tardieu avec Un mot pour un autre, en avril Reybaz révèle Boris Vian avec L’Équarrissage pour tous. En mai Nicolas Bataille donne, sans succès, La Cantatrice chauve [36] […].
Cette Cantatrice chauve que Ionesco considère comme « une des toutes premières pièces de ce théâtre qu’on a pu appeler la nouvelle avant-garde d’après-guerre [37] » est donc précédée de quelques mois par un spectacle de cabaret – rappelons qu’Un mot pour un autre est joué chez Agnès Capri – dont la chercheuse se garde bien de préciser l’origine. Ce qu’à la suite du sketch de Tardieu, de nombreuses saynètes de cabaret partagent avec leurs « grands contemporains, Ionesco et Beckett », « c’est la volonté de changer un peu le théâtre [38] ». Elles s’efforcent, comme le suggère à son tour Ionesco, de « dépouiller l’action théâtrale de tout ce qu’elle a de particulier, son intrigue, les traits accidentels de ses personnages, […] les raisons apparentes du conflit dramatique, toutes justifications, toutes explications, toute la logique du conflit [39] ».
La structure dramatique de ces pièces est en effet volontiers malmenée. Le format rapide du sketch, privilégié au cabaret, facilite l’éclatement de l’intrigue, qui perd, dans la précipitation et la succession des scènes, sa forme et son sens. Dans Ça vient, ça vient de Boris Vian, on passe ainsi, en une cascade de tableaux, d’une salle de rédaction de journal aux « pentes glacées de l’Himalaya [40] », puis au détroit de Gibraltar, course qui s’achève avec fantaisie et sans logique dans les locaux de recrutement de la Légion martienne. Bâti sur une suite de meurtres gratuits, le sketch « Gangster » de Cinémassacre accentue encore l’arbitraire de sa composition en exhibant grossièrement les rouages de son fonctionnement. Il s’achève en effet de la manière suivante :
LA FILLE – Salut, je remplace Chick. (Encore un ou deux meurtres, puis quelqu’un s’amène avec une grosse pancarte : ETC., ETC. [41])
La fille remplace Chick, comme le Barman avant elle, de même que les Martin se substituent aux Smith à la fin de La Cantatrice chauve. Dépourvus de toute psychologie, les personnages sont en effet interchangeables, comme Nestor et Oscar dans Les Harengs terribles d’Alexandre Breffort, joué Chez Gilles. Dans ce « fait-divers tragi-comique et du milieu en trois déchéances et une rédemption [42] », Nestor le Fripé se déguise en Monsieur Oscar pour obtenir deux fois les faveurs d’Irma la Douce dont il est le souteneur, tant et si bien que Nestor et Oscar en viennent à constituer deux personnages distincts :
NESTOR LE FRIPÉ – Elle m’a trompé. Avec qui ? Mais avec moi. L’être ou ne pas l’être. Je le suis [43].
Les tourments métaphysiques du héros shakespearien servent ici de contrepoint comique à la désagrégation toute formelle du personnage par ce théâtre qui fait de la parodie un ressort privilégié. Ce sont surtout les genres dramatiques institués qui sont tournés en « dérision » – autre posture que partagent le cabaret et le théâtre dit d’avant-garde [44]. Comme La Cantatrice chauve après lui, L’Étranger au théâtre d’André Roussin se moque ainsi du théâtre de boulevard : tout en convoquant les traceurs du genre – intérieur bourgeois, cercle familial, portes qui claquent [45] –, il en révèle le caractère conventionnel. Les personnages s’expriment en effet dans un sabir qui rend leurs dialogues tout à fait incompréhensibles : le vaudeville se réduit alors à un cadre sans contenu, à une vaine et insignifiante mécanique :
JEUNE HOMME (indiquant ses souliers relativement propres) – Nékotitio yamin radikish.
MONSIEUR (se frottant les mains et secouant les épaules, allant vers le poêle) – Lacoum totürst.
JEUNE HOMME (poli mais distant) – Yot, yot ; ist era traï, tibiatt.
MADAME – Yot ! Tratun [46] !
De la convention au cliché, il n’y a qu’un pas, que franchissent sans cesse les spectacles de cabaret pour mettre en cause les raideurs du langage et de la pensée, dont la représentation tire sa saveur comique. Là encore, le dialogue avec l’avant-garde est évident, qui révèle, en l’exacerbant, l’inconsistance burlesque de la « parlerie quotidienne [47] ». Ce commentaire du narrateur dans Les Harengs terribles est exemplaire d’une telle démarche : « Elle n’avait rien vu. L’amour étant aveugle, ils s’engouffrèrent dans l’hôtel borgne [48] ». L’obscurité du langage « où foisonnent non-sens et quiproquos [49] » est aussi éreintée avec humour au cabaret. À cet égard, la leçon de danse inintelligible de La Tour Eiffel qui tue anticipe sur le jargon des guides de musées raillé par Tardieu dans La Société Apollon ou Comment parler des arts, ou celui des technocrates, ridiculisé dans Tueur sans gages de Ionesco :
Allons, messieurs… le corps perpendiculaire au plancher… par une translation ayant son centre dans l’orteil du pied droit, le corps décrit un arc de cercle de quarante degrés […]. La jambe gauche trace une ellipse ayant un de ses foyers dans l’os cubitus [50].
La langue cocasse que parlent les personnages de L’Étranger au théâtre ou d’Un mot pour un autre n’a rien à envier non plus sur le plan de la fantaisie et de l’extravagance aux chapelets de lieux communs sans fondement qu’égrènent les époux Smith dans La Cantatrice chauve. L’étrangeté du discours, sur laquelle repose le comique de ces pièces, pointe dans tous les cas l’arbitraire de notre usage quotidien de la langue et de notre rapport au monde :
MADAME DE PERLEMINOUZE – Tant mieux ! Je m’en recuis ! Vous avez bien mérité de vous tartiner, après les gommes que vous avez brûlées ! Poussez donc : depuis le mou de Crapaud jusqu’à la mi-Brioche, on ne vous a vue ni au « Water-proof », ni sous les alpagas du bois de Migraine ! Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisée [51] !
En montrant que les « spectacles de minuit » partagent nombre de caractéristiques – mise en crise de la structure dramatique et du langage notamment – avec la dramaturgie du « nouveau théâtre » dont ils semblent parfois anticiper les audaces au point que tel journaliste a pu parler de « cabaret d’avant-garde [52] », nous ne cherchons pas pour autant à affirmer que le renouvellement dramatique trouve au cabaret son sens ou son essence. Il ne faudrait pas surestimer le rôle joué par le cabaret, incontestable mais limité, en cédant à la tentation de tout orienter, de tout reconstruire à partir de cet objet – modeste, ne l’oublions pas. Malgré le succès certain de leur formule, les cabarets demeurent en effet des lieux assez confidentiels. Si les œuvres de Beckett, d’Adamov, de Ionesco finissent par délaisser les « pissotières » pour être jouées dans de plus grands théâtres et toucher un plus large public, les pièces de cabaret, parce qu’elles sont justement « de cabaret », indissociables de l’espace qui les a vu naître et du spectacle auquel elles prennent part, ne quitteront jamais la rive gauche et ne survivront pas aux années 1950. La mobilité d’un Beckett ou d’un Ionesco, leur passage d’une rive à l’autre de la Seine, des théâtres de poche aux salles illustres, apparaît d’ailleurs au critique dramatique Guy Dumur comme un parcours initiatique indispensable, une consécration tout à la fois économique et littéraire qui vaut pour preuve de l’« importance considérable [53] » de ce théâtre – importance institutionnelle conquise de haute lutte dont le cabaret et ses trop petits spectacles restent définitivement privés :
La tendance actuelle de ce théâtre d’avant-garde est cependant de passer la Seine – sans jeu de mots – pour conquérir le reste de Paris. J’ai parlé, il y a deux mois, du triomphe fait au Mal court d’Audiberti au théâtre de la Bruyère. Ionesco est joué près de l’Alma [54].
Le détour par le cabaret n’a pourtant rien d’une curiosité gratuite. Le pan négligé de l’histoire théâtrale qu’il nous a permis de reconstituer nous permet de « ménager le champ d’un recul [55] » à même de suspendre les catégories préconstruites de perception du littéraire et d’en redistribuer les perspectives. Alors que du théâtre d’avant-garde, de ce « nouveau théâtre », que construit rétrospectivement la critique pour donner une cohérence à ce qui apparaît d’abord comme un jaillissement indiscipliné, les histoires littéraires retiennent surtout des noms d’auteurs et des œuvres, un panthéon cloisonné, soigneusement composé (ou recomposé) de succès et de scandales de L’Invasion à Fin de partie, le cabaret modifie le regard que nous posons sur la création théâtrale d’après-guerre et les filtres que nous avons l’habitude de lui appliquer. Ce n’est plus une trajectoire orientée de réussites à venir, de triomphes annoncés, qui apparaît au gré de cette posture décentrée mais un creuset d’inspirations partagées et d’influences croisées, un « milieu » d’échanges – le terme est proposé par le critique Marc Beigbeder [56] –, de frémissements artistiques, aboutis ou manqués, d’interactions plus ou moins fécondes entre des espaces, des genres et des individus, où le théâtre peut indéfiniment trouver matière à métamorphose, sans système ni étiquette. C’est ainsi qu’un dramaturge comme André Roussin, pourtant considéré comme un auteur de théâtre de boulevard, en tout point opposé au théâtre nouveau qui s’élabore dans le refus, précisément, du « vieux théâtre dialogué [57] », trouve ponctuellement sa place dans cette nouvelle projection, pensée en dehors des catégories prédéfinies, contre l’idée d’une littérature dramatique sacralisée [58].
Ce point de vue écarté souligne également l’intérêt d’auteurs comme Jean Tardieu, Boris Vian ou François Billetdoux dont le théâtre buissonnier s’accorde mal avec les cadres uniformes de l’histoire littéraire au point qu’Emmanuel Jacquart, dans son étude sur le nouveau théâtre, choisit par exemple de les passer sous silence [59]. Parce qu’ils échappent pour partie aux scènes de théâtre et explorent d’autres lieux et d’autres formats – le sketch, plus volontiers que la « grande pièce » – que les critiques distinguent du théâtre proprement dit, leurs créations peinent souvent à être appréhendées et l’on préfère les tenir à distance, les évoquer « à part », alors même qu’elles contribuent au renouveau dramatique. Aussi Michel Corvin ne commente-t-il guère les premières pièces de Vian, J’irai cracher sur vos tombes et L’Équarrissage pour tous – il ne dit pas un mot, bien sûr, de Cinémassacre –, estimant qu’elles sont « limitées par leur filiation avec le cabaret [60] ». En renonçant aux partitions génériques et en intégrant le cabaret à notre champ de vision, on peut au contraire saisir plus fermement le travail de réforme dramaturgique mené par ces auteurs de façon continue et cohérente du cabaret au théâtre. Tardieu ne suggère-t-il pas, dans la préface de son Théâtre de chambre que le « cadre étroit des cabarets-théâtres » a été favorable à la « recherche qu[’il] poursui[t] pour construire un art dramatique nouveau [61] » ?
École et laboratoire dramatique : le cabaret « au passage »
Propice à la recherche car le dramaturge, l’acteur et le metteur en scène peuvent s’y essayer, ébaucher, esquisser – ces mots reviennent constamment sous la plume de Tardieu –, le cabaret permet donc d’envisager cet « art dramatique nouveau » non comme une réalité déjà constituée et codifiée, mais comme une découverte à l’œuvre, au travail, une élaboration en marche, saisie au gré de ses hésitations, au fil de ses ébauches.
Lorsqu’il est question du cabaret, l’idée d’un apprentissage est d’ailleurs souvent convoquée par les témoins comme les acteurs du genre. Un mot pour un autre fait ainsi partie des « essais », des « ébauches », des « esquisses », qui jalonnent la « recherche [62] » dramatique de Tardieu. Une telle « étude » s’épanouit parfaitement au cabaret, espace – nous citons encore le dramaturge – « sans cérémonie où l’on accueille avec courage les maladresses et les hardiesses, plus ou moins involontaires, des débutants, où chacun est libre de chercher, aussi bien que de se tromper [63] ». La critique confirme la conviction de Tardieu et découvre au cabaret une « école du théâtre [64] », un « magnifique Conservatoire [65] ». On y forme des acteurs – « si vous saviez quelle bonne école peut être le cabaret [66] ! » s’exclame d’ailleurs Yves Robert –, mais aussi des dramaturges. Christian Mégret remarque ainsi dès 1948 que les scènes de la Rose Rouge et du Caveau de la Huchette sont « un terrain favorable à la germination » d’une comédie nouvelle. Et d’annoncer : « C’est des caves que nous vient la lumière [67] ». Le cabaret étant « la jeunesse et l’école du théâtre [68] », on y observe volontiers les progrès tangibles des acteurs et des auteurs. Si certains critiques remarquent « ce qu’il peut y avoir d’improvisé dans les sketches présentés sur la scène [69] » des cabarets, leur caractère d’ébauches, René Guilly salue la maturité gagnée d’un spectacle à l’autre par les Grenier-Hussenot. Jean-Pierre Grenier, Olivier Hussenot et l’ensemble de leur troupe, qui font les beaux soirs de la Rose Rouge, de Chez Gilles et de la Fontaine des Quatre Saisons, « ont renouvelé leur répertoire et amené leur style au point de la perfection [70] ». Agnès Capri, quant à elle, semble « préférer les répétitions aux représentations [71] », le travail, l’exercice et ses tâtonnements à l’œuvre achevée.
Lieu de formation, le cabaret est aussi volontiers considéré comme un espace d’expérimentation. Ce glissement conceptuel affleure dans les exemples déjà cités. Il est évident chez Tardieu : ses esquisses sont un mode de recherche, ses tâtonnements participent pleinement de la constitution progressive de sa manière dramatique. Si les critiques font souvent du cabaret un « Conservatoire », celui-ci n’a rien d’une institution rigide et rétrograde, et se présente même comme un « laboratoire ». Paul-Louis Mignon, fort d’un certain recul temporel, pourra ainsi affirmer en 1978 qu’il ne faut pas « négliger le champ d’expérimentation qu’ont pu offrir les cabarets littéraires ou les cafés-théâtres [72] ». En 1954, un journaliste de la revue Arts était déjà sensible à l’entreprise de découverte menée au cabaret et proposait un article de synthèse intitulé « Les cabarets parisiens sont les laboratoires du nouveau théâtre », affirmant que ces petites scènes ont donné « une vigoureuse impulsion à la mise en scène dramatique, révélé une pléiade d’auteurs et d’acteurs [73] ».
L’emploi d’un tel lexique est à historiciser et éclaire la place originale qu’occupe le cabaret dans l’histoire de la création théâtrale. Il établit en effet une filiation implicite avec d’autres tentatives antérieures de « rénovation dramatique [74] » – l’expression est de Jacques Copeau – et instaure ainsi une continuité à travers le siècle, là où la critique semble par ailleurs surtout sensible à la rupture définitive éprouvée après-guerre. L’idée d’un théâtre-laboratoire naît à la fin du XIXe siècle. C’est André Antoine, le premier, qui affirme que le Théâtre Libre est un « laboratoire d’essai [75] ». Quelques années plus tard, Jacques Copeau et Charles Dullin reprennent l’idée – ils emploient tous deux le mot « laboratoire » à partir de 1921 [76] –, révélatrice de l’exigence de leur démarche. En luttant pour un « théâtre d’essai [77] », ils cherchent à combattre les facilités d’un divertissement commercial qui reproduit, inlassablement, les mêmes formules éculées. Charles Dullin conçoit ainsi l’Atelier, fondé en 1921, comme un « laboratoire d’essais dramatiques [78] » ou de « recherches dramatiques [79] ». Il s’agit également d’une « école nouvelle du comédien », expérimentation et formation étant jugées indissociables [80]. En 1946, il confirme que l’Atelier a été pensé comme « un vrai laboratoire de travail, de recherche et d’ébauches de création [81] » et envisage le renouvellement d’une telle expérience, ainsi définie :
Le but de ce théâtre d’essai doit être de permettre à de jeunes auteurs et à de jeunes acteurs de s’exprimer et par l’expérience de la scène et du public de parfaire leur apprentissage… Le mot Essai ne doit pas être pris seulement dans le sens de balbutiement, mais dans son sens le plus large de « tentative »… Ce laboratoire doit être ouvert à tous ceux qui apportent des idées constructives et qui sont capables de les réaliser. Il doit être le contraire de l’amateurisme. Il doit élargir l’horizon [82] […].
Ces déclarations entrent en résonance avec les discours tenus sur les cabarets après-guerre, d’autant que des liens tangibles existent entre les deux expériences. La Compagnie Grenier-Hussenot, qui joue la plupart des spectacles de théâtre donnés au cabaret, a en effet été fondée par deux anciens Comédiens Routiers, Jean-Pierre Grenier et Olivier Hussenot, formés par Léon Chancerel. Or, Léon Chancerel est un disciple de Copeau depuis le Vieux-Colombier et l’a suivi en Bourgogne au temps des Copiaux. Par ailleurs, nombre d’acteurs de cabaret ont fait leurs classes à l’école Dullin, familiers et héritiers, donc, de sa conception de la création théâtrale. Par conséquent, loin d’exprimer une infériorité esthétique ou un quelconque amateurisme, les apprentissages et les tâtonnements au cabaret font au contraire valoir l’exigence d’une démarche qui puise ses modèles dans une histoire longue. Maillon et passeur, le cabaret contribue ainsi à transmettre une certaine conception de la création théâtrale, pensée comme expérimentation, que ni la guerre, ni la mort de Copeau et Dullin n’ont suspendue. Sans prétendre que le cabaret constitue cet idéal « théâtre d’essai » qu’attendait Dullin ni la « véritable école de comédiens [83] » rêvée par Copeau, nous pouvons avancer qu’il a contribué à diffuser un regard, un scrupule et un modèle que le théâtre nouveau reprendra à son compte. Ionesco ne considère-t-il pas qu’il doit proposer « une démarche théâtrale, un chemin à défricher », « ce qu’il est convenu d’appeler du travail de laboratoire [84] » ? N’affirme-t-il pas que pour se renouveler le « théâtre […] a besoin […] de ces locaux d’expérience, de ces salles de laboratoire à l’abri de la superficialité du grand public [85] » ?
Nous intéresser au « cabaret-théâtre » que découvre Paris après la Seconde Guerre mondiale, étroitement intégré au champ théâtral en dépit de sa position marginale et relativement négligée, nous a permis de porter sur la création dramatique contemporaine et l’histoire du théâtre un regard décentré riche d’enseignements. Outre les liens, peu ou pas étudiés, qu’il partage avec le nouveau théâtre, il questionne les perspectives et les fondements de cet ensemble dont la critique a fabriqué l’unité, et en révèle les tâtonnements et les ébauches. Observatoire d’un renouvellement à l’œuvre, à l’essai, il se fait aisément le relais d’une certaine idée de la création théâtrale, pensée comme un travail d’expérimentation, un laboratoire de recherches – conception encore très vivante aujourd’hui où nombre de performances scéniques et de productions dramatiques sont présentées comme autant de works-in-progress, de travaux d’ateliers. École du dramaturge et du comédien, le cabaret façonne donc aussi le regard du public, qui y apprend que le geste essayé et la scène inachevée, à leur manière, font œuvre.
Annexe : Quelques pièces de théâtre jouées au cabaret (1948-1954)
| Cabaret | Date | Titre | Auteur | Metteur en scène |
|---|---|---|---|---|
| LA ROSE ROUGE (76, rue de Rennes) | Septembre 1948 | L’Étranger au théâtre | André Roussin | Yves Robert |
| Novembre 1948 | Petite suite en noir | Yves Robert | ||
| Novembre 1948 | Terror of Oklahoma | Albert Vidalie | Yves Robert | |
| Avril 1949 | Exercices de style | Raymond Queneau | Yves Robert | |
| Début 1951 | Ça vient, ça vient | Boris Vian | ||
| Janvier 1951 | Fantômas | Robert Desnos, adapté par Guillaume Hanoteau | ||
| Mars 1951 | Les Bonnes Manières | Jean Bellanger | ||
| Avril 1952 | Cinémassacre | Boris Vian | ||
| LE CAVEAU DE LA HUCHETTE (5, rue de la Huchette) | Octobre 1948 | « suite de sketches » | Courteline, O’Henry | Michel de Ré |
| Mai 1949 | La Tour Eiffel qui tue | Guillaume Hanoteau | Michel de Ré | |
| CHEZ GILLES (5, avenue de l’Opéra) | Automne 1949 | La Tour de Nesle | ||
| Mars 1950 | Justine est r’faite | |||
| Mars 1950 | L’Étranger au théâtre | André Roussin | Yves Robert | |
| Mars 1950 | Les Harengs terribles | Alexandre Breffort | Yves Robert | |
| Mars 1950 | Un petit air de trempette | Jean Bellanger | Yves Robert | |
| Octobre 1950 | L’Adolescente parfumée | |||
| 1951 | À chacun son serpent | Boris Vian | Michel de Ré | |
| 1951 | Le Coup de l’ascenceur | Guillaume Hanoteau | ||
| 1951 | Incertitude | Jean Marsan | ||
| CHEZ AGNÈS CAPRI (5, rue Molière) | 1950 | Zig-Zag 50 Un rajah qui s’embête |
Alphonse Allais | Michel de Ré |
| 1950 | Zig-Zag 50 Chez la fiancée |
Alfred Jarry | Michel de Ré | |
| 1950 | Zig-Zag 50 L’Auteur au théâtre |
Max Jacob | Michel de Ré | |
| 1950 | Zig-Zag 50 Un mot pour un autre |
Jean Tardieu | Michel de Ré | |
| 1950 | Zig-Zag 50 Un policier vous parle |
Jacques Dufilho | Michel de Ré | |
| 1950 | Zig-Zag 50 Le Cauchemar |
Guillaume Hanoteau | Michel de Ré | |
| 1950 | Zig-Zag 50 Les Nuits de Chicago |
Georges Neveux | Michel de Ré | |
| Février 1951 | « six petites pièces » | Mérimée, Radiguet, Tardieu, Satie, Capri, Lahaye | ||
| LA FONTAINE DES QUATRE SAISONS (59, rue de Grenelle) | 1951 | Le Dîner de têtes | Jacques Prévert | Albert Médina |
| Octobre 1951 | Le Petit Bi | René-Maurice Picard et Hubert Deschamps | ||
| Juillet 1952 | Quadrille à Saint-Cucufa | René-Maurice Picard | ||
| Février 1953 | L’École du crime | Albert Vidalie | ||
| Novembre 1953 | Les Images d’Épinal | Albert Vidalie | ||
| 1954 | La Famille Tuyau-de-Poêle | Jacques Prévert | ||
| Mai 1955 | Les Petites Filles modèles |
Sources périodiques :
[années consultées : 1948-1954]
Carrefour : la semaine en France et dans le monde
Combat : de la Résistance à la Révolution
Libération
Une semaine de Paris. Hebdomadaire d’information des spectacles et des arts
Bibliographie
ADAMOV, Arthur, L’Homme et l’enfant, Paris, Gallimard / NRF, 1968.
BEIGBEDER, Marc, Le Théâtre en France depuis la Libération, Paris, Bordas, 1959.
BONAL, Gérard, Saint-Germain-des-Prés, Paris, Éditions du Seuil, 2008.
BREFFORT, Alexandre, Les Harengs terribles, Paris, Librairie théâtrale, 1951.
CAPRI, Agnès, Sept épées de mélancolie, Paris, Julliard, coll. « Drôle de vie », 1975.
COPEAU, Jacques, Souvenirs du Vieux-Colombier, Paris, Nouvelles éditions latines, 1921.
CORVIN, Michel, Le Théâtre nouveau en France, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1969.
DULLIN, Charles, Ce sont les dieux qu’il nous faut, Paris, Gallimard / NRF, coll. « Pratique du théâtre », 1969.
DUMUR, Guy, L’Expression théâtrale, textes réunis par Colette Dumur, Paris, Gallimard / NRF, 2001.
GARCIA, Joëlle (éd.), Charles Dullin, introduction et choix des textes par Joëlle Garcia, Arles, Actes Sud, 2011.
HANOTEAU, Guilleaume, La Tour Eiffel qui tue, dans Les Œuvres libres, no 266, 15 septembre 1949.
HUBERT, Marie-Claude, Le Nouveau Théâtre (1950-1968), Paris, Honoré Champion, 2008.
IONESCO, Eugène, Notes et contre-notes, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1966.
JACQUART, Emmanuel, Le Théâtre de dérision : Beckett, Ionesco, Adamov, édition revue et augmentée, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1974.
LATOUR, Geneviève, Petites scènes, grand théâtre, Paris, Délégation à l’action artistique de la Ville de Paris, 1986.
LATOUR, Geneviève, « Les cabarets du VIe arrondissement », conférence du 25 juin 1998, dans Bulletin de la société historique du VIe arrondissement de Paris, no 17, 1998-1999.
LEMARCHAND, Jacques, Le Nouveau Théâtre : 1947-1968, un combat au jour le jour, textes réunis et présentés par Véronique Hoffmann-Martinot, Paris, Gallimard / NRF, 2009.
MIGNON, Paul-Louis, Panorama du théâtre au XXe siècle, Paris, Gallimard / NRF, 1978.
MIGNON, Paul-Louis et HAUTOIS, Delphine (éd.), Jean Tardieu, l’amateur de théâtre, Paris, Gallimard, coll. « Les cahiers de la NRF », 2003.
PRUNER, Michel, Les Théâtres de l’absurde, Paris, Nathan Université, coll. « Lettres sup », 2003.
REYBAZ, André, Têtes d’affiche, Paris, La Table ronde, 1975.
ROUSSIN, André, L’Étranger au théâtre, dans Treize comédies en un acte, Monaco, Le Rocher, coll. « NRP/Littérature », 1987.
SERREAU, Geneviève, Histoire du nouveau théâtre, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1966.
SCHLESSER, Gilles, Le Cabaret « rive-gauche ». De la Rose Rouge au Bateau Ivre (1946-1974), Paris, L’Archipel, 2007.
TARDIEU, Jean, Théâtre de chambre, Paris, Gallimard / NRF, 1966.
VIAN, Boris, Manuel de Saint-Germain-des-Prés, Œuvres, t. XIV, Paris, Fayard, 2002.
VIAN, Boris, Petits spectacles, choix, préface et notices de Noël Arnaud, Paris, LGF, coll. « Le Livre de Poche », 2006.
VITALY Georges, En toute vitalyté : 50 ans de théâtre, Paris, Nizet, coll. « Théâtre en mémoire(s) », 1995.