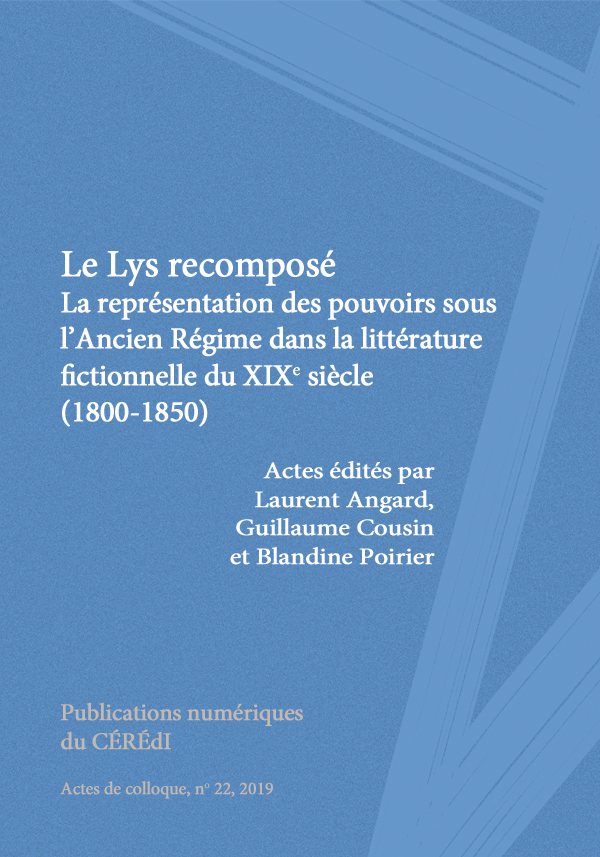« …ce que je regrette avant tout, ce que mon regard rétrospectif cherche dans le passé, c’est la société qui s’en va, qui s’évapore, qui disparaît, comme un de ces fantômes dont je vais vous raconter l’histoire. »
A. Dumas, Préface des Mille et Un Fantômes, 1849.
Comme tous ses contemporains, Dumas a été obsédé par la Révolution et s’est constamment interrogé sur ses causes, son caractère inéluctable ou accidentel, les bouleversements sociaux qu’elle a initiés. Dès 1833, dans un ouvrage à prétention historique, intitulé Gaule et France, il a brossé un récit des origines de la nation orienté vers cette issue, qui est aussi un essai d’histoire sociale. Ses investigations prennent ensuite la forme de grands cycles romanesques recréant le monde disparu de l’Ancien Régime pour procéder à son examen clinique. La Trilogie (Les Trois Mousquetaires, Vingt Ans après, Le Vicomte de Bragelonne) retrace l’établissement du pouvoir absolu au XVIIe siècle ; Les Mémoires d’un médecin (Joseph Balsamo, Le Collier de la reine, Ange Pitou, La Comtesse de Charny) relatent les dernières années de la monarchie et le séisme révolutionnaire. Dans cette vaste rétrospection, l’objectif et la méthode du romancier-historien consistent à mettre en évidence « les intérêts qui s’[...] agitent entre le peuple, la noblesse et la royauté [1] », à retracer, en somme, une lutte des classes avant la lettre. Autant que du politique et du militaire, l’histoire vue par Dumas relève du social.
La reconstitution de l’Ancien Régime sur le mode romanesque réserve logiquement une place de premier plan à la noblesse, qui en est un acteur majeur. Mais de quelle noblesse parle-t-on ? Ce vocable commode recouvre une classe très hétérogène et en évolution, traitée dans la fiction sous un mode plus affectif que scientifique, ce qui retentit également sur l’analyse de son rôle historique. Au préalable, quelques remarques s’imposent sur la perception dont elle fait l’objet au XIXe siècle, tant sa représentation est tributaire du contexte de l’écriture, encore proche du monde ancien et du séisme révolutionnaire.
La noblesse au XIXe siècle
Malgré l’affirmation de Vigny selon laquelle elle serait « morte socialement depuis 1789 [2] », force est de reconnaître que la noblesse, éliminée juridiquement avec l’abolition des privilèges (4 août 1789) et des titres (loi du 23 juin 1790), reste bien vivante au XIXe siècle, même dans un contexte compliqué. Il y a certes un passif : sous la Révolution, la noblesse a été considérée comme l’ennemie de la nation. Les affirmations fracassantes de Siéyès dans Qu’est-ce que le Tiers-État ? (« Il faut prouver que l’ordre noble n’entre point dans l’organisation sociale […]. Une telle classe est assurément étrangère à la nation [3] ») ont laissé des traces. Ce refus d’englober la noblesse dans le giron national est d’ailleurs une sorte d’effet boomerang de la théorie de Boulainvilliers qui faisait descendre la noblesse des invasions franques, d’où la suggestion de Siéyès de la « renvoyer dans les forêts de la Franconie [4] ». Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant qu’une partie de l’aristocratie, rescapée de la guillotine ou revenue d’émigration, ait eu sous l’Empire le sentiment de jouer le rôle de bouc émissaire. Certaines expériences individuelles en témoignent, comme celle de Vigny, qui dans le Journal d’un poète, raconte que ses camarades de classes le frappaient à cause de sa particule, et qu’il se sentait d’« une race maudite [5] ». Par ailleurs, l’Empire fait apparaître une caste concurrente, fondée sur la valeur militaire récente, que la Restauration entérine dans un souci d’apaisement (« La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens [6] »). À partir de ce moment se met en place un processus général de dilution, qui s’accélère sous la monarchie de Juillet, marquant la perte de spécificité de l’ancienne noblesse. De nouvelles élites émergent, notamment la grande bourgeoisie d’affaires ; l’histoire et l’ancienneté se retrouvent concurrencées par l’argent, la réussite, le prestige intellectuel ou mondain. Le « monde », qui a éclipsé la cour, devient un ensemble hétéroclite qu’on appelle le Tout-Paris [7].
D’autres éléments permettent de dresser un bilan différent. Sur le plan politique, la noblesse profite de l’arrivée des ultras au pouvoir avec Richelieu (1820-1821) et surtout Villèle (1821-1828). Leurs ministères se concrétisent notamment par le rétablissement de l’hérédité de la Pairie (qui sera abolie en 1831) et la loi sur le milliard des émigrés (1825). Sur le plan intellectuel, on notera que le courant contre-révolutionnaire, après l’étouffoir impérial, rencontre un écho certain, notamment avec Montlosier et Bonald qui développent un discours d’apologie de la noblesse. Les Considérations sur la noblesse [8] présentent l’organisation de la société en ordres comme « naturelle et nécessaire » ; l’ouvrage insiste sur le sens du service de l’État propre à la noblesse, et sur son rôle de limitation du pouvoir central (que ce soit une monarchie ou une république). Sur le plan de l’image, le modèle aristocratique continue de bénéficier d’un grand prestige, comme le montre l’attraction qu’exerce le faubourg Saint-Germain. Enfin, sur le plan littéraire, on remarquera que les nobles sont bien représentés chez les Romantiques (Chateaubriand, Vigny, Lamartine). D’autres, sans appartenir à cette caste, soutiennent au début la monarchie restaurée, comme Hugo et Nodier qui assistent au couronnement de Charles X.
Où se situe Dumas ? Il est proche du trône aussi, mais du côté Orléans. C’est une figure emblématique de ce Tout-Paris, avec ses origines familiales très mélangées : grand-père marquis créole (marquis de la Pailletterie), grand-mère esclave, père général, mère de petite bourgeoisie… Dumas-Davy de la Pailletterie est aussi un homme nouveau, sans fortune, sans héritage, à part le nom de son père, donc obligé de travailler pour vivre, comme Hugo, comme Balzac. Pour reprendre la terminologie de Vigny, il fait partie de « ceux qui gagnent », et non pas de « ceux qui ont ».
La question de la noblesse rencontre donc une histoire personnelle qui retentit sur l’entreprise littéraire dumasienne. Une lettre de 1838, bien qu’antérieure aux romans de notre étude, est révélatrice à ce sujet :
Appartenant moi-même à une ancienne famille dont par un concours de circonstances étrange, je ne porte plus le nom, j’ai toujours pris à tâche, malgré mes opinions à peu près républicaines, de grandir notre vieille noblesse au lieu de l’abaisser, et j’ai fait un peu pour elle ce que les Castillans avaient fait pour le Cid. Je l’ai attachée morte mais debout sur son cheval de bataille pour que ses ennemis la crussent encore vivante [9].
Ressusciter l’Ancien Régime et sa noblesse pour mieux comprendre l’Histoire : l’entreprise n’est pas sans rappeler le projet non abouti de Vigny, vingt ans plus tôt, d’écrire une histoire de la noblesse dans un but apologétique [10], dont Cinq-Mars est le résultat partiel. Avec Dumas, qui théorise moins mais écrit plus, l’idée se concrétise et s’élargit à la dimension nationale.
Des modèles nobiliaires en mutation
Elle prend également une indéniable dimension sociologique. La méthodologie exposée en 1836 (« … étudier les intérêts qui s’[…] agitent entre le peuple, la noblesse et la royauté [11] ») interdit de réduire les cycles romanesques ultérieurs à l’anecdotique et l’événementiel. Les personnages, même fictifs, sont des représentants de leur classe, et donnent au lecteur l’impression de l’appréhender « de l’intérieur », par le biais de mentalités reconstituées. Ces modèles évoluent et enregistrent des variations, parfois d’un cycle à l’autre, parfois à l’intérieur d’un même ensemble. C’est ce qui se vérifie en particulier pour la noblesse dont l’appellation générique ne doit pas faire illusion. Fondant sa spécificité et ses prétentions sur différents facteurs (l’ancienneté historique, la race, le rôle de limitation du pouvoir, l’éducation, certaines valeurs, le prix du sang), elle n’a jamais formé une caste homogène ; on distingue la petite ou la grande noblesse, la noblesse parisienne, de province, riche ou pauvre, la noblesse de cour, d’épée, de robe… Sa diversité se retrouve logiquement sur le plan romanesque, qui présente des figures emblématiques de ces différentes catégories illustrant ainsi son évolution historique et sociale. Loin de s’attacher à une caste figée, la fiction met en scène un processus qui voit les modèles nobiliaires se succéder, coexister et/ou se remplacer. Théorisé dès 1833 dans l’épilogue de Gaule et France [12], il marque les étapes suivantes : les « grands vassaux », sous Hugues Capet, affaiblis ensuite par Louis XI, laissent la place aux « grands seigneurs », sous François Ier, qui sont décimés par Richelieu (en qui Dumas voit le continuateur de Louis XI) et par Louis XIV, dont le règne est « le 93 de la grande seigneurie ». La dernière étape, qui traduit la « substitution de la quantité à la force », voit l’apparition des « cinquante mille aristocrates de la Régence orléaniste », destinés à être éliminés sous la Révolution. Ce schéma directeur se retrouve globalement dans les principaux cycles. La Trilogie illustre l’action victorieuse menée par le pouvoir central contre les « grands seigneurs », qu’il condamne à disparaître, remplacés par la noblesse de cour ou les bourgeois anoblis. Les Mémoires d’un médecin, dont l’action se situe avant et pendant la Révolution, relatent l’élimination violente de la jeune et prometteuse (mais fragile) noblesse des Lumières. Une étude de la succession de ces différents modèles nobiliaires s’impose.
Le dernier des grands seigneurs
Peu développée dans Les Trois Mousquetaires, la question de la caste prend plus d’importance dans Vingt Ans après, qui met l’accent sur les différences de condition entre les héros : d’Artagnan est de petite et pauvre (mais très ancienne) noblesse gasconne, Porthos est riche, mais roturier et aspire à être anobli, ce qui prouve le prestige de cette classe, Athos et Aramis appartiennent à des familles plus prestigieuses que leurs camarades. Athos, en particulier, représente le type même de cette noblesse de grand seigneur que Gaule et France fait apparaître sous François Ier (ce que souligne son admiration maintes fois proclamée pour ce règne [13]). Il évoque son droit de justice haute et basse dans son fief [14] et insiste sur l’ancienneté de sa « race », qu’il prétend supérieure aux « races royales [15] ». Entretenant un rapport distant avec le pouvoir, il voue néanmoins son fils au service du trône.
Les principes sur lesquels il se fonde recèlent une ambiguïté, liée à la définition du service : s’agit-il de servir le roi, la royauté ou l’État ? Un représentant de l’ancienne noblesse, antérieure à l’apparition de la notion d’État, ne peut lui accorder une valeur absolue. L’hésitation se joue donc entre le roi (sa personne) et la royauté (le principe). Athos, pour lequel « il n’y a qu’une […] cause […] : celle du roi [16] », choisit pour servir le principe le camp des Frondeurs (donc des rebelles), ce qui traduit sa préférence pour le principe. Il prononce cependant deux professions de foi qui sont contradictoires. Lors de l’épisode du serment de Saint-Denis, faisant jurer à son fils fidélité au roi et surtout à la royauté, il reste sur cette ligne : « le roi n’est qu’un homme, la royauté, c’est l’esprit de Dieu ». C’est ce qui explique qu’il rende hommage à Richelieu, car « s’il a fait le roi petit, il a fait la royauté grande [17] ». Dans ce discours aux accents maistriens, Athos voit dans le roi l’incarnation d’un principe divin, par essence différent des autres grands personnages. Mais quelques chapitres plus tard, sur le champ de bataille de Newcastle, il énonce un autre credo à la tonalité différente : reprochant à d’Artagnan sa proximité avec Mazarin et Cromwell, il insiste sur la fraternité de caste qui devrait guider ses choix : « […] tous les gentilshommes sont des frères, […] les rois de tous les pays sont les premiers de tous les gentilshommes [18]… » Ces propos, qui rappellent la position de Bassompierre dans Cinq-Mars, font du roi non plus le représentant de Dieu sur terre, mais plus modestement le primus inter pares parmi ses vassaux.
L’affrontement est alors inévitable entre le dernier représentant des grands seigneurs et un jeune monarque nec pluribus impar qui veut affirmer sa suprématie. Il a lieu dans Le Vicomte de Bragelonne qui relate l’avènement d’un pouvoir fort, absolu, c’est-à-dire indépendant, porté naturellement à limiter les contre-pouvoirs (clergé, noblesse), réclamant des serviteurs obéissants et non pas des individualités fortes et potentiellement gênantes. On notera cependant que la rupture (dans le chapitre CXCVII intitulé significativement « Roi et noblesse ») a une cause privée et non politique, à savoir la rivalité amoureuse entre le roi et Raoul de Bragelonne, et que, malgré sa grande force symbolique (Athos brise son épée, ce qui traduit la fin d’une fidélité séculaire et intergénérationnelle), elle ne se traduit pas par une révolte armée, mais par un éloignement hautain du gentilhomme sur ses terres. Cet isolement signe la mort sociale d’un modèle, bientôt suivie par la mort réelle d’Athos et de Bragelonne. Suicide, absence de postérité : tout insiste sur l’effacement radical d’une caste, souligné par le double enterrement du père et du fils [19]. Dans l’épilogue, quelques pages plus loin (et quelques années plus tard), une autre scène symbolique enfonce le clou : le héron, oiseau libre et noble, est tué par le faucon royal sur le tombeau de Bragelonne, profané par le roi et la Montespan. La caste des grands seigneurs est bien morte.
Le serviteur-salarié de l’État
Coexistant avec cet ancien modèle, un autre type de noblesse, très différent, est incarné par d’Artagnan. Malgré la dénomination commune de noblesse d’épée, il y a un monde entre le grand seigneur de province et l’officier de service, sur le plan matériel mais aussi sur le plan des valeurs. D’Artagnan est imprégné d’une mentalité quasi-bourgeoise, au lieu de la mystique royale ou du lien vassalique : il s’attache au service de l’État-patron, dont il attend un salaire [20], des augmentations, de l’avancement, d’ailleurs très lent (il met trente ans pour passer de lieutenant à capitaine, et ne devient maréchal de France qu’à la dernière page du roman). L’engagement fait la part au calcul, la fidélité devient conditionnelle et laisse peu de place au service gratuit fondé sur un principe sacré. En serviteur insatisfait, d’Artagnan récrimine constamment contre Mazarin, puis contre le jeune Louis XIV, faisant entendre un discours de revendications souvent matérielles. Mais il souffre aussi d’un manque de reconnaissance, comme il l’exprime hautement dans Bragelonne : « Oubli, oubli partout ! le maître a oublié le serviteur, et voilà que le serviteur en est réduit à oublier le maître [21] ».
Obéissant à une logique matérialiste, qui rappelle le fameux « Enrichissez-vous ! » de Guizot, d’Artagnan s’allie à son ancien valet Planchet, fonde une maison avec des participations financières dont les actions montent ou baissent. S’il œuvre avec Athos pour la restauration de Charles II, il s’agit pour lui non d’un devoir sacré mais d’un coup commercial risqué (il se compare aux « capitaines du XVe siècle, aventure et coup de mains »). Se voyant ruiné, il s’inquiète du passif et se répand auprès d’Athos en lamentations sur « la généalogie des avares [22] », avant de se réjouir des récompenses financières que Charles II lui accorde, et de reprendre du service auprès de Louis XIV qui lui donne enfin son brevet de capitaine, et de l’argent.
Mais d’Artagnan est un personnage complexe plutôt que simple. Partagé entre l’honneur aristocratique et le service de l’État, entre le modèle du grand seigneur et celui du serviteur salarié, il est déchiré par des conflits de loyauté : il se laisse facilement détourner de sa tâche auprès de Cromwell, qui ne lui plaît guère, et regimbe ouvertement contre les missions qui visent ses amis rebelles. D’où des actes répétés de désobéissance, parfaitement assumés et même revendiqués. Censé arrêter Athos, puis Fouquet, il laisse au premier (sans succès) l’occasion de s’enfuir et rend son épée au roi en signe de protestation [23] ; il confie le second à « un de [s]es brigadiers le plus maladroit qu’[il] ai[t] pu trouver [24] » en espérant qu’il se sauve. À Belle-Isle, il incite un jeune officier à violer la consigne pour pouvoir voir ses amis seuls à seuls, ce dont il se targue devant le roi [25]. Toutes ces marques de rébellion témoignent de son refus de l’obéissance sans états d’âme et montrent que l’éthique aristocratique compte encore pour lui et que la fidélité à l’amitié passe avant le service du roi. Ce comportement traduit aussi une certaine conception de la fonction royale. D’Artagnan s’oppose à Louis XIV pour des motifs opposés, le trouvant d’abord trop faible et trop soumis à Mazarin [26], puis trop « absolu » et pas assez clément, la fameuse clémence étant le trait royal par excellence. En creux se dessine le souverain idéal, celui que le mousquetaire aimerait servir, et à quoi Louis XIV finit par ressembler, si bien qu’il capitule et se courbe devant lui, « parce qu’[il a] pris l’habitude, depuis trente ans, de venir prendre le mot d’ordre [27] ». Le serviteur a fait évoluer son maître, si bien que d’Artagnan peut mourir au service du roi.
L’apparition du courtisan
Mais en fait, d’Artagnan est mort avant Maestricht, ou plutôt, le type de serviteur noble qu’il incarne a déjà disparu au profit d’un autre, à savoir le courtisan. Le conflit entre la vieille noblesse et le roi est d’ordre générationnel et politique. La mise en place d’un pouvoir absolu relègue au second plan cette rude et franche noblesse militaire, et la fait tomber en désuétude ; elle est écartée du pouvoir (que de toute façon le roi n’avait jamais partagé avec elle) au profit des financiers et des bureaucrates parfois anoblis, comme Colbert. Il ne reste plus pour ses rejetons qu’une fonction purement décorative ; c’est ainsi qu’on voit apparaître une jeune noblesse préposée à la représentation, à l’organisation des plaisirs du roi, à ses histoires sentimentales, aux cancans. De d’Artagnan à Manicamp ou Saint-Aignan, ou du combattant au courtisan, Bragelonne relate, entre autres, le processus de curialisation décrit par Norbert Elias dans La Société de cour [28], c’est-à-dire la domestication d’une caste, dont la référence devient Castiglione plutôt que Bayard, ce qui est présenté comme une dégradation [29]. Sur le plan romanesque, la temporalité de la chronique s’installe, axée sur la peinture d’une micro-société avec son fonctionnement autonome et centré autour du roi. La vie de cour est mise en scène avec une acuité quasi-sociologique, insistant sur la présentation de soi, la nécessité de l’auto-contrôle, le jeu des regards, le relevé des signes de (dé)faveur. Ce sont ces facteurs qui influent sur les sentiments et les rapports humains, et non plus la bravoure, le partage du danger et de l’aventure. La situation de d’Artagnan, vieux soldat isolé et marginalisé dans cette société, fonctionne comme un révélateur de ce processus : encore populaire, mais complètement déphasé, il est perçu comme un vieux souvenir, n’ayant « absolument rien à faire dans ce monde brillant et léger [30] ». Tout en restant physiquement présent, il pratique l’éloignement intérieur, finalement peu différent de l’éloignement extérieur et géographique d’Athos. Mais avant de se résigner, conscient de cette mutation essentielle, il affronte vivement Louis XIV : « Voulez-vous des amis ou des valets ? des soldats ou des danseurs à révérence ? des grands hommes ou des polichinelles ? Voulez-vous qu’on vous serve ou voulez-vous qu’on vous plie [31] ? ». Ces sorties, qui se reproduisent à plusieurs reprises, traduisent la révolte devant l’ordre nouveau du représentant de l’ancien monde ; le renforcement de la Couronne suscite chez les perdants un discours décadentiel propre au romantisme aristocratique, qui trouve sans doute quelque écho tout au long du XIXe siècle.
La noblesse des Lumières
Dans le cycle des Mémoires d’un médecin, qui couvre les dernières années de l’Ancien Régime et de la Révolution, la noblesse se partage en deux camps opposant de vieux cyniques et de jeunes idéalistes qui se réfèrent à des systèmes de valeurs radicalement différents. Cette opposition ne correspond guère à la réalité historique : il y a eu des nobles « progressistes » remettant en cause leurs privilèges sous le règne de Louis XV, comme par exemple le marquis d’Argenson [32]. Mais la logique romanesque privilégie le clivage générationnel et place la jeune noblesse des Lumières sous le feu des projecteurs tout en réservant au camp des « anciens » le rôle peu glorieux de repoussoir. Ces vieux corrompus, issus de l’aristocratie de la Régence, restent marqués par le souvenir de la débauche couramment associée à cette période. Au service de Louis XV, présenté comme un vieillard libidineux, se tiennent Richelieu, son proxénète, chargé de l’approvisionner en chair fraîche, et le baron de Taverney, son fournisseur, qui lit des romans licencieux et voudrait mettre sa fille dans le lit du roi. Pour nuancer cette peinture simpliste, on notera que ce personnage incarne aussi, sur le plan sociologique, la difficile condition de la noblesse pauvre de province qui s’agrippe à ses privilèges parce qu’ils constituent sa seule richesse et son seul recours.
De l’autre côté, la jeune génération apparaît pleine de promesses, exempte des défauts de ses ancêtres. Cette noblesse est incarnée par des officiers, comme Philippe de Taverney, qui a pris part à la guerre d’indépendance américaine, une guerre « juste » au service des idéaux modernes. Olivier de Charny, neveu de Suffren, est aussi un officier courageux dont le rôle décisif lors d’une bataille navale est souligné devant les souverains. Cette jeune noblesse des Lumières se signale donc très classiquement par sa valeur militaire, en lien logique avec sa vocation de payer l’impôt du sang. En cela, elle perpétue une tradition séculaire, et infirme l’idée de décadence qui imprégnait Le Vicomte de Bragelonne. Mais sa mentalité la distingue de ses ancêtres : acquise aux idées progressistes, elle nie toute barrière de classe entre les hommes. « Les hommes sont ici pour s’entraider. Ne sont-ils pas frères [33] ? », dit Philippe de Taverney, au pauvre va-nu-pieds Gilbert en lui proposant son appui. Alors qu’Athos exaltait la fraternité entre gentilshommes, Taverney élargit ce principe à l’humanité toute entière, et se prononce en faveur de l’affranchissement des Noirs, ce qui suscite l’incompréhension et la colère de son père : « Foi de gentilhomme, il faut qu’il y ait quelque chose dans l’air qui leur tourne la tête, il a prétendu que tous les hommes étaient frères ! Moi, le frère d’un Mozambique [34] ! ». La réaction paternelle traduit la dimension générationnelle de ces prises de position, soulignée également par Philippe qui précise que « le dauphin lui-même partage ces principes ». S’il n’a pas de fibre humanitaire aussi forte, Olivier de Charny a adhéré à la franc-maçonnerie, avant de s’en dégager par fidélité monarchique. Son frère cadet Isidor ne théorise pas sur ces questions de société, mais ses engagements privés sont parlants : amoureux de la paysanne Catherine Billot, il a la ferme intention de l’épouser malgré la différence de caste. Seule sa mort empêche la réalisation de ce projet.
Cette jeunesse s’attache au mérite personnel et non pas à l’appartenance à une lignée. Devant Marie-Antoinette qui évoque la gloire militaire de ses aïeux à Fontenoy, Steinkerque, Lens, Rocroi, Marignan, Azincourt, Charny remet en cause cet argument : « Madame ! madame, […] ne parlez pas tant du sang de la noblesse ; le peuple aussi a du sang dans les veines [35] ». Au contraire de la vieille aristocratie qui campait sur sa spécificité, gage de sa survie, la jeune génération ne s’en reconnaît pas vraiment. Cette position ne relève pas uniquement de la fiction et fait référence à des engagements très réels d’une partie de la noblesse pré-révolutionnaire exprimés dans les Cahiers des États-Généraux, qui tentaient de concilier monarchie et modernisation.
Mais dans le roman, Philippe de Taverney et Olivier de Charny n’ont pas de rôle historique ou politique ; tous deux amoureux de Marie-Antoinette dans Le Collier de la Reine, ils évoluent principalement dans le domaine sentimental. Loin de la galanterie ou du libertinage de la Régence, ils se comportent comme de véritables héros romantiques épris d’absolu et condamnés aux amours malheureuses. Le roman se termine dans une atmosphère de désolation : Philippe de Taverney part avec La Peyrouse, ce qui est une forme de suicide, Olivier de Charny épouse contre son gré Andrée de Taverney pour sauver l’honneur de la reine. Sacrifiant d’abord leur bonheur puis leur vie, ils représentent en quelque sorte, la postérité posthume de Raoul de Bragelonne.
Nouveaux représentants, nouveaux modèles, nouveaux idéaux : d’un cycle à l’autre, la mutation de la noblesse apparaît avec évidence. Cette évolution lui permet-elle de mieux se situer dans l’histoire et d’y prendre sa place ? L’approche typologique doit alors être complétée par l’examen du rôle historique qui lui est dévolu.
La noblesse dans l’Histoire
Pour reprendre la formule lumineuse de Claudie Bernard [36], la particularité du roman historique tient à sa conjugaison de l’histoire-récit avec l’histoire-problème. Le problème intellectuel majeur, pour un esprit du XIXe siècle, c’est bien évidemment la Révolution et la césure qu’elle représente dans l’histoire. Si le discours traditionnaliste privilégie une vision religieuse et symbolique selon laquelle la Révolution serait une rébellion contre Dieu, la recherche des causes est une véritable obsession pour la plupart des historiens, romanciers, philosophes, politologues, etc. Marchant sur le terrain des historiens, les romanciers prétendent apporter par le biais de la fiction d’importants éléments d’explication mêlant l’affectif et l’analyse. Le projet de Vigny pointait la responsabilité du trône dans la révolution : ayant sciemment abaissé l’aristocratie pour mieux la dominer, le pouvoir monarchique se serait privé de son appui le plus précieux au moment du cataclysme. Bien plus tard, Hugo s’attelle à une construction idéologiquement très différente, mais d’ampleur comparable, qu’il expose dans une lettre à Auguste Vacquerie datée du 27 janvier 1869 :
C’est une trilogie qui commence.
L’Aristocratie (L’Homme qui rit)
La Monarchie
Quatre-vingt Treize.
Et j’aurais fait la preuve de la Révolution. Ce sera le pendant des Misérables.
L’entreprise de Dumas, située dans les années 1840-1850, constitue le chaînon médian entre ces deux projets. Ce que racontent ces cycles, c’est la mise en place d’un régime absolu (la Trilogie) puis son effondrement (Les Mémoires d’un médecin). L’analyse des causes de cet effondrement, et le rôle qu’a joué la noblesse (agent de dégradation et/ou victime expiatoire ?), loin d’illustrer une position simple, reflète deux théories omniprésentes dans le débat public, entre lesquelles Dumas peine à choisir, que ce soit par volonté de refléter toutes les sensibilités, ou par hésitation personnelle.
Le discours à charge accuse la noblesse d’avoir affaibli le pouvoir royal pour maintenir des archaïsmes propres à sa caste. La Révolution aurait été provoquée par la réaction nobiliaire qui a exaspéré les antagonismes sociaux. C’est globalement la thèse de Michelet, développée dans son Histoire de la Révolution [37], qui rend responsable de l’abolition de la monarchie, laquelle n’était nullement à l’ordre du jour en 1789, une élite imperméable aux réalités et opposée à l’abolition de ses privilèges. Optant (parfois inconsciemment) pour la politique du pire (et la pire des politiques), la noblesse aurait joué un jeu suicidaire pour entraîner la monarchie dans son naufrage.
Du côté de la défense, certains théoriciens, défendant l’organisation en ordres comme naturelle et nécessaire, donnent à la noblesse un rôle de rempart contre l’absolutisme, notion qui apparaît précisément au XIXe siècle. Loin d’être un corps campant sur ses archaïsmes, elle aurait au contraire incarné l’équilibre et la décentralisation du pouvoir [38]. Ils insistent aussi sur son sens du service, qui légitime sa participation aux affaires publiques, dont l’État (roi et ministres) s’est privé en diminuant son rôle au profit du Tiers. Ce faisant, la couronne s’est coupée de son soutien naturel (thèse de Vigny). Cette ingratitude du pouvoir n’a pas empêché la noblesse d’être fidèle jusqu’au bout. C’est un discours qu’on trouve (malgré leurs points de désaccord) chez Bonald et Montlosier. S’il fonctionne assez bien pour le XVIIe siècle, notamment pour analyser l’action de Louis XIV, il faut reconnaître qu’il s’applique moins aux règnes de Louis XV et de Louis XVI, qui ont plutôt favorisé la réaction nobiliaire.
N’étant ni théoricien politique, ni historien malgré son désir d’être reconnu comme tel, Dumas passe avec une certaine liberté d’un discours à un autre. Liberté, ou incohérence, diront ses détracteurs. Mais les retournements ont leur logique interne et s’organisent selon le statut de la narration (récit ou discours) et selon la nature (historique ou fictive) des personnages et des événements. Pour dire les choses autrement, Dumas analyste et orateur et Dumas romancier ne disent pas tout à fait la même chose. La noblesse historique donne souvent prise aux accusations, alors que les personnages fictifs s’inscrivent dans un discours de réhabilitation. C’est ce qu’on va vérifier dans les exemples qui suivent.
La Fronde
Vingt Ans après, qui traite de la Fronde, s’attache à la question suivante : la noblesse frondeuse a-t-elle agi contre le trône ? Précisons que l’épisode relaté dans le roman est en fait la Fronde parlementaire de 1848-1849, et non pas la Fronde des Princes de 1650-1653. Elle est peinte sous un jour qui minimise les événements, et invalide la théorie d’un corps visant à amoindrir le pouvoir royal. Il n’y a pas de comparaison possible avec la Ligue dépeinte dans La Dame de Monsoreau qui montrait un chef de maison visant à s’emparer du trône. Même éclatée en deux camps, la noblesse reste attachée à une seule cause : celle du roi. Les Frondeurs, se fondant sur la situation toute particulière de la Régence, prétendent servir le roi contre lui-même, l’État étant incarné par une reine et un ministre étrangers. Malgré tout, le roman les peint sans complaisance, en pointant le caractère contre-nature de leur alliance avec les magistrats, la bourgeoisie, le peuple, et en insistant sur le ridicule et la vacuité des grands personnages, comme Beaufort et Bouillon. L’accent est également mis sur leur manque de programme politique, et sur les raisons bien matérielles de leur apaisement, à savoir les avantages personnels qu’ils obtiennent au cours de peu glorieuses tractations [39]. La noblesse non frondeuse n’est guère mieux traitée, comme le montre l’insistance sur le poids du préjugé nobiliaire, relevé dans les deux camps : si les Frondeurs s’opposent à Mazarin, étranger et roturier, les loyalistes refusent d’être dans le même camp que des parlementaires et des bourgeois pour la même raison [40].
En revanche, les personnages romanesques se distinguent par leurs actions d’éclat ou par leur hauteur morale. D’Artagnan maugrée contre Mazarin, mais fait de son corps un bouclier pour le jeune roi entouré par la foule. Aramis et Athos sont dans le camp des Frondeurs, mais très critiques vis-à-vis de ses chefs ; cela ne les empêche pas de protester de leur fidélité au roi. Athos a d’ailleurs engagé son fils dans le serment solennel qu’il prononce à Saint-Denis. Mais les loyautés individuelles souffrent de la complexité de la situation, qui recèle plus d’une contradiction : malgré sa prise de position, Athos envoie Raoul combattre dans l’armée royale. Ce brouillage des repères suscite le malaise des héros devant une histoire illisible. « Tout est pauvre et mesquin en France en ce moment [41] », dit Athos, en pleine crise de mélancolie romantique, dans un contexte désenchanté qui peut s’appliquer autant à 1649 qu’à 1845. « Tout », c’est-à-dire les circonstances, les personnages historiques, la place nécessaire des compromis. Dédaignant les demi-mesures, les héros dumasiens se rebiffent contre la realpolitik.
La révolution anglaise
C’est alors qu’une grande cause se présente à eux : servir un roi étranger et menacé. Cet épisode revêt une importance capitale : on sait que pour la plupart des historiens du XIXe siècle, notamment Guizot, il y a un lien évident entre la révolution anglaise et la révolution française, et entre l’exécution de Charles Ier et celle de Louis XVI.
La dimension historique de Charles Ier est très peu évoquée dans le roman, qui retient surtout l’image pathétique d’un roi trahi par les siens [42]. Dans ce contexte, l’engagement des personnages prend un sens plus moral que politique et se détermine par des valeurs liées aux vertus aristocratiques, comme le montre le chap. LXI de Vingt Ans après, intitulé précisément « Les gentilshommes » : pour Athos, il faut servir « la cause la plus sacrée qu’il y ait au monde : celle du malheur, de la royauté et de la religion ». Cet impératif catégorique à dimension internationale entraîne un devoir d’ingérence impérieux, fût-ce contre son propre pays. La fiction traduit alors le point de vue propre à la noblesse, européen autant voire plus que national [43] ; malgré les apparences, il n’est pas question de trahison, mais de prise en compte d’une instance plus élevée. C’est avec ce système de valeurs qu’Athos parvient à « retourner » d’Artagnan à qui il fait comprendre que sa mission auprès de Cromwell est incompatible avec son honneur de gentilhomme. « Tous les gentilshommes sont frères ; les rois de tous les pays sont les premiers des gentilshommes : et vous d’Artagnan, vous avez contribué à livrer un roi à des marchands de bière, à des charretiers ! Comme soldat, peut-être avez-vous fait votre devoir, mais comme gentilhomme, vous êtes coupable, je vous le dis… » Que d’Artagnan et Porthos changent de camp en entendant ce discours est une chose, qu’il ne fasse pas du tout réagir négativement les lecteurs d’une époque acquise aux idéaux démocratiques et à l’idée de nation apparaît plus surprenant, même si la distance chronologique et psychologique apporte une part d’explication.
Se dévouant jusqu’au bout, les Mousquetaires reçoivent la Jarretière de la part de Charles Ier et sont adoubés par lui, qui se pose en primus inter pares. Ils ne meurent pas sur l’échafaud, mais Aramis y monte pour assister le roi et Athos est dessous pour recueillir ses dernières paroles, témoignant d’un dévouement totalement désintéressé qui débouchera sur la restauration de Charles II dans Le Vicomte de Bragelonne.
Que retirer de ces épisodes ? Loin d’affaiblir la couronne, la Fronde l’a renforcée, fût-ce à son corps défendant. Son échec débouche sur l’instauration de l’absolutisme, comme le dira le jeune Louis XIV : « La Fronde, qui devait perdre la monarchie, l’a émancipée [44]. » Sur le plan romanesque, les héros se rallient à Mazarin (comme ils s’étaient ralliés à Richelieu à la fin des Trois Mousquetaires) ou se désengagent de la lutte armée ; les Frondeurs, séduits par une proposition de « paix des braves », font taire leur opposition, ce qui traduit moins la réalité historique que l’obsession d’unité nationale récurrente chez Dumas. La noblesse romanesque, du fait de ses valeurs spécifiques, a prouvé son dévouement pour un trône étranger menacé avant de le prouver dans le contexte français.
La Révolution française
Dans Les Mémoires d’un médecin, l’Histoire apparaît comme le produit d’un complot (mené par les Illuminés), ou de l’action populaire, si bien que les élites (couronne et noblesse) apparaissent dépassées et impuissantes dans un mouvement qui leur échappe. Dépossédée de son rôle politique, la noblesse subit l’histoire plus qu’elle ne la fait, ce qui n’empêche pas l’analyse, ni le cas échéant la mise en accusation. Refusant l’univocité, le roman fonctionne sur le mode pluriel, distinguant bons et mauvais nobles. Largement influencé par Michelet, dont il reprend parfois mot pour mot le discours accusateur, il charge les profiteurs, comme les Polignac [45], qui, après avoir ruiné la popularité de la couronne, abandonnent leur poste et émigrent dès juillet 1789 [46]. Cette question de l’émigration, encore importante au XIXe siècle, a valu à la noblesse l’accusation d’être anti-nationale, à laquelle répond Germaine de Staël [47] en distinguant la mauvaise émigration de la première heure (contre la nation) et l’émigration de légitime défense pour assurer sa survie.
Mais ces personnages « à charge » sont à peine esquissés. Le roman préfère rappeler le dévouement de certains nobles « historiques » comme le comte de Favras, assimilé à un martyr, dont le supplice est longuement relaté [48]. Il insiste surtout sur les modèles de loyauté et de constance qu’incarnent certains héros romanesques ; Olivier de Charny, notamment, agit par pur sentimentalisme monarchique, sans aucune illusion sur l’avenir du régime, si bien qu’il est dédouané de toute solidarité idéologique avec un système présenté comme dépassé. Acquis à la cause démocratique, il manifeste « quand même » sa fidélité au trône, sans être aucunement un ultra avant l’heure, malgré ce que pourrait suggérer cette expression. Jouant un rôle de soutien psychologique plus que politique, il est en fait principalement dévoué à la reine, alors que le conseiller du roi est le docteur Gilbert, un bourgeois libéral. Le roman exalte cette fidélité sans pour autant le compromettre avec Marie-Antoinette, qui fait l’objet d’un portrait ambivalent. Olivier de Charny prône la modération, ce qui est pour lui la meilleure des protections, et tempère l’humeur belliqueuse de la reine, qui veut marcher sur Paris après le 14 juillet [49]. Il ne se dissimule cependant pas l’approche de la tragédie. À la reine qui lui demande : « Comment faut-il que je tombe ? », il répond « en victime, Madame, comme tombe une reine, en souriant et en pardonnant à ceux qui la frappent [50] ». Cette lucidité (qui sent un peu l’a posteriori) ne l’empêche pas de s’attacher, au fil des événements, non pas à préserver la royauté, mais à sauver physiquement la reine, le roi et leur famille, comme pour illustrer les derniers mots de Gaule et France : « Meure la royauté ! mais Dieu sauve le roi [51] !… ». Ce dévouement dépasse d’ailleurs le cadre individuel et caractérise toute la famille Charny. Les trois frères servent la reine jusqu’au bout : le plus jeune tombe devant sa porte, lors de la journée des 5 et 6 octobre, le second, Isidor, est tué après l’arrestation de Varennes en la protégeant, Olivier, enfin, meurt lors de la prise des Tuileries en couvrant sa fuite vers l’Assemblée. La série funèbre n’est pas terminée et se poursuit avec l’assassinat d’Andrée de Charny pendant les massacres de septembre. Toute la famille reste fidèle sans illusions à une cause perdue, payant ainsi un nouveau type d’impôt du sang, non dans de glorieuses batailles, mais dans la confusion de la guerre civile.
Qu’en est-il de la noblesse après le séisme révolutionnaire ? La fin du roman (et du cycle) résonne comme un requiem consacrant sa disparition, voire son extinction. Mais cette idée est infirmée par la présence discrète de deux personnages qui illustrent sa survie sous une autre forme. Sébastien Gilbert, fruit d’un viol, et Isidore de Charny, l’enfant de l’amour, incarnent le mélange entre l’élément noble et l’élément populaire. Et si le premier émigre en Amérique avec son père pour fuir les soubresauts de l’histoire de France, le second grandit tranquillement à Villers-Cotterêts (comme Dumas), dans une fin apaisée qui illustre la réconciliation des castes. Mais pas la société sans classes : l’apologie de la noblesse débouche sur un nouveau modèle, fondé sur le mélange social, redéfinissant les élites sans les remettre en cause.
Doit-on s’étonner de cette peinture quasi-hagiographique de la noblesse romanesque de la part de quelqu’un qui dit professer des opinions « à peu près républicaines » ? L’entreprise de résurrection d’une société partiellement disparue n’est pas exempte d’une forte dimension nostalgique [52]. L’adhésion aux idéaux démocratiques n’empêche pas la séduction persistante du modèle aristocratique, et en cela Dumas se rapproche de Tocqueville et de Vigny [53]. Cette attitude marque aussi une prise de distance par rapport à l’état d’esprit bourgeois et utilitaire de la monarchie de Louis-Philippe, mais encore plus par rapport à la IIe république, qui nie la notion même d’élite. La France du milieu du siècle traverse une crise d’identité, qui, comme toutes les périodes de redéfinition, est propice au regard dans le rétroviseur. Le besoin se fait sentir de ne pas renier un passé qui fait partie de la mémoire collective. Le roman historique, qui invite le temps d’une lecture à adhérer à des idéaux et à un système de valeurs obsolètes, favorise peut-être une certaine schizophrénie chez son public, mais fait sans doute tout autant fonction de thérapie collective en aidant à supporter les soubresauts de l’histoire et à colmater les déchirures. Loin d’être une simple excroissance du passé, le débat s’inscrit dans un pays en pleine construction identitaire. Dès ses premiers romans [54], le romancier y a contribué en revisitant la question des origines. Durant toute sa vie, scandée par les répliques de 1789 et 1793, il s’attache par le biais de l’écriture à réconcilier la France issue de la Révolution et celle qui la refuse ; la réintégration de la noblesse dans le roman national en est une condition sine qua non.