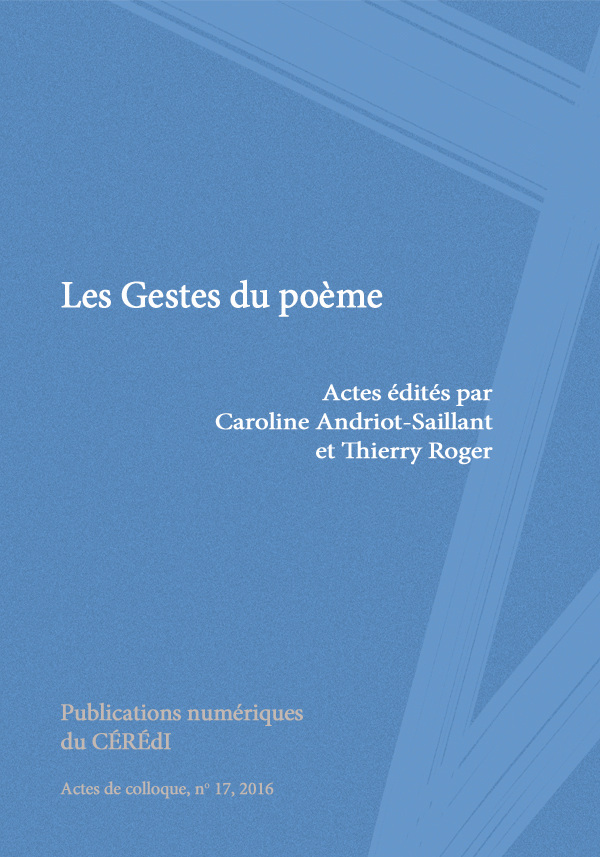« Écrire, c’est accepter d’être un homme, de le faire, de se le faire savoir, aux frontières de l’absurde et du précaire de notre condition. […] C’est être certain d’une chose indicible, qui fait corps avec notre fragilité essentielle [1] » écrit Georges Perros dans Papiers collés 2. L’être-au-monde participe d’un flux où l’homme est à la fois passif et actif, dans l’acquiescement et dans l’action. L’homme est saisi et se ressaisit à la fois, consent à et met l’accent sur la fragilité de sa condition. Accepter et faire savoir requièrent un double mouvement de l’écriture, entre consentement et geste vers l’autre. Chez Perros, ce mélange d’acquiescement et de geste incarné prend une forme étonnante dont il témoigne dans ses Entretiens : la paradoxale urgence d’écrire pour ne pas avoir à écrire : « Écrire n’est pas un plaisir, certainement pas. […] Je me débarrasse, c’est comme quand j’enlève une guêpe de mon front, c’est quelque chose qui me gêne […], qui brûle, qui fait mal, qui a le temps de mettre son dard dans la peau [2]. » Le premier geste de l’écriture est ainsi lié à une menace de la chair même, à une souffrance, à un assaut bourdonnant. Le geste de la main, signe d’une écriture incarnée, est d’abord un refus, un élan subi, une tentative d’interruption, comme une réponse à une dynamique qui le précède. La poésie de Perros est toujours placée sous le signe d’une inquiétude, d’une intranquillité, de l’aiguillon de la douleur. La conscience de la précarité engendre une écriture de l’imminence, de l’urgence, qui va développer deux motifs : le creux et le comble.
Écrire c’est […] pénétrer dans la mine, où très possible le coup de grisou. Un homme qui écrit et qui s’y tient, est menacé. […] Écrire, […] c’est frapper à la porte jamais ouverte, au seuil de laquelle se sentir comblé [3].
C’est cette problématique du creux et du comble qu’il convient d’explorer, pour mettre en lumière le geste essentiel du poème – creuser – qui prend une allure particulière chez Perros : écrire, c’est « fouailler » ses mots, c’est-à-dire à la fois fouiller et fouetter. Il s’agit donc d’étudier dans quelle mesure les figures de creux, de cavité, et les dynamiques de relance, de comblement requièrent des gestes particuliers du poème et constituent la singularité de l’écriture de Perros.
De Poèmes bleus à Une vie ordinaire, la poésie de Perros est marquée par le surgissement de figures creuses qui sont de deux ordres : des figures qui enterrent ou des figures qui recueillent. Les premières sont des cavités morbides, des espaces creusés, propres à exprimer le désenchantement du poète : « les hommes sont dans une ornière » écrit d’emblée Perros dans « Ken avo », premier poème du premier recueil. Le lieu même de l’écriture est un décor marin fait de cavités morbides :
[…] Ce passage haineux
Où la mer est tuberculeuse
Avec des cavernes des trous
Des toux de sa poitrine en feu
Entre le nid de roches brunes [4].
Ornière, caverne, trous, « nid de vipères » des rochers d’Ouessant dessinent dans Poèmes bleus une mythologie personnelle de l’ordre du minéral, que l’on retrouve dans Une vie ordinaire dans des variations autour du motif du fossé funèbre, de la tombe, également dans l’épitaphe ironique en début de poème, sorte de clin d’œil à Villon :
Ici naquit Georges Machin
qui pendant sa vie ne fut rien
et qui continue Il aura
su tromper son monde en donnant
quelques fugitives promesses
mais il lui manquait c’est certain
de quoi faire qu’on le conserve
en boîte d’immortalité [5].
L’image décalée de la boîte de conserve inaugure une longue série d’images de creux, dans Une vie ordinaire, et plus précisément de cercles vides. En effet la quête de soi passe d’abord par la quête du vide : « ce que je cherche c’est ce trou », « Je cherche / à savoir ce que pense un homme / quand il ne pense à rien », « Je cherche / à savoir ce que sont les hommes / quand ils sont comme moi présents / dans un espace sans personne [6] ». Cette recherche de présence dans et malgré le vide, Perros la manifeste par le biais de figures circulaires, le plus souvent de tonalité négative : « défunt cerceau », difficulté à être « dans mon assiette », « trou d’où le sang coule en ma mémoire », « fosse aux ours », « Le zéro / est notre actuel numéro ».
D’autres motifs creux ouvrent une série de figures qui recueillent, au double sens de « contenir » et (se) « recueillir ». Les figures en creux se font alors images de contenant. Ce sont d’abord des images d’une Bretagne ancestrale et mystérieuse :
L’amour qu’on éprouve pour un pays
Cela tient à rien
[…] À une rue très mal pavée
Au coin de laquelle il est sage
De rester muet […]
À une odeur, une fontaine
Dans le secret d’un chemin creux
Un lavoir où tout le linge du quartier
Depuis des siècles
Vient se faire battre en mesure
Il y a toujours un peu de paradis
Sur notre boule terrestre
La Bretagne en a gobé une bonne partie [7].
Les images de la fontaine et du lavoir expriment bien la dynamique circulatoire de l’écriture de Perros : « il y a lyrisme dès qu’il y a circulation », rappelle-t-il dans Papiers collés 3. L’évocation exprime une sorte d’expérience synesthésique quasi sacrée, qui invite au recueillement. Le geste essentiel du poème est aussi une invitation à l’exploration d’un espace intérieur, à la fois circulaire et rectiligne, profondeur et surgissement :
Je t’invite à te recueillir […]
À l’intérieur de cette région en toi
restée vierge […]
Cette région de confidence indicible […]
Au rythme de la pulsation horizontale
Que la Bretagne rentre […]
Dans les mille rues de ton âme […]
Rues qui montent, montent, et soudain
Tout l’horizon sous ta paupière [8].
Linge qui « vient se faire battre en mesure », surgissement de « tout l’horizon sous ta paupière » : tout se passe comme si la mesure, la cadence rythmique, et les images recueillantes créaient les conditions d’une performativité de la poésie de Perros, une invitation à un espace de possibles, qui puisse être réappropriable par le lecteur, comme en témoigne le vœu du « miracle / de nos mémoires conjuguées ». Cette parole réappropriable, c’est aussi le coquillage qui en est le réceptacle, espace creux au creux de l’oreille : « Dans le cœur mat d’un coquillage / On l’entend encore chanter [9]. » Objet courbe et creux, le coquillage accueille la parole qui désigne aussi le pro-verbe, cette parole en avant, supérieure, sacrée, dont la trajectoire mène au lieu même de la parole – la gorge, précisément cavité résonante de poésie : « Et c’est bien la poésie / Qui s’est enfoncée jusqu’à la garde / Dans la gorge de la Bretagne [10]. »
Les figures de creux évoquées témoignent d’un geste poétique fondateur – creuser – ou plus particulièrement « fouailler » les mots. Perros en désigne l’enjeu dans Une vie ordinaire : « Quand je fouaille mes mots c’est là / que je soupçonne mon espace / avant tout langage / […] pour le moment ô précaire [11]. » La surimpression paronymique et sémantique entre « fouailler », « fouiller » et « fouetter » suggère l’alliance du concret et de l’abstrait, la stimulation (« fouetter ») par le fait de creuser (« fouiller ») toujours plus profond. Les formes et la dynamique du creux renvoient à cette quête de profondeur jusqu’à l’humus, qui est aussi cette quête d’un sermo humilis porteur de vérité : on songe à nouveau ici à l’image du lavoir, espace de pauvreté, espace de rythme où « battre en mesure » équivaut à battre la mesure, et devient geste essentiel de la quête de transparence.
Quelles sont alors les conditions et les modalités de ce geste essentiel de « fouailler » ? La dynamique de l’évidement, du creusement – qui rappelle la métaphore de l’écriture comme entrée « dans la mine » – est intimement liée à une dynamique de ressassement, dans une fébrilité du geste qui témoigne, chez Perros, d’une incarnation fragile. Cette fébrilité est exprimée par les modalités du tremblement, dans un rapport au monde de l’ordre de la pulsation, du « tressaillement organique », mais qui est aussi un tremblement assumé, recherché même, au nom d’une justesse de vie et de ton : « Ce que je cherche ce n’est pas la justice de mes pensées, mais la justesse, le tremblement, la solidification de leur “liquidité” naturelle », écrit Perros dans Papiers collés [12], « Je ne peux être présent, vibrant, grésillant en moi qu’entre deux trains [13]. » La fragilité de l’être engendre une fébrilité de l’écriture, que Perros définit, dans ses Entretiens, par un geste, par une image incarnée : « Pour moi le langage, le mien, c’est comme […] la chair de poule, c’est comme la mer quand on la regarde. La mer est très frileuse, en fait. Ou quand on touche la peau d’un cheval, quand on la caresse et tout à coup […] une espèce de mouvement. » Cette incarnation tressaillante de l’écriture renvoie à la matérialité d’un corps qui fait défaut. L’humilité du geste d’écriture se retrouve dans un étonnant hommage à la main, dans l’affirmation des valeurs paradoxales de pauvreté, de vibration et de présence :
[…] Et la vie
elle recommence demain
jusqu’à la mort de cette main
qui tient ce stylo main fébrile
et qu’un maigre poignet retient
[…] Main qui me fit moquer de moi
pour n’avoir que doigts inutiles
inaptes aux sacrés travaux
sinon pour cueillir une fleur
et encore main de fortune
on ne sait comment venue là
pour finir un corps sans présence
que seule allume la douleur [14].
Dans ces derniers vers d’Une vie ordinaire, la synecdoque prend le relais du « corps difficile à traîner », qui n’a « plus rien que la peau et les os ». La main prend en charge l’expression du poète impuissant. La main « orphique » du poète, qui pourrait transformer la fleur en chant (« doigts inutiles / […] sinon pour cueillir une fleur ») demeure fragile. La main est en effet toujours associée à la pauvreté, à la fragilité. Perros définit Une vie ordinaire comme « une espèce de poème-journal intime, avec les choses et les êtres pris là, sous la main, dans la pauvreté du moment ». Le manuscrit lui-même est en posture précaire : « je veux t’oublier maintenant, manuscrit. »
La vie, comme l’écriture, « elle recommence / demain » : le geste poétique essentiel de Perros – fouailler – rend compte à la fois de la nécessité et de la fragilité de l’engagement à creuser le vécu. Le terme « fouailler » dit bien le ressassement inhérent au geste, la stimulation, la répétition qui conduit, dans la poésie de Perros, à ce qu’on pourrait appeler une poétique de la reprise, au double sens de relancer et de repriser. L’écriture renvoie en effet à cette dynamique qui à la fois avance, se relance et corrige, engendrant dans Poèmes bleus notamment, un effet stylistique singulier, une « rhétorique de l’empilement ». Cette rhétorique est notamment à l’œuvre à travers la figure de l’anaphore. Cette forme dynamique du geste poétique, par reprise, juxtaposition, surimpression, acquiert une valeur structurante et rythmique fondamentale : cette relance anaphorique se combine d’une part avec une forme d’injonction au lecteur, entre invitation, ordre et supplication [15], d’autre part avec des tournures démonstratives et présentatives, comme si Perros voulait à la fois donner à voir, creuser et combler la fragilité des images de possible plénitude :
Je t’invite à te recueillir
Je t’invite à chercher avec moi
[…] dans cette carte imaginaire
dont je te propose l’exploration […]
Je te propose ce fugitif compagnonnage
Songe […]
À ces noms de rivière aussi
Ces rivières qui viennent doucement mourir
[…]
Laisse-toi prendre dans ces mots
Baigne-toi d’abord dans ces mots
Qui sentent bon la terre humide
Mots qui braconnent
[…]
Au contact rugueux des galets
De ces galets que l’on ramasse
Que l’on caresse [16].
C’est bien la figure de l’anadiplose qui mène le rythme des vers et crée un tempo très singulier, un effet de spirale, que Perros lui-même compare au crachin breton [17]. Cet effet de vertige même est renforcé par un jeu d’homonymie, sur la nature des mots en anaphores : « Entre avec moi dans cette brume […] / Entre le sauvage et le tendre / Entre le roc […] / Entre l’effroi / Et le plaisir d’être vivant [18]. »
L’anaphore, aux fonctions à la fois structurante et rythmique, est aussi au service de la construction rhétorique d’une exemplarité humaine. On est là au cœur de l’écriture de Perros. En effet, dans un recueil souvent désenchanté, Poèmes bleus, surgit un portrait d’hommage aux marins, dépliant comme un éventail les facettes de l’homme de mer :
Tout à fait indifférent aux autres hommes sur la terre […]
Un homme en état de sauvagerie […]
Un homme en posture d’enfance
Un homme avec la ruse la brutalité
Mais aussi cette ingénuité […]
Mais aussi cette étrange soumission
À la femme à l’épouse […]
Son homme est en mer
Mais c’est elle qui lui conserve la terre [19].
Le mouvement de reprise instaure une tension entre général et particulier. C’est bien par le geste du poème, par le déploiement d’images en constante relance – « Il faut […] / que je t’ouvre comme un éventail » écrit Perros dans son adresse à la Bretagne – que, de vers en vers le lecteur fait l’expérience du cheminement de l’exemplification à l’exemplarité. C’est en fouaillant les mots, en creusant et en comblant les vides que Perros présente une image d’homme quotidien exemplaire, comble d’humanité, exemple par excellence d’une certaine vision de l’homme. Le comble est à la fois un type d’incarnation – le marin – et une dynamique d’écriture au rythme cadencé et à l’énergie circulatoire. Le marin devient ainsi un modèle éthique par son rapport au langage et par son être-au-monde. Le marin est un exemple à la fois comme illustration métonymique – du caractère breton, des gens de mer – et comme paradigme métaphorique qui donne corps et émotion à la pensée. À travers lui se dessine un modèle d’humanité et de vérité. Et si « la mer est broyeuse d’histoire », le portrait du marin, entre singularité et généralité, précisément par le geste du poème, le fouaillement des mots, devient mémorable.
Les effets de relance et d’enjambement évoqués pour Poèmes bleus prennent un relief particulier concernant Une vie ordinaire, long poème autobiographique en octosyllabes. En effet, c’est précisément en termes de contention et débordement que s’exprime Perros pour définir son écriture. Se déclarant « assailli, sollicité par une meute de mots en dérive […] moutons d’un Panurge éberlué qui n’a que le temps d’enregistrer leur fragile parole [20] », il évoque surtout une incroyable chevauchée :
J’entendais des huit pieds qui me galopaient dans la peau, une espèce de Camargue de huit pieds.
C’est le jeu des huitains, des voyelles et consonnes, qui m’a amusé. Des dérapages, freinages, pitreries.
Cette fameuse chose que je cherche toujours, que je chercherai sans arrêt, […] que je freine justement de temps en temps, que je mets en musique, petite musique [21].
Si « raconter sa vie en octosyllabique / n’est pas courant [22] », comme le concède Perros, il en fait une expérience courante, au double sens de « ordinaire » et de « dynamique ». La nécessité de freinages, de contention d’un rythme galopant, débordant, Perros la développe précisément par une métaphore de cavité, qui dit à la fois le trou, la capacité de recueillement, le double geste de creuser et de combler : c’est l’image du puits. Et comme si un mot en appelait un autre, l’assaut des vers conduit au seau du puits et au saut des vers :
Le vers de huit pieds est une espèce de puits, comme un seau qui ferait la navette dans le puits. Alors ça sort dix vers, ça sort vingt vers. Ça se lit comme ça, je crois, la Vie ordinaire. C’est une espèce de petit puits et la lecture, c’est le seau. On met le seau dedans et on en retire quelque chose. Le vers de huit pieds, c’est l’eau qui dépasse du seau. Ce n’est pas le seau, ce n’est pas l’eau dans le seau, c’est l’eau qui saute. C’est ça qui donne cette espèce de pulsation, de mouvement, sans doute, quelque chose qui coule, comme ça. Un mot chasse l’autre, dans tous les sens du terme [23].
« C’est l’eau qui saute » : la formule dit à la fois l’élan et l’échappée des vers. Or Perros l’affirme : « ce qui m’intéresse c’est ce qui m’échappe. Et ce qui m’échappe me donne la mesure de ce que je suis [24] » : cette mesure est à la fois rythme, cadence, et vigilance, repli – débordement et contention.
La métaphore du puits est récurrente dans Une vie ordinaire, expression de la solitude, du vide : « « Et puis cette façon d’aller / au puits pour boire poésie / ce qui demeure après l’été / en ton fond ce n’est pas permis [25] », « en nous tous la solitude / est un puits […] ». Écho au « lavoir » et à la « fontaine » propres à éveiller la magie de la Bretagne, le puits est un symbole poétique, au sens premier de lieu de réconciliation. Il constitue le comble du creux, si l’on peut dire. À la fois lieu du vide et du plein, du sec et du liquide, de la verticalité et de la circularité, il permet une écriture « de sources et de secours », pour reprendre une anagramme de Perros et semble désigner le lieu même de la poésie, comme fondement et comme pratique. Espace délimité en même temps qu’espace de liberté, de mouvement, de liquidité, de fluidité, l’octosyllabe, « espèce de puits », crée un appel, un élan mystérieux et musical qui révèle le pouvoir rythmique de la langue à exprimer la vie :
D’où nous viennent ces rythmes, ces cadrages respiratoires qui nous forcent à obéir à leur exigence musicale, et nous font croire que tout le monde parle non pas tant en vers que soumis à une mystérieuse métrique qui les caractérise plus et mieux que leurs paroles mêmes [26].
Dans ce transfert du quotidien à la langue écrite, de l’attention au monde à la solitude de la méditation personnelle, le poète se fait passeur, dans et par le poème.
Si le comble du creux renvoie au puits, en désignant un espace de poésie, en désignant le double geste du poème, creuser et combler, le comble désigne aussi un espace protégé qui permet les conditions propres à l’écriture poétique, une sorte de locus amoenus. En effet, par un effet de topologie gigogne, l’emboîtement progressif des lieux perrossiens conduit peu à peu à l’espace essentiel de la sensibilité de Perros : le comble, c’est-à-dire la mansarde, et ses variantes, le grenier ou le garni. Le lieu du comble, à la fois élevé, trop plein et restreint, constitue un fil d’Ariane dans le parcours initiatique de l’enfance et de l’âge d’homme [27]. En effet, la naissance (« Je suis né dans une mansarde »), l’adolescence (« Je partais de la rue Lepic / d’un garni »), le temps de l’écrivain puis celui de la mort sont placés sous ce signe du comble : « J’ai dans un coin de ma mansarde / petits cahiers à l’encre rouge [28]. » Sens concret et sens métaphorique se mêlent pour désigner le comble de ce mouvement centripète, cet espace paradoxal à la fois brisé et rassurant, élevé et pauvre, froid et source de chaleur, lieu de l’écriture et affirmation du rien. « Je suis bien dans ma turne, qu’on me foute la paix », écrit Perros à Michel Butor [29]. En outre, la volonté d’épure de l’espace semble se prolonger dans des espaces en voie de miniaturisation : le « coin de [la] mansarde » est aussi le lieu du « paravent », du « tiroir », qui renferment et protègent des pans de vie entière. Le désir de repli est lui-même à son comble chez Perros, pour lequel la mansarde en haut des escaliers désigne à la fois une dimension spirituelle et un degré supplémentaire de solitude : « quand on monte l’escalier / souvent je ferme à double tour / pour ne pas avoir à souffrir [30]. »
Tout se passe comme si la « poétique du fouailler », qui exige la solitude du comble pour aller au creux des mots, constituait la condition et le moyen d’une « éthique du foyer », qui viserait à conjurer la précarité par une qualité de présence à soi, et de relation à l’autre – ce que Perros appelle la fraternité.
Le lieu poétique élu est donc le lieu du comble, qui renvoie aussi à la tradition des lieux de solitude et d’écriture, les loci génériques du discours de retraite et de méditation. La retraite est chez Perros à la fois une position, un renoncement, un art de vivre et un état de l’être. Évoquant son père « en retraite », il écrit :
[…] Je l’ai prise
la mienne bien avant qu’on me
signifie que j’y avais droit
oui j’aurai commencé par là
sans le dire comme en cachette
La retraite crée un état de disponibilité et d’écoute de l’autre, une réceptivité optimale à tout assaut du quotidien, à tout événement. « La poésie, pour moi, c’est le temps durant lequel l’homme oublie qu’il va mourir [31] », écrit-il dans Papiers collés 3. Comme si, pour Perros, vouloir écrire « pour se sentir comblé », c’était écrire dans les lieux du comble. Ce repli n’est cependant pas une posture négative. Parlant de sa vie en marge, dans une banalité quotidienne, de la nécessité d’écrire « pour combler la marge », Perros rappelle qu’« il ne s’agit pas d’un nombre incalculable de NON à la société, mais d’un tout petit OUI tenace, imbécile, têtu, un oui d’âne. Je me suis mis au coin [32]. » Entre affirmation et consentement, le « oui » de Perros exprime une infirmité acceptée et métamorphosée dans et par la poésie [33]. Cette existence « en instance » d’unité, il la reconnaît dans un néologisme d’Antonin Artaud qui le bouleverse, « l’êtreté [34] ». Face au défi grandiose et dérisoire de trouver quotidiennement sa respiration, cette « êtreté » quotidiennement compromise, entre le calme et la folie de la mansarde, repose sur une alliance illusoire : « Un type m’a écrit que j’étais amer et enchanté. Pas mal vu. Mais voilà deux pinces cruelles [35]. » Ces deux pinces cruelles, ce sont également le creux et le comble, dans un geste poétique tenace – fouailler, qui dit autant la banalité que l’exigence, le cheminement que le ressassement, la quête de soi que la mesure du poème.