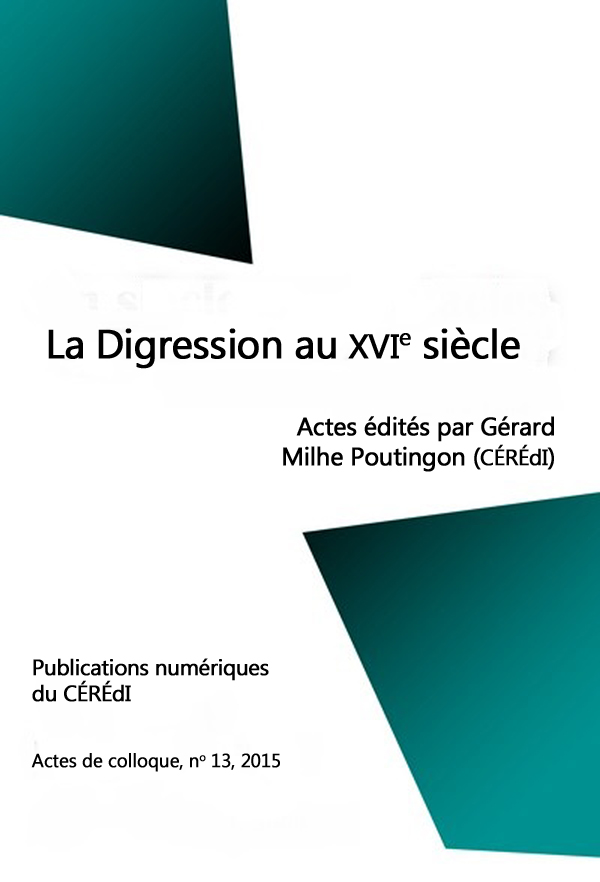Assumée ou refoulée, la digression hante la littérature du XVIe siècle. Les questions soulevées par ses définitions et usages sont nombreuses. Plusieurs d’entre elles ont été abordées lors de la journée d’étude qui s’est déroulée à l’Université de Rouen le 6 novembre 2014.
Tout d’abord, des problèmes de définition, et même de terminologie [1]. Les noms de la digression sont en effet multiples [2]. Lorsqu’il l’aborde directement, Quintilien la désigne en ces termes : « Hanc partem parekbasin vocant Graeci, Latini egressum vel egressionem » [3]. Mais il utilise aussi digressus [4], excursio [5], excursus [6], procursio [7], excessus [8]. La tradition utilisera ces termes [9], parfois repris de Cicéron [10], qui a par ailleurs recours à la notion de declinatio brevis a proposito [11]. Le grec parekbasis s’est imposé grâce au choix de Quintilien [12], mais existe aussi diexodos, etc. En français, le mot parenthèse désigne fréquemment une digression [13], bien que les emplois de ce mot ne correspondent pas systématiquement à un tel usage [14]. La digression peut en outre se confondre, par métonymie, avec certaines de ses fonctions. Elle sera alors présentée comme une description, un récit, un commentaire [15]… En définitive, comme le remarque Randa Sabry, l’« excentricité » de la digression « éclate à travers la série des signifiants choisis pour la désigner » [16].
Le mot digression est lui-même l’objet d’un débat, que l’on peut considérer comme symbolique des relations tendues entre le détour et les normes du bien-dire. Digression forme en effet un doublet avec le mot disgression, ce dernier étant généralement considéré aujourd’hui comme un barbarisme, c’est-à-dire une forme fautive, inexistante. Pourtant, disgression a bel et bien été en usage dans notre langue. On le rencontre couramment au XVIe siècle :
La neufviesme [manière de « saillir de son histoyre »] est disgression, et est saillir de sa principalle matiere et entrer par incident en nouvelle de non semblable substance, puis retourner a son propos devant dit et ne doibt point estre ladicte disgression longue [17].
On le retrouve ensuite, tout aussi couramment, aux XVIIe [18] et XVIIIe siècles [19]. Ainsi, pendant longtemps, digression et disgression ont coexisté. L’hésitation est remarquable lorsque ces deux mots cohabitent dans un contexte étroit, en particulier pour référer à un même détour :
Comme les plus aigres Censeurs […] prennent toutes concions pour autant de Digressions de l’Histoire, […] qui n’aura honte d’user de ces feintes et controuvées disgressions [20] ?
Or l’on me pourroit objecter pourquoy j’ay faict cette disgression […]. Si faut-il que je fasse encor ceste digression [21].
Il est certain que la guerre de Jugurtha n’eust pas esté moins bien descritte sans ceste Disgression […]. Je serois bien fasché qu’on crût qu’en remarquant cette Digression de Salluste, je la voulusse condamner [22].
Les Historiens se plaisent fort aux digressions. […] L’envie de paroistre savans jusques dans les choses qui ne sont pas de leur metier, leur fait faire quelquefois des disgressions tres-mal entenduës [23].
Cette ambivalence se retrouve dans les dictionnaires. C’est par exemple le cas dans le Dictionnaire d’Antoine Oudin, où Digressione a le sens de « Digression » alors que Digresso, quelques lignes plus bas, signifie « Disgression » [24]. Et si on retrouve ce cas dans le Diccionario español e ingles de Baretti [25], c’est tout simplement parce que la langue anglaise connaît elle aussi l’ambivalence disgression / digression ! De même d’ailleurs que l’espagnole…
Au XVIIIe siècle, toutefois, un changement s’opère : disgression est fréquemment corrigé en digression dans les listes d’errata [26]. C’est le signe que l’orthographe de ce mot commence à se fixer, la forme digression l’emportant. Évolution logique de ce changement, la forme disgression devient, au XIXe siècle, une « locution vicieuse » :
Locut. Vic. Cette disgression est inutile.
Locut. Corr. Cette digression est inutile.
Ce jugement, tiré du Dictionnaire critique et raisonné du langage vicieux ou réputé vicieux [27] écrit « par un ancien professeur », n’est malheureusement pas expliqué par son auteur. Ce qui n’est pas le cas des jugements portés sur toutes les autres « locutions vicieuses », ces manières de parler « tout à fait triviales, vraiment dignes des tréteaux de Bobêche », qui n’ont « en leur faveur d’autre autorité que celle d’un mauvais usage » et qui ne sont « jamais usitées par nos bons écrivains modernes » (locutions dont on s’aperçoit qu’elles sont parfois aujourd’hui en usage, comme ce « mot boursouflé » qu’est dînatoire). Le discrédit frappant le mot disgression est désormais bien installé chez nos puristes.
Pourquoi les lettrés des époques préclassique et classique déclarent-ils composer des « disgressions » autant que des « digressions » ? Pour la raison que disgredior est attesté en latin. Digressio est en effet issu de digredi, lui-même issu de dis- + gradi. La forme primitive, avec le préfixe dis-, ne s’est toutefois pas maintenue car, en latin comme en français, le -s- de ce préfixe disparaît devant consonne sonore [28]. C’est cette évolution phonétique, ajoutée au fait que notre langue s’est retrouvée avec deux formes presque identiques référant à la même chose (ce qui rendait l’une d’elles superflue), qui explique que la graphie disgression soit progressivement tombée en désuétude.
Certes, cette forme est aujourd’hui singulière, affranchie de notre usage actuel. Elle peut donc apparaître comme un « barbarisme ». Mais à condition de bien savoir de quoi l’on parle. Car, comme on le comprend, la graphie disgression est en réalité une forme savante, comme il en existait beaucoup d’autres dans les imprimés de l’époque, et c’est bien ainsi qu’elle était comprise par les lettrés du XVIe siècle.
Le conflit entre ces deux formes ne fait qu’exhiber un aspect supplémentaire des rapports difficiles que la digression entretient avec les normes du dire. Là encore, nos jugements contemporains font parfois montre d’un défaut de mémoire. Car, on l’oublie souvent, la tradition oppose en réalité deux digressions. Est tolérée, parfois valorisée, la digression courte, issue de la cause et utile à celle-ci. C’est la digression trop longue, étrangère au sujet, simple bavardage ennuyeux, qui est jugée inconvenante. Pour être convenable, le détour devra donc d’abord être bref. Quintilien insiste : la digression « doit se faire en peu de mots » [29], elle « ne devra être employée qu’autant qu’elle sera courte » [30]. Le risque est en effet à la fois d’ennuyer l’auditoire et de lui faire oublier le sujet :
Il est à craindre que l’esprit du juge, distrait par d’autres objets, et fatigué par des retards inutiles, ne perde de vue la narration [31].
Cicéron avait lui aussi précisé que ce sont les digressions courtes qui « jettent de l’éclat sur le discours » [32]. Pour Fabri, comme nous l’avons constaté, « ladicte disgression » ne « doibt point estre longue ». Très nombreux sont les repentirs d’écrivains (faussement) inquiets d’avoir trop longtemps digressé : « mais il est temps de sortir de cette digression » [33], « j’ay usé de trop longue digression » [34]. Cette norme va perdurer : Furetière dira qu’« on pardonne les digressions quand elles sont fort courtes et à propos » [35].
Le second critère du détour convenable est la pertinence. L’écart doit conserver un rapport avec le sujet principal. En fait, cette pertinence est le critère majeur. Car la brièveté consiste moins à dire peu, qu’à dire à bon escient. Pour Fabri,
la disgression [ne] doibt point estre longue […] car les auditeurs se resjouyssent de ouyr brief et mieulx retiennent, et se fait en [gardant] ses principaulx poinctz de sa matiere sans vaguer [36].
Une digression est donc courte si elle sait intéresser ou divertir ; la digression inconvenante, toujours trop longue, ennuie ou dérange. Une bonne digression doit adhérer au discours, non le briser et désunir avec la force d’un coin :
J’avoue que les digressions contribuent beaucoup à embellir et orner le discours, mais pourvu qu’il y ait cohésion et suite, et non pas si on les fait entrer de force, à la manière d’un coin, en séparant ce qui est naturellement joint [37].
Cerner soigneusement le sujet, tenir un discours approprié, est l’une des règles les plus constantes de la rhétorique : « L’art de bien dire suppose nécessairement, chez celui qui parle, l’examen antérieur et à chaque fois approfondi du sujet dont il parle » [38]. Une fois cette précaution prise, l’orateur peut tenir un discours ferme et pertinent :
Je commence par ce qui devrait être, à mon avis, le début de toutes les discussions, par déterminer soigneusement l’objet de la dispute. On empêche ainsi le discours d’aller à l’aventure ou à la dérive [ne uagari et errare cogatur oratio], comme cela se produit quand les interlocuteurs en désaccord n’entendent pas de la même façon le point à débattre [39].
Ce vaguer est l’une des métaphores les plus courantes de l’incongruence : « Extravaguer, et se mettre bien avant en choses impertinentes, ou non servantes à la matiere, Digredi a proposito, et longius aberrare » [40].
Plusieurs études sur la digression réunies ici examinent les aspects de cette norme de pertinence. Anne-Pascale Pouey-Mounou (« “A propos” : digressions rabelaisiennes ») soulève la question de l’acceptabilité de la digression, de son à-propos, chez Rabelais. Cette question, que posent avec malice de brillants causeurs tels que Frère Jean et Panurge, est située dans le cadre de la tempestivitas. Au cours de cette étude, nous voyons se dévoiler chez Rabelais, à la faveur de jeux de mots sur le terme propos, une « prédilection pour les digressions dérangeantes, leurs modes d’imposition paradoxaux, leurs conditions de légitimité et les voies d’une narration de plus en plus rompue et discoureuse ».
D’autres jeux linguistiques sont mis en œuvre par les écrivains de la Renaissance pour faire cadrer leurs détours avec les normes héritées de la rhétorique. Xavier Bonnier (« Digression et ekphrasis dans deux odes ronsardiennes ») analyse le statut digressif de l’ekphrasis chez Ronsard. Le problème de l’équilibre entre homogénéité et hétérogénéité du texte est posé. Ronsard organise l’acceptabilité de l’écart produit par des pièces certes rapportées, néanmoins « mystérieusement nécessaires ». Cette stratégie passe en particulier par de subtiles et récurrentes énallages temporelles.
Pascale Mounier (« L’amplificatio par l’anecdote personnelle : le meurtre en exemples chez Henri Estienne (Apologie pour Herodote, chap. 18) ») étudie le rapport entre acceptabilité et inconvenance dans les digressions de l’Apologie pour Herodote. Henri Estienne construit d’abord « un cadre relativement ferme dans lequel s’insèrent les dérives », « articulant ensuite de manière soignée les récits à l’énoncé principal », enfin « ménageant entre ceux qu’il rapporte successivement des transitions qui les rattachent au thème examiné ». Comme celle de Xavier Bonnier, cette étude montre combien les écrivains du XVIe siècle sont souvent contraints de faire preuve d’un talent d’équilibriste pour concilier les exigences normatives de cohésion et leurs désirs de dépasser celles-ci.
L’une des voies suivies par la tradition rhétorique pour légitimer la digression au regard de la norme de pertinence fut d’en faire un instrument du movere :
Pour que la narration soit claire et brève, rien ne sera plus rarement motivé que la digression ; et encore ne devra-t-elle être employée qu’autant qu’elle sera courte, et telle que nous paraissions avoir été jetés hors du droit chemin par la force de la passion [41].
La digression est propice à l’ostentation des sentiments, à l’abandon de soi, à l’excitation des passions, chez l’orateur comme dans l’auditoire [42]. Cicéron admet le recours à l’excursus lorsqu’il s’agit de « toucher » :
Après l’exposé des faits dans la narration, on peut trouver souvent l’occasion de placer une digression touchante [43].
Là encore, la Renaissance suit fidèlement ses modèles :
Somme, il fault que l’orateur argumente, et en parlant delecte et meuve […], usant d’exemples, similitudes, comparaisons, digressions, faceties, parlemens [44].
Sangoul Ndong (« L’éloquence huguenote. Lecture pragmatique de la dispositio des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné ») met ainsi en évidence, dans les Tragiques, les éléments d’une « écriture disloquée », d’une « poésie des affects » qui « au-delà de l’imitation du déchirement de la France, reste plus celle de l’émouvoir que celle de la didactique ».
Ce rapport à l’émotion explique pourquoi la digression offre aux écrivains un espace privilégié pour parler d’eux-mêmes. Une autre explication de cette subjectivité digressionniste se trouve dans la pratique du commentaire, dont le détour est une forme majeure [45], le commentateur faisant état de son savoir, de ses opinions, dans une énonciation enrichie de mélanges dialogiques avec d’autres voix. Puisqu’elle est propice à l’expression du Moi, la digression devient en particulier un espace de confidences personnelles. Par exemple, Étienne Dolet digresse afin d’exposer ses infortunes :
Avant de venir à des exemples de ce mot [fatum], sache, lecteur, qu’à nous aussi il est parfois arrivé d’être misérablement frappé par le destin [46]…
Dans cette perspective, Ginette Vagenheim (« Digression et autobiographie chez Pirro Ligorio (1512-1582). L’éloge de Michel-Ange et de la peinture ») étudie la motivation autobiographique de certaines digressions chez Ligorio. Ces dernières concernent des « zones d’ombres à peine évoquées » de la vie de Ligorio, livrant des informations sur son premier métier de peintre et sur les raisons qui l’ont poussé à devenir antiquaire. Elles apportent également un éclairage sur ses rapports avec Michel-Ange, et viennent « remettre en question la thèse classique d’une inimitié mortelle entre les deux artistes ».
Ariane Bayle, quant à elle, montre l’usage de la digression dans certains textes médicaux. Chez Mercurio, Matthiole et Paré, le détour est le lieu d’une connivence, refoulée ou consentie, avec le charlatan. Lorsqu’il s’agit de dénoncer les abus de ce dernier, la digression devient ainsi une forme discursive renvoyant les médecins à leurs propres pratiques et, surtout, à la communication qu’ils instaurent avec leurs lecteurs.
Mais lorsque la digression est seulement motivée par le Moi de son producteur, elle devient l’expression de sa vanité. L’orateur peut en effet, au mépris de la cause, s’égarer dans des détours im-pertinents où ne compte que le souci de briller :
C’est un usage, presque général aujourd’hui, de se jeter, aussitôt après la narration, dans un lieu commun, où l’orateur peut se donner carrière, et d’y faire une excursion brillante, aux applaudissements des assistants. Né de l’ostentation déclamatoire, cet usage a passé de l’école au barreau, depuis que les avocats se sont avisés de préférer, dans la plaidoirie, leur propre gloire à l’intérêt de leurs clients [47].
Du Bartas prend ainsi soin de nous avertir que ses « disgressions » ne sont caractérisées ni par l’incongruence ni par la vana gloria :
Les autres pensent que j’ay recerché industrieusement plusieurs disgressions et hors de propos pour faire une vaine parade de suffisance, et me rendre admirable au vulgaire [48].
En suivant cette voie, je tente de montrer comment les discours seconds que sont digressions, parenthèses, citations et annotations, lorsqu’ils sont bavards, superflus et ostentatoires, sont impliqués dans un imaginaire associant langage et accessoires vestimentaires (« “Superfluité d’habits” et “superfluité de langage”. Morales du vêtement et du discours au XVIe siècle »). Détours bavards, fraises, godrons et autres « entortillements » des vêtements courtisans, sont les cibles d’une même critique moralisatrice de la superfluité vaniteuse.
Lorsque le détour « extravague » franchement, et que la digression ne coïncide plus assez avec son cadre, l’œuvre fait alors penser, comme les chapitres des Essais de Montaigne, à une « marqueterie mal jointe » [49]. La digression trop libre a le statut d’une pièce rapportée, excédentaire et superflue. Ellen Delvallée (« Spécification et consolation dans La Couronne Margaritique de Jean Lemaire de Belges ») étudie, chez Lemaire de Belges, les digressions par « specification », terme employé par ce dernier pour désigner ses nombreux détours au moyen desquels il examine des notions générales par énumération de leurs propriétés. Ces digressions, a priori de simples pièces surnuméraires, s’insèrent en réalité avec pertinence dans La Couronne Margaritique, où « la spécification concourt, de différentes façons, à la réalisation du véritable projet rhétorique que le poète s’est fixé dans son prosimètre ».
Les rapports tendus avec l’idéal de pertinence s’observent également dans le rôle que joue la digression vis-à-vis de certaines normes textuelles. L’un des points les plus délicats concerne le genre narratif, où peuvent se rencontrer des alternances d’épisodes rompant avec la continuité du récit, selon un mode de construction dans lequel les théoriciens de l’époque ne voient pas toujours des digressions [50]. Pascale Mougeolle (« La varietà ou l’illusion du détour dans la Jérusalem délivrée ») analyse ce genre de détour dans l’épopée du Tasse. Notamment, elle aborde le problème théorique difficile que posent les aventures particulières d’un personnage lorsqu’elles sont extraites du récit principal : « Rompant d’une certaine manière avec la traduction de l’épopée en digressions et épisodes, [le Tasse] invente un concept, la variétà qu’il applique à la Jérusalem délivrée et dont la particularité est de se déployer dans la narration à travers des chatoiements dont les contours sont toutefois nettement délimités. »
Enfin, l’un des aspects les plus fascinants de la pratique digressionniste renaissante tient aux jeux linguistiques affectant son métalangage. Intuitivement, l’idée d’abandonner un sujet se conçoit sans difficulté : on cesse d’évoquer un thème, on l’« oublie » [51] ou on le (dé)laisse [52]. Si elle se comprend aisément, cette idée est-elle pour autant simple ?
L’abandon – ainsi que la récupération – du sujet peuvent se traduire littéralement. Mais la tradition n’a eu de cesse d’envisager également ces sortes d’actions de façon métaphorique. Force est constater que, dans le métadiscours digressionniste, c’est cette expression métaphorique qui domine. Notamment, il est courant d’assimiler l’abandon et la récupération à des expériences territoriales. Celles-ci peuvent être envisagées d’une façon globale et vague : « Mais pour retourner à nostre propos » (Estienne), « Pour revenir à la curiosité de votre Etymologie » (Peletier du Mans), « Vous me donnez bien congé de reprendre le fil de mon propos, duquel je m’estoy destourné » (Montaigne). Elles peuvent aussi être comprises spécifiquement, comme des expériences cynégétiques, maritimes, etc. : « Mais afin que nous reprenons les erres de nostre matiere » (Boaistuau), « Je retourne faire scale au port dont suis yssu » (Rabelais)… Sans oublier les autres représentations métaphoriques, elles aussi particulièrement abondantes et riches, en particulier celle de l’insertion, qui assimile le détour à un corps étranger forçant l’intégrité du discours : « J’insereray ici [l’histoire du] paillard de la femme de Bérenger » (Estienne), « cette farcisseure est un peu hors de mon theme » (Montaigne). Ces métaphores métadiscursives commentent les étapes du dire digressif en les assimilant à des actions au sein d’un espace, voire plus précisément d’un territoire. Elles trouvent en partie leur origine dans le mot digression lui-même, qui évoque de façon imagée un fait spatial, de même que la plupart des autres termes servant à désigner le bien nommé « détour » : egressus, excursio, excursus, procursio, excessus, etc.
Ces métaphores sont tellement usuelles qu’elles passent inaperçues. Or, au XVIe siècle, elles sont constamment remotivées. Les images spatiales sont en permanence renvoyées vers leur origine expérientielle par association avec des descriptions de mouvements concrets. Monluc, après une digression, reprend ainsi le récit de ses souvenirs en associant les mouvements discursifs du digressionniste (« je reviens à mon propos ») et ceux, physiques, du soldat voyageur :
Je reviens à mon propos. Or, je m’en retournay devers le pays d’Agenois. À mon arrivée à Agen, je m’offençai une jambe […], je m’en vins à Cassaigne [53].
Chez Tyard, nous voyons le Solitaire contraint de digresser par une question de son interlocutrice. Afin de répondre, il invite celle-ci à se lever et à changer de lieu : « Prenez (luy dy-je en me levant) la peine de venir jusques vers vostre espinette. » La digression s’achève ensuite par une invitation de la dame à revenir au lieu initial :
Apres laquelle espreuve, retournons (dict-elle), Solitaire, retournons nous asseoir, et achevez s’il vous plait les proportions du Tetracorde synemmenon, lesquelles je vous ay faict entrerompre [54].
Dans cette invitation à clore la digression, une syllepse sur « retournons » (ou une antanaclase, si on estime que les deux occurrences de « retournons » n’ont pas les mêmes référents) identifie le mouvement corporel des deux protagonistes revenant à leur lieu initial et le retour au sujet. Syllepses et antanaclases sur les termes courants du métalangage digressionniste sont permanentes dans les textes du XVIe siècle. Elles font de la digression la clé d’une pratique généralisée de la métalepse telle que l’a analysée Gérard Genette [55], procédé par lequel les plans de l’énoncé et de l’énonciation s’interpénètrent.
Xavier Malassagne (« La digression dans l’Histoire universelle d’Aubigné ») examine dans cette perspective les digressions de l’Histoire universelle, en insistant sur le rôle des métaphores spatiales. Il étudie particulièrement la « parenté du récit avec un espace », montrant comment s’opère une assimilation de l’énoncé et de l’énonciation, l’espace discursif au sein duquel se déroule la parole étant rapproché de l’expérience du territoire.
La généralisation de la métalepse dans les textes du XVIe siècle permet à nos lettrés de suggérer de multiples interactions entre le discours et son milieu concret de production. Celles-ci peuvent être analysées de diverses façons. Essentiellement, on peut y voir le souvenir de pratiques rhétoriques anciennes dominées par l’oralité et, de ce fait, ancrant le discours et son énonciateur dans leur quotidien naturel. On peut aussi, les deux hypothèses ne s’excluant pas, les comprendre comme des indices d’une pensée concrète. Car les lettrés de la Renaissance sont « davantage attirés par l’aspect concret des réalités que par la spéculation » [56]. Valorisée, l’expérience s’allie à la rationalité que confère la connaissance livresque. Comme le dit Étienne du Tronchet, qui déclare avoir cherché la « souveraine vertu […] tant par la lecture des livres que par l’experience des choses » [57], la « plume » de l’écrivain vole désormais « avec les aisles de l’experience et de la raison » [58]. Dans ce cadre d’un langage orienté vers le monde naturel, Olivier Guerrier (« “Discours naturel” et digression : Montaigne, La Boétie ») enquête sur ce qu’il nomme la « tradition du discours naturel ». Il montre que la Renaissance a cherché à rapprocher le langage de la nature, « à doter les verba de l’épaisseur des res ». Ce sont les manifestations de ce discours naturel qui sont étudiées dans l’usage de la digression chez Montaigne et chez La Boétie.
La digression est un fait de langage que la rhétorique a voulu normer en contrôlant ses usages. Elle est ainsi devenue un instrument de l’ornementation et de l’amplification du discours, dans le but d’émouvoir, divertir ou instruire. La tradition a aussi tenté de définir cette digression. Abandonner de façon provisoire un sujet pour en traiter un autre se conçoit, a priori, très simplement. En réalité, cette opération soulève de nombreuses difficultés. Toutes sortes de perspectives restent à explorer.