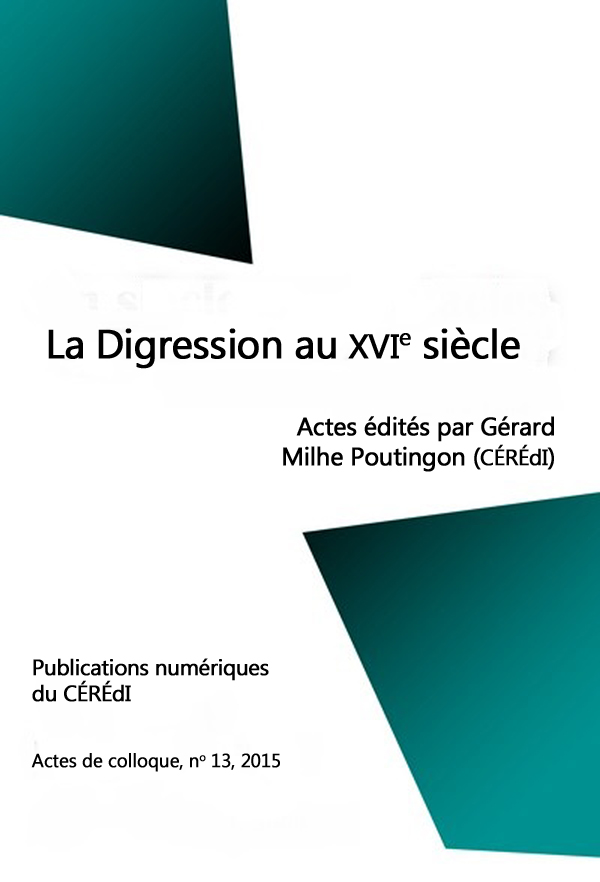J’entreprendrai ici de mettre à l’épreuve une hypothèse développée déjà dans quelques articles à propos ce que j’ai appelé, à tort ou à raison, le « discours naturel ». Je présenterai d’abord ce qu’on peut entendre par là, et rapidement la tradition sur laquelle l’expression peut se fonder. Puis, j’en viendrai à la digression et à son statut dans ce cadre, en tant que figure et modalité pouvant être particulièrement représentatives. Avec pour points d’appuis spécifiques – et dont les économies ne sont du reste pas tout à fait identiques – les Essais d’abord, le Discours de la servitude volontaire ensuite.
« L’on ne sort pas des arbres par des moyens d’arbres », déclare Francis Ponge dans Le Parti pris des choses [1], pour exprimer son peu d’illusion sur la possibilité d’atteindre l’objet réel servant de « prétexte » au texte. Il conviendra alors pour lui de produire un objet verbal qui ait, dans le monde des paroles, la même « manière d’être » que la chose dans le monde physique. Il s’agit là d’un avatar contemporain d’une tentation qui hante la production « littéraire », et que nous qualifierons donc de « tradition du discours naturel » [2]. Cette dernière n’est à rapporter ni au mythe d’une langue naturelle première, ni à un quelconque cratylisme : elle reste un conventionnalisme, consciente de l’arbitraire du signe, mais désireuse malgré tout de rapprocher le langage de la nature. Concevant le discours comme miroir de cette dernière ou des choses, voire encore de l’âme ou de la parole vive, elle implique une série de propriétés : des fondements de type philosophique ou spirituel ; un rapport spécifique à l’écrit ; une position du coup décalée par rapport aux canons des disciplines qui ont entendu orienter le discours dans le sens de l’« art ».
Pour pouvoir se départir de son statut d’artifice, le discours doit être d’abord rapporté à des soubassements intellectuels, qui permettent de faire l’archéologie de ce fantasme de « présence ». Jalon premier, et majeur, Platon, et le Phèdre. Socrate y oppose la mauvaise façon de parler ou d’écrire, celle du logographe ou du sophiste, à la bonne, du sage ou du philosophe (258d). Plus tard, il se déclare étranger à l’art oratoire mensonger de Lysias (262d puis 269d), pour prôner un discours semblable à un être vivant (264c). Ceci va jeter pour longtemps le discrédit sur la mauvaise rhétorique, celle des sophistes, également épinglés par Aristote. En attendant, nous tenons là un moment fondateur d’un continuisme, d’une position située si l’on veut entre Cratyle et Hermogène, et qu’on pourrait en conséquence qualifier de conventionnalisme « naturel ».
Au Moyen Âge, bien des théories vont s’employer à maintenir ce lien, à conférer une plénitude organique à la parole, ou, en termes plus médiévaux et renaissants, à doter les verba de l’épaisseur des res. Les traités rhétoriques et poétiques ne sont pas en reste, et depuis longtemps : effets de présence, « évidence » oratoire, energeia, ou encore « sermo pedestris », « humilis » ou « fortuitus » repris à Cicéron et Quintilien [3] par les poéticiens du XVIe siècle, peu à peu propres à des textes écrits ou destinés à une lecture désormais individuelle, qui singent de différentes manières la spontanéité et l’oralité, et par lesquels les « arts » se donnent l’illusion de leur « naturel ».
Précisément, parce qu’elle recueille et recycle ces données antérieures, parce qu’elle entend renouer le lien distendu entre rhétorique et philosophie ou spiritualité, parce que l’imprimerie efface avec peine les traces de l’ancienne culture orale, la Renaissance figure un moment charnière dans l’histoire du « discours naturel ». Les textes y restent travaillés par un désir, parfois nostalgique, de transparence. Cela se retrouve chez Érasme, sur le plan spirituel, mais aussi, sur un plan beaucoup plus séculier et dans un ouvrage en français, chez Montaigne, qui ne cesse de revendiquer le caractère organique de ses « fantaisies » « mises en rôle », dans la mesure où il conçoit ses écrits comme la fidèle transcription de ses pensées, elles-mêmes naturelles. D’où leur caractère hasardeux :
Je n’ai pas point d’autre sergent de bande à ranger mes pièces, que la fortune. À même que mes rêveries se présentent, je les entasse : tantôt elle se pressent en foule, tantôt elles se trainent à la file. Je veux qu’on voie mon pas naturel et ordinaire ainsi détraqué qu’il est. Je me laisse aller comme je me trouve. Aussi ne sont ce pas ici matières qu’il ne soit pas permis d’ignorer, et d’en parler casuellement et témérairement [4].
L’inscription du plan d’immanence au sein de l’espace textuel est consubstantielle au projet qui consigne d’« heure en heure, de minute en minute » ce qui advient à l’esprit. S’il sait le fossé qui séparera toujours le texte de son équivalent oral, Montaigne aspire ainsi à « naturaliser l’art », voire à produire des « essais en chair et en os ». Il convient alors de prendre au sérieux les métaphores naturalistes ou physiologiques récurrentes dans les Essais. Ici, au début du chapitre « De la ressemblance des enfants aux pères » :
[A] Je veux représenter le progrès de mes humeurs, et qu’on voie chaque pièce en sa naissance [5].
Là, à la fin de « De l’art de conférer » :
[C] Je hasarde souvent des boutades de mon esprit desquelles je me défie, et certaines finesses verbales dequoi je secoue les oreilles : mais je les laisse courir à l’aventure. Je vois qu’on s’honore de pareilles choses. Ce n’est pas à moi seul d’en juger. Je me présente debout et couché, le devant et le derrière, à droite et à gauche, et en tous mes naturels plis [6].
Et, en ouverture du livre III, Montaigne marque l’équivalence entre la parole proférée au premier venu et tout ce qui va suivre :
[B] Personne n’est exempt de dire des fadaises. Le malheur est de les dire curieusement.
Næiste magno conatu magnas nugas dixerit.
Cela ne me touche pas. Les miennes m’échappent aussi nonchalamment qu’elles le valent. D’où bien leur prend. Je les quitterais soudain, à peu de coût qu’il y eût, Et ne les achète, ni les vends, que ce qu’elles pèsent. Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre. Qu’il soit vrai, voici dequoi [7].
Il retrouve ce faisant la parrhêsia des Grecs, parole d’occasion, franche et libre, comme celle de Socrate à ses juges dans l’Apologie, mais la constitue en patron propre à informer ses développements.
Soit, dira-t-on, mais il est tout de même bien question d’écriture dans tout cela. À preuve, le fait d’abord que les métaphores corporelles désignant l’esprit ne sont rien moins que topoï [8], tout comme l’est le discours conçu comme « miroir de l’âme ». De surcroît, il est aisé de prendre l’auteur en défaut en montrant que celui qui pourfend en bien des endroits les canons de la rhétorique, elocutio comme dipositio, les mobilise ailleurs. On trouve ainsi dans les Essais des enchaînements semblables à ceux des œuvres savamment agencées, et parmi eux, certains qui ont l’allure de « digressions », lesquelles sont également soigneusement codifiées par les professionnels de l’éloquence [9]. Nous en examinerons quelques-uns avec quelque attention.
D’abord, dans « Divers événements de même conseil » (I, 24), le moment où Montaigne, après avoir attribué à la fortune un rôle prépondérant dans les événements humains, perçoit l’influence de cette dernière dans les pratiques artistiques et oratoires elles-mêmes :
Or je dis que non en la médecine seulement : mais en plusieurs arts plus certaines la fortune y a bonne part. Les saillies poétiques, qui emportent leur auteur et le ravissent hors de soi, pourquoi ne les attribuerons nous pas à son bon heur ? puisqu’il confesse lui-même qu’elles surpassent sa suffisance et ses forces, et les reconnaît venir d’ailleurs que de soi, et ne les avoir aucunement en sa puissance : non plus que les orateurs ne disent avoir en le leur ces mouvements et agitations extraordinaires, qui les poussent au delà de leur dessein. Il en est de même en la peinture, qu’il échappe par fois des traits de la main du peintre surpassant sa conception et sa science, qui le tirent lui-même en admiration, et qui l’étonnent [10].
Le dernier cas rappelle étrangement l’épisode de l’éponge d’Apelle, archétype du coup du sort heureux. Auparavant, sont déclinés les autres domaines où celui-ci intervient (médecine, poésie, éloquence), par éclairs mystérieux qui dévient l’ordre réglé des actes ou des propos. Montaigne en fournit une explication qui n’a rien de transcendantal, naturalisant en quelque sorte l’interprétation. Et, comme pour mettre en œuvre de tels caprices, il donne au passage un air digressif, qui invite à associer ses écrits à la liste des activités soumises à la fortune. Éloge du détour, le texte se présente également comme une réflexion sur les manœuvres de cette dernière, qui dépasse le constat empirique et la relation des événements qui l’entourent, pour reconnaître en toute activité l’omnipotence du hasard. La digression est déchiffrement, elle acquiert une vertu heuristique, se trouvant au centre d’un dévoilement qui s’appuie sur le primesaut pour rompre les apprêts de l’écriture et sortir des chemins tout tracés de la pensée [11]. L’occurrence tendrait à montrer que se combinent dans les Essais une pratique réflexive sans doute tributaire de la glose, et les échappées de la « fantasie ». Pour le dire autrement, il n’y aurait pas de hiatus entre le travail du jugement et les « saillies » de l’esprit, mais imbrication et fusion des deux, les secondes restant perceptibles au creux du premier.
Second cas, très célèbre, dans « De la vanité », chapitre où Montaigne réfléchit sur sa propension au vagabondage :
[B] […]Quo diuersus abis ?
Cette farcissure est un peu hors de mon thème. Je m’égare : mais plutôt par licence que par mégarde. Mes fantaisies se suivent : mais par fois c’est de loin : Et se regardent, mais d’une vue oblique. [C] J’ay passé les yeux sur tel dialogue de Platon mi-parti d’une fantastique bigarrure, le devant à l’amour, tout le bas à la rhétorique. Ils ne craignent point ces muances. Et ont une merveilleuse grâce à se laisser ainsi rouler au vent, ou à le sembler. [B] Les noms de mes chapitres n’en embrassent pas toujours la matière : souvent ils la dénotent seulement par quelque marque, comme ces autres titres, L’Andrie, L’Eunuque, ou ces autres noms, Sylla, Cicero, Torquatus. [C] Il est des ouvrages en Plutarque où il oublie son thème, où le propos de son argument ne se trouve que par incident : tout étouffé en matière étrangère. Voyez ses allures au Démon de Socrate. O dieu ! que ces gaillardes escapades, que cette variation a de beauté, et plus lors que plus elle retire au nonchalant et fortuite. C’est l’indiligent lecteur qui perd mon sujet, non pas moi : il s’en trouvera toujours en un coin quelque mot qui ne laisse pas d’être bastant quoiqu’il soit serré. [B] J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades. [C] C’est un art, comme dit Platon, légère, volage, démoniacle [B] Et vois au change indiscrètement et tumultuairement. [C] Mon style et mon esprit vont vagabondant de même. [B] Il faut avoir un peu de folie, qui ne veut avoir plus de sottise, [C] disent et les préceptes de nos maîtres et encore plus leurs exemples. [B] Mille poètes traînent et languissent à la prosaïque, Mais la meilleure prose ancienne [C] – et je la sème céans indifféremment pour vers – [B] reluit par tout de la vigueur et hardiesse poétique : et représente l’air de sa fureur. Il lui faut certes quitter la maitrise, et prééminence en la parlerie : [C] c’est l’originel langage des Dieux. Le poète, dit Platon, assis sur le trépied des muses, verse de furie tout ce qui lui vient en la bouche, comme la gargouille d’une fontaine, sans le ruminer et peser : et lui échappe des choses de diverse couleur, de contraire substance, et d’un cours rompu. Lui- même est tout poétique. Et la vieille théologie, poésie, disent les savants, et la première philosophie. [B] J’entends que la matière se distingue soi-même, Elle montre assez où elle se change, où elle conclut, où elle commence, où elle se reprend, sans l’entrelacer de paroles de liaison et de couture, introduites pour le service des oreilles faibles ou nonchalantes, et sans me gloser moi-même. Qui est celui qui n’aime mieux n’être pas leu, que de l’être en dormant ou en fuyant ? [C] Nihil est tam utile, quod in transitu prosit. Si prendre des livres était les apprendre, et si les voir était les regarder, et les parcourir les saisir, j’aurais tort de me faire du tout si ignorant que je dis. [B] Puisque je ne puis arrêter l’attention du lecteur par le pois, manco male s’il advient que je l’arrête par mon embrouillure. – Voire mais il se repentira par après de s’y être amusé – C’est mon : mais il s’y sera toujours amusé. Et puis il est des humeurs comme cela : à qui l’intelligence porte dédain : Qui m’en estimeront mieux de ce qu’ils ne sauront ce que je dis : Ils concluront la profondeur de mon sens, par l’obscurité – Laquelle, à parler en bon escient, je hais bien fort, et l’éviterais si je me savais éviter. Aristote se vante en quelque lieu de l’affecter : Vicieuse affectation [12].
Le passage, emblématisé par la citation de Virgile qui l’ouvre, apparaît comme la concrétisation du détour de la « plume », mais aussi de nouveau comme une réflexion sur celui-ci, avec le Phèdre et le Démon de Socrate comme modèles, et avec indications de lecture pour le partenaire, tout ceci refluant sur l’ensemble du chapitre, et plus généralement l’ensemble des Essais. Mais si le digressif n’est jamais très loin du réflexif, l’inverse est également vrai, comme le montre l’extrait qui conclut cette fois « Sur des vers de Virgile » :
Pour finir ce notable commentaire qui m’est échappé d’un flux de caquet, Flux impétueux par fois et nuisible,
Ut missum sponsi furtiuo munere malum
Procurrit casto virginis e gremio :
Quod miserae oblitae molli sub veste locatum,
Dum aduentu matris prosilit, excutitur,
Atque illud prono praeceps agitur decursu,
Huic manat tristi conscius ore rubor,
Je dis, que les mâles et femelles sont jetés en même moule : Sauf l’institution et l’usage, la différence n’y est pas grande [13].
Avant la comparaison avec la pomme échappée de la tunique de la vierge qu’introduisent ici les vers de Catulle, le « notable commentaire » est rapporté à un « flux de caquet », l’image étant proche de celles que l’on trouve dans la Lingua d’Érasme mais aussi de celles du traité de Plutarque « Du trop parler », où la parole du babillard est assimilée autant à l’eau qui s’écoule d’un vaisseau percé ou à un navire sans attache qu’à une semence devenue stérile à force d’être trop épandue [14]. La métaphore naturaliste, chez Montaigne, rend finalement le chapitre à la combinaison qui le caractérise, combinaison des discours « sérieux et réglés » et des « rêveries » qui en rompent le cours en s’affranchissant de leurs contraintes. Elle rend aussi à une oralité « impétueuse » tous les types de séquences qu’on vient d’y lire.
Par où l’on constate que Montaigne considère ses « commentaires » comme des événements langagiers, au plein sens du terme. Ils expliquent le désordre du texte, sont un des principaux agents de celui-ci, d’autant qu’ils portent en eux cette part qui résiste à toute systématisation [15]. En eux se noue une dialectique de l’errance et de la réflexion, puisque par eux l’errance du propos peut être réfléchie, tout comme la réflexion peut se faire errante [16]. En conséquence de quoi, ils ne sont pas très loin d’être des « digressions », ce qui peut être encore favorisé par une autre grande spécificité des Essais, à savoir l’inscription du temps dans l’espace textuel, l’un étant consubstantiel à l’autre :
[A] Ce fagotage de tant de diverses pièces se fait en cette condition, que je n’y mets la main que lors qu’une trop lâche oisiveté me presse : et non ailleurs que chez moi. Ainsi il s’est bâti à diverses pauses et intervalles, comme les occasions me détiennent ailleurs par fois plusieurs mois [17].
Rien dans tout ceci n’empêche d’identifier, encore une fois, des arguments ou cheminements familiers. Et Montaigne le reconnaît bien volontiers, lui qui renonce d’emblée à se peindre « tout entier et tout nu », ou « tout fin seul » selon la formule du chapitre « De la physionomie » [18]. La chose, de toute façon, serait inconcevable, à n’importe quelle époque, mais plus que jamais au temps de l’humanisme. Mais c’est l’intention qui détermine cette sollicitation qui est ici différente, en ce qu’elle requiert une sorte de lâcher prise par rapport aux discours accrédités et à leurs formes.
À ce compte, ce qui est assimilable à la digression prend un statut particulier, en raison de la logique et de la philosophie d’ensemble des Essais, de trajets méditatifs qui ne visent pas d’abord à persuader selon les visées rhétoriques usuelles, mais qui se présentent comme la radiographie d’une « pensée tumultuaire et vacillante », à reconnaître par le jeu de la distance critique et de la relecture, et à soumettre à un éventuel partenaire pour assentiment libre.
Il n’y a qu’un pas des Essais au Discours de la servitude volontaire, même si ce dernier se présente apparemment comme plus « rhétorique », mais d’une rhétorique pas si orthodoxe que cela croyons-nous.
D’abord, c’est un « discours ». Considérons ce qu’en écrit Nicot dans le Thresor de la langue françoise de 1606 :
Discours, m, acut. : Est quand ou de parole ou par escrit on traite esparsément de quelque matiere. Mot imité de l’italien, Discorso, qui vient du Latin Discursus, ainsi que Cesar le prend lib. 8 de bell. Gall. Et partant cette diction est mal adaptée, & par les Italiens, & par nous és deductions faites par art, & (s’il se peut ainsi) par entre deux lices ou hayes des preceptes d’iceluy art. Il se prend aussi pour simple recit & narration de quelque chose, Oratio, narratio, sermonis persecutio, comme, Cela est de trop long discours, Nimium prolix amorationem postulat [19].
Outre l’origine italienne – qui évoque dans le contexte les Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio de Machiavel en particulier –, on voit que le « discours » se distingue par exemple de la harangue, et plus largement de tout ce qui est fait « par art », car il traite ses matières « esparsément » et ne saurait se borner à des cadres imposés (ce que figure l’image des « lices » – palissades – ou « hayes »). Dans ce cadre, le texte de La Boétie est ponctué par trois digressions, reconnaissables par les clausules qui les ouvrent : « A quel propos tout ceci ? », « Mais pour revenir a notre propos duquel je m’estois quasi perdu », et « Mais pour retourner d’où je ne scay comment j’avois destourné le fil de mon propos » [20]. Elles interviennent toutes trois dans la longue discussion sur la coutume. Pour en saisir la portée, nous commencerons par reproduire l’analyse que contient un ouvrage récent :
Si l’on accepte l’idée que ce passage sur les méthodes d’asservissement du « gros populas » est en lui-même une digression, qui n’apporte rien d’essentiel à la discussion principale puisqu’en définitive aucune solution ne peut venir du peuple (p. 89), alors la seconde digression, qui ouvre la discussion sur les hommes « mieux-nés que les autres » (p. 103) est une digression dans la digression, une sorte de mise en abyme, dont la conclusion est assez évasive. Certes le peuple se laisse berner ; les bons esprits, eux, savent réinventer la liberté, même s’ils ne l’ont jamais connue, mais ils peuvent être isolés et réduits à quia ; cependant un cœur généreux – contrairement à un hypocrite – ne manque pas de réussir dans ses entreprises libératrices. Cette parenthèse refermée, l’orateur revient à l’examen des moyens utilisés par le tyran pour « efféminer » son peuple. La mise en abyme centrale laisse donc ouverte la question de la servitude éventuelle des bons esprits. La digression principale établit les moyens par lesquels le tyran obtient le consentement du peuple ; il restera à examiner comment il obtient la complicité des élites.
En quoi cette longue digression, qui en contient une deuxième, est-elle « nécessaire » [Fanlo, 1997] ? Quels en sont les effets ? D’abord, elle permet à l’orateur de montrer le caractère universel de la domination, et l’universalité des moyens employés pour obtenir le consentement. Ainsi se trouve corroborée, par le moyen de l’amplification, l’idée que la servitude se produit « en tous pais, par tous les hommes, tous les jours » (p. 84). Et, en effet, le lecteur se perd, tout comme l’orateur apparemment, dans cette suite de cas tant anciens que modernes. Mais le fait de placer, dans cette énumération même, trois clausules remarquables suggère que la démonstration principale n’est pas là. La preuve que le tyran parvient à fasciner son peuple n’est qu’une explication accessoire ou incidente : « Doncques ce que j’ay dit jusques icy qui apprend les gens a servir plus volontiers ne sert guere aus tirans que pour le menu et grossier peuple » (p. 117, immédiatement, donc, après la troisième clausule), et il faudra bien en venir au « ressort et secret de la domination ». L’orateur se disperse à prouver une idée, par ailleurs assez conventionnelle, avant de revenir au cœur de son propos, à son point nodal. La digression, en exerçant sur le lecteur le charme d’un verbe facile, nourri d’exemples illustres, fournit une explication somme toute rassurante dont on pourrait trouver la formulation page 102 : « a l’homme toutes choses lui sont comme naturelles, a quoy il se nourrit et accoustume » ou page 105 « la premiere raison pourquoy les hommes servent volontiers, est pource qu’ils naissent serfs et sont nourris tels ». Cependant, croire cette explication comme nous sommes tentés de le faire, comme « enchantés et charmés » (p. 80), non par « le nom seul d’un » mais par le nombre au contraire des témoignages historiques et des sages qui abondent dans ce sens, ce serait encore se fier trop naïvement aux mirages du texte et à la fascination qu’exercent sur nous les maîtres de la pensée. Cette « première » raison de la servitude, toute classique, n’est point la seule et certes pas « le ressort et le secret », qu’il faut chercher ailleurs, dans la complicité des élites. Ainsi, la digression peut-elle correspondre, à nos yeux, à l’exploration d’une nouvelle impasse : elle explique la servitude des lourdauds, mais pas celle des hommes qui comptent. Bercés et leurrés par les anecdotes, nous pourrions la prendre pour essentielle. Le réveil n’en est que plus brutal : le secret n’est pas là. Et celui qui s’est laissé prendre à l’explication sans en voir les insuffisances, ayant perdu de vue que ce n’est pas la soumission du peuple qui pose problème, fait l’intime expérience de l’enchantement d’un discours trompeur. C’est que, à l’image de l’orateur qui feint de s’être perdu, il s’est laissé porter par la pensée d’un autre, de nombreux autres, en oubliant la fameuse leçon de méfiance inaugurée par la discussion d’Ulysse dans l’exorde. De ce point de vue, l’expérience de lecture que nous faisons, si nous aussi nous avons perdu le fil, cette expérience d’un endormissement de l’esprit, peut être considérée comme l’expérience même du renoncement à l’autonomie de la pensée qui, se reposant sur autrui du souci d’examiner, conduit les peuples à la servitude [21].
L’interprétation, qui met en relation les phénomènes textuels et la thèse centrale de l’œuvre, table sur un effet calculé que chercherait à produire le scripteur. Elle s’inscrit dans la logique de la rhétorique paradoxale de la « déclamation », mise en lumière par Jean Lafont [22] et après lui Michael Boulet [23] – même si ce dernier montre que le Discours, en raison notamment de sa situation d’énonciation d’ensemble, tend à compliquer encore le genre tel qu’il se pratique alors. En même temps, elle évoque l’« exploration d’une […] impasse », ce qui est susceptible d’infléchir quelque peu la lecture. En effet, en mettant d’abord l’accent sur l’instance de production, on peut considérer le texte comme l’épreuve d’une pensée en acte, qui ne cesse de chercher des solutions aux problèmes auxquels elle se heurte. Moyennant quoi, si les digressions sont « nécessaires » [24], c’est selon une nécessité qui ne répond pas d’abord à celle qui régit les formes usuelles de la persuasion, et qui ne vise pas toute séance tenante un auditeur extérieur, à gagner à tout prix à sa cause. Relisons ces lignes de Claude Lefort, qui allaient selon nous à l’essentiel. Commentant l’apostrophe aux « pauvres et misérables peuples insensés », ce dernier mettait l’accent sur le caractère mystérieux d’une parole qui brise les cadres dans lesquels elle s’inscrit :
Et, alors, dirait-on, une parole vive sort du texte, et nous l’écoutons plutôt que nous la lisons […]. Effet rhétorique ? Sans doute. Mais nul procédé n’a jamais suffi à rendre sensible une voix. Or, avec quelle vigueur nous atteint-elle ? Au reste, la rhétorique n’est pas établie à l’époque de La Boétie, de sorte qu’il n’aurait qu’à exploiter des artifices de persuasion ; elle s’invente ou se réinvente, en même temps que la pensée défait le nœud du savoir et de l’autorité. Et tel est justement le mouvement d’invention de la langue et de libération de la pensée que, si chargée et fatiguée soit notre propre mémoire des exercices classiques, il la traverse sans perdre de sa force et nous sommes jetés au présent de la question. Ne saurions-nous rien des circonstances du Discours […], nous nous sentirions mis en demeure d’interroger de notre place, nous recevrions le choc de la question de la servitude volontaire. Le Discours force le mur du temps. Il y parvient, disions-nous, de faire résonner une voix. Faut-il ajouter que ceux-là seuls l’entendent qui ne restent pas sourds ici et maintenant à l’oppression [25].
Il convient alors d’opérer une mutation du regard, en tenant compte du fait que la puissance de la question et l’urgence de la recherche sont ici si intenses qu’elles finissent par modifier l’enjeu de la convocation des différents modèles discursifs disponibles. L’inflexion conduit alors à considérer que ces derniers obéiraient à un mouvement là encore avant tout intérieur, de type heuristique. Il n’est pas impossible que La Boétie, tout en inscrivant sa réflexion dans une matrice tout de même oratoire, retrouve là quelque chose comme le principe du dialogue philosophique à la mode antique, voire du dialogue socratique, converti en une sorte de joute intime où l’esprit se donnerait un trajet ardu à accomplir, mais dont il devrait confesser les chausse-trappes successives. Ou encore, qu’on soit en présence d’une forme de méditation, caractérisée par un rythme spécifique, venu hanter les schémas attendus. Quoi qu’il en soit, s’exprime une résistance globale à l’« ordre du discours », pour reprendre l’expression de Michel Foucault, c’est-à-dire finalement un refus de faire acte d’allégeance au pouvoir et donc à la servitude. La forte implication du locuteur dote ainsi le texte d’une vigueur et d’une authenticité qui maintiennent le « naturel » à l’intérieur de la langue. Du coup, par la forme déroutante qu’il adopte, il constituerait lui aussi une sorte de photographie des pensées en acte, une façon d’exposer dans le champ de la dénaturation un sujet resté « naïf » (jeune), et un message qui n’a pu en être corrompu.
Montaigne, à n’en point douter, doit beaucoup à tout cela. À côté de l’empreinte que laissent les thématiques du Discours sur les Essais, on rappellera juste qu’avec l’expression « par manière d’essai », employée dans le chapitre « De l’amitié » des seconds pour qualifier la conception du premier [26], il fait allusion au « coup d’essai » du novice ou de l’apprenti – de façon bien moins dépréciative que plus tard un Sainte-Beuve. Mieux : il évoque probablement le trait le plus significatif de ses propres écrits : la réflexivité, selon laquelle le propos sur l’objet reflète ipso facto le regard qui le parcourt, et les options qui en découlent, toutes précaires qu’elles soient. S’il avait à l’origine connu La Boétie par son Discours, lequel avait « servi moyen à [leur] première accointance », c’est peut-être parce que justement une « voix sortait du texte » et un sujet de son message. Comme il advient lorsque l’impératif et l’investissement sont si forts, voire vitaux, que tous les calculs en deviennent secondaires.
On pourra objecter qu’il entre une part de projection dans une lecture comme celle-là, et que, dès lors qu’il s’agit d’écriture, la préméditation, chassée par la porte, est toujours susceptible de revenir par la fenêtre. Tant il est difficile de « sortir de l’arbre »… N’empêche que le Discours, et les Essais qui lui font suite, s’inscrivent dans une chaîne dont ils constituent des maillons forts, voire des moments nodaux.
Si cette tradition du « discours naturel » modifie en profondeur les paramètres usuels de la production textuelle, il en va de même en fait de ceux de la réception. Les deux ouvrages, de manière différente, font en effet de leur destinataire une instance au visage indistinct, et même dramatisent les conditions de leur réception [27] : car à refuser les subterfuges de l’« art », on substitue à un lecteur docile un partenaire incertain, mais auquel on aspire avec espérance. C’est dans cet inconfort que peut venir une homologation, qui est l’espace où communient les hommes libres. C’est, pour paraphraser une phrase de Sterne sur la digression, de son soleil que peut venir la lumière.