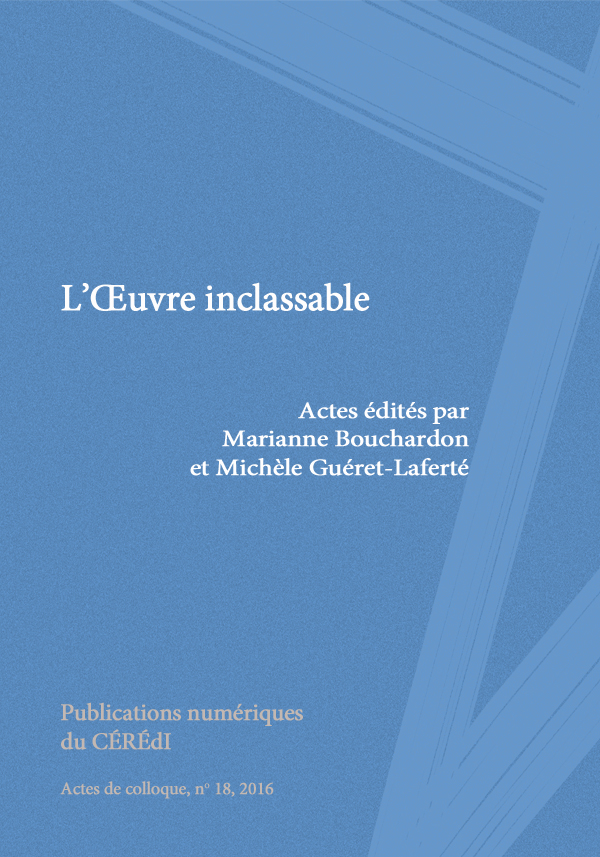Il y a comme un paradoxe, presque une forme de provocation, à proposer de parler de Voltaire dans un ouvrage consacré à « l’œuvre inclassable », tant Voltaire est un classique de l’institution scolaire, presque prescrit par elle non sans quelques effets parfois regrettables sur la réception possible, aujourd’hui pour nous, de ses textes et de ses idées. Tant aussi (et ceci n’est pas sans rapport avec cela) Voltaire et ses éditeurs [1] ont très tôt travaillé à « classer » sa production, une production presque monstrueuse aussi bien par sa masse et sa variété que par son étendue dans le temps. Soixante années séparent la publication d’Œdipe (1718) de l’acclamation d’Irène en 1778, deux tragédies qui nous rappellent que pour les contemporains et à s’en tenir à ses propres affirmations, Voltaire fut d’abord un poète dramatique, même s’il ne fut pas seulement que cela comme des recherches récentes sur les liens du jeune écrivain avec les idées clandestines ont pu le montrer [2].
On peut évidemment se contenter de constater que dans ses affirmations théoriques, Voltaire, en bon disciple du classicisme, est un adepte de la séparation (hiérarchique) des genres. Je ne m’attarderai pas sur ce point bien connu. C’est par exemple le cas dans le Fragment sur la corruption du style (sans doute 1742) où il affirme sans grandes nuances :
On se plaint généralement, que l’éloquence est corrompue, quoique nous ayons des modèles presque en tous les genres. Un des grands défauts de ce siècle, qui contribue le plus à cette décadence, c’est le mélange des styles [3].
Sur le plan théorique, sa pensée est d’abord une pensée de la convenance, concept-clé des poétiques normatives des genres, construite sur l’exigence de propriété et de bienséance. Ainsi du genre épistolaire, dans le même Fragment :
On tolère dans une lettre l’irrégularité, la licence du style, l’incorrection, les plaisanteries hasardées, parce que des lettres écrites sans dessein et sans art, sont des entretiens négligés ; mais quand on parle, ou qu’on écrit avec respect, on s’astreint alors à la bienséance.
« On tolère », « On s’astreint… », « Est-il permis… », « On doit » : à première vue et dans les premiers textes théoriques au moins, la pensée du genre, cette catégorie intermédiaire, apparaît terriblement normative. Mais chez Voltaire (et il n’est pas le seul à l’âge classique), cette convenance générique est moins pensée en termes essentialistes – les genres existant de manière immuable, de toute éternité – qu’en termes d’effets, soit comme « ce qui marche [4] » pour le public, lequel est, pratiquement mais aussi théoriquement, sa pensée constante et la pierre de touche de son esthétique. « Or je demande », conclut-il le raisonnement sur la lettre précédemment évoqué, « à qui doit-on plus de respect qu’au public ? »
Formé à l’école des Jésuites, Voltaire, comme beaucoup d’auteurs de la période classique, pense en fait d’abord l’efficacité des genres en termes rhétoriques et fondamentalement pragmatiques dans une approche de la convenance générique récemment réévaluée par Gérard Genette [5]. Cette pensée pragmatique de la convenance générique explique peut-être un point qui a été maintes fois souligné, à savoir que la pratique de Voltaire s’éloigne beaucoup, voire radicalement, de ses prises de position théoriques en la matière, somme toute traditionnelles et attendues.
Elle s’en éloigne par le vaste éventail des genres constitués que Voltaire pratique d’abord, comme si son œuvre par certains aspects monstrueuse ne cessait de tester et de réinventer dans les différents genres – genres de surcroît en constante évolution, ce qu’un historien de la littérature comme lui ne pouvait ignorer – la validité de ses propositions. Elle s’en éloigne par sa pratique éditoriale des « mélanges » dont un numéro de la Revue Voltaire (2006) a montré qu’elle n’était pas sans lien avec une « prédilection [inavouée] pour les genres informes [6] ». Plus généralement, cette prédilection a à voir avec un travail de l’œuvre par l’hybridation, travail si important qu’il laisse, de l’aveu de Christiane Mervaud, « une part non négligeable de sa production pratiquement inclassable [7] ». Où classer par exemple le vaste ensemble alphabétique des Questions sur l’Encyclopédie, réédité à la Voltaire Foundation pour la première fois depuis le XVIIIe siècle ? Ou bien les Questions sur les miracles, pot-pourri de récits et de dialogues initialement intitulées Lettres sur les miracles, et qui donc changèrent de genre ? Ou même, pour rester dans les œuvres plus connues, les Lettres philosophiques qui, jusque dans l’épistolaire, relèvent plutôt du voyage philosophique et du journal à la manière d’Addison ?
Mais s’il est un point qui met en échec la stricte hiérarchie des genres pensée théoriquement, c’est peut-être surtout la cohérence profonde de l’écriture voltairienne, car un critère guide indéfectiblement Voltaire que Marc Hersant vient d’interroger de manière convaincante dans son ouvrage Voltaire : écriture et vérité (2015) et ce critère est, selon Hersant, le critère de vérité auquel Voltaire soumet le geste littéraire. Formé par la fréquentation de la bibliothèque choisie de Gordon, son compagnon d’infortune à la Bastille, l’Ingénu s’écrie : « Ah ! s’il nous faut des fables, que ces fables soient du moins l’emblème de la vérité [8]. » La vérité, un critère extra-littéraire donc, qui justifie à la fois théoriquement l’idée de convenance générique en même temps qu’il remet en question en des termes radicalement nouveaux la vision axiologique et fonctionnaliste des genres, ou pour le dire autrement, de la valeur de la littérature :
La plaisanterie n’est jamais bonne dans le genre sérieux, parce qu’elle ne porte jamais que sur un côté des objets, qui n’est pas celui que l’on considère : elle roule presque toujours sur des rapports faux, sur des équivoques ; de là vient que les plaisants de profession ont presque tous l’esprit faux autant que superficiel,
écrit-il ainsi dans le Fragment sur la corruption du style, plusieurs fois cité déjà [9].
C’est sous cet angle et dans la lignée des travaux récents que je viens d’évoquer que je me propose de reprendre le dossier bien chargé et nonobstant toujours débattu de L’Ingénu, un texte de la maturité militante de Voltaire (1767) et celui de ses récits philosophiques qui a peut-être posé le plus clairement la question du classement. Celui dans lequel certains critiques – thèse aujourd’hui battue en brèche – ont cru déceler ce que j’ai proposé d’appeler (en l’accompagnant d’un prudent point d’interrogation) « la tentation du roman [10] ».
Sans reprendre tous les éléments de ce gros dossier et notamment la question de la structure de L’Ingénu qui a mobilisé de manière un peu redondante la critique [11], je me proposerai plutôt de relire L’Ingénu à la lumière des récents travaux consacrés aux généralités intermédiaires permettant l’accès au texte (le genre mais aussi le registre) de manière à apporter, sinon une réponse définitive à la question peut-être oiseuse de l’appartenance de L’Ingénu à tel ou tel genre ou non-genre (le plus intéressant n’est-il pas décidément qu’on hésite ?), du moins un éclairage de la complexité de la fiction voltairienne, trop souvent caricaturée et réduite à une ironie elle-même rabattue sur l’antiphrase. Alors que L’Ingénu se situe a priori historiquement en amont du basculement de la généricité à la littérarité, je voudrais montrer que concernant L’Ingénu les choses apparaissent plus complexes et, peut-être, qu’un certain glissement s’y opère déjà. Je m’intéresserai d’abord à la question des possibles genres de L’Ingénu, puis au jeu sur les registres, avant d’interroger les rapports entre fiction et diction dans le texte et, plus largement, dans le récit philosophique voltairien.
Genres
Partons donc, pour commencer de la question moult fois débattue : de quel genre L’Ingénu relève-t-il ? Une première manière de répondre à la question, adoptée par la critique traditionnelle, consiste à recueillir les indications de genre fournies, plus ou moins explicitement par Voltaire ou son entourage proche, souvent téléguidé. Cette perception du genre décidée par l’auteur constitue ce que Jean-Marie Schaeffer appelle la généricité auctoriale.
Deux sources peuvent être croisées sur ce point dans le cas de L’Ingénu : la correspondance, et le paratexte, en l’occurrence le système des titres. À Damillaville, le 26 août 1767, Voltaire (qui dénie la paternité du texte à longueur de lettres pendant tout l’été) écrit : « C’est un roman fait pour amuser quelque temps les gens oisifs ; il m’a paru fort innocent [12]… » Et à son libraire Gabriel Cramer, agacé sans doute que Grasset lui ait volé la primeur de l’original : « L’Ingénu vaut mieux que Candide, en ce qu’il est infiniment plus vraisemblable [13]. »
On reviendra sur cette question de la valeur. Le genre vers lequel pointe l’adjectif vraisemblable, comme le formule explicitement la lettre précédente, c’est d’abord le genre du roman, conformément à la définition plutôt large qu’en donne encore Jaucourt dans l’article « Roman » de l’Encyclopédie, deux ans plus tôt : « récit fictif de diverses aventures merveilleuses ou vraisemblables de la vie humaine [14] ». Le roman, ainsi, a à voir avec la vie même – définition incroyablement moderne de la littérature, en apparence au moins – même si sa tâche première consiste toujours, à cette date avancée dans le siècle, à se débarrasser du double soupçon d’invraisemblance et d’immoralité qui continue de grever, mais de moins en moins, son développement. La page de titre de l’édition originale de L’Ingénu publiée à Genève sous la fausse adresse d’Utrecht, qui contient une liste d’errata de Voltaire et qui sert généralement de base à toutes les éditions modernes de L’Ingénu, de même que le faux-titre de cette édition, présente du reste encore L’Ingénu comme une « Histoire véritable, tirée des manuscrits du père Quesnel ». Si l’attribution fantaisiste ne trompe personne, cette étiquette générique dit le statut encore fragile du roman, rapporté (fût-ce au prix d’un leurre) au genre historique autrement plus noble. Un brouillon sans date présente en outre une première esquisse du récit présenté alors comme l’ « Histoire de l’Ingénu, élevé chez les sauvages, puis chez les Anglais, instruit dans la religion en Basse-Bretagne, tonsuré, confessé, se battant avec son confesseur… »
À aucun moment donc, concernant L’Ingénu dont par ailleurs il parle peu, Voltaire n’utilise le terme de conte qu’il pratique pourtant depuis les années 1710, aussi bien en vers qu’en prose, et ceci alors que trois ans plus tôt, il conseillait à Marmontel
de nous faire des contes philosophiques [15] où vous rendrez ridicules certains sots et certaines sottises, certaines méchancetés et certains méchants, le tout avec discrétion en prenant bien votre temps, et en rognant les ongles de la bête quand vous la trouverez un peu endormie [16].
Si sots et méchants ne manquent pas dans L’Ingénu (le bailli, l’espion jésuite, Saint-Pouange) et si 1767 est peut-être un moment de relatif soulagement après les derniers sursauts de la bête de l’Infâme (après la querelle des Philosophes du tournant des années 1760, l’affaire Calas puis l’affaire La Barre en 1766 encore), L’Ingénu ne rejoindra aucun des importants projets d’édition supervisés par Voltaire sous l’étiquette de conte : dès 1768, il paraît aux côtés de L’Homme aux quarante écus et de La Princesse de Babylone, mais aussi des Homélies prononcées à Londres, dans le tome 6 des Nouveaux mélanges ; et en 1775, à l’occasion d’un reclassement de la matière voltairienne pensée par le patriarche lui-même, il rejoint le tome 36 des « Romans philosophiques » de l’« encadrée », la dernière édition revue par Voltaire.
La généricité auctoriale de L’Ingénu tire donc sans conteste le texte du côté du roman, quelque complexe que soit la réalité que recouvre encore cette étiquette à ce moment du XVIIIe siècle et même si les clins d’œil au conte ne manquent pas (principalement l’incipit et le second dénouement du texte). Mais si « l’auteur propose, le lecteur dispose », rappelle Schaeffer. Qu’en est-il du côté du lecteur et de la généricité lectoriale de L’Ingénu ? L’affaire apparaît plus compliquée.
Dans les périodiques de l’époque, peu nombreux à recenser le texte qui n’est pas autorisé, on observe que la question de la satire travaille le texte. Ainsi lit-on à la date du 15 septembre 1767 dans la Gazette d’Utrecht :
Il s’est fait deux éditions en trois jours de L’Ingénu, nouveau roman de Voltaire, plein d’une critique enjouée des mœurs de notre nation. L’Ingénu est un jeune huron qui se trouve en France, qui est baptisé et à qui il arrive toutes sortes d’aventures ; les Jésuites y jouent de très vilains rôles [17].
Et lorsque le Courrier du Bas-Rhin, un périodique publié sous le patronage de Frédéric II et très diffusé dans le Nord de la France entreprend de publier L’Ingénu sous forme d’extraits en huit livraisons de la mi-septembre à la mi-octobre 1767, il écrit :
Ce petit roman écrit avec légèreté est attribué à M. de Voltaire, l’on croit en effet le connaître pour le frère de Candide ; sa singularité mérite que nous en mettions un extrait sous les yeux du lecteur [18].
Si malgré sa brièveté le texte s’apparente au roman (par ses aventures ?), sa « légèreté », le sel avec lequel il est écrit, le tirent du côté de la satire, idée que l’on retrouve dans une lettre de Servan à Voltaire qui désigne l’Ingénu comme le « très digne frère de l’allemand Candide [19] ». Pour le lecteur de l’époque donc – et c’est sans doute encore plus vrai pour nous aujourd’hui – il y a comme un « effet de conte », effet sériel qui constitue, malgré les nombreuses dénégations de Voltaire, la signature du texte lequel vient naturellement prendre sa place dans la famille des contes voltairiens. À Louise Ulrica, reine de Suède sa mère, le roi Gustave III écrit, à propos du « nouveau roman de M. de Voltaire que Votre Majesté a lu dans l’annonce de Grimm [20] » : « ce petit roman est dans le goût de Candide, mais beaucoup plus décent », « on y reconnaît Voltaire à chaque ligne [21] ».
Si Voltaire et ses éditeurs tirent donc L’Ingénu du côté du roman, aidés en cela par l’intrigue amoureuse qui continue à définir le genre jusqu’à une date assez avancée du siècle, l’horizon d’attente contrecarre un peu ce projet car c’est dans la série des contes et dans la lignée de Candide que les lecteurs d’alors le lisent aussi.
Registres
Un deuxième point semble intéressant à souligner, qui tient à la question des rapports entre genre et registre, deux concepts rabattus l’un sur l’autre depuis Aristote et dans l’esthétique classique, que Voltaire tend à disjoindre dans son écriture fictionnelle, me semble-t-il, tandis qu’il l’observe rigoureusement dans ses écrits historiques par exemple.
Dans la définition d’Alain Viala, on le sait, les registres désignent « les catégories de représentation et de perception du monde que la littérature exprime, et qui correspondent à des attitudes en face de l’existence, à des émotions fondamentales [22] ». Le registre a part liée au genre. On connaît la conception que Nietzsche, par ailleurs nourri de la pensée de Voltaire, forma dans La Naissance de la tragédie (1872) du genre tragique, défini par la tension entre un pôle apollinien, mesuré et lumineux et un pôle dionysiaque, dynamique et hors de contrôle [23].
Pour ce qui concerne le registre, force est de constater que L’Ingénu se soustrait aux modèles définis et identifiables, non en cherchant à y échapper, mais encore une fois par excès, en multipliant les registres. Les registres recouvrent plus ou moins les grands genres dans l’optique normative et essentialiste classique et Voltaire en maîtrise superlativement la variété et les nuances, qu’en 1767 il a amplement eu le temps de mettre en pratique dans son œuvre tragique (bien plus mobile et réactive aux innovations contemporaines qu’on ne l’a dit), dans ses textes épiques et historiques où, en vers comme en prose, il a sondé les ressources de l’épique, et dans son œuvre polémique plus récente où satirique et ironique apparaissent comme deux sous-registres du comique.
Dans L’Ingénu, Voltaire sollicite tout particulièrement les registres pour orienter ou plutôt désorienter le lecteur, sollicité en peu de pages par une multitude d’émotions apparemment contradictoires. Le tragique, défini par Marc Escola comme sentiment de la mort et détresse de la raison face à l’évidence de notre mortalité [24], est le plus discret peut-être des registres présents dans L’Ingénu. Gouvernant l’incipit du chapitre 7 si finement analysé par Jean Starobinski (« L’Ingénu, plongé dans une sombre et profonde mélancolie, se promena vers le bord de la mer, son fusil à deux coups sur l’épaule, son grand coutelas au côté, tirant de temps en temps sur quelques oiseaux, et souvent tenté de tirer sur lui-même »), il est congédié bien lestement (« mais il aimait encore la vie, à cause de mademoiselle de Saint-Yves ») et plus rapidement encore à la mort de la dite cause, la belle Saint-Yves consumée par la culpabilité (« Le temps adoucit tout [25] »). Dans les quelques pages qu’il consacre à L’Ingénu, conte ou roman, Marc Hersant, contaminé peut-être par l’ironie voltairienne, parle pour ce même chapitre 7 de « tempête sous un crâne complaisamment rapportée dans ses moindres nuances [26] », sous-estimant peut-être le scepticisme et la mélancolie voltairiens si bien perçues par Starobinski, qui relèvent pleinement du tragique, dégradé dans le registre pathétique et élégiaque dans la fin du texte sur laquelle on reviendra.
Il n’en est pas moins vrai qu’un véritable travail de sape est principalement opéré par le registre comique, de loin le plus présent dans L’Ingénu, notamment dans la première partie antérieure à l’embastillement du huron – qu’on songe aux sous-entendus grivois quant à la plastique avantageuse et à la « vertu mâle » du nouvel Hercule, ou au quiproquo qui conduit l’Ingénu à vouloir « faire mariage » en défonçant nuitamment « la porte mal fermée » de Mademoiselle de Saint-Yves. De fait, ce qui fait que L’Ingénu, peut-être, résiste au roman, pour Françoise Gevrey qui a étudié les liens très étroits et nombreux entre Cleveland et L’Ingénu [27], ce sont ces éléments de pur comique qui, pour les lecteurs de l’époque, rattacheraient plutôt le texte au genre du conte si l’on en croit du moins les Éléments de littérature de Marmontel – par ailleurs auteur de contes moraux et d’une adaptation de L’Ingénu pour l’Opéra-comique – qui affirme que « le conte est à la comédie, ce que l’épopée est à la tragédie [28] ». La forme non dramatisée de la comédie donc.
On ne saurait pourtant réduire le comique à ces seuls aspects, fussent-ils particulièrement savoureux car comme le rappelle Marielle Macé, « le comique enferme [aussi] le satirique et l’ironique qui mêlent au rire l’indignation ou la prise de distance [29] » et c’est par ces aspects, davantage encore que par ses grivoiseries que L’Ingénu, qui prend pour cible les Jésuites, la révocation de l’Édit de Nantes et les dysfonctionnements de la France de Louis XV, illustre ce registre et ressortit peut-être du conte.
Enfin, si l’épique, ce registre de l’admiration, n’est pas totalement absent du texte, c’est sans doute le recours au pathétique qui distingue tout particulièrement L’Ingénu, comme le soulignèrent du reste les disciples-partisans de Voltaire. Si pour Linguet, L’Ingénu est « peut-être le plus parfait des trois » contes de Voltaire, c’est ainsi que « c’est de tous les ouvrages en prose de M. de Voltaire le seul où il ait dessiné une scène vraiment pathétique […]. L’aventure de Mademoiselle de Saint-Yves, sa maladie, sa mort, arrachent des larmes [30] » et, précise Linguet en 1788, « ce genre-là [31] manquait [encore] à M. de Voltaire ». Dix-huit ans plus tard, en 1806, Palissot de Montenoy prend à contrepied la réaction de Grimm, qui avait trouvé la deuxième partie de L’Ingénu « un peu languissante » et qui avait retenu du roman de Mademoiselle de Saint-Yves la seule conversation du père Tout-à-tous. Il le présente comme « un chef d’œuvre » en mettant clairement en avant, comme ce qui le singularise, le mélange des registres propre au texte :
Ce qui doit le plus étonner dans ce roman, c’est l’art avec lequel, à travers les saillies d’une gaîté quelquefois immodérée, l’auteur a su se ménager le dénouement le plus pathétique. Voltaire seul, il faut en convenir, avait le secret de faire naître ainsi, à volonté, les émotions les plus douces, après les traits les plus vifs de la plaisanterie [32].
Et un peu plus loin, dans une note :
Nous ne connaissons […] rien de plus aimable, et de plus intéressant que le caractère de Mademoiselle de Saint-Yves, et de plus pathétique que sa mort [33].
De fait, le personnage de Mademoiselle de Saint-Yves est peut-être l’un des plus beaux personnages de femme jamais tracé par Voltaire. C’est un personnage proprement romanesque, mais pas seulement par sa mort pathétique dans laquelle on a pu voir une parodie de la mort de Julie ou un décalque du sort réservé aux héroïnes de Richardson [34]. D’abord présentée comme un pâle doublon de Mademoiselle de Kerkabon (qui rappellerait plutôt Mademoiselle Haberdt la cadette, dans Le Paysan parvenu), Mademoiselle de Saint-Yves s’anime en effet peu à peu et porte largement – sur le plan dramatique tout au moins – ce qu’on a coutume de désigner comme la seconde partie du récit : c’est pour elle que L’Ingénu est enfermé à la Bastille, c’est elle, au prix de sa vertu puis de sa vie, qui va l’en libérer.
Même si l’on accède pas à l’intériorité du personnage, l’éveil du sentiment amoureux chez la jeune femme, discrètement évoqué dès le chapitre 1, a préparé cette évolution (« Mademoiselle de Saint-Yves était fort curieuse de savoir comment on faisait l’amour au pays des Hurons », « Mademoiselle de Saint-Yves rougit et fut fort aise », « Mademoiselle de Saint-Yves, à ce récit, sentait un plaisir secret d’apprendre que l’Ingénu n’avait eu qu’une maîtresse, et qu’Abacaba n’était plus ; mais elle ne démêlait pas les causes de son plaisir »). Les titres des chapitres de la première partie, qui centrent l’attention sur le personnage masculin, fonctionnent comme des leurres car plus que l’Ingénu encore, c’est bien Mademoiselle de Saint-Yves qui tombe amoureuse comme le montre le chapitre 5 (« L’Ingénu amoureux ») : « Cependant, comme elle était bien élevée et fort modeste, elle n’osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments [35]. »
Cette évolution du personnage, programmée dès le début du texte, n’apparaît cependant de manière évidente et assumée que dans la « seconde » partie du texte où, suite à l’embastillement de son amant, Mademoiselle de Saint-Yves devient une femme forte qui a l’initiative de l’action. Qu’on songe seulement aux titres des chapitres 13, 15, 16, 17, 18 : « La belle Saint-Yves va à Versailles », « La belle Saint-Yves résiste à des propositions indélicates », « Elle consulte un jésuite », « Elle succombe par vertu », « Elle délivre son amant et un janséniste ». Peut-on dès lors vraiment, la concernant, parler de « schématisme », d’une « intériorité sculptée à la serpe [36] » ? Certes, on est bien loin de la Marianne de Marivaux, ne serait-ce que parce que le choix de la troisième personne interdit l’accès à cette intériorité permise par le roman-mémoires que les travaux de Jean Sgard et de Jean-Paul Sermain ont remarquablement illustré. Mais, comme le reconnaît Marc Hersant lui-même, « il n’est pas certain que la complexité soit un critère valable de reconnaissance du roman à toutes les époques [37] » et peut-être pas même au XVIIIe siècle [38]. De sorte que si quelque chose retient L’Ingénu « au bord du roman », selon la belle expression du critique, c’est cette figure de Mademoiselle de Saint-Yves, d’autant plus remarquable peut-être qu’à travers elle et dans la fiction, Voltaire semble développer une réflexion sur les rapports entre sexe et autorité, notamment sur la violence sexuelle comme enjeu de pouvoir, dont Myrtille Méricam-Bourdet a montré qu’elle n’était pas absente de ses textes historiques [39]. En clair, l’aspect parodique (de Rousseau, de Richardson, de Prévost) ne saurait épuiser la singularité de cette figure féminine [40], ce qui ne veut pas dire que Marc Hersant ait tort quand il remarque que « le dialogue des genres narratifs constitue l’arrière-plan permanent du récit voltairien ». L’Ingénu se charge ici, via le pathétique, d’un discours de condamnation des crimes sexuels dont les femmes sont victimes, qu’il élude au même moment dans ses textes sur la justice [41].
Un problème demeure toutefois car si roman de Mademoiselle de Saint-Yves il y a, Voltaire liquide effectivement ce roman (Mademoiselle de Saint-Yves pourrait écrire « Voltaire m’a tuer »), le vraisemblable étant porté jusqu’à la limite de la folie comme si la fin de Mademoiselle de Saint-Yves faisait d’elle la sœur en fiction de ces folles qui peupleront le roman de la fin de du XVIIIe siècle – la Présidente des Liaisons dangereuses ou Lodoiska [42]. On a observé que L’Ingénu commençait par un conte satirique et « se termin[ait] presque comme un roman [43] ». Le conte, d’une certaine manière, subit le même sort, « liquidé » par un autre dénouement : celui du roman puis celui du conte, l’un comme l’autre « bête[s] comme la vie » pour reprendre le mot de Flaubert à propos de Candide [44]. Une pratique sceptique de la fiction donc.
En guise de conclusion, L’Ingénu entre fiction et diction
De fait, L’Ingénu se révèle peut-être surtout inclassable en tant qu’il met en échec ce que Genette a théorisé par l’opposition entre fiction et diction. Gérard Genette désigne par ces deux termes les deux uniques critères de littérarité, dans une démarche que Marielle Macé résume ainsi : « un roman est littéraire parce qu’il est fictionnel, alors que des Mémoires – comme plus généralement les formes dictionnelles – ne sont littéraires que si on les trouve bien écrits [45]. » Le récit philosophique tel qu’il a été pratiqué mais pas théorisé par Voltaire n’est-il pas au fond inclassable parce qu’ayant été conçu « à côté » de la poétique essentialiste et close de l’époque classique, il excède la fiction, par l’ironie notamment ? Il me semble en effet qu’« écriv[ant] pour agir », le vieil écrivain nous invite dans sa pratique du récit philosophique, comme plus tard le feront les formes de la prose dictionnelle (autobiographie, essai, témoignage), « à des appréciations dynamiques, contractuelles, s’en remettant au jugement du lecteur, redéfinissant le lieu de la littérature [46] ». Assurément, le double dénouement de L’Ingénu laisse le lecteur démuni et semble l’inviter, comme la préface du Dictionnaire philosophique, à faire l’autre moitié du chemin [47].
Idéologie et poétique ont partie liée, tout récit voltairien mettant finalement en jeu, dans une optique polémique qui, de l’aveu même de Voltaire, l’emporte sur toute considération de genre, le rapport que tout récit entretient à la vérité. Il faut douter de toute fable, de tout récit, histoire, conte, roman. Dès lors, liquider le roman de Mademoiselle de Saint-Yves ou « faire faux », c’est dénoncer les prestiges de toute parole (fût-ce la sienne) et plus largement – on voit bien où Voltaire veut en venir – toute ambition d’autorité. Déjouer les pièges de toute taxinomie y participe.
Pour conclure, si L’Ingénu est inclassable, c’est donc sans doute d’abord dans son rapport problématique au roman, genre-monstre (ou non-genre) dont Bakhtine a montré qu’il se nourrit de tous les genres, de toutes les formes et de tous les discours sociaux. Mais par la résistance qu’il oppose à tout classement, L’Ingénu engage aussi sans doute une redéfinition du genre-maison, le « conte philosophique » qu’on a tort d’envisager uniment. Ce genre-maison, Voltaire l’avait un peu laissé en jachère avec le lancement de la campagne contre l’Infâme et il y remet la main juste avant L’Ingénu, le soumettant à partir de là à des expérimentations formelles très variées mais dont l’unité est à chercher dans le primat donné à la valeur d’utilité du récit philosophique, à l’opposé de tout canon. Deux titres donnent l’idée de ce travail : Pot-pourri (1765) et Petite digression (1766) [48]. « Jamais catin ne prêcha plus, et jamais valet suborneur de filles ne fut plus philosophe », avait écrit très méchamment Voltaire de La Nouvelle Héloïse en 1761, qui n’était pas pour peu dans son rejet du roman. « Ce n’est ni Télémaque ni La Princesse de Clèves ni Zaïde : c’est JEAN-JACQUES tout pur [49]. » On serait tentée de lui retourner le compliment concernant L’Ingénu. De fait L’Ingénu, ce n’est ni Télémaque, ni La Princesse de Clèves, ni Zayde, même si c’est un peu Télémaque, un peu La Princesse de Clèves et un peu Zaïde tout à la fois : c’est Voltaire tout pur. Mais un Voltaire moins conforme à sa statue qu’un Voltaire en mouvement révélant jusque dans ses tout derniers textes (et dans ceux-là particulièrement) une pensée en construction s’édifiant aussi – et finalement surtout, au regard de sa réception posthume – dans les marges des hiérarchies classiques.