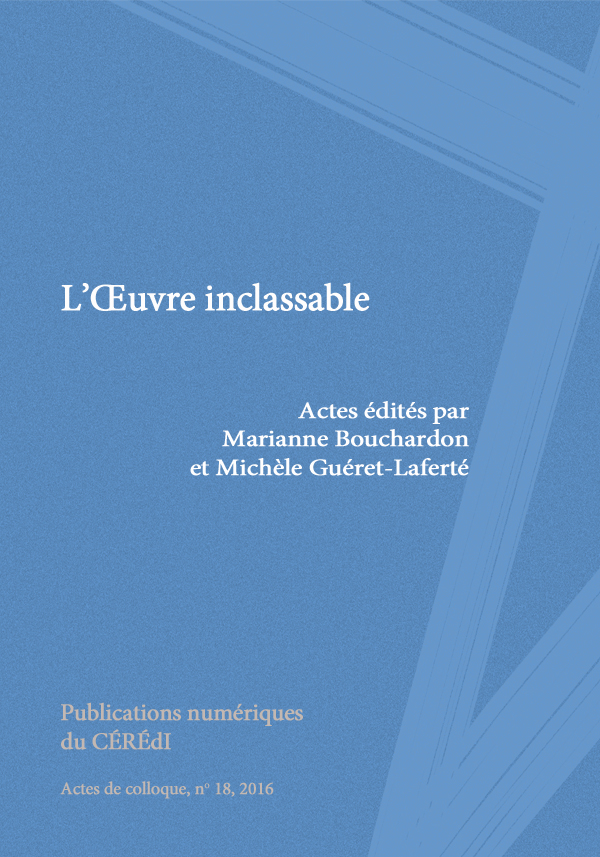La question de l’œuvre inclassable est bien l’une de celles que le post-structuralisme nous a laissées en héritage, l’une des plus inévitables et l’une des plus insolubles. L’une des plus inévitables, tant il est vrai que la poétique est, depuis son origine même, une affaire de classement – la Poétique d’Aristote débute ainsi : « Nous allons traiter de l’art poétique lui-même et de ses espèces, de l’effet propre à chacune d’entre elles, […] du nombre et de la nature des parties qui la constituent et pareillement de toutes les questions qui appartiennent au même domaine de recherche, en commençant d’abord par ce qui vient d’abord, suivant l’ordre naturel [1]. » Et en même temps l’une des plus lancinantes, des plus insolubles, tant elle condense les tensions à l’œuvre dans le domaine de la théorie depuis les années 1980. D’une certaine manière, elle en résume les grands enjeux, et rien ne le montre mieux que la polémique à fleurets mouchetés qui eut lieu entre Gérard Genette et Jacques Derrida. Cet épisode n’est pas l’un des plus célèbres ou des plus marquants, et néanmoins il résume parfaitement les deux grandes tendances qui furent celle des débats en théorie littéraire depuis un peu plus d’une trentaine d’années, tendances entre lesquelles nous nous tenons toujours, incapables en quelque sorte de trancher.
Les deux hommes s’étaient connus à la khâgne du Mans, où Genette avait fait venir son condisciple de l’ENS en 1959, et Derrida fut initialement très présent dans la revue Poétique, ainsi qu’en témoignent en particulier deux numéros, le no 5, « Rhétorique et philosophie [2] » et le no 21, « Littérature et philosophie mêlées [3] ». L’affrontement entre ces deux amis eut lieu lors d’une communication, « La loi du genre », présentée en juillet 1979 dans le cadre d’un colloque organisé à Strasbourg (entre autres par Lacoue-Labarthe et Nancy) sur la question du genre, puis publiée en français et en anglais avant d’être reprise dans Parages. Derrida s’avançait ici en terre conquise, occupée par les deux anciens directeurs de ladite revue Poétique, Genette et Todorov qui avaient publié, le premier un article fondamental paru dans le no 32 de Poétique en novembre 1977 sous le titre « Genres, “types”, modes [4] », et le second l’Introduction à la littérature fantastique en 1970, puis Les Genres du discours en 1978. C’est Gérard Genette qui est pris pour cible dans « La loi du genre », certainement parce que son projet, plus ambitieux, visait à démêler les fils très embrouillés du système des genres depuis Aristote et Platon afin, grâce à ce processus d’historicisation, de dénaturaliser les partages établis (à savoir l’attribution à ces deux ancêtres de la théorie des « trois genres fondamentaux ») et de leur substituer une division plus nette entre « genres » (définis par une spécification du contenu) et « modes » (à l’inverse sans spécification de contenu). Or ce que Derrida dénonce, en commentant « Genres, “types”, modes » – tout en couvrant Genette des plus vibrants éloges, cela va de soi –, c’est « l’ivresse terminologique » et « l’exubérance taxinomique » du poéticien [5], autrement dit sa prétention à ordonner non seulement l’ensemble des textes existants mais plus largement l’ensemble de tous les textes possibles en un système de classement cohérent – tendance que couronneront, on le sait, la réorganisation en 1982 des cinq types de relations transtextuelles en ouverture à Palimpsestes, puis la distinction entre Fiction et diction en 1991.
À vrai dire, le duel ne se limitait pas aux seuls Genette et Derrida. En effet, toute l’argumentation du second trouve appui sur la pensée de Maurice Blanchot, porte-parole d’un refus radical, propre à la littérature moderne, de cette fameuse « loi du genre » au nom de laquelle il n’est aucune « œuvre d’art, quelle qu’elle soit et singulièrement une œuvre d’art discursive, qui ne porte la marque d’un genre et qui ne la signale, remarque ou donne à remarquer de quelque façon [6] ». Avec l’élargissement à Blanchot, ce sont donc les deux voies ouvertes dans les années 1950 et 1960 qui s’affrontent ici : l’une, taxinomique, vise au dénombrement et à l’ordonnancement des formes textuelles, là où l’autre s’attache à une essence de la littérature par-delà les formes constatées (que cette essence s’incarne dans l’« œuvre », l’« écriture », ou le « fragment »…), ainsi que Blanchot en a fixé le modèle dans Le Livre à venir, où les textes n’appartiennent plus à des genres, mais à la littérature seule, dont l’essence est précisément d’échapper à toute détermination essentielle, à tout principe de classification [7]. Moins tranché néanmoins que Blanchot, c’est une autre loi que Derrida allègue contre la loi du genre, nommée « loi de débordement », selon laquelle les classes (genre ou mode) sont elles-mêmes « inclassables », ruinant ainsi toute prétention à « ranger les multiplicités dans une nomenclature [8] », puisqu’en tant que « trait supplémentaire et distinctif, marque de l’appartenance ou de l’inclusion », elles-mêmes ne relèvent « d’aucun genre et d’aucune classe [9] ». Manière de dire qu’un texte participe d’un ou plusieurs genres, mais n’appartient à aucun d’entre eux :
Et cela non pas à cause d’un débordement de richesse ou de productivité libre, anarchique et inclassable, mais à cause du trait de participation lui-même, de l’effet de code et de la marque générique. En se marquant de genre, un texte s’en démarque. Si la remarque d’appartenance appartient sans appartenir, participe sans appartenir, la mention de genre ne fait pas simplement partie du corpus [10].
Aux yeux de Derrida, ce principe simple explique que quantité de textes, tel La Folie du jour de Blanchot auquel « La loi du genre » est justement consacrée, puisse prétendre échapper à toute catégorie générique, alors même qu’il y est continuellement question de « récit » – mais, souligne Derrida, précisément afin de rendre compte de l’impossibilité de tout récit (« Un récit ? Non, pas de récit, plus jamais »).
Dans son « Carnet d’un biographe », Benoît Peeters rapporte les souvenirs que Gérard Genette lui livra de Jacques Derrida dont il préparait la biographie (parue chez Flammarion en 2010). À la sortie de son entretien, Peeters nota :
Entre Derrida et Genette, il dut toujours y avoir une immédiate différence de ton : gravité d’un côté, goût du jeu de l’autre. Blanchot est le parfait emblème de ce qui les sépare. L’amusant, à cet égard, c’est que mon propre tempérament me ferait plutôt pencher du côté de Genette [11].
On ne saurait mieux résumer la rivalité entre les deux théoriciens, plus complexe qu’il n’y paraît, puisque si le sérieux appartient bien au premier et l’ironie au second, c’est Genette néanmoins qui fut régulièrement accusé de rigidité taxinomique, cela quand bien même le même Genette a livré de cette opposition entre principe de classement et irréductibilité à toute mise en ordre la solution la plus souple et la plus satisfaisante en 2002 dans un chapitre de Figures V intitulé : « Des genres et des œuvres », dans lequel il rappelle qu’il existe une « interaction constante entre l’œuvre individuelle et le concept générique », autrement dit que la théorie des genres n’a de valeur qu’à se confronter continuellement à la singularité des œuvres toujours en excès et que la critique, attachée à son tour aux œuvres, ne peut, quant à elle, s’abstenir des catégories génériques « sous peine de s’enfermer dans une extase muette, ou purement exclamative [12] ».
Le propre de la réflexion littéraire est bien d’osciller, sans espoir de repos, entre l’unique et la série, entre l’original et le commun. Le différend théorique entre Genette et Derrida dont il vient d’être question ne fait ainsi lui-même que répéter une très vieille querelle, dont les tenants et les aboutissants ont été formulés de manière exemplaire par Albert Thibaudet dans un article fort court mais célèbre, étant donné qu’« Attention à l’unique » est la dernière « Réflexion » que celui-ci publia de son vivant dans la NRF, le 1er avril 1936. L’auteur des « trois critiques », attentif aux phénomènes de génération et théoricien génial des noms de genre, y répliquait à Gabriel Marcel tonnant dans L’Europe nouvelle contre « l’excès d’esprit classificateur » de la critique littéraire :
Après tout, c’est possible, écrivait Thibaudet. Mais s’il n’y a pas de critique littéraire digne de ce nom sans l’attention à l’unique, c’est-à-dire sans le sens des individualités et des différences, est-il bien sûr qu’il en existe une en dehors d’un certain sens social de la République des Lettres, c’est-à-dire d’un sentiment des ressemblances, des affinités, qui est bien obligé de s’exprimer de temps en temps par des classements [13].
De ce rôle des classements pour comprendre le génie ou la rupture dans les régularités, on pourrait faire une règle que d’aucuns jugeront tout à fait banale. De fait, la question vaut d’être posée : faut-il nous interroger encore sur les limites de tout classement ? Ou n’aurions-nous pas plutôt intérêt à ranger ce serpent de mer parmi les questions insolubles, désormais interdites, ainsi que l’Académie des sciences de Paris le fit en 1775 au sujet de la quadrature du cercle ?
Tout l’objet de ce colloque est précisément de montrer que l’on aurait tort de croire un tel problème dépassé. Et cela pour une raison qui tient à ce qu’il n’est presque rien, dans le domaine de la sélection, de l’analyse et la transmission des textes que les philosophes, les historiens ou les sociologues ne puissent faire aussi bien, voire parfois mieux que les littéraires. Les travaux de Martha Nussbaum (La Connaissance de l’amour, Éditions du Cerf, 2010), de Judith Lyon-Caen (La Lecture et la Vie, Tallandier, 2006), ou ceux de Gisèle Sapiro (La Responsabilité de l’écrivain, Éditions du Seuil, 2011) montrent que les sciences humaines voisines sont en mesure de replacer les textes à visée esthétique dans des ensembles notionnels ou historiques vastes sans en ignorer la singularité, et parfois même en les soumettant à de véritables micro-analyses. En revanche, ce que les littéraires semblent avoir en propre, et ce que ni les philosophes, ni les historiens, ni les sociologues ne veulent ou ne savent traiter avec pertinence, c’est précisément le pluriel des noms de genre et des logiques de dé/classement qui en résultent. Non qu’ils ignorent ces noms de genres et n’y aient souvent recours : du moins les enjeux de tout ce qui se situe à l’interface entre l’unique et le général leur restent-ils souvent indifférents, ou se voient étroitement indexés à la doxa en cours parmi les théoriciens de la littérature sur lesquels ils s’appuient (mais avec retard sur les recherches les plus actuelles).
Dès lors, il serait dangereux de fixer un moratoire sur une question que l’on peut juger insoluble, mais qui n’en reste pas moins au cœur de notre approche des textes. Et s’il est une difficulté, celle-ci tient, en réalité, plus à la multiplicité des pratiques de classement, que nous ne distinguons pas toujours entre elles. Qu’il s’agissent des éditeurs (pour qui il est essentiel d’identifier les genres par le biais de sous-titres rhématiques et de collections ou à l’inverse de brouiller des catégories reconnues pour des raisons juridiques par exemple comme dans le cas de l’autofiction), mais également des libraires et des bibliothécaires (tous confrontés à d’autres formes de classement, variables selon les moyens disponibles, les publics visés et les politiques culturelles encouragées par les institutions publiques), le corps enseignant (chargé de transmettre à la fois la langue française et le patrimoine littéraire en accordant autant que possible les catégories en usage aux normes universitaires en cours), enfin les représentants de ce qu’Albert Thibaudet nommait les « trois critiques » (la critique spontanée des salons ou des journaux, la critique professionnelle, et la critique des écrivains), tous ces agents de classement multiplient les opérations destinées à sélectionner, à évaluer ou à mettre en réseau les textes.
Mais pourquoi la variété, voire l’hétérogénéité de ces différentes pratiques de classement, dont les critères ne coïncident que rarement entre eux, joue-t-elle un rôle si important dans le domaine de la littérature (comme des arts en général) ? C’est ici la notion de « culture du commentaire », avancée par Michel Charles dans L’Arbre et la Source (Éditions du Seuil, 1985) qui rend compte des contradictions dans lesquelles nous nous débattons depuis si longtemps : là où la culture classique, dominée par la rhétorique, concevait la lecture comme tournée vers l’écriture selon des règles de production commune, de ce fait, au créateur et à son public, nous sommes entrés depuis le XIXe siècle dans une culture du commentaire où l’essentiel de la réflexion est tournée vers l’établissement et l’approfondissement du sens des textes. Toutefois entre ces deux cultures, la frontière est loin d’être étanche : le structuralisme puis la poétique ont précisément représenté une tentative très élaborée d’analyse systématique des propriétés définissant le discours littéraire, mais cela en pleine période de culture du commentaire. D’où l’impression d’inévitables tensions entre les deux pôles que nous nous fixons : toute proposition de mise en ordre alimente en effet le besoin, pour chaque œuvre examinée, de revendiquer une forme d’exceptionnalité et notre incessant retour aux textes exige, inversement, que nous renforcions les cadres d’appréhension généraux propres à garantir la valeur revendiquée en propre pour tel ou tel écrit. En sorte que les modes de classement sont à la fois sollicités et dénoncés, affinés et contestés. Ainsi s’explique que même le théoricien le plus rigoureux est susceptible de prétendre au luxe de l’exception, ainsi que Gérard Genette l’a fait dans la dernière partie de son œuvre, initiée par Bardadrac (Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2011). Notant lors d’un entretien publié dans Fabula-LHT que son ambition classificatrice avait atteint son point culminant avec L’Œuvre de l’art, situé (comme les livres suivants destinés à compléter sur des points de détails le tableau d’ensemble peu à peu construit depuis ses premiers essais) dans la collection « Poétique », le critique ajoutait :
Ce qui ne l’avait plus, ce sont évidemment les deux inclassables Bardadrac et Codicille, que je n’ai même pas songé à (me) proposer pour « Poétique », et qui ont trouvé, sans changer (encore) de trottoir, un nouveau site aux Éditions du Seuil, dans la collection si opportunément intitulée « Fiction & Cie », et que dirige Bernard Comment. Cette embardée-là (car c’en est une pour le coup, quoique envisagée de longue date), ce n’est pas à moi de tenter de dire quel rapport elle entretient avec la poétique (et l’esthétique) comme activités intellectuelles, mais il me semble qu’elle n’a plus grand chose à voir avec les quarante ans (de la revue et) de la collection « Poétique », que je continue de « diriger » sans plus (je ne dis pas « jamais plus ») l’encombrer de mes écrits [14].
Bien entendu, cette inclassabilité s’avère toute relative, étant donné que ces deux textes (ainsi qu’Apostille, Épilogue et Postscript qui s’y sont ajoutés depuis) se présentent comme d’étonnantes rêveries, faussement désordonnées sur les innombrables possibilités de classement, d’ordonnancement et de mise en système de toutes sortes d’objets, des plus nobles aux plus ordinaires, des plus singuliers aux plus généraux.
D’une certaine manière, l’œuvre inclassable représente bien un idéal et une prétention creuse – un idéal que l’exercice du commentaire se fixe dans sa quête de singularité et une posture sans cesse menacée d’épuisement, tant la revendication d’une absolue singularité risque de se réduire à une simple rhétorique du commentaire. Dans un article initialement paru dans Les Lettres françaises en mai 1968 (no 1233), « L’homme coupé en deux » (puis intégré dans l’Œuvre poétique, t. II), Aragon témoignait de cette ambivalence lorsqu’au sujet des Champs magnétiques de Breton et Soupault, il arguait du caractère irréductible de ce texte échappant, selon lui, à toute classification :
Et si je ne craignais pas de dépasser ici mon sujet, mon objet… je dirais bien, à cette occasion, que la beauté de ces quatre diamants insensés tient précisément à cette irréductibilité ; que, narguant toutes les esthétiques cataloguées, je suis tout prêt à affirmer qu’il n’y a de beauté véritable que de l’irréductible, de l’inclassable. En tout cas, aucun de vos moyens, Messieurs, ne permet d’expliquer ceci sans en briser la lumière, l’éclat [15].
La revendication d’Aragon ne se justifiait néanmoins qu’en raison du lien unique entre l’écrivain et ses deux amis en surréalisme : c’est dans le cadre très particulier d’une critique d’auteur s’opposant aux lectures plus techniques mais jugées réductrices des commentateurs savants que se situait l’affirmation d’irréductibilité. Autrement dit, Les Champs magnétiques n’étaient inclassables qu’au regard d’un commentaire forcé de se démarquer des approches universitaires mais ne renonçant pas pour autant à définir lui-même l’écriture automatique et à la réinscrire dans une poétique surréaliste qu’Aragon se réservait le droit d’énoncer.
Toute lecture critique se voit prise dans ce que l’auteur de La Mise à mort nomme ailleurs un « sentiment double », décrit comme « une soif de connaître à l’horreur de la profanation mêlée [16] ». De fait, le processus par lequel une œuvre échappe aux différents types de classement dont elle est susceptible joue un rôle stratégique dans nos pratiques de commentaire. Plus encore, si peu d’œuvres peuvent prétendre être radicalement inclassables – et il resterait à savoir si par « inclassable », on entend désigner un texte résiduel, situé en excès par rapport à tout regroupement possible, ou plus simplement un effet de surprise suscité par la novation mais qu’il est possible ensuite de résorber dans des ensembles reconnus, voire enfin une façon de tester la résistance des catégories disponibles et dont la confrontation avec des textes réfractaires permet d’évaluer l’intérêt –, en revanche, il existe différentes manières pour une œuvre de se jouer des généralités et d’en perturber le fonctionnement. On peut ainsi parler d’œuvres déclassées (ce serait le cas d’une tragédie de Voltaire que l’on jouerait dans une perspective strictement parodique), d’œuvres reclassées (telles les Lettres persanes écrites comme un roman mais très souvent lues aujourd’hui comme un essai, tant la dimension romanesque nous est devenue secondaire au regard de la dimension pré-anthropologique, ou Les Provinciales que presque plus personne ne lit comme un écrit apologétique), d’œuvres biclassables (il paraît vain de se demander si Chêne et chien est un recueil de poésie ou une autobiographie, puisque Queneau a précisément voulu confondre les deux), voire d’œuvres poly- ou multiclassables (les exemples sont légion). Tel est bien le sens des travaux qu’Alistair Fowler (dans Kinds of Literature, Harvard University Press, 1982) ou Jean-Marie Schaeffer (dans Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Éditions du Seuil, 1989) ont menés sur les genres, en particulier pour le premier en avançant la notion de répertoire dans une perspective pragmatique, autrement dit en assouplissant considérablement les manières que nous avons d’identifier des traits génériques, tous susceptibles de se superposer les uns ou autres, d’évoluer avec le temps, de disparaître brusquement ou au contraire de réapparaître à un moment donné, aucune identité de genre n’existant de manière stable, unitaire et intangible.
C’est ce « sentiment double », ce va-et-vient incessant entre l’unique et le pluriel qui gouverne notre rapport aux textes que les communications de ce colloque vont s’employer à déployer afin d’en montrer à la fois les infinies variations et le caractère structurant pour notre discipline. Peut-être la notion d’œuvre inclassable n’a-t-elle jamais été plus urgente à interroger qu’aujourd’hui, à un moment où les nouvelles approches théoriques (génétique des œuvres, études post-coloniales, ouverture aux écrits factuels, humanités numériques, approches cognitivistes, etc.) repoussent sans cesse les frontières de la littérature et démultiplient les corpus existants, rendant ainsi d’autant plus urgent la question de savoir ce qu’il en est des œuvres et de ce qui en elle échappe ou non aux classes et aux genres.