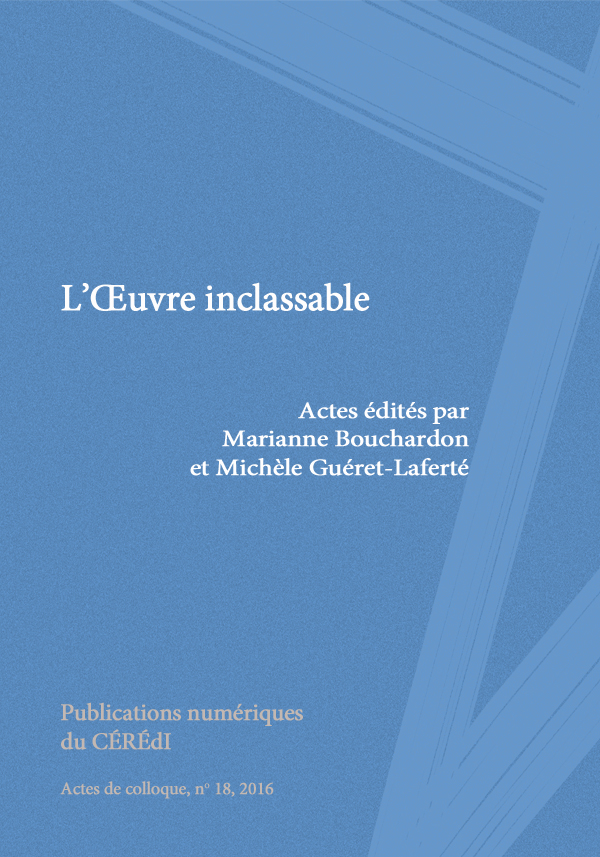Face à une œuvre inclassable, les lecteurs voient leurs attentes déjouées. Surpris, ils perdent leurs repères. L’auteur, de son côté, crée de lui-même une image de singularité. Il semble que Rabelais mette en scène une « stratégie de l’inclassable ». Celle-ci serait au service d’une conception des rapports entre l’auteur et ses lecteurs et, plus largement, l’individu et la collectivité.
Les récits rabelaisiens échappent à une classification générique étroite. Les deux premiers (Pantagruel, Roy des Dipsodes, restitué à son naturel, avec ses faictz et prouesses espoventables et La Vie tres horrificque du grand Gargantua) présentent les caractéristiques du roman de chevalerie, dont ils reproduisent un schéma courant : à la naissance du héros succèdent son éducation puis ses exploits en compagnie de fidèles compagnons. Le titre complet de Pantagruel, qui annonce des « faictz et prouesses », souligne cette influence ; dans le prologue, Alcofribas, le narrateur, confirme que le modèle adopté est celui de « livres de haulte fustaye » tels que le Roland furieux ou la chanson de geste Huon de Bordeaux. Mais d’autres genres enrichissent ces deux romans. Le titre de Gargantua renvoie aux biographies de grands seigneurs, en vogue au siècle précédent, voire aux hagiographies [1]. Pantagruel relève lui aussi du genre biographique, Rabelais s’inspirant de la vie de Pic de la Mirandole, écrite par son neveu [2]. D’autre part, ces romans se caractérisent par l’insertion de poésies, d’énigmes, d’apologues, d’exposés didactiques… On a même pu remarquer que les bois ayant servi à imprimer la page de titre de Pantagruel chez Claude Nourry, l’imprimeur de Rabelais, étaient spécifiquement employés pour des ouvrages sérieux, en latin, de religion et de droit [3]. L’utilisation de ces bois pour annoncer les faictz et prouesses espoventables en français d’un géant, dont le nom était celui d’un diablotin du folklore mis en scène dans des farces, témoigne bien d’une volonté de jouer avec les catégories textuelles.
Cette hybridité générique se retrouve dans le Tiers Livre. Les prouesses épiques des deux premiers ouvrages y sont remplacées par des dialogues au cours desquels se succèdent divers conseillers venus aider Panurge à résoudre son dilemme sur le mariage. Les discussions comportent nombre d’exposés didactiques de philosophie, d’histoire naturelle, de droit… Une place importante est faite en outre à l’éloquence, puisque ce livre s’ouvre sur le long éloge des dettes et se clôt sur celui d’une plante nommée « Pantagruélion ». Ces deux morceaux de bravoure relèvent du genre de l’éloge paradoxal, consistant à célébrer des sujets de peu d’importance ou suscitant la désapprobation.
Le dernier livre authentique de Rabelais, le Quart Livre, où est racontée la navigation des Pantagruélistes vers l’île de la Dive Bouteille, s’apparente au récit de voyage. Rabelais lui donne certaines caractéristiques des journaux de bord, comme celui de Jacques Cartier (le Brief recit, 1545), faisant montre de grandes connaissances techniques et nautiques [4]. Mais c’est bien d’un récit imaginaire qu’il s’agit, comme le montre, dès la première phrase du premier chapitre, la date du départ des navigateurs (« On moys de Juin, au jour des festes Vestales… »), allusion aux Argonautiques d’Apollonios de Rhodes. De surcroît, si le récit comporte certains faits spécifiques du récit de voyage, c’est souvent pour en modifier les enjeux. Par exemple, ce départ comporte des allusions à l’évangélisme, de même que le long épisode de la tempête en mer. Et lorsqu’il faut se conformer aux récits de voyage non plus réels mais imaginaires, empreints de merveilleux, en décrivant l’affrontement avec un monstre marin, c’est d’une manière déceptive et parodique, le monstre tué par Pantagruel n’étant en fin de compte qu’une simple baleine. Enfin, le Quart Livre abonde en genres secondaires, tels que l’anecdote exemplaire, l’apologue, le conte, la lettre… On y trouve même un court dictionnaire, la Briefve Declaration, dont Rabelais est très probablement l’auteur. Ce dictionnaire contient une indication sur l’un des genres auxquels s’apparente la fiction rabelaisienne. Dans l’épître liminaire, Rabelais qualifie ses romans de « mythologies Pantagruelicques ». Or la première entrée de la Briefve Declaration est une définition de cette expression : « Mythologies. Fabuleuses narrations. » Les romans rabelaisiens relèvent donc aussi de l’« histoire fabuleuse », fabulosa narratio. Ce genre est notamment codifié dans un texte de Macrobe (auteur que Rabelais a édité) : le Commentaire sur le Songe de Scipion de Cicéron. La fabulosa narratio s’applique aux fictions qui ne recherchent pas le seul plaisir du lecteur. Allégoriques, reposant sur la dissimulation, ces fictions cachent des points de doctrine religieuse, morale ou politique [5].
Si les romans rabelaisiens ne se laissent pas saisir à l’intérieur d’un cadre unique, leur singularité s’affirme aussi dans la langue employée par Rabelais. Celle-ci, comme l’a montré Mireille Huchon, est une création artificielle, étrangère aux usages. Une preuve du travail méticuleux de Rabelais sur la langue est le soin qu’il apporte à l’écriture de Pantagruel. D’édition en édition, il remanie son texte. S’affinent ainsi, progressivement, non seulement un style mais aussi un système syntaxique, orthographique et lexical tout personnel, qu’il nomme « censure antique [6] ». Les néologismes sont abondants. Dans Pantagruel apparaissent pour la première fois des mots comme bavard, badaud, bocal, caballe, génie, horaire, indigène, progrès, tergiverser, utopie… Gargantua compterait à lui seul environ 800 premières dates [7]. Rien de moins « populaire » que cette langue qui crée page après page toutes sortes de mots savants. Seuls les érudits pouvaient identifier ce que Panurge utilise pour confectionner ses drogues : une « lycisque orgoose [8] » (expression grecque signifiant « chienne en chaleur »). L’hybridité générique n’est donc pas l’unique obstacle à la réception des romans rabelaisiens : leur langue crée de l’étrangeté, bouscule le lecteur.
S’il a été possible de voir dans Rabelais un chantre de la culture populaire, c’est parce que ses romans ne sont pas avares en scènes farcesques, parfois radicales jusqu’à l’obscénité. Mais il faut surtout considérer celles-ci en fonction de leur proximité avec des passages sérieux voire graves. On trouve dans Pantagruel aussi bien une profession de foi évangélique (la prière du géant face à son ennemi Loup-Garou) que des plaisanteries graveleuses (le discours de Panurge sur la façon de bâtir les murailles de Paris). Dans Gargantua, le géant noie la population du quartier de la Sorbonne sous un déluge d’urine, mais il prononce également, face aux ennemis vaincus, un discours humaniste dans les règles de la rhétorique d’apparat. La fiction rabelaisienne, où cohabitent farce et sérieux, fait aussi perdre ses repères au lecteur parce qu’elle est profondément ambivalente [9].
Cette ambivalence est souvent très déroutante. Considérons le cas d’Alcofribas, narrateur et personnage. Rabelais, dans ses deux premiers romans, lui délègue sa voix. Mais Alcofribas peut se montrer ridicule et vain. La pensée humaniste est en effet une éthique, et on voit, dans Pantagruel, le géant déclarer son amour de la vérité :
Or, mon amy, contez-moy de poinct en poinct vostre affaire selon la verité ; car, par le corps bieu, si vous en mentés d’un mot, je vous osteray la teste de dessus les espaules [10].
Or Alcofribas, historien, « chroniqueur » des exploits des géants, faisant volontiers montre d’un savoir creux et inutile, affiche dans ce même roman une conception désinvolte du vrai : « On moys de octobre, ce me semble, ou bien de septembre », « Quelque jour, je ne sçay quand ». Cette désinvolture est celle d’un ivrogne : « Avés vous le tout entendu ? Beuvez donc un bon coup sans eaue », « À la mienne volunté que je eusse maintenant un boucal du meilleur vin », « Les registres de mon cerveau sont quelque peu brouillez de ceste purée de septembre »… Particulièrement significatif est son refus de mentir au moment de décrire un objet de pure fiction comme la masse d’arme féerique de Loup-Garou. En outre, dès le prologue, ce chroniqueur ivre et ridicule prétend attester la vérité en citant l’évangile de Jean : « Quod vidimus testamur. » Mais il voue ensuite aux pires souffrances les lecteurs sensés et incrédules :
Le feu sainct Antoine vous arde, mau de terre vous vire, le lancy, le maulubec vous trousse, la caquesangue vous viengne, […] et comme Sodome et Gomorrhe puissiez tomber en soulphre, en feu et en abysme, en cas que ne croyez fermement tout ce que je vous racompteray en ceste présente Chronicque [11].
Jean Thénaud, contemporain et ami de Rabelais, adaptant en français l’Éloge de la folie, souligne l’agressivité des prédicateurs vaniteux, cibles des humanistes :
Et si quelqu’un se monstre ennuyé d’ouyr telles follies et qu’il s’en aille il sera monstré aveques le doy, vituperé, blasmé et luy conviendra soustenir telles injures ou invectives, comme s’il avoit commis crime de leze majesté [12].
Alcofribas se comporte comme ces orateurs ridicules invectivant un public rendu sceptique et moqueur par tant d’incongruités. Il est donc lui aussi, à certains égards, l’un de ces superstitieux ineptes dont les humanistes ne cessent de dénoncer les erreurs. Retenons enfin son attitude dans le chapitre XVII de Pantagruel, où la rouerie de Panurge, procédurier et pilleur de troncs, apparaît le plus. Ce dernier appelle Alcofribas « mon ami » et lui propose de former ensemble une alliance diabolique : « Et si vouloys te raislier avecques moy, nous ferions diables. » La réponse est éclairante : « Non, non (dis-je), par sainct Adauras, car tu seras une foys pendu. » Alcofribas ne refuse que parce qu’il craint d’être pendu, ce qui en dit long sur sa moralité. En outre, le saint est inconnu, inventé pour la circonstance (sur le latin ad auras, « en l’air »), comme le confirme la réplique de Panurge : « Et toy (dist-il) tu seras une foys enterré : lequel est plus honorablement ou l’air ou la terre ? » Dans le chapitre XVI de Gargantua, où le géant châtie les Parisiens « oultrecuidés » du quartier de la Sorbonne en les noyant sous son urine, Rabelais dénonce les impiétés de ces superstitieux qui s’en prennent à Dieu (« Je renye Dieu ! »), hurlent des imprécations sentant la sorcellerie (« Carymary, carymara ! ») et implorent toutes sortes de saints ridicules (« Par saincte Mamye ! »). Or, parmi ces derniers, figure, semblable au « sainct Adauras » d’Alcofribas, un saint ad hoc : « Par sainct Andouille ! », l’andouille désignant le membre viril, cause du malheur des Parisiens. Alcofribas, dont le pédantisme fait de lui un pur produit de la Sorbonne, est à l’image de ces vaniteux superstitieux qui peuplent le Quartier latin. Rabelais choisit donc un porte-parole aux antipodes de sa pensée, humaniste, chrétienne et évangélique.
Toutefois, Alcofribas peut aussi, dans le même roman, tenir des propos conformes à cette pensée. Dans le dernier chapitre de Pantagruel (à partir de l’édition de 1534), il répond aux lecteurs qui lui reprocheraient de ne pas s’être montré « grandement saige » à la composition de « ces balivernes et plaisantes mocquettes » : « Vous ne l’estes gueres plus, de vous amuser à les lire. » Alcofribas nous engage de la sorte sur la voie de la morale : avant de critiquer autrui, considérons nos propres fautes. En outre, dit-il, si nous avons trouvé « passetemps joyeulx » à la lecture du roman, nous sommes « plus dignes de pardon qu’un grand tas de Sarrabovites [Sarabaïtes, moines débauchés d’Égypte], Cagotz [ladres], Escargotz [hypocrites, l’escargot dissimulant ses cornes], Hypocrites, Caffars [hypocrites], Frapars [moines menant une vie déréglée], Botineurs [moines et frères prêcheurs, les bottines étant des chaussures de moine] et aultres telles sectes de gens, qui se sont desguisez comme masques pour tromper le monde ». Les derniers mots d’Alcofribas vouent ainsi aux gémonies les suppôts de Satan, qui se dissimulent pour calomnier et semer la discorde parmi les hommes. Sous le comique, c’est à un éloge de l’esprit de charité que se livre ce narrateur. L’ambivalence de ses discours fait ainsi hésiter sur la finalité du roman : récit comique ou œuvre empreinte de doctrine ?
Enfin, l’étrangeté des romans rabelaisiens tient à leur extrême érudition. Rabelais élabore une fiction savante, encyclopédique (c’est d’ailleurs dans Pantagruel que le mot encyclopédie apparaît pour la première fois en français dans un imprimé), difficile d’accès. Cette érudition se manifeste au moyen de références directes, parfois entassées au point d’occuper un chapitre entier (comme le chapitre X de Gargantua, par exemple). Mais elle alimente aussi les récits sous des formes très discrètes : les romans rabelaisiens sont des accumulations d’intertextes reposant sur un « art de l’allusion » (selon l’expression de Mireille Huchon), ce qui pose le problème de leur réception. Rabelais a surtout pour particularité de modifier profondément certains textes sources, de les « altérer » comme le dit Romain Menini. Ce dernier a récemment montré comment s’applique à l’œuvre de Lucien cette « machine à faire tout autre chose », à « métamorphoser comme jamais » ses modèles qu’est l’écriture rabelaisienne, « travail différentiel d’élaboration à peu près inouï dans l’histoire de la réécriture littéraire [13] ».
L’hybridité générique, l’étrangeté de leur langue, leurs ambivalences, leur exploitation de vastes et complexes sources savantes plus ou moins retravaillées, tout cela rend les ouvrages de Rabelais particulièrement ardus, autant pour nous que pour leurs contemporains (lesquels étaient sans doute encore plus déroutés par cette langue que nous, qui sommes au moins familiarisés avec certains mots rabelaisiens passés dans le langage courant !). L’œuvre apparaît à certains égards comme une forteresse infranchissable, qui n’ouvrirait pleinement ses portes qu’à un lectorat restreint. Or cette posture est paradoxale si l’on considère que la charité, le souci d’autrui, la quête d’une société fondée sur la compréhension mutuelle, anime les humanistes chrétiens, au nombre desquels figure Rabelais. Ces idéaux sont d’ailleurs présentés à plusieurs reprises dans son œuvre, en particulier au cours de l’épisode de Thélème, abbaye « au rebours » des autres puisque l’on y pratique la charité en se préparant au mariage : une fois réunis, les époux quittent l’abbaye afin de rejoindre et construire une société civile cohérente et harmonieuse.
Quel but Rabelais poursuit-il lorsqu’il déstabilise ses lecteurs ? Pour tenter de répondre à cette question, restons avec les Thélémites. Animés à la fois par un sentiment d’individualité et par le désir de se conformer à la volonté de tous, ils réconcilient les termes de ce qui n’est un paradoxe qu’en apparence. C’est en réalité l’amour-agapê qui leur permet de concilier liberté et collectivité. Chacun fait ce qu’il veut tout en se conformant aux désirs des autres, car la fraternité consiste à adopter librement les conventions d’autrui. C’est sur cette idée que repose notamment la conception rabelaisienne du signe [14]. Lorsque Gargantua nomme son fils « Pantagruel », {}le nom de ce géant, signifiant « tout altéré », est en adéquation avec le fait que, « à l’heure de sa nativité, le monde estoit tout altéré ». Ainsi le nom signifie-t-il naturellement (aux yeux du « monde ») tout en étant donné dans l’acte pourtant arbitraire, et singulier, de la nomination. D’une façon plus générale, on peut dire que l’œuvre de Rabelais repose sur cet idéal d’un arbitraire naturel et collectif, où la libre volonté d’un individu se fait accepter par chacun.
À présent, considérons le prologue du Tiers Livre, où figure la plus importante déclaration de Rabelais sur sa réception. Y est en effet longuement exposé le problème du caractère inattendu, nouveau, inclassable de son livre. Remarquons d’abord que Rabelais déclare préalablement son intention de se montrer utile en écrivant des romans. C’est sa manière, dit-il, de jouer son rôle à l’égard de la collectivité. Rester « ocieux » devant les efforts de ses concitoyens affairés à la défense de l’État {}serait pour lui une source de « honte plus que mediocre [15] ». Ce faisant, il s’inscrit dans un courant de pensée humaniste et évangélique pour lequel la charité est aux fondements de l’éthique [16]. C’est après cette déclaration que Rabelais confie ses doutes sur les réactions de ses lecteurs. Lui arrivera-t-il la même mésaventure qu’à Ptolémée, roi d’Égypte, fils de Lagus, dont Lucien fait mention dans son opuscule À un homme qui lui avait dit : « Tu es Prométhée dans tes discours » ? Ptolémée, de retour de ses conquêtes, présenta à son peuple des merveilles inédites : « un chameau Bactrian tout noir, et un esclave biguarré tellement que de son corps l’une part estoit noire, l’autre blanche ». Ces « choses non encores veues en Ægypte » étaient si nouvelles que ses sujets furent « effroyez et indignez ». Devant l’esclave, « aucuns se mocquerent, autres le abhominerent comme monstre infame, créé par erreur de nature ». Ainsi, « l’esperance que [Ptolémée] avoit de complaire à ses Ægyptiens, et par ce moyen extendre l’affection qu’ilz luy portoient naturellement, luy decoulla des mains ».
Dans le traité dont s’inspire Rabelais, Lucien mentionne cette anecdote pour exposer ses propres inquiétudes sur « l’accueil qui sera réservé au genre nouveau qu’il a élaboré en associant comédie et dialogue [17] ». Avant lui, en effet, le dialogue était réservé à la philosophie. Son Tiers Livre étant lui aussi un dialogue comique, Rabelais, ce « Lucian françois [18] », avoue qu’il éprouve les mêmes doutes que le Samosatois : il redoute de « fascher » ses lecteurs au lieu de les « servir », de les « offenser » au lieu de les « esbaudir », de leur « desplaire » au lieu de leur « complaire ».
Ces inquiétudes peuvent d’ailleurs s’appliquer aux autres romans, car le Tiers Livre a été tiré, dit Rabelais, du même « tonneau » que Pantagruel et Gargantua. Par ailleurs, pour traduire le mécontentement des Égyptiens, Rabelais emploie deux termes clés : les sujets de Ptolémée, préférant les « choses belles, eleguantes et perfaictes », jugent les nouveautés présentées par leur roi « ridicules et monstrueuses ». Or Socrate, présenté dans le prologue de Gargantua comme une allégorie des romans rabelaisiens, est lui aussi un être « ridicule » (il était « laid de corps et ridicule en son maintien [19] »), qui n’est pas reconnu à sa juste valeur par la population. Quant à la « monstruosité », elle se manifeste dans le physique « biguarré » de l’esclave de Ptolémée. Or le monstrueux, comme le bigarré, c’est ce qui est composite, hybride [20]. À l’instar, précisément, des romans rabelaisiens, empilages disparates de genres, de sources et de tons. Il faut ajouter que, dans le prologue du Cinquiesme Livre, première version de celui du Tiers Livre, Rabelais défend son langage contre la « rhetorique armoisine, cramoisine » des poètes contemporains qui « ne traittent que gestes heroïques, choses grandes, matieres ardues, graves et difficiles [21] ». L’opposition entre les nouveautés de Ptolémée et leur réception par un public accoutumé aux productions élégantes est ainsi appliquée non plus à l’invention romanesque mais au langage. Ce n’est donc pas seulement le Tiers Livre mais bien tous les aspects de son œuvre romanesque qui posent des difficultés de réception auprès d’un lectorat habitué aux conventions et peu enclin à la nouveauté.
Toutefois, il est permis de considérer les inquiétudes de Rabelais avec une certaine méfiance. Son mélange de philosophie et de comédie n’est en effet pas si nouveau. N’a-t-il pas déjà été proposé par Lucien ? Cette déclaration inquiète n’est finalement que l’expression d’une allégeance : Rabelais signale qu’il se définit comme un « Lucian françois ». En fait, lorsqu’il évoque l’incompréhension, le déplaisir ou la réprobation que ses œuvres pourraient susciter, c’est toujours pour s’en indigner ou s’en moquer, jamais pour s’en inquiéter. À la fin du prologue du Tiers Livre, les doutes font en effet place à la certitude et à l’exaltation. Rabelais fait confiance à ses lecteurs, il les invite à boire « à pleins guodetz » le contenu de son « tonneau » romanesque. Puis il insulte longuement ses censeurs : il n’a écrit ses livres que pour les « Gens de bien », pas pour les « Caphars » ni les « Cagotz », qu’il voue aux pires tourments (« Jamais ne puissiez vous fianter, que à sanglades d’estrivieres. Jamais pisser, que à l’estrapade : jamais eschauffer, que à coups de baston »). Dans le prologue de Gargantua, il réagit aux critiques malveillantes d’un « Tirelupin » par une formule lapidaire : « bren [« merde »] pour luy [22] ». Nous avons déjà vu comment, dans Pantagruel, par la voix d’Alcofribas, il réplique vertement aux lecteurs qui lui reprocheraient d’avoir manqué de sagesse en écrivant toutes « ces balivernes », pour dénoncer ensuite avec violence les « Hypocrites » qui déforment les propos d’un auteur dans le but de lui nuire. Dans le prologue du Cinquiesme Livre, il se déclare « asseuré » que son langage sera accepté tel qu’il est par ses « bons » lecteurs. Quant aux autres, les « envieux », les « revendeurs de vieux mots latins tous moisis et incertains », il les envoie se faire pendre : « allez vous pendre et vous mesmes choisissez arbre pour pendage [23] ». On retrouve cette violence plus loin dans le Cinquiesme Livre, lorsque Rabelais fait allusion à la réception de ses œuvres au moyen d’une ekphrasis allégorique. Dans cette description d’une mosaïque montrant l’invasion de l’Inde par l’armée burlesque de Bachus, les Indiens se font massacrer parce qu’ils ont commis l’erreur de mépriser leurs ennemis, armée ridicule de bacchantes en furie, de faunes et de satyres menée par le grotesque Silène. Il est permis de voir là une allusion de Rabelais à sa foi dans la force de ses écrits, aussi ridicules en apparence que l’armée bachique. En d’autres termes, si la difficulté de réception est l’un des thèmes récurrents des livres rabelaisiens, elle est pleinement assumée, et ne fait l’objet d’aucun doute. On peut donc soupçonner que le recours à l’anecdote de Ptolémée est en réalité une stratégie visant à rappeler, à proclamer, combien le roman rabelaisien peut être inclassable et choquant.
Dans ces déclarations métatextuelles, Rabelais admet que ses livres soulèvent des difficultés de lecture. Cette question est si importante qu’il l’aborde non seulement dans la périphérie des romans (prologues, conclusions) mais aussi au sein de la fiction. Outre l’allégorie du Cinquiesme Livre, on pourrait par exemple relever, dans Pantagruel, l’épisode de Thaumaste, qui porte, précisément, sur l’interprétation. Le savant anglais débat par signes, sans parler, avec Panurge. Il s’efforce d’interpréter la gestuelle du compagnon de Pantagruel, dont le symbolisme est parfois sérieux, parfois ironique et obscène. Avant ce débat, l’Anglais a discuté avec le géant. Alcofribas commente cette rencontre en nous renvoyant, lecteurs, à notre propre situation de lecture : « Messieurs, vous qui lisez ce present escript, ne pensez que jamais gens plus feussent eslevez et transportez en pensée que furent, toute celle nuict, tant Thaumaste que Pantagruel. » Aussitôt après cette apostrophe, le géant est à son tour présenté comme un lecteur :
Pantagruel entra en la haulte game, et toute la nuyct ne faisoit que ravasser après : Le livre de Beda, De Numeris et Signis ; Le livre de Plotin De Inenarrabilibus ; Le livre de Procle, De Magia ; Les livres de Artemidore Peri onirocriticon ; de Anaxagoras, Peri Semion ; d’Ynarius, Peri Aphaton ; Les livres de Philistion ; Hipponax, Peri Anecphoneton ; et un tas d’aultres [24].
Pantagruel serait-il une représentation du lecteur de Rabelais ? De fait, la liste des livres qu’il s’efforce d’assimiler se caractérise par son ambivalence référentielle : les ouvrages de Bède le Vénérable, de Plotin, de Proclus et d’Artémidore sont authentiques ; Anaxagore, Philistion et Hipponax ont existé mais pas les livres que leur attribue Alcofribas ; Dynarius est fictif. Autrement dit, comme ceux de Rabelais, qui font constamment la satire du monde contemporain, ces livres sont un mélange de fiction et de vérité. Surtout, ils montrent un savoir encyclopédique tantôt reproduit fidèlement, tantôt retravaillé, partiellement ou totalement, par l’imaginaire, particularité remarquable de la fiction rabelaisienne, comme on l’a vu. Auteurs et ouvrages de cette liste s’ordonnent donc selon un axe du vrai au faux avec des étapes intermédiaires, reflétant le fonctionnement référentiel des romans de Rabelais. C’est ensuite que se déroule le débat entre Thaumaste, interprète de bonne volonté désireux de s’instruire, et Panurge. Ce dernier est un rusé producteur de sens, qui manipule son interprète en délivrant un discours à la fois grotesque, savant et sérieux. Autrement dit, il offre une représentation acceptable de Rabelais lui-même. Enfin, le débat fait l’objet d’une impression : « Thaumaste en feist un grand livre, imprimé à Londres, auquel il déclaire tout sans rien laisser. » Le livre de Thaumaste, dans la mesure où il est associé à un lieu réel (Londres), renvoie au livre que nous, lecteurs authentiques d’Alcofribas, tenons en main (« Messieurs, vous qui lisez ce present escript… »). Ce double motif du livre encadre donc l’épisode, clôturant un dispositif allégorique au cours duquel Pantagruel, Panurge et l’Anglais semblent reproduire des aspects de la relation complexe établie par Rabelais entre son monde fictionnel et celui de ses lecteurs.
Rabelais met en scène la réception de ses œuvres, pour la raison qu’il veut expliquer leur manière d’être lues. De telles œuvres sont en effet difficiles d’accès, si peu rapportées à un genre romanesque homogène qu’elles peuvent se voir définies d’après une mosaïque ou une « dispute » par signes. La manière de les lire aura donc peu à voir avec une herméneutique de la lecture, dont les codes sont certes rappelés dans le prologue de Gargantua (la fameuse opposition entre les sens littéral et allégorique), mais de façon si obscure qu’il n’est guère possible, comme on le sait, d’en tirer une leçon certaine [25]. C’est que Rabelais, en réalité, nous orienterait plutôt vers un mode de lecture d’ordre moral et éthique. Ainsi qu’il le dit dans le prologue du Tiers Livre, ses « bons » lecteurs doivent en effet être animés moins par l’intelligence des textes, par leur capacité rationnelle à interpréter, que par le « Pantagruélisme ». Cette vertu, faite de gaieté et de charité (et de diogénisme), consiste à prendre charitablement en bonne part ce qui vient d’un cœur « bon, franc et loyal » :
Je recongnois en eulx tous une forme specificque, et proprieté individuale, laquelle nos majeurs nommoient Pantagruelisme, moienant laquelle jamais en maulvaise partie ne prendront choses quelconques ilz congnoistront sourdre de bon, franc, et loyal couraige. Je les ay ordinairement veuz bon vouloir en payement prendre, et en icelluy acquiescer, quand debilité de puissance y a esté associée [26].
Les hypocrites contre lesquels Rabelais s’emporte sont, au contraire, les mauvais lecteurs. Animés par l’esprit de discorde, ils personnifient l’anti-charité.
Dans ce prologue, un terme joue un rôle important : Rabelais, désireux d’être utile, se voit comme l’« architriclin » de ses concitoyens : « Et me auront […] pour Architriclin loyal [27] ». Le titre de la Pantagruéline prognostication, contemporaine de Pantagruel, présente Alcofribas comme l’« architriclin dudict Pantagruel ». Dans le prologue de Pantagruel, Alcofribas est en outre le serviteur du géant, qu’il a « servy à gaiges ». Rabelais, dans une lettre à Antoine Hullot (1542), se dit « humble architriclin, serviteur et amy » du destinataire. L’architriclin est le maître d’hôtel, l’organisateur de banquets. Le mot est calqué sur le latin chrétien architriclinus, à partir d’un vocable grec employé dans l’évangile de Jean (II, 9) pour désigner l’ordonnateur du festin de Cana. Rabelais associe donc les rôles de serviteur, d’ordonnateur de banquet et d’ami. Vin, nourriture et charité, service et amour d’autrui, sous le signe de Cana. Or, dans le prologue du Tiers Livre, ce miracle est l’une des métaphores employées par Rabelais pour définir son roman hors-normes : « beuvez à pleins guodetz [de ce livre] comme es nopces de Cana ». L’architriclin est aussi l’écrivain.
Dans le récit de Jean, le maître d’hôtel est le premier à constater la métamorphose de l’eau en vin réalisée par le Christ. À la fin de l’Enchiridion militis christiani d’Érasme, l’une des sources de Rabelais pour la dialectique des sens littéral et spirituel, le vin de Cana est une métaphore de l’altior sensus : le Christ « a changé l’eau de la lettre froide et insipide dans le vin de l’esprit », faisant advenir « le mystère sous la lettre [28] ». Le miracle de Cana inspirera aussi l’initiation de Panurge à la fin du Cinquiesme Livre. La « pontife » Bacbuc offre à boire aux Pantagruélistes l’eau issue d’une « fontaine fantastique ». Pour les Pantagruélistes, ce n’est que de l’eau « fresche ». Bacbuc leur ordonne alors d’user de leur imagination. Soudain, « l’eau de la fontaine rendoit goust de vin selon l’imagination des beuvans ». Boire est ici un acte interprétatif, qui métamorphose l’eau en vin. Mais ce vin est divers : pour les uns, c’est du vin de Beaune, pour d’autres du vin de Grèce, etc. Chacun trouve dans cette eau un vin particulier. Toutefois, tous y voient du vin. Nous retrouvons la leçon de Thélème : une association du sens individuel et du sens collectif, réalisée par les membres d’une « compagnie » buvant ensemble, trinquant (c’est la leçon de la Dive Bouteille : « Trinch ! ») dans une sorte de communion guidée par l’esprit de charité.
L’architriclin rabelaisien est donc celui qui invite les lecteurs à faire advenir le sens, à interpréter ensemble et à adopter librement l’arbitraire d’un seul auteur. Après avoir offert aux Pantagruélistes des outres pleines de cette « eau phantastique » symbolisant la fraternité, Bacbuc, en guise de conclusion, définit leur quête comme une venatio sapientiae, une quête de sens. Les difficultés et ambivalences du roman rabelaisien trouveraient donc là une fonction : il s’agirait d’une stratégie visant à mettre le lecteur à l’épreuve, à le pousser à adopter un mode charitable d’accès au sens, afin qu’il établisse une relation fraternelle avec l’auteur, condition pour asseoir une société civile harmonieuse.