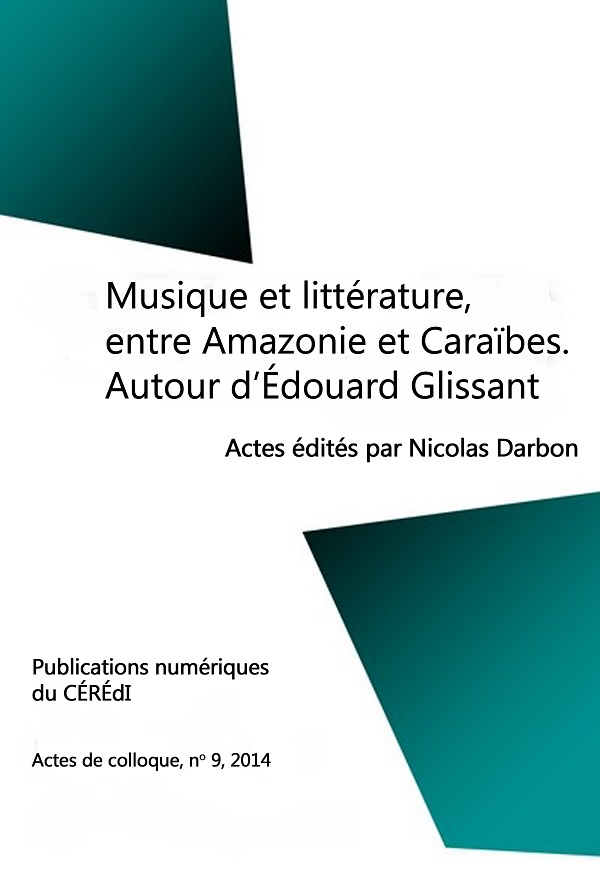À Jean-Luc Tamby,
en souvenir de discussions fécondes
portant sur une pluralité de musiques.
« POÉTIQUE
L’étant, multiple infini dans sa subsistance ».
Édouard Glissant, Poétique de la Relation
Le recours au prédicat « poétique » invite à embrasser une bonne part de la phénoménologie artistique qui illumine le monde. Au sein de la sphère esthétique, l’« étant poétique » concerne alors autant le producteur que le récepteur, autant le faiseur [1] que le jouisseur [2]. Et si dans le Banquet, Platon désigne par poiesis à la fois la « fabrication » des artisans et la « production » des poètes, Édouard Glissant remarque que « les anciens découvreurs / découverts s’équivalent dans la Relation [3] ». Ainsi, si la légitimité peut se substituer à l’éventualité, alors la poétique peut sans complexe prendre des allures de gestualité artistique et des factures d’universalité esthétique. À ce propos, Rudolf Otto ne comptait-il pas sur cette définition : « Est esthétique tout jugement qui n’est ni rationnel ni moral, et qui implique une activité du sentiment [4] » ?
Au cœur de ses différents écrits relatifs à la paraphilosophie [5] et aux principes de la Relation, Édouard Glissant a semé çà et là quelques graines conceptuelles repérées sous sa plume comme étant des « poétiques [6] » (poétique des profondeurs, poétique de l’extension, poétique de la structure, poétique de la durée et de l’instant, poétique du Divers [7]…), autant de catégories métaphoriques qu’à présent le musicologue peut à loisir examiner au prisme colorimétrique de l’art sonore. En l’occurrence, évoquant ses propres préceptes « relationnels », le poète du Tout-Monde [8] a parlé de la « poétique » en ces termes : elle est « précisément cette double portée, d’une théorie qui tâche à conclure, d’une présence qui ne conclut (ne présume) de rien. Non point l’une sans l’autre. C’est par là que l’instant et la durée nous confortent. Toute poétique est un palliatif d’éternité [9]. » En outre, notons que, ramenant ostensiblement la réflexion à l’ordre du sensible, Gaston Bachelard avouait réagir au « doublet phénoménologique des résonances et du ressentiment », précisant que « les résonances se dispersent sur les différents plans de notre vie dans le monde » et que « le ressentiment nous appelle à un approfondissement de notre propre existence [10] ».
Naissance, connaissance
« Il faut que le rhizome multiplie au loin. »
Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde
Si « la Relation, qui s’épart de l’être, affirme le sujet », alors « le sujet est à lui-même une nuée de connaissance. [11] » Dans Race et histoire, Claude Lévi-Strauss avait aussi insisté sur le fait civilisateur qui implique d’emblée la coexistence des connaissances : « La civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition, à l’échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité [12]. » Se fondant sur les éléments d’une philosophie pessimiste et chaotique qui dénoncent la stérilité du XXe siècle, Oscar Splenger avait, quant à lui, raisonnablement pensé que « chaque culture est déterminée par son héritage, ses valeurs et son sentiment du destin [13]. » Dans l’illumination de sa propre lignée « totémiste [14] », le compositeur européen reste donc intimement mêlé au contexte historique de sa destinée paramétrée (incluant le fait génétique, politique, religieux, festif, rituel, culturel et social) même si, pour Édouard Glissant, « l’idée de filiation, son énergie, sa force linéaire ne fonctionne plus – pour nous –, ni ne s’impose la légitimité enracinante et conquérante, ni par conséquent la généralisation à fondement ontologique [15] ».
Réfléchissant aux assises de l’art, Léon Tolstoï avait pointé que « poétique, cela signifie simplement : emprunté ailleurs [16] ». De même, Édouard Glissant relate : « le pouvoir de ressentir le choc de l’ailleurs est ce qui nomme le poète. » Par conséquent, qu’il soit en prise directe avec les agissements du peuple ou qu’il veuille atteindre – même avec un esprit d’athée – la sphère rituelle du culturel, l’artiste ou l’artisan doit prendre soin d’arborer indéfectiblement les « signes de la tribu [17] » pour une refondation utopique et atypique du monde. S’exprimant sur la notion d’intégration culturelle, Edgar Morin a même montré que « la récréation est vécue mythologiquement comme une re-création du monde. Et la fête, loin d’écarter provisoirement les sapiens de sa propre voie, révèle, exprime et nourrit sa nature ubrique et extatique [18]. »
Dès lors, imprégnés autant de la philosophie de l’homo symbolicus [19] que de la spiritualité de l’homo religiosus [20], les gestes de hiérophanies [21] artistiques de certains musiciens (tels Migot, Messiaen, Scelsi, Jolivet, Stockhausen, Penderecki, Pärt… à des degrés divers) ont impliqué une réalité méta-empirique en ce sens qu’ils se sont présentés en tant que manifestation intime du sacré. Ainsi, face à l’histoire de l’humanité emplie de mysticisme et d’utopie, de primitivisme et de spiritualité, de tradition et de religion, d’impacts psychologiques et de chocs mémoratifs, l’œuvre musicale contemporaine a été épisodiquement composée à des fins invocatoires. Et si l’on disserte sur les souches rhizomatiques et les couches stratigraphiques des musiques ancestrales, il est possible de conclure avec Jean During que « toute tradition musicale a quelque chose de sacré [22] ». Ainsi que l’a distingué Emmanuel Gorge, par l’intermédiaire de leur « idéologie » respective, le primitivisme et l’utopie entretiennent « des liens profonds à travers l’imaginaire de la création. Cet imaginaire s’est focalisé sur différents thèmes, sur différents espaces, ainsi que sur différentes temporalités des cultures humaines [23]. »
Introversion, extension
« Extension vertigineuse, non pas sur le monde,
mais vers les abîmes que l’homme porte en lui. »
Édouard Glissant, Poétique de la Relation
À travers le cycle intitulé In die Tiefe der Zeit entrepris dans les années 1990, Toshio Hosokawa a travaillé, à l’image d’un Luigi Nono, sur « l’écoute profonde du son ». Le compositeur japonais s’est ainsi expliqué comme suit : « Cette écoute lente, verticale, du paysage sonore prend du temps, le temps qu’il faut pour regarder ce paysage en constante mouvance, comme si l’on contemplait un tableau. Le temps de l’écoute, en se demandant d’où vient le son et comment il est arrivé là. L’air a traversé un espace vide, vide de sons, il a heurté un solide, il a produit un son. L’écoute captive du paysage de la genèse, de la création et de l’extinction de ce son… Comme si l’on suivait attentivement le lent cheminement d’un nuage dans le ciel. Mais peut-être n’est-il pas possible d’écouter le son de cette manière ? Depuis les profondeurs de ses origines, le moindre son porte en lui un monde d’une richesse infinie. Je voudrais que l’expérience de ce son nous fasse ressentir l’énergie de la nature qui circule dans les profondeurs les plus lointaines de notre être, qu’elle nous fasse prendre conscience d’un profond silence [24] », a développé l’ancien élève de Isang Yun, à propos de In die Tiefe der Zeit (1994-1996 – « La profondeur du temps »), partition écrite pour violoncelle et accordéon.
À vivre le « silence profond », à penser le « Chaos-Monde [25] » ou à vouloir les outrepasser d’une manière sincère, dévouée, voire engagée, certains compositeurs « inspirés » (tels Karlheinz Stockhausen ou Sun Ra – pour ne citer que deux exemples « créolisés [26] » pris dans les chapelles de la musique savante et de la musique populaire – ont brandi les symboles [27] multiples de cette volonté d’évasion spirituelle par le truchement non pondéré de leur mode d’expression respectif. Adepte de la « transmolécularisation [28] », le jazzman gourou a par exemple avoué que, parmi moult expériences d’ordre cosmique, sa peau noire s’est un jour transformée en rayons de lumière, d’une intense énergie : « Tandis que je priais, un ange vint, me toucha, et c’était comme si j’étais un homme neuf. […] J’aperçus alors mon vieux corps au-dessus d’une fournaise ardente [29] […] ».
C’est précisément ce mythique caldarium [30] évoqué dans l’apocryphe au Livre de Daniel (chapitre III) qui a servi de contexte au Gesang der Jünglinge (1955-1956) de Karlheinz Stockhausen. Il faut dire qu’à partir de cette œuvre mixte (pour voix d’enfants et sons électroniques – la première du genre, dix ans après la tabula rasa de la Seconde Guerre mondiale), l’expérimentateur de musique électronique a toujours manifesté un goût prononcé pour le rituel (Zyklus – 1959, Prozession – 1967) ainsi que pour la prière syncrétique (Stimmung – 1968, Alphabet für Liège – 1972, Inori – 1973-1977)… « J’essaie depuis très longtemps de former un rituel différent pour chaque œuvre, pour chaque programme, pour que l’on n’oublie pas cette œuvre. C’est-à-dire, j’écris des suggestions pour les interprètes, pour certains costumes ; les gestes sont indiqués dans pas mal d’œuvres, ainsi que les poses [31]... », confiera le musicien allemand.
« À quelle profondeur philosophique peut atteindre un poète qui accepte la leçon totale de la rêverie [32] ? », demande alors Gaston Bachelard. Précisément rêvée durant sept jours, la partition d’Aus den sieben Tagen (mai 1968) a tenté de donner des éléments de réponse à une interrogation fortement existentielle. En effet, c’est à cette époque que Stockhausen a compris, en lisant notamment les écrits de Satprem portant sur Aurobindo, qu’une force supra-mentale pouvait avoir une réalité : « Les êtres humains ne sont rien que des incarnations de courants spécifiques de forces spirituelles [33] », affirmait alors le futur auteur de Licht (1977-2003 [34]). Conséquemment, des textes de méditation profonde, d’ascèse contenue, de prospection cosmique, d’écoute intérieure ont été écrits dans le but de favoriser la découverte de la musique que nous portons en nous, l’œuvre étant « archive des corps […], silencieusement encore actif sous lui [35] », analyse à sa manière Bernard Vecchione.
Pragmatiquement parlant, cette poésie stockhausenienne, quasi automatique, doit impliquer de la part du chanteur ou de l’instrumentiste (car rien n’est arrêté à ce niveau, ni même en ce qui concerne la gestion du temps des parties) une nouvelle forme de virtuosité improvisée et une prise de conscience de l’imagination intuitive. Parfois théâtralisées, les quinze pièces du cycle proposent ainsi d’aborder les notions de « Durées justes », d’« Illimité », de « Communion », de « Litanie » ou de « Venue »… En guise de partition, le mouvement intitulé « Liaison » doit prendre en compte ce texte renvoyant exclusivement au domaine de l’introversion :
Joue une vibration au rythme de ton corps
Joue une vibration au rythme de ton cœur
Joue une vibration au rythme de ton souffle
Joue une vibration au rythme de ta pensée
Joue une vibration au rythme de ton intuition
Joue une vibration au rythme de ton illumination
Joue une vibration au rythme de l’univers
Mêle ces vibrations en une succession libre
Laisse entre elles assez de silence [36].
Cimentant toute prière solipsiste et auréolant toute incantation solitaire, ce rapport au « silenciaire [37] » (pour prendre le titre d’un opus de Maurice Ohana de 1969) est à l’image de certains monochromes qui laissent volontiers vagabonder l’esprit au travers de l’unique, de l’étale et du discret. Ici, rien n’est apparence, tout est essence. Et si la totalité semble prégnante, rien n’est palpable ; l’ordre de la sensibilité gérant de la même manière le subtile et l’inexprimable [38]. Blaise Pascal ne pensait-il pas que « les appréhensions des sens sont toujours vraies [39] » ? Dans ce contexte d’ordre quasi médiumnique, partisan d’une religion « flottante [40] » et messager zélé [41] exerçant spirituellement entre la terre et le cosmos, Giacinto Scelsi affirmait que « tout art n’est que la projection dans une matière verbale, sonore ou plastique des images créées par les éléments fondamentaux. Par l’analyse de ces éléments dans l’œuvre d’art, on obtient la révélation des impulsions créatrices extériorisées et cristallisées par l’artiste [42] ». Parmi tant d’opus pertinents du grand œuvre scelsien, Okanagon écrit en 1968 pour harpe, contrebasse et tam-tam est par exemple présenté par le compositeur poète comme une prière au « caractère rituel [43] ».
Dans cette optique, exposant sporadiquement des signes de représentation spirituelle plus ou moins affirmés, la ligne esthétique des improvisations et des partitions corollaires scelsiennes est manifestement orchestrée par (ou pour) une famille de serviteurs multiples [44]. De fait, d’aura anti-nietzschéenne et d’indice globalisant, le catalogue du maestro romain s’est laissé porter par plusieurs vents solaires reliés à une kyrielle de divinités [45] rencontrées tant en Orient [46] qu’en Occident : Brahma [47], Visnù [48], Shiva [49], Krishna [50], Jésus [51]…Comme l’écrit Heinrich Zimmer : « Tous les dieux sont en nous. [52] » Ainsi, l’œuvre d’art possède-t-elle des racines enfouies qui alimentent les reflets [53] sensibles d’une archéologie instinctive du devenir sonore. Comme le relate Michel Serres, « nous sommes ensevelis en nous-mêmes, nous émettons des gestes, des signes et des sons, indéfiniment, inutilement [54]. »
L’artisanat de la méditation et de l’introspection était si fort que, prônant les vertus des « profondeurs de l’objet [55] » acoustique, Giacinto Scelsi, en pionnier naïf de la spectralité intuitive [56], militait pour que les compositeurs œuvrent à « l’intérieur du son [57] ». En effet, « dans le son, on découvre un univers entier avec des harmoniques que l’on n’entend jamais […] Tout est là-dedans. Il y a déjà dans ce son-là, tout le cosmos entier qui remplit l’espace. Tous les sons possibles sont contenus en lui [58] », remarquait l’auteur des Quattro pezzi (su una nota sola). Alors, comme dans le mythe de Väinämöinen à propos duquel le chaman na-khi chante : « Si on ignore l’origine de la danse, on ne peut pas danser [59] », ne pourrions-nous pas tout aussi bien dire au sujet des opus scelsiens : « on ne peut musiquer si l’on ne connaît pas l’origine de la musique » ?
Étant multiple, état poétique
« La pensée fait de la musique. »
Édouard Glissant, Poétique de la Relation
Quant à la « poétique des profondeurs », Édouard Glissant a vu en la figure tutélaire de Charles Baudelaire le premier explorateur du genre littéraire [60]. Pour mémoire, concernant la troisième édition des Fleurs du mal en 1868, n’était-il pas l’auteur d’un sonnet – parmi tant d’autres – symboliquement intitulé Le Gouffre [61] ? Si « l’identité-Relation autorise infiniment [62] », sur un plan d’ordre identitaire, la question de l’« étant poétique [63] » (d’obédience humaine comme artistique) doit se poser à la fois sur un modèle d’envergure collective (délimitation « objective » de l’œuvre visant l’appartenance à une civilisation, une religion, une communauté, une ethnie, une classe sociale, une génération, un courant politique, etc.) et sur un prototype d’aura individuelle (détermination « subjective » montrant comment l’artiste ou l’artisan se situe par rapport à ces déterminants).
Ainsi au travers des vapeurs diffusées par l’échappement de ce moteur binaire se laissent dessiner les volutes d’« une dialectique de l’interne et de l’externe, du dehors et du dedans [64] », ces « polarités signifiantes [65] » occupées également par les dominos suivants : passé des origines [66] / actualité du présent ; positif / négatif [67] ; objectif / subjectif ; collectif / individuel ; archaïsme / modernité ; culturel / cultuel ; chute / surgissement [68] ; silence / bruit [69] ; clair / obscur ; jour / nuit [70] ; enfer / paradis ; étant / état [71]… Dans Nocturne en plein jour, le poète Jules Supervielle se posait une question : « Mais laquelle des deux nuits / Du dehors ou du dedans ? / L’ombre est une et circulante / Le ciel, le sang ne font qu’un [72]. » Quant à la pertinence de l’ouïe en situation noctambule, David Herbert Lawrence ne notait-il pas dans Psychanalyse et Inconscient que « l’oreille peut entendre plus profondément que les yeux ne peuvent voir [73] » ? L’oreille est alors « le sens de la nuit, et surtout le sens de la plus sensible des nuits : la nuit souterraine, nuit enclose, nuit de la profondeur, nuit de la mort [74] », avait anticipé Gaston Bachelard.
Au travers du texte rédigé en faveur de l’exécutant pour la réalisation de « Litanie » extraite d’Aus den sieben Tagen (op. cit.), Karlheinz Stockhausen a bien évidemment évoqué la phénoménologie d’une écoute intérieure, et notamment celle de la capture des ondes courtes et de leur source intarissable. Dans la conclusion, en fervent défenseur de la concentration méditative et de l’art sonore intuitif, il en est venu à disserter sur « les vibrations venant d’une région plus élevée et directement agissante ; plus élevée non pas au-dessus, en dehors de nous, mais plus élevée à la fois en nous et au dehors [75] ». Selon Giacinto Scelsi qui parlait souvent du « yoga du son », « les vibrations créent une forme qui est moulée selon la loi d’affinité, s’accordant à sa voûte de résonance, mais en la transformant aussi. C’est la base de la doctrine, car selon celle-ci, le SON est à la source de toute révélation révélée de l’intérieur [76] ».
Souvenons-nous : écrit pour violoncelle et contrebasse, Dharana (1975) de Scelsi fait référence à la profonde concentration de la pratique du yoga (ex. 1). Architecturée selon plusieurs séquences enchainées, la partition [77] est fondée sur des notes pédales qui gouvernent une suite de polarités essentielles (omniprésence de faux unissons ou de fausses octaves, grâce à des micro-intervalles : quart ou huitième de ton). Accusé par des nuances extrêmes, le vocabulaire des cordes frottées demande également des sons obscurs ou plus clairs (più chiaro), des gestes portamento, divers vibratos et trémolos, des bruits de percussion complémentaires… autant de spasmes qui ébranlent sporadiquement la tranquillité idéelle de l’âme, autant d’éléments dynamico-timbriques (colorés la plupart du temps au travers d’un registre grave, même si parfois le violoncelle joue la partie de véritable basse) censés perturber l’itinéraire d’un voyage méditatif à l’intérieur de soi. « Pourquoi fallait-il que la beauté au lieu de rayonner directement à l’extérieur et au grand jour, comme la splendeur resplendie de l’âme, se cachât pudiquement, honteusement, farouchement dans les profondeurs, de façon à rendre inévitable le malheur nécessaire de l’interprétation avec ses aléas et ses méprises [78] ? », demandait inopinément Vladimir Jankélévitch.

Ex. 1. Début coloré par la polarité de fa, extrait de Dharana pour violoncelle et contrebasse de Giacinto Scelsi (Paris, © Salabert, 1986, p. 3)
De même, s’inspirant de la pensée de Donald Winnicott, le compositeur Philippe Leroux n’explique-t-il pas que la musique peut se dérouler dans « un lieu paradoxal et intermédiaire entre le moi et le non-moi, le dedans et le dehors, l’intérieur et l’extérieur. La fonction de l’œuvre est alors d’être un lieu d’expériences multiformes où peuvent se rejoindre compositeurs et auditeurs. [79] »
Dans le domaine de la pensée sonore – entre subjectivité et objectivité – les abysses des origines ont été aussi traités à différentes niveaux de l’expression. Concernant le rapport au corporel et au gestuel, faut-il alléguer par exemple les « poèmes à crier et à danser » du dadaïste Pierre Albert-Birot qui faisaient florès à Paris dès 1916 et surtout la poésie phonétique de l’Ursonate (1922-1932) de Kurt Schwitters (adepte par ailleurs de l’« art total [80] ») ? Appelé parfois « Sonate aux sons primitifs », ce solo vocal asémantique a été interprété avec gravité puis enregistré par le peintre sculpteur allemand lui-même, en 1932, à la Süddeutschen Rundfunk de Francfort (ex. 2).

Ex. 2. Extrait du « Largo » de l’Ursonate pour voix solo, partition verbale [81] de Kurt Schwitters (Köln, © DuMont Buchverlag)
En outre, relativement aux origines de l’émission glottique, il est peut-être éclairant de rappeler que « la bouche est l’organe du parasite. Sa polyvalence est admirable : on y mange, on y parle, on y crie, on y rote, on y hoquette, on y gargouille. Tout est bien là en place, et rien n’est oublié [82] ». On comprend alors que certains avant-gardistes comme Dieter Schnebel (Glossolalie – 1960-1961) ou Joseph Anton Riedl (Vielleicht Duo – 1963-1970) aient eu envie de renouer avec le balbutiement inarticulé de nos très vieux ancêtres. Sans parler de la référence singulière au cri [83] cathartique présent tant dans la musique populaire (Prayer / Protest / Peace – 1960 – de Max Roach…) que dans la musique savante (Eight Songs for a Mad King – 1969 – de Peter Maxwell Davies), faut-il évoquer, sous couvert du retour aux origines (et à leurs profondeurs), le rapport primaire à l’abject [84] et au monstrueux ?
Dans ce registre flirtant même parfois avec l’obscène, rappelons que les principes de la musique de Franck Bedrossian et de Raphael Cendo [85] ont été insufflés par une certaine turbulence « extra-esthétique [86] » du terribilis, de l’horribilis et du monstruosus, domaines référentiels incitant à modeler consciemment les éléments symptomatiques et paroxystiques d’une catharsis empruntant ses bases dynamiques au réseau des émotions hyper fortes [87]. Édouard Glissant notait que « la force poétique (l’énergie) du monde, maintenue vive en nous, s’appose par frissons fragiles, fugitifs, à la prescience de poésie qui divague en nos profondeurs. La violence à l’œuvre dans le réel nous distrait de le savoir [88]. » En d’autres termes, au cœur de la représentation chaotique des angoisses de la philosophie contemporaine [89], l’objet esthétique violemment bruiteux a aimé se parer des timbres archétypiques des expressions de la Ur-Musik [90] comme de la transcendance du Dasein [91]. Dans le contexte de l’arkhaismos et de l’inventio, à la recherche d’une nouvelle culture primitive (en l’occurrence celle de la profondeur du son [92]), ces « nouveaux brutalistes [93] » se sont présentés comme des musiciens radicalement audacieux et des poètes intègrement fantasques [94].
En prise directe avec les formants de la déviation impulsive, la « poétique » exubérante [95] de ces bad boys a ainsi versé dans ce que Jean Cohen appelle la « stylistique de genre [96] ». Créée en 2009, l’Introduction aux ténèbres de Raphaël Cendo a été écrite pour baryton, contrebasse solo, treize instruments (plutôt graves) et électronique live sur trois textes en latin extraits de l’Apocalypse de Jean. Reflétant entre autres le chaos rencontré sur le champ de bataille entre le Bien et le Mal, ce texte controversé – présent dans le Nouveau Testament – n’évoque pas seulement le déluge matériel de la fin du monde, mais il traite également de l’anéantissement de toute âme humaine. Dégagé de toute obédience religieuse, le « deuxième chant » demande ainsi de « monter » des profondeurs terrestres pour connaître là-haut « ce qui doit arriver par la suite ». In fine, la musique accède malaisément au registre suraigu, « seul moment de lumière de toute la pièce », concède le compositeur. Au niveau du matériau, le travail d’écriture musicale est fondé sur des procédés d’« infra-saturation » qui affectent et enrichissent le timbre. « C’est le règne des lieux hantés par les déchirements passés et plongés dans des nuits infinies […]. En deçà de la saturation mais toujours portée par elle, l’infra-saturation n’est que l’évocation de ses propres Ténèbres, l’avènement d’une énergie noire, une descente aux enfers de sa condition saturée [97]. »
Les métaphores sonores de l’abîme (et de la cime)
« Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs
Du ciel, où tu régnas, et dans les profondeurs
De l’Enfer, où, vaincu, tu rêves en silence ! »
Charles Baudelaire, « Les litanies de Satan », Les Fleurs du mal
Toujours dans le champ de la figuration musicale orientée, il serait possible de narrer l’épisode infernal de l’épopée orphique. De la sorte, au cœur des catalogues mettant en scène la légende enjôleuse du personnage d’Orphée (par exemple, tous styles confondus : Orphée aux enfers – 1858 – de Jacques Offenbach, Pour en finir avec le pouvoir d’Orphée – 1971 – de Bernard Parmegiani, Orphée – 1995 – d’Aldo Brizzi…), le décorum sonore de Lucifer et de ses semblables a été traité sombrement de mille et une façons. « Tout homme qui veut devenir Orphée […] doit se mettre à l’écoute de cette musique originelle du corps, de cette symphonie des entrailles [98] », rappelle Francesco Spampinato. D’altérations [99] en métaphores, de digressions en métamorphoses, le mythe d’Orphée s’est vu valoriser – notamment au vingtième siècle – par un faisceau de messages primitifs, oniriques, déviés, élargis ou transcendés.
Sur près de trois quarts de siècle de création musicale, toutes esthétiques fusionnées, tentons de discerner par exemple le rôle éminent du non-dit d’un Ernst Krenek (Orpheus und Eurydike – 1923), la part de l’appréhension quasi rustique d’un Darius Milhaud (Les Malheurs d’Orphée – 1924), le rapport au geste chorégraphique d’un Hilding Rosenberg (Orfeus i sta’n – 1938 – « Orphée dans la ville »), la marge d’élégance ambiguë d’un Igor Stravinsky pour son ballet Orphée échafaudé en 1947, le désir de la portée cosmique d’un Pierre Henry (Le Voile d’Orphée – 1958 – dernière pièce d’Orphée 53), la charge affective des bruits-sons vocaux d’Arthur Pétronio (Orphée – 1953-1955 – opéra de chambre avec chœur de femmes verbophonique), le thème de l’injustice qui s’abat sur l’humanité suscité par Luciano Berio (Opera – 1969-1970), la nécessité d’une doublure d’aura technologique d’un Harrison Birtwistle (The Mask of Orpheus – 1973-1984 – tragédie lyrique réalisée en partie à l’IRCAM à Paris), la révérence virgilienne d’un Xavier Darasse (À propos d’Orphée – I 1978, II 1984, III 1987), l’esprit chambriste de Bruno Bjelinski (Orphée du XXe siècle – 1978), la part de métamorphose musicale pour Orpheus behind the Wire (1981-1983) de Hans Werner Henze écrit sur un texte d’Edward Bond, ou l’intimité retrouvée dans l’opéra de chambre Orphée (1992) de Phil Glass [100] …/… « Orphée transforme le bruit en musique. Et l’invente sans doute en ces lieux si dangereux [101] », conclut Michel Serres.
« Les graves s’immobilisent par le flux, et, en retour, le flux s’immobilise parmi les graves [102] », remarquait Michel Serres. En l’occurrence, il serait aisé d’initier une étude de l’instrumentarium qui sélectionne au premier chef les registres infra-graves (voix de basse, contrebasse, contrebasson, orgue, timbale, grosse caisse, tam-tam, ordinateur, synthétiseur, bruits enregistrés…) pour tapisser (électro)acoustiquement les décors méphistophéliques et autres lieux abyssaux. Dans l’« Abîme des oiseaux » (« lent, expressif et triste ») pour clarinette seule d’Olivier Messiaen, troisième mouvement du Quatuor pour la fin du temps (1940), si l’aigu de l’instrument rappelle à l’évidence quelques mélopées imaginaires proches du modèle d’un chant de merle noir, en revanche le registre du chalumeau désire peindre sans ambages l’harassement des profondeurs. « L’abîme, c’est le Temps, avec ses tristesses, ses lassitudes. Les oiseaux, c’est le contraire du Temps : ils font contraste et symbolisent notre désir de lumière, d’étoiles, d’arcs-en-ciel et de jubilantes vocalises [103] ! », a naturellement justifié le compositeur.
D’une manière semblable, à propos du mouvement central de sa Symphonie Liturgique (ex. 3) écrite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Arthur Honegger a avoué avoir eu recours au figuralisme de la profondeur [104] en usant systématiquement du registre grave instrumental : « À un moment, les contrebasses, le contrebasson et le piano – tout ce qu’il y a de plus profond dans l’orchestre – scandent la prose funèbre : De profundis clamavi ad te Domine [105] ! » Précédées d’un sforzando dévolu au couple piano / tam-tam et accompagnées d’une fanfare illuminée par les cuivres, ces noires munies d’un chevron sont alors à interpréter marcato, comme des syllabes homorythmiques d’un slogan provenant de manifestations outrancières. Allant dans ce sens, Gaston Bachelard affirmait que « la culture de la volonté réclame des monosyllabes. L’énergie d’une langue est souvent aussi intraduisible que sa poésie. L’imagination dynamique reçoit de la langue des impulsions primitives [106]. »

Ex. 3. Extrait du « De profundis clamavi », adagio de la Symphonie Liturgique (1945-1946) d’Arthur Honegger (Paris, Édition Salabert, © MCMXLVI, p. 49)
De même, la formation instrumentale de Mura della cittá di dite (1969, cf. ex. 4) de Hugues Dufourt utilise, entre autres, une flûte basse, un cor anglais, une clarinette basse, un cor, un trombone, des percussions, des claviers (dont un orgue électronique) et un quintette à cordes. Emprunté à Dante, le titre italien (signifiant « Les murs de la cité de Dite ») est extrait du « chant VIII » de L’Enfer. Faisant référence à un monde clos sur lui-même, là où s’abolit la raison du monde, Dite (ou Dis, qui figure le nom de Lucifer) représente la cité maudite cachée au centre de la terre. Pour honorer sonorement cette « dernière figure du Mal » (expression dantesque non loin des propos rencontrés dans l’Apocalypse de Jean – op. cit.) et sans tomber dans l’anecdote d’ordre primaire [107], le compositeur a usé d’artifices comme des traits de violence homorythmique ou des effets de dissonance fortement accusée (c’est-à-dire renforcée les unes par les autres). James Joyce n’écrivait-il pas qu’en enfer, « chaque torture, au lieu de réagir contre une autre, lui prête une force plus grande [108] » ? Dans ce contexte cloacal, la fin de ce diptyque de jeunesse (opus 2) laisse circuler des trainées de spectre bruiteux à la source improbable… « L’enfer de Dis n’est que morne répétition et retour à l’inerte [109] », tenait à préciser Dufourt à la création de la pièce à Genève.

Ex. 4. Trio d’instruments graves (flûte basse, cor anglais, trombone) mis en exergue dans Mura della cittá di Dite de Hugues Dufourt (Paris, Édition Jobert, © 1975, p. 36)
Auteur de L’Apocalypse de Jean (1968) – fresque catastrophique et cataclysmique où les Âmes et les Martyrs hurlent à tues têtes des tréfonds de l’univers – Pierre Henry a écrit Dieu, en 1977. Dans cet essai de « théâtre sonore » conçu d’après un texte de Victor Hugo, les scènes s’intitulent « Ce que la Mort me dit » ou « Enfer et Noir Diapason / Satan parle »… Au plan figuraliste, afin de cerner musicalement la matité des geôles de l’enfer, l’électroacousticien a choisi d’élaborer à dessein de sombres sonorités privées d’aura harmonique, ne présentant en l’occurrence aucune perspective dans le registre aigu. Comme toujours chez cet artisan furieux, l’effet est saisissant. Dans cet interminable maelstrom où l’hyperactivité gère les flux de l’exaspération, « Dieu reste jusqu’à la fin une promesse, un mot, un « grand mot ténébreux tout gorgé de clarté », un nom que l’on crie dans l’espace [110] ». Par ailleurs, rappelons que, jouant sur l’en-soi et le hors de soi, Le Voyage (1962) de cet avant-gardiste est bâti sur une alternance insigne entre l’« Innenwelt » et l’« Aussenwelt ». S’inspirant du Livre des morts tibétain, l’œuvre tente ainsi de mettre en évidence la problématique du cheminement des trépassés (les 49 jours établissant l’état intermédiaire juste après le décès). À noter qu’à la création de la version chorégraphiée à Cologne, Maurice Béjart faisait chuter des personnages cadavériques du haut d’une rampe stylisée, descente symbolique vers des profondeurs accidentées, accompagnée (dans le mouvement intitulé « Souffle 1 ») de forts retentissements sonores, bourdonnants et assourdissants, à la limite du soutenable.
Concentrant tour à tour leur inspiration sur l’aveuglement du clair et le mystère de l’obscur [111], certains compositeurs ont donné dans la spécialité de l’éclectisme des parcours extrêmes. Ainsi, au sein du catalogue pluriel [112] de George Crumb, la participation instrumentale ou la déclamation vocale ont pu revêtir des accents d’une fraîcheur puérile insoupçonnable ou se parer de susurrements sombres, nostalgiques de primarité. Abordant autant les conditions de la philosophie, de la superstition, de la religion, du mystère, du bien et du mal que celui du milieu glauque contrariant et de l’aura pure étincelante, voire de la profondeur infernale et de l’illumination céleste [113], l’œuvre de Crumb diffuse les éclats de la psyché tout en recourant à la médiation de la communion précaire (au sens de precarius induisant la notion de prière, même profane). À propos du sens véhiculé par les partitions crumbiennes présentées plastiquement (Makrokosmos – 1972-1973…) ou au travers d’un contenu métaphorique, spirituel ou socio-politique (Black Angels – 1970…), invoquons la parole de Hans Blumenberg qui maintenait que « les métaphores sont des fossiles-conducteurs issus d’une couche archaïque du processus de la curiosité théorique, qui n’est pas forcément anachronique sous prétexte qu’on ne peut revenir à la profusion de ses stimulations et attentes de vérité [114]. »
Composée de cinq mouvements disposés en arche autour du troisième panneau nommé « The Advent », Music for a Summer Evening (Makrokosmos III – 1974) de George Crumb se fonde sur des devises littéraires. Le premier mouvement intitulé « Nocturnal Sounds » (The Awakening) (« Sons nocturnes » – L’Éveil) est attaché à la prose de l’écrivain italien Salvatore Quasimodo : « J’entends des échos éphémères, oubli de la nuit profonde dans les eaux étoilées. » Rappelant parfois certaines couleurs bartókiennes, sons isolés et trémolos répétés, sources tempérées et données bruiteuses, détonations subites et résonances dilatées réfléchissent l’acoustique imaginaire des voûtes paradisiaque et infernale. Quant au long dernier mouvement baptisé « Music of the Starry Night » (« Musique de la nuit étoilée »), il est adossé à des vers du poète Rainer Maria Rilke : « Et dans la nuit, la lourde terre tombe de tous les astres dans la solitude. Tous nous tombons… Il en est Un qui néanmoins, avec une infinie douceur, tient cette chute dans ses mains. » Cristallisée en tutti (deux pianos et deux percussions), l’idée gestuelle de cette quasi musique à programme est figurée par cinq élans descendants.
Au demeurant, il faut dire qu’à l’instar de la production musicale d’un Hugues Dufourt par exemple [115], George Crumb se montre volontiers comme un musicien « saturnien » qui broie perpétuellement le noir de la mélancolie et de la mort [116], qui se complait dans les profondeurs obituaires, qui dépeint le lugubre avec nécessité, et qui côtoie les ombres errantes par nature plus que par envie. Il n’empêche, entre la science et la conscience, entre le dicible et l’indicible, entre la fable et l’ineffable, entre un sentiment permanent de douce persécution et une « illusion d’immanence [117] » de simulacres pervers et de sortilèges engloutis… l’art imaginatif de ce musicien américain [118] ne se présente-t-il pas simplement comme le mixte d’un récit profondément existentiel en sa tour de Babel bien enracinée, celui de notre vie singulièrement imaginative et de notre propre douleur quotidienne [119] ? Ainsi que l’écrivait Roland Barthes dans L’Obtus et l’Obvie : « Peut-être qu’une chose ne vaut que par sa force métaphorique ; peut-être que c’est cela, la valeur de la musique : d’être une bonne métaphore [120]. »
S’« il n’est pas tout à fait possible de penser diurne sans passer par le relais de nocturne, et sans retenir quelque chose de ce détour [121] », il paraît alors tout aussi évident de traiter de la profondeur sans avoir recours à son antonyme. Dès lors, dénonçant à la fois la profondeur des entrailles et la flèche des cimes du très-haut, cette idée générale accusée sous forme de « métaphores continuées [122] » est semblable à celle qui a motivé Olivier Messiaen pour écrire, entre 1971 et 1974, la grande œuvre pour orchestre intitulée Des Canyons aux Étoiles. Dans la préface placée en tête de la partition, le compositeur n’a-t-il pas mentionné : « Des Canyons aux Étoiles, c’est-à-dire en s’élevant des canyons jusqu’aux étoiles – et plus haut, jusqu’aux ressuscités du Paradis – pour glorifier Dieu dans toute sa création [123] » ? Pour mémoire, englobant la phénoménologie de l’ascension libératrice et de l’espérance lumineuse [124], rappelons que les allusions à ce fonds fusionnel (dans l’ordre de l’espace-temps) des extrêmes du plan vertical (sur l’Axis Mundi reliant Terre et Ciel) se sont trouvées énoncées à maintes reprises dans les œuvres de jeunesse du rythmicien français [125].
D’Edison Denisov à Sofia Gubaidulina, bon nombre de compositeurs ont alors œuvré sur cette symbolique auratique de la quête de lumière et de pureté. Parmi ceux-ci, citons Klaus Huber qui présentait ainsi les esquisses de son Deuxième quatuor à cordes… Von Zeit zu Zeit… (1984-1985) : « Y a-t-il encore un recommencement ? ! Faire sortir le (dernier) sens brillant, comme une « nouvelle naissance » ; une naissance émergeant d’une totale obscurité [126]… ». De même, devisant sur les associations relationnelles qui ont présidé au contexte d’écriture d’Erwartung (1909), monodrame expressionniste d’Arnold Schoenberg fondé sur un texte de Maria Pappenheim, Philippe Albèra assure que « la musique transcrit, littéralement, le sentiment du temps et de l’espace – ces deux formes a priori de la sensibilité pour Kant – d’un sujet plongé dans les ténèbres. La perception temporelle concrète du déroulement temporel, hors des repères qui servent à marquer le temps ou à l’ordonner architecturalement – une perception qu’il faudrait rapporter à ces expériences d’individus isolés au fond d’une grotte, et privé de lumière –, fait du temps comme essence du vécu le contenu même de la musique [127]. »
Voyageant entre refuge archaïque et profondeur confinée, les écrits de Mircea Eliade ont montré qu’en offrant un passage entre notre condition sociétale et le monde intérieur souterrain, qu’en érigeant une passerelle dorée entre le royaume de la vie et l’antre des morts, l’univers des grottes évoque les fonctions primaires de la terre nourricière en tant qu’utérus et en tant que tombeau : « […] les cavernes étaient assimilées à la matrice de la Terre-Mère [128] ». Intégré à l’opéra Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (1996) écrit d’après Hans Christian[Andersen, Léonard de Vinci et Gudrun Ensslin, Zwei Gefühle…, Musik mit Leonardo (1992) d’Helmut Lachenmann a investi de près ou de loin cette thématique de l’ombre profonde. En effet, à l’instar de La Niche des lumières d’Al-Ghazâli, usant de moult références figuralistes (populaires ou savantes), un épisode conte ouvertement la scrutation d’un aven dans le noir. Dans ce contexte exploratoire, la pièce musicale lachenmannienne a éveillé deux forts sentiments contraires : l’angoisse de l’obscurité ambiante et l’envie de se repérer et d’exister dans l’habitacle non éclairé [129].
De même, la partition de Lezea 2 (1989-1991) de Dominique Lemaître – titre qui tire son nom du mot basque signifiant « caverne » – débute comme un éclair flamboyant grâce au tutti d’un dixtuor joué fortissimo. En fait, l’atmosphère générale de l’œuvre a été inspirée par une sensation notablement vécue au travers d’une profondeur opaque : « Lorsque l’on entre dans une grotte, dans un premier temps, on ne voit rien (en quelque sorte l’obscurité nous aveugle) puis, peu à peu, l’œil s’acclimate, apprivoise l’espace ; après quelques secondes des formes apparaissent, l’espace se découvre [130]… », a ainsi expliqué le compositeur. Durant toute la pièce de musique de chambre, le jeu dichotomique va accuser la perspective portée ou non (éclairée ou pas) des différents éléments acoustiques en présence.
« Le pur est dans l’impur et l’obscur dans le clair. Nous vivons et nous pensons dans le mélange [131] », écrivait Michel Serres. À compulser en détails ce choix d’exemples multiples et variés (pris exclusivement dans le domaine de la « musique contemporaine »), ce principe métaphorique de verticalité (profondeur et hauteur) mais aussi d’horizontalité (ex situ et in situ…) ne semble alors aucunement à négliger. « C’est un principe d’ordre, une loi de filiation, une échelle le long de laquelle on éprouve les degrés d’une sensibilité spéciale [132] », tenait à remarquer Gaston Bachelard.
Le cri des profondeurs
« J’implore ta pitié. Toi, l’unique que j’aime.
Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. »
Charles Baudelaire, « De profundis clamavi », Les Fleurs du mal
Afin de tenter de compléter les différents éléments d’une poétique des profondeurs [133], il nous a paru nécessaire d’évoquer un peu plus précisément la mise en musique – malheureusement en ne nous positionnant qu’à partir du XXe siècle – du Psaume 129 de la Vulgate (ou 130 dans l’usage réformé). Car faisant partie des sept psaumes de la pénitence, ce texte est sans doute mieux connu dans la tradition des croyants comme étant celui du De Profundis (son nom latin signifiant précisément « Des profondeurs »). Peignant un sentiment de détresse sangloté du fond de l’abîme, ce psaume ancestral implore la miséricorde en présentant les dispositions de ceux qui attendent le pardon comme une rançon libératrice. Adopté par l’usage catholique comme l’une des pièces maîtresses de la liturgie des défunts (rapport au Requiem) au moment de la levée du corps, ce psaume a été appliqué dans la prière publique de l’Église à ceux qui ont été emportés dans le gouffre de la mort : « Des profondeurs, je crie vers toi, Yahvé : Seigneur, écoute mon appel… ».
Symbole de l’avènement de la « ténèbre » – au singulier tel que l’ont exprimé Maître Eckhart et Édouard Glissant [134] – l’entreprise de la « mise au tombeau » a été exaltée par bon nombre de musiciens occidentaux. Cette phase illustre en effet le dernier épisode de la « Passion du Christ ». En outre, notons que ses premières représentations paraboliques se sont rencontrées par exemple dans les illustrations de l’histoire de Jonas [135]. Dans ce contexte, se fondant sur une traduction française du texte biblique, Jacques Feuillie a écrit Jonas (1985) pour chanteurs solistes, chœur mixte et quatorze instrumentistes (ex. 5). Dans la deuxième partie de cet oratorio, après un épisode violent animé par une terrible tempête, le héros se retrouve avalé par une baleine. Une prière au Seigneur est alors adressée : « Du gouffre de la mort, j’ai appelé au secours, et tu m’as entendu. Tu m’avais jeté dans la mer au plus profond de l’eau […] Les portes du monde des morts se refermaient pour toujours sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m’as fait remonter vivant du gouffre [136] ». En dehors de la source biblique, et par-delà les frontières de l’Occident, l’image de Jonas réfugié dans l’obscurité d’un ventre de cétacé s’est ensuite retrouvée dans de nombreux contes et légendes mythologiques.

Ex. 5. Jonas (ténor solo) et la compagnie des voix graves (alti et basses) dans la deuxième partie de Jonas de Jacques Feuillie (Partition inédite, manuscrit de 1985, p. 49)
Par ailleurs, résonant depuis au moins le XIIIe siècle dans le contexte artistique, l’entreprise symbolique du placement en sépulture reste un élément dramatique important à traiter musicalement car couronné d’une aura à portée universelle. Parmi une pléiade de chefs-d’œuvre, si la Passion selon Saint-Matthieu (1666) d’Heinrich Schütz ou la Passion selon saint Jean (1723) de Jean-Sébastien Bach demeurent des plus démonstratives et des plus expressives, celles de Wolfgang Rihm et de Sofia Gubaidulina restent bien symptomatiques et symboliques de l’engagement spirituel des musiciens abordant la spiritualité du XXIe siècle. Dans Deus Passus [137] (2000), le compositeur allemand a fait par exemple chanter dans un mouvement calme (par les mezzo-soprano, alto soli et le chœur) un extrait de l’Évangile selon saint-Luc : « Et il y eut des ténèbres sur toute la terre… » alors que la musicienne russe a évoqué dans Johannes-Passion (2000) le fameux « puits de l’abîme » (n° 8, « Le chemin de Golgotha ») juste avant la dépôt du corps de Jésus dans le sépulcre obscur.
Dans la liturgie de la semaine sainte [138], la scène du tombeau cristallise l’ultime maillon symbolique du « Chemin de croix ». Et contrairement à ce que pensait le poète Rainer Maria Rilke [139], la tradition semble se perpétuer en matière de gestus évocatoire et dans le domaine conducteur de sens spirituel. Dans Quatorze stations (1970) pour percussion et sextuor de Marius Constant, l’instrumentarium soliste est traité comme masse sonore à vocation expressive. Si la première station (« La Condamnation ») fait tinter enclumes et cloche-plaque très grave [140], le court dernier mouvement intitulé « Ensevelissement » est confié à des timbres percutants secs et mats tels que bongos, tambour saharien, temple-blocks, tumbas et wood-chimes. Ceints de lourds silences éloquents, les divers éléments épars semblent dénudés (sons squelettiques) pour évoquer déjà un autre monde, absolument nocturne et profondément insolite. Gaston Bachelard ne disait-il pas que « le silence de la Nuit augmente la « profondeur » des cieux [141] » ?
La Mise au tombeau (ex. 6) renvoie également au titre d’une œuvre de Georges Migot écrite en 1949 pour petit chœur mixte et quintette à vent (sur un texte du compositeur). Ce petit oratorio qui fait partie d’un cycle de neuf opus consacrés à la vie du Christ (conçus entre 1936 et 1955) est « issu du tréfonds de l’être du musicien et témoigne du caractère mystique de sa foi. Migot ne cherche pas en premier lieu à raconter une histoire, glosée ou non, comme c’est le cas dans la plupart des histoires sacrées et des oratorios classiques, mais il met tout son effort dans le désir de nous placer en présence du Christ vivant, de le faire descendre en nos cœurs [142] […] », analyse Marc Honegger. Comportant deux chorals, la partition montre des passages notés « lourd », « sauvage », « avec terreur » ou « avec tendresse douloureuse ». Si l’œuvre débute solennellement comme une marche funèbre, « hésitante et irréelle », elle se termine en évoquant le tombeau clos, avant que les voix, par le truchement d’entrées successives, ne se figent doucement et symboliquement (bouche fermée) sur une pédale de sol grave.

Ex. 6. Dernières mesures de La Mise au tombeau de Georges Migot (Haguenau, Édition des Amis de l’œuvre et de la Pensée de Georges Migot, © 1990, p. 39)
Revenons au genre du De profundis pour mentionner quelques chefs-d’œuvre (avec ou sans texte, chantés ou non [143]) ayant vu le jour tout au long de l’histoire de la musique du XXe siècle. En premier lieu, considéré comme une « litanie éplorée d’un « miserere » hébraïque [144] », Mimaamaquim pour voix et piano (1946) d’Arthur Honegger présente en musique le texte de ce psaume 130 en faisant appel à de pesants accords pianistiques imitant l’éclat mystérieux d’un glas funèbre. À noter que la même année, s’inspirant d’un motif emprunté à un psaume de Jean-Sébastien Bach, le compositeur suisse a précisément nommé De profundis le mouvement médian de sa Symphonie liturgique (op. cit.). Familier de quelques éléments spirituels propres à l’écriture de Jeanne d’Arc au bûcher (1935), cet adagio se présentait à l’origine comme une « prière sans espoir » (« la méditation douloureuse de l’homme abandonné par la divinité [145] »).
Au plan exclusivement instrumental, repérons également le tout premier mouvement de Et expecto resurrectionem mortuorum (1964) écrit par Olivier Messiaen pour orchestre de 18 bois, 16 cuivres et 6 percussions métalliques. La partition de cette pièce initiale a mis en effet en exergue l’incipit du psaume 130 : « Des profondeurs de l’abîme, je crie vers toi, Seigneur : Seigneur, écoute ma voix ». Entendu dans la première partie, le « thème de la profondeur » (expression de Messiaen) est spécialement dédié aux cuivres graves (voir l’harmonisation en complexes colorés illustrée en sextuor par les cors). Quant aux échos de ce légendaire « cri de l’Abîme » (expression de Messiaen), ils sont consolidés par des attaques de gongs et de tam-tams affermies par des sonorités stridentes d’instruments à vent logées dans leur registre suraigu. Gaston Bachelard notait que « le cri est à la fois la première réalité verbale et la première réalité cosmogonique [146] ». Dans ce sillage, prière d’écouter également le De profundis inséré au début de la 14e Symphonie (1969, avec voix) de Dimitri Chostakovitch ainsi que celui placé dans la Première Symphonie mystique – La vie du monde qui vient : Requiem (1953-1973) de Claude Ballif ; sans parler du De profundis (1978) pour accordéon (appelé « bayan » en Russie) de Sofia Gubaidulina (ex. 7) et du Clamavi (1994) pour violoncelle et percussion [147] d’Alain Louvier, écrit à la mémoire de Dominique Troncin… Enfin, au XXIe siècle, citons encore De profundis clamavi, sous-titré « Hommage à Alban Berg » (2007) écrit pour quatuor à cordes et électronique par Patricia Alessandrini.

Ex. 7. Les clusters symboliquement graves du début du De Profundis pour accordéon de Sofia Gubaidulina [148] (Moscou, Édition Musyka, © 1982, p. 2)
Comme « le multiple roule en tourbillonnant [149] », les pièces vocales sont bien évidemment légion au sein de la pluralité des sources possibles. Le De profundis (1950) pour chœur mixte a cappella (opus 50 b) d’Arnold Schoenberg est bâti sur le texte original hébreu alors que celui d’Arvo Pärt écrit pour voix, orgue et percussions ad libitum (grosse caisse, tam-tam) en 1983 scande en valeurs égales le début de la formulation de la Néo-Vulgate, en latin (De profundis clamavi ad te, Domine…). Animées d’une ferveur sincère, ces partitions sont toutes deux pensées dans l’esprit rituel et non ostentatoire du déroulement d’un office imaginaire (dissonant pour le premier grâce à la présence de grands intervalles disjoints, consonant pour le second soutenu par une écriture d’obédience diatonique). Vu le contexte de revendication circonstanciée, la conduite schönbergienne des voix est traitée de manière saisissante, versant de concert dans les expressions complémentaires de la supplication contrite, du « lyrisme religieux [150] » (bel canto) et du pathos dramatique de l’extra-vocalité (parlé, quasi crié). De plus, au travers de cette dernière pièce achevée par le maître autrichien (décédé en 1951), la tentative de fusion des voix parlées et chantées (et ce, dès le début de la partition) fait terriblement songer au comportement du chœur du « Buisson ardent » placé dans le premier acte de Moïse et Aaron (1923-1937). De source biblique, cet opéra inachevé a été considéré par Theodor W. Adorno comme étant une œuvre « sacrée [151] » affirmant « par elle-même le caractère obligatoire de son contenu, par-delà toute nostalgie et toute expression subjective [152] ».
Dans la partition du musicien estonien (ex. 8), le chant de la basse profonde (qui intervient dès la première mesure, serti par de douces sonorités instrumentales, pianissimo) se cantonne au minimalisme d’un fragment de mode de la transposé sur mi. Jouant sur la lente répétition de brefs motifs conjoints (ascendants ou descendants), De profundis d’Arvo Pärt est en effet éclairé par un contrechant discret à l’orgue (joué par la main droite). À l’inverse de la pièce vocale schönbergienne qui possède somme toute un « caractère menaçant et démoniaque [153] », le discours musical pärtien laisse résonner (en un long crescendo continu sur toute la pièce) quelques espoirs de claire sérénité à venir : la coda se termine sans la partie grave du pédalier de l’orgue alors que l’ensemble des autres voix campe dans un registre aigu.

Ex. 8. Premières mesures dans le grave du De profundis de Arvo Pärt (Wien, Universal Edition n° 17410, © 1981, p. 2)
« La Relation relie (relaie), relate [154] », synthétise Édouard Glissant. À l’instar du verbe religare signifiant « relier » la noirceur de l’ici-bas aux lueurs des astres paradisiaques (et donnant in fine le terme de « religion [155] »), examinons aussi quelques exemples pour lesquels l’idée d’agent de liaison de la « psychologie de la verticalité [156] » a été interprétée de façon différente par les compositeurs. D’une part, relevons la pièce pour accordéon intitulée Des ténèbres à la lumière (1995) d’Edison Denisov qui est réellement spécifique de cette volonté d’élévation et de cette thématique luminescente d’une quête de pureté. Citons également du même compositeur le Requiem (1980) au travers duquel cinq courts poèmes de Francisco Tanzer ont aidé à charpenter la partition symboliquement raccordée par une chaîne allant de la lumière de la vie à l’illumination de la mort [157]. D’autre part, rappelant les sonorités de la sombre incertitude de la nuit, Nyx (1984) pour orgue de Dominique Lemaître est charpenté en six sections enchaînées dans une sorte de crescendo allusif global (allégorie dynamique visant le chemin rectiligne qui va de l’obscurité à la lumière [158]). En résonance : « Ô nuit ! plus que le chemin frappé de crépuscules, seule [159] », chantait pour sa part Édouard Glissant.
Comme le couple tension / détente gouverne la majorité de la conduite de la musique occidentale savante, l’association des adjectifs clair / obscur (op. cit.) reste un trait récurrent de l’imaginaire des musiciens ou des livrets suggérés, visités ou rédigés par les compositeurs [160]. Écrit pour chœur mixte, le De profundis – Psaume 129 (1997) de Brice Pauset est par exemple de cet acabit. En effet, dans ce triptyque a cappella, l’artiste a tenu à ménager une courbe ascensionnelle partant des obscures profondeurs pour accéder in fine à la lumière. Il a animé ainsi la partition en partant d’un contrepoint sombre destiné aux basses pour arriver sur un Alleluia flamboyant, géré par les sopranos. Formé de trois sections, l’ensemble débute par une « déploration » liminaire grave (De profundis) alors que dans un deuxième temps un crescendo traduit l’inquiétude du pécheur face à la justice divine (Si iniquátes). La tension agogique générale aboutira fatalement à un « cri d’effroi » (quis sustinebit ?). Enfin, cette longue pièce vocale (durant plus d’un quart d’heure) se termine par une « psalmodie » apaisée (sparávit ánima mea) prenant les atours métaphoriques d’une « berceuse », comme indiqué sur la partition [161].
Réalités suprêmes, irréalités extrêmes
« L’espace intérieur est aussi infini à explorer
que les espaces terrestres. »
Édouard Glissant, Poétique de la Relation
À l’opposé d’une vision à connotation officiellement figuraliste, Fausto Romitelli a tenté d’arpenter l’infini de l’abstraction au travers d’un opéra-vidéo (An Index of Metals – 2003 – son dernier opus achevé). Dans le sillage d’une quête de profondeur inhérente à tout shooter post-hippie, il s’est mis dans l’esprit, pour « composer visuellement le son » et « filmer acoustiquement l’image [162] », de provoquer l’entente cordiale de la « Techno » et de la « Tekhnê [163] ». Gouverné néanmoins par la raison poétique, la pensée pragmatique (efficacité de l’audition intérieure, soin dans l’écriture, refus de l’indéterminisme et de l’improvisation) et la nécessité esthétique (immanence gestuelle de la dramaturgie sonore : tension / détente, hiatus / continuum, son pur / bruit modulé, intervalles non tempérés / registres hyper distendus…), le souci permanent de l’extravagans de Romitelli [164] a fait voler en éclats les divers codes de surface, mêlant les salissures de la musique pop aux dissonances de l’avant-garde européenne tout en cristallisant les trainées de larsens comme des fragments de turbulences fatales. Aussi, dans ces circonstances, « l’accident, qui est le bonheur du poétique, est-il apprivoisable par les circuits [165] ? », demandait à sa manière Édouard Glissant.
Désireux de s’écarter des conventions langagières du sens commun pour se laisser officieusement consumer à petits feux dans le tréfonds d’une noirceur hybride, le compositeur italien a voulu aussi privilégier les plis endogènes de l’introversion créatrice [166], les déplis hallucinogènes de la conscience [167] et les replis hétérogènes de la parasitose sonore. Au cœur de la fabrique du projet multimédia, « grain, épaisseur, porosité, brillance, densité, élasticité » ont alors façonné les caractéristiques principales de ces « sculptures de sons [168] » obtenues par l’amplification, les traitements électroacoustiques mais aussi l’écriture purement instrumentale ». Ici, les techniques du figuralisme ne sont pas franchement de mise. Stéphane Mallarmé regrettait du reste que « le discours défaille à exprimer les objets par des touches y répondant en coloris ou en allure [169] ». L’intention poétique de Fausto Romitelli ne se substituant à rien de concret, sa musique est devenue avant tout « création à l’état sauvage, sans commentaire ni réplique » – pour prendre une expression de Clément Rosset : « Cela pour une simple raison : la musique n’imite pas, et puise sa réalisation dans sa seule production, tel l’ens realissimum – réalité suprême – par lequel les métaphysiciens caractérisent l’essence, d’être à toute chose modèle possible de n’être elle-même modelée sur rien [170]. »
Diffusant à tout rompre des rythmes irrationnels, incrustant dans le détail moult micro-intervalles, sculptant tout un chapelet de sons hybrides, galbant à loisir bon nombre de glissandi dramatiques (effectifs ou virtuels), les partitions de cet élève de Franco Donatoni ont montré autant de rais d’ombres et de lumières [171] qui se tressent en de fabuleuses architectures instables [172], élevées à la gloire des dieux déchus et des âmes damnées [173]. Sollicitant en abondance l’affectation de tous les vecteurs de la sensibilité, l’idée globalisante d’une surexposition à la fois sensitive, expressive et onirique a alors cristallisé un faisceau d’anamorphoses sans précédent ; une gerbe dont l’écume serait irisée par une constellation rétractée au sein d’une « hétérotopie » dramatique (juxtaposant – selon Michel Foucault – « en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements en eux-mêmes incompatibles, et supposant un système d’ouverture et de fermeture qui les isole et les rend pénétrables [174] »).
Créé avec un contexte de vidéos (dues à Magali Lara), Un posible Dia (2010-2011) de Javier Torres Maldonado a exhorté un ressentiment d’angoisses fatalement assumées grâce à un décor uniformément tapissé par le monochrome d’une obscurité totale. Fondée sur des textes d’Ana Candida de Carvalho Carneiro et de José Manuel Recillas, l’œuvre pour soprano, récitant, ensemble instrumental et électronique a ainsi louvoyé entre théâtre imaginaire et musique irréelle. Gaston Bachelard pensait par ailleurs qu’« un être privé de la fonction de l’irréel est un névrosé aussi bien que l’être de la fonction du réel [175] ». Présentée comme un quasi « radio-drame », l’œuvre épique maldonadienne se déroule en fait dans les profondeurs lugubres de l’océan, « fissure abyssale » qui couve dans le ventre de l’anima féminine un « monde insaisissable [176] ». Découpée en quatorze mouvements, la pièce débute par un prologue instrumental baptisé « Maelstrom ». S’en suivent des séries facilement repérables du type « Introspection I », « Introspection II » ou « Abîme I », « Abîme II », « Abîme III ». Pour ne prendre qu’un seul exemple parmi les nombreuses pistes « multi-directionnelles » voulues par le compositeur mexicain, « Abîme I » décrit parfaitement les tenants d’une nébulosité absolue, « sombre comme la mort » ou « sombre comme les fentes de l’âme »… Dans ce cadre, ravagé par les ombres glauques du milieu aquatique, l’univers mixte de Maldonado a tenté d’élever à un niveau expressif les sillages tentaculaires d’une représentation passablement virtuelle, celle émanant d’une mémoire ontogénétique ou celle survenue d’un conte fantasmagorique.
Songes de chute, chimères de vertige
« Chaque poète nous doit donc son invitation au voyage. »
Gaston Bachelard, L’Air et les Songes
Le descensus ad inferos anime bon nombre de mythes. Car, « naturellement, il y a un voyage vers le bas ; la chute, avant même l’intervention de toute métaphore morale, est une réalité psychique de toutes les heures [177] ». La symbolique de l’effondrement dans le vide [178], de l’avalanche, de la cascade [179] ou l’allégorie de la dégringolade vers des régions « inférieures » (ce que Rainer Maria Rilke nomme poétiquement « l’obscurité des chutes infinies [180] ») sont ainsi en phase avec la visitation des niches infernales de la psyché, ce mouvement de descente constituant un aspect essentiel du processus initiatique des évolutions compositionnelles, des voyages épiques, voire des cultes secrets et des rites mystagogiques (le regressus ad uterum des héros aventuriers, la traversée d’une vagina denta, la descente périlleuse dans une grotte ou une caverne…). « Oui, la société forme séquence, est formée de structures d’ordre, asymétriques, irréversibles, elle prépare ainsi le sens de l’histoire, qui va vers le puits le plus attractif. Bas [181] », conte Michel Serres.
Partant de ces effets, citons quelques exemples : charpenté en trois mouvements entourés de courts interludes, Vortex Temporum (1994-1996) de Gérard Grisey est écrit pour flûte, clarinette, piano, violon, alto et violoncelle. L’idée générale du vortex placée dans le titre induit autant des formules d’arpèges qui tournoient en spirales que des alternances contrastées de divers objets sonores (silencieux, bruiteux ou musicaux – « Le silence fait de ce bruit un son [182] », murmurait Glissant). Accusant l’agogique d’un temps dilaté, le deuxième mouvement de ce sextuor tente de gérer l’idée d’une aspiration dans le tourbillon du temps. « J’ai cherché à créer dans la lenteur une sensation de mouvement sphérique et vertigineux. Les mouvements ascendants des spectres, l’emboîtement des fondamentaux en descentes chromatiques et les filtrages continus du piano génèrent une sorte de double rotation, un mouvement hélicoïdal et continu qui s’enroule sur lui-même [183] », a notifié le compositeur. « Cette force du monde ne dirige pas de ligne de force, elle en révèle à l’infini. Comme un paysage, qu’on ne saurait arrêter. Elle nous contraint de l’imaginer, même alors que nous restons là neutres et inertes [184] », expliquait Édouard Glissant.
D’une manière concrète, la considération du modèle spiralé semble la plupart du temps imposer une circularité spatio-temporelle presque toujours bidimensionnelle. Car, en fait, une fois habitée (tant par les éléments de la réalité que par les sujets du mythe), la spirale se présente tel un agent double en puissance : accentuant tantôt le profil longiligne de l’espace, accusant tantôt la résonance de profondeur du temps. Ainsi, à l’instar du labyrinthe légendaire qui ne possède aucune issue de secours, l’appareil spiralé devient « le symétrique du sablier [185] » : l’un figurant du temps dans l’espace ; l’autre, de l’espace dans le temps. À la même époque que celle de l’écriture de Vortex Temporum, repérons aussi la construction de Spira manes (1994-1995) autour d’un centre tourbillonnaire descendant. Sous-titrée « la spirale des âmes défuntes », cette pièce de Florence Baschet est écrite pour sept voix, sept instruments et dispositif électronique. Accusant une certaine redondance chère au concept de répétition défendu par Édouard Glissant [186], le schéma structurel de l’œuvre montre à chaque point de ses révolutions des lignes de fuite tombantes. [187] « Aussi bien la répétition est-elle, ici et là, un mode avoué de la connaissance. Reprendre sans répit ce que depuis toujours vous avez dit. Consentir à l’élan infinitésimal, à l’ajout, inaperçu peut-être, qui dans votre savoir s’obstinent [188] », synthétisait à sa manière le poète de la Relation.
Congruente au concept de gravité, cette idée globalisante de la chute dynamique se rencontre également au travers des sons paradoxaux de Computer Suite from Little Boy (1968) composée par Jean-Claude Risset (intitulé « Fall », le deuxième mouvement – au demeurant de courte durée – se réfère au largage symbolique de la bombe d’Hiroshima). Par ailleurs, faisant peu ou prou référence à Down to a sunless sea (1970) pour orchestre de chambre, Euclidian Abyss (1996) de Hugues Dufourt explore l’archétype immémorial de la chute et de la spirale [189]. En effet, dans cet octuor, « les images de l’abîme sont multiples : malaise, dérobade, trébuchement, enfoncement, effroi, vertige, terreur ». Le compositeur a avoué que « la forme musicale est celle d’une spire, d’une circonvolution en hélice. Expansions et contractions, enroulements et déroulements rythment l’œuvre et lui confèrent son articulation paradoxale [190] ». Symptomatique à souhait, le milieu de la pièce met en branle un espace tourbillonnaire [191] proche des idées énoncées par Gaston Bachelard dans L’Air et les songes : « Puisqu’il s’agit d’un voyage dans les profondeurs, puisqu’il s’agit de provoquer une rêverie de chute, il faut partir des impressions de vertige [192] », notait le philosophe de psychanalyse générale. Un autre exemple parmi cent : se référant à un vers de Pierre Corneille extrait de Mithridate (« Dans quel abîme affreux vous me précipitez »), l’ultime fin de l’Agrexandrin VIII d’Alain Louvier montre, dans ce contexte de hâte et de chute dans un précipice, un inévitable trait en triple croches descendant dans l’extrême grave du clavier (ex. 9).

Ex. 9. Les dernières mesures se précipitant dans le grave du piano extraites de l’Agrexandrin VIII (livre 2) d’Alain Louvier (Paris, Leduc, © 1994, p. 24)
Les songes en creux et les rêves en vase clos (compromettant les « voyages [193] » intérieurs rappelant parfois l’accession aux « nouveaux royaumes de la conscience [194] » des musiciens pop dans les Sixties) et les interprétations manifestement réalisées en toute conscience sont donc à double entrée. Alors, aimantés par des forces invisibles vers un réseau gérant une collection de sondes sourdes, l’auteur comme l’auditeur tentent, à des titres divers, de vivre ces différentes œuvres dans un état second, comme auréolés de vertige, ceints de nausée, irrités de vigueur et baignés de torpeur. « Tu nous gagnes, tu cultives nos profondeurs / Où le jour ne va pas, tu pénètres sans heurts [195] », analysait à sa manière le poète Supervielle. Ainsi, les œuvres de Romitelli, Baschet, Dufourt, Risset… incarnent la notion nietzschéenne de la métaphore « étrange [196] » (du latin metaphora qui signifie précisément « transport »). En ce sens, il n’est pas incongru qu’elles s’exposent et exhalent en sons inouïs et en couleurs inédites, en sautes d’humeur sporadiques et même en échos parfois hurlés spontanément. Comme l’a remarqué Paul Valéry en 1935, « l’opération de l’artiste consiste à tenter d’enfermer un infini. Un infini potentiel dans un fini actuel [197] ».
Fiefs d’ombres, reliefs de décombres
« Ô, ombres vaines,
autrement que pour la vue ! »
« Purgatoire », La Divine Comédie
Au cœur de l’introversion et de la profondeur d’âme, le rapport à l’ombre reste à bien des égards primordial, cette imago mentalis désignant l’icône même des choses fugitives, la gouvernante des visions irréelles comme la magicienne des rêves profondément enfouis. Devons-nous alors évoquer la phénoménologie du sonore en tant que Schattenhaft, c’est-à-dire ce qui émane « de la nature de l’ombre » ? Inscrit judicieusement en exergue du « Scherzo » de la Septième Symphonie (1904-1905) et aussi dans la Neuvième Symphonie (1909) de Gustav Mahler, ce terme allemand – quasi intraduisible en français – indique l’existence d’une aura de rayonnement centrifuge complétant un espace musical centripète. Dès lors, dans la Septième Symphonie, l’expression dynamique veut présider à la danse ternaire d’esprits fantastiquement maléfiques : au niveau de l’instrumentation, le mouvement indécis mais tournoyant accuse la raucité de timbres inouïs, tout en montrant une débauche de sonorités plutôt sales. Ici, les distorsions musicales au niveau rythmique (troisième temps accentué par la gravité de la timbale...) ou timbrique (col legno quintuple forte des contrebasses, cors bouchés...) modèlent les grimaces expressionnistes des gnomes pressentis. À noter que quelques générations plus tard, Gérard Grisey parlera encore de « l’ombre des sons » qui nourrit un des processus de sa pièce pour orgue électrique et ensemble : Sortie vers la lumière du jour (1978).
Loin de la laideur considérée comme nouvelle forme d’esthétique et des bruits métaphoriquement dépeints par certains avant-gardistes (par exemple dans certaines œuvres radicales d’Helmut Lachenmann qui n’ont pas manqué de faire scandale [198]…), Yoshihisa Taïra a milité pour que cette image poétique de l’assombrissement confus renvoie à l’atmosphère d’une méditation recueillie, d’une profondeur intime, là où stagnent des ombres diversement grisées, produites par un entrecroisement de faisceaux plus ou moins luminescents. Ce compositeur japonais a précisément débuté en 1981 un cycle intitulé Pénombres considéré comme une suite de songes ponctués d’événements inattendus, rehaussés de couleurs contrastées (très sombres mais aussi parfois très vives), rappelant la perception à la conscience, dans les creux de l’espace intérieur, de paysages musicaux imaginaires. Transposant ainsi les déclinaisons de l’obscurcissement [199] en phénomènes audibles, le musicien a tenu à intégrer à son propre univers acoustique des impressions visuelles à l’équilibre paradoxalement statique (rappelant peut-être, de près ou de loin, la célèbre donnée d’« explosante-fixe » inventée par André Breton).
Le sentiment de la « trace » avancé par Édouard Glissant [200] ne doit pas être mis à l’écart, il peut très bien aider à la construction d’une « sémiotique de la mémoire [201] ». À l’aune de la rêverie barbare ou du cauchemar mélancolique, de l’oraison profane ou de la prière œcuménique, la profondeur de champ peut également devenir une aire de représentation intime. Dans Théâtre d’ombres (1987-1989), l’électroacousticien François Bayle a corroyé l’ombre des objets musicaux pour qu’elle devienne image, contour, forme, empreinte, trace et même signe. « Marquer l’invisible par les dessins des sons – et leurs ombres portées dans le monde ombré des images mentales – c’est raconter autrement une histoire » – nous a-t-il expliqué [202]. La fiction a alors mis en scène des sonorités qui sont organisées de manière à jouer dans une sorte de « cinéma pour l’oreille ». En l’occurrence, elle propose douze scènes enchaînées où des « personnages-sons » se retrouvent en butte avec des décors spacieux à travers lesquels ils vivent, se déploient, se multiplient ; espaces bénéfiques ou gouffres maléfiques, milieux résistants ou cavités hostiles, reliefs hérissés et abrupts, ou au contraire sculptures harmonieuses et lisses, passages élémentaires répétitifs et modelés extérieurs non contondants. « La victoire consistera pour le héros-auditeur à passer « derrière l’image » pour atteindre la région des « ombres blanches », c’est-à-dire ce lieu de sérénité où devient transparente l’ombre humaine. Appelons silence cette transparence [203]… »
Enfin, maître d’un catalogue pourtant ouvertement non religieux, Iannis Xenakis – auteur entre autres de Nuits (1967-1968) – a invoqué à sa manière le royaume sonore des disparus en composant Aïs (1980) pour baryton, percussion et grand orchestre. Se référant ouvertement à l’Hadès des morts, l’œuvre est conçue pour résonner avec de lourdes et profondes accentuations dissymétriques. Néanmoins, dédiée à la divinité légendaire des enfers, la pièce semble ménager des échos provenant plus d’un culte imaginaire d’accompagnement profane que d’un rituel foncièrement spirituel. Certes, dans Nekuïa (1981) écrit pour chœur mixte et orchestre, le compositeur architecte a désiré établir l’ordonnancement de sa partition en relation avec celui d’une cérémonie funéraire ; le titre grec signifiant entre autre : « rite magique où les ombres des morts sont invoquées et questionnées sur l’avenir ». Symboliquement, à l’heure du décès, proche de la tombe, l’ombre doit par principe endosser l’habit du messager. L’âme s’élevant hors de la pesanteur terrestre, c’est à la condition du relais virtuel que l’ombre maintient alors le réseau de relations avec les vivants. Dessiné sur un papyrus de Néferoubenef [204], vers 1400 avant Jésus-Christ, l’amateur peut ainsi contempler l’âme et l’ombre sortant de concert du fondement d’un tombeau [205], non loin du regard contrastant d’un plein soleil complice.
De Pierre Boulez à Walter Zimmermann, de Giacinto Scelsi à Mauricio Kagel, de Roger Tessier à Brian Ferneyhough, de François Bayle à Hugues Dufourt, de Henri Dutilleux à André Boucourechliev, de Peter Eötvös à François Nicolas, de Helmut Lachenmann à Pascal Dusapin, de Maurice Ohana à François-Bernard Mâche, de Bret Dean à Ana-Maria Avram, de Thierry Escaich à Bernard de Vienne… la métaphore de l’ombre a subséquemment servi de médium sensible à une kyrielle d’esthétiques musicales foncièrement différentes, bien qu’au sein de l’imaginaire collectif artistique, elles se soient toutes vouées à ce phénomène initialement visuel et troublant de la profondeur sépulcrale ou du dédoublement fictif, du confident naturel ou du messager spirituel [206].
La poétique rêvée d’une Musique-Monde
« L’imaginaire n’est pas le songe,
ni l’évidé de l’illusion. »
Édouard Glissant, Traité du Tout-monde
Sous prétexte d’entraîner la recherche dans le déchiffrement des partitions, la musicographie a le pouvoir de tenter d’apporter la preuve d’une intention poétique. Dans le sens d’une étude portant sur « la poétique des profondeurs », nous avons vu que la plupart du temps, les compositeurs faisaient appel au « langage-en-soi » et aux bonnes vieilles recettes attachées au figuralisme primaire, illustrant sporadiquement le propos basique de sonorités imagées, littérales, symboliques, parfois (hyper-)mnésiques. Certes, l’impulsion qui stimule le glissement de l’allégorique au figuratif peut sans doute être confondue avec le courant qui innerve cette « poétique » imaginative émanant de l’auteur, de l’émetteur et du récepteur (le faiseur et le jouisseur). Dans cet univers de la métaphore plus ou moins filée, chacun s’engouffre ou creuse à loisir sa propre profondeur (le paradis de l’un étant l’enfer de l’autre, et réciproquement).
Ainsi, toute traduction musicale d’un énoncé iconique ou discursif peut se fonder sur l’orientation figurée et la dimension métaphorique des matériaux en présence. Dans certains cas, si l’imaginaire se veut « non projetant [207] », la perspective d’une spatialité projective peut tout de même être entrevue : ainsi, « dans l’image et dans le représenté quelque chose doit se retrouver identiquement, pour que l’une soit proprement l’image de l’autre ». Plus loin, Ludwig Wittgenstein complète : « Mais sa forme de représentation, l’image ne peut la représenter ; elle la montre [208]. » En d’autres termes, Paul Valéry écrit encore : « Le souvenir ne devient pas intelligible immédiatement. Sa matière le précède [209]. » Dans notre étude, bien qu’autonome et libre de ses affects, la musique a été considérée comme le corrélat poétique de la représentation de la profondeur (des profondeurs), même si, bien entendu, elle possède la capacité de transporter « l’universel avant le sens [210] ». Jouant sur le pré-texte [211] (l’exemple du psaume 130 lors d’un De profundis chanté) ou sur le prétexte (le cas du De profundis instrumental, foncièrement sans parole), le passage de l’entendement au second degré peut dans ces cas rendre la transtexualité [212] plus ou moins équivoque.
À l’horizon de ce périmètre de réciprocité et d’extension, songeons aussi au Darstellarkeit consigné cette fois par Sigmund Freud au cœur de son Complément métaphysique à la théorie du rêve [213]. Dans cet essai, le médecin psychanalyste n’a-t-il pas relaté en substance qu’il est toujours possible de convertir un texte abstrait par un autre plus imagé ? – élément métaphorique de substitution qui semble néanmoins lié au premier d’une façon ou d’une autre, par le truchement de la métonymie, l’hypallage, l’allusion directe, la symbolisation, l’allégorie, l’opposition… Dans ce cadre d’envergure quasi philosophique, et grâce aux visions proligères et prophétiques des écrits d’Édouard Glissant, la musicologie peut assurément concevoir un vivier conceptuel intéressant à ausculter. Entraînant dans son sillon les problématiques méta-poétiques de l’obscur et de l’enfer, de l’enfermement et de l’introversion, de la chute et de l’infini, du vertige et de l’ombre… la présente prospection « en archipel » nous a ainsi conduit au cœur de l’Urgrund et même jusqu’aux affres de la Mort [214].
Dès lors, il était pleinement légitime de chercher des éléments symboliques provenant d’une raison universelle et transculturelle comme il semblait tout aussi évident de pouvoir évoquer – partant d’un examen portant sur l’idée de profondeur en musique et d’une manière corollaire et somme toute complémentaire [215] – les diverses références métaphoriques liées aux multiples images étincelantes de la sphère paradisiaque (à ce titre, Friedrich Nietzsche ne disait-il pas que « la profondeur est en haut [216] » ?). Dans ce sens qui induit la coincidentia oppositorum des anciens [217], « le blanc comme le noir est associé à la mort […] Au cours de sa traversée de l’Asie centrale, Marco Polo nota que, dans une province de l’Inde, le noir avait la faveur et que l’on réservait au diable le blanc – tandis que les Tartares, de leur côté, n’aimaient rien mieux que le blanc [218]. » En outre, au travers de tous ces exemples variés – certes non exhaustifs – insinuant finalement que les extrêmes sont interchangeables ou que les seuils sont transitionnels [219], la part philosophique ou métaphysique de « la poétique des profondeurs » nous a encore montré [220] qu’elle pouvait porter aux nues les valeurs héraldiques d’une volonté atavique de transmission, la Relation étant selon le poète caribéen « passage, non spatial d’abord, qui se donne pour passage et confronte l’imaginaire [221]. »
À chaque visitation opportune, à chaque lecture propice, la sapience de la Relation glissantienne peut de facto dévoiler une prégnance à l’onirisme voluptueux en même temps qu’elle dégage et diffuse une fulgurance des tropismes, à analyser peu ou prou. « L’analyse nous aide à mieux imaginer ; l’imaginaire, à mieux saisir les éléments (non premiers) de notre totalité [222] », a révélé le romancier. À partir de ces éléments, sur le tronc commun de l’expression poétique regorgeant à foison de cette « esthétique du bouleversement et de l’intrusion », les textures chaotiques ou les tapis hiératiques de la musique moderne et postmoderne du second après-guerre [223] peuvent sans doute s’observer naturellement au travers du prisme principiel légué par la pensée d’Édouard Glissant : « L’étendue se trame. Bond et variance, dans une autre poétique. Transversalité. Infini quantifiable. Quantité qu’on ne réalise. Emmêlement qu’on n’épuise. L’étendue n’est pas que d’espace, elle est aussi se son propre temps rêvé [224]. »
Dans ce cadre en perpétuelle turgescence, il nous reste encore à « rêver le monde [225] », à disserter sur les universaux [226] de la « poétique de l’extension », la « poétique de la structure », la « poétique de la durée et de l’instant »… autant de pistes attachantes suggérées par Édouard Glissant qui, à l’évidence, appelleront à une nouvelle vision d’une « Musique-Monde [227] » (et non d’une soit disant World music au teint passablement galvaudeux [228]). Auteur d’un morceau intitulé « Le cheminement à travers les mondes » – troisième partie de À l’approche du feu méditant [229] (1983) –, Jean-Claude Eloy a expliqué, en compositeur nomade, que « la véritable « ligne de résistance », le véritable combat, à l’échelle mondiale, aujourd’hui, est celui qui sépare d’un côté toutes les musiques non standardisées, quelles que soient leurs origines (contemporaines ou traditionnelles), et de l’autre, l’immense tissu des musiques commerciales standardisées, omniprésentes dans les consciences, et qui recouvrent désormais la totalité de la planète [230]. » Une nouvelle fois, à la croisée de la recherche et de la méditation, Édouard Glissant a tracé l’empreinte de la prospection fondamentale : ainsi « il convient de s’accorder à ce qui du monde s’est diffusé en archipel précisément, ces sortes d’étendues, qui pourtant rallient des rives et marient des horizons [231]. »