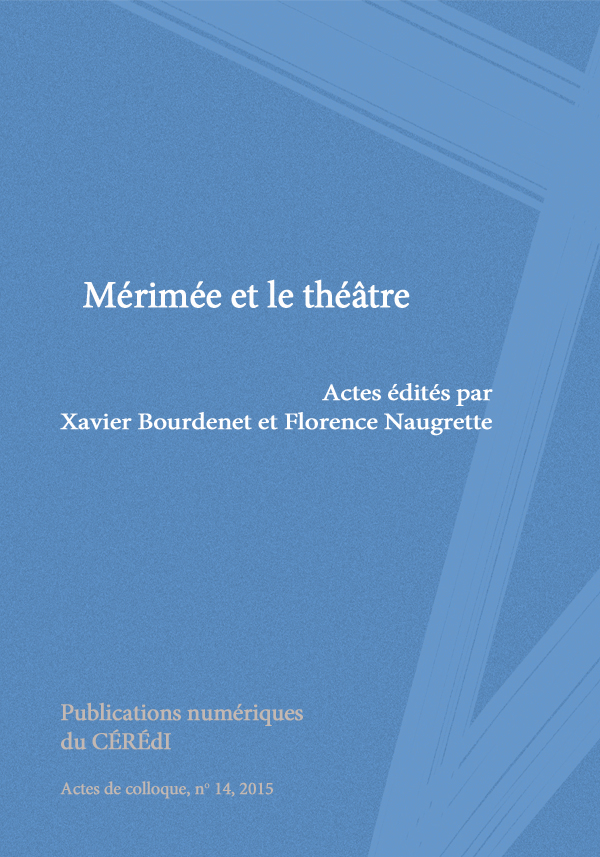Lorsque La Jaquerie est publiée en 1828 [1], la page de couverture indique comme mention générique « scènes féodales » ; il est aisé, derrière cette mention, de percevoir celle de « scènes historiques » que Ludovic Vitet plaçait en tête de son propre ouvrage : Les Barricades [2], ouvrage publié seulement deux ans avant celui de Mérimée. On peut dès lors penser que la déclaration liminaire de Vitet vaudrait pour Mérimée : « Ce n’est point une pièce de théâtre qu’on va lire, ce sont des faits historiques présentés sous la forme dramatique, mais sans la prétention d’en composer un drame [3] » ; Mérimée, lui-même ne se prononce pas quant au genre de son œuvre, dans la courte préface de La Jaquerie. C’est dire que la « scène historique » n’est pas du théâtre, mais s’écrit cependant par rapport à lui, puisque, pour la définir, on est contraint d’avoir recours au genre dramatique. Situation dont on perçoit immédiatement l’ambiguïté. Ambiguïté décuplée, lorsque l’on constate qu’il faut probablement chercher l’origine de ce genre chez Shakespeare, homme de théâtre s’il en est. En effet, Vitet cite, pour lui rendre hommage comme devancier, le président Hénault ; ce dernier, en 1747 avait publié un François II, roi de France, en cinq actes [4]. Le président, dans la préface à son propre ouvrage, explique : « Le théâtre anglais de Shakespeare m’a donné l’idée de cet ouvrage. » La lecture de La Tragédie de Henri VI, lui apporte une connaissance assez complète de la fameuse guerre des Deux Roses et « tout à coup – poursuit-il – oubliant que je lisais une tragédie, et Shakespeare lui-même aidant à mon erreur par l’extrême différence qu’il y a de sa pièce à une tragédie, je me suis cru avec un historien, et je me suis dit : Pourquoi notre histoire n’est-elle pas écrite ainsi ? Et comment cette pensée n’est-elle venue à personne ? » Ainsi les scènes historiques reconnaîtraient Shakespeare comme père fondateur, mais en tant que ses tragédies historiques n’en sont pas [5].
Entreprendre l’étude de La Jaquerie peut se faire, comme le souligne Roger Bellet [6], sur un plan historique ou sur un plan esthétique. Nous ferons choix du deuxième terme de cette alternative, selon l’objectif suivant : mettre au jour la relation que Mérimée continue d’avoir avec la dramaturgie – lui qui, dans le même temps, écrit pour le théâtre – et plus particulièrement en ce qui concerne le jeu sur et avec l’espace. L’objectif qui guidera notre réflexion sera donc d’évaluer ce qu’il reste d’écriture purement dramaturgique dans ces scènes historiques et dans quelle mesure l’imaginaire scénique continue à se manifester malgré le refus de la représentation.
L’unité adoptée par Mérimée comme par Vitet pour organiser leurs œuvres est la scène – 36 pour La Jaquerie, 15 pour Les Barricades – alors que « tableau » aurait été plus en situation. Bien que ce terme – la scène – appartienne en propre au vocabulaire théâtral, on admettra volontiers que cet « emprunt » n’est pas bien significatif. En revanche, on ne peut qu’être intrigué par une didascalie indiquant que des gendarmes d’Apremont prennent la parole « derrière la scène » (p. 42 [7]). Cette fois, on ne peut plus penser à un emploi qui désignerait de façon commode une division du texte : il s’agit bien de se référer à la réalité spatiale que suppose la représentation. Mentionner « derrière la scène » implique un point de vue, celui d’un spectateur qui a devant lui un espace de jeu et qui perçoit auditivement le discours de personnages qui lui sont cachés par un élément de décor (on retrouvera ce cas de figure à la toute fin de l’œuvre : « Hommes d’armes derrière la scène », p. 230). Cette fois la réalité théâtrale est bien présente, on n’en peut douter. Dans cette même quatrième scène, on pourra lire en fin de prélude didascalique : « Sur le devant, assis à la même table », suit la liste des personnages qui vont avoir la majeure partie du dialogue. Comme précédemment, la spatialisation indiquée par l’adverbe substantivé « le devant », ne laisse pas de doute sur le domaine de référence que suppose cette localisation ; en revanche, une indication comme « un grand chêne au milieu » d’une clairière (p. 108) offre moins de prise à une lecture strictement théâtrale ; en effet, la précision concernant l’arbre est relative à un élément de l’espace fictif, la clairière, alors que celle qui concerne la table de la place de village est relative à l’espace dramatique, c’est-à-dire celui qui se fonde sur une relation entre spectacle et spectateurs. Or cette relation suppose un placement de l’un par rapport à l’autre. Face aux deux mentions citées plus haut (« derrière la scène » et « Sur le devant »), il est clair que Mérimée travaille sur un rapport frontal des deux entités, semblable à celui qui prévaut dans le théâtre à l’italienne ; toutefois, en l’absence de mentions qui préciseraient la coulisse droite ou gauche (cour ou jardin), on ne peut aller jusqu’à affirmer que c’est ce type d’espace qui prévaut absolument.
On pourra encore relever dans le prélude didascalique de la scène deuxième cette notation : « Sur le devant de la scène » (p. 10) avec le nom des personnages qui vont parler : Frère Ignace, F. Goderan, F. Sulpice. Il s’agit de représenter une « salle gothique dans l’abbaye de Saint-Leufroy » dans laquelle va avoir lieu l’élection du nouveau Supérieur. À quoi visent ces précisions spatiales ? À disposer au premier plan les personnages qui auront du texte : il importe donc que les spectateurs les voient et les entendent bien. On apprend également que la scène est occupée par le « Chapitre des moines assemblés », ce qui suppose la présence de figurants qui n’auront pas de texte et qui donc peuvent se situer en retrait. Il est évident que seule une préoccupation liée à la représentation peut opérer une telle hiérarchie entre les personnages. Dans le réel, il importerait peu que ceux qui vont s’exprimer soient situés à une place ou à une autre : on pourrait imaginer que le choix se fasse pour des raisons stratégiques internes (ne pas être entendu des autres, ou au contraire pouvoir l’être). Que les personnages à texte soient en avant-scène et que les figurants soient sur des plans plus éloignés participent évidemment d’un code de la représentation qui, seule, peut justifier ces choix.
L’organisation spatiale semble donc se faire en relation implicite avec un spectateur dont il est possible de percevoir la présence par d’autres biais.
En effet, le didascale Mérimée use à plusieurs moments d’un verbe de perception dont le sujet est un « on » qui en contexte ne peut généralement avoir qu’un référent [8]. Ainsi on relèvera : « On voit dans le fond Siward, Brown et les Anglais, pillant et emmenant les bestiaux. » (p. 39). Il s’agit de la scène 4 déjà évoquée plus haut, une des plus longues de l’œuvre. Mérimée a mis en scène – s’il est permis de s’exprimer ainsi – certains paysans et l’Anglais Brown qui sortent à l’entrée du Sénéchal, Pierre et quelques hommes d’armes, puis ce sera le tour du Frère Jean et enfin d’Isabelle et de Montreuil ; soudain des paysans crient : « Les Anglais ! Les Anglais ! Alarme ! » (p. 39). La scène s’anime avec cette didascalie : « Entre une foule d’hommes, de femmes et d’enfants fuyant de tous les côtés, emmenant leurs bestiaux etc. » (ibid.). Notons au passage que si cette didascalie indique bien l’entrée du groupe, elle ne mentionne pas le sens et l’origine spatiale de cette entrée. Suivra la didascalie citée plus haut : « On voit dans le fond […] ». Là, en revanche, ce nouveau groupe est clairement situé dans l’espace pseudo-scénique : « dans le fond », expression qui, comme dans les exemples déjà cités vise à structurer l’espace en une série de plans parallèles à la ligne qui sépare le spectateur (« on ») du spectacle. On relèvera d’autres occurrences du même type : « On voit un tas d’armes de toute espèce » (p. 128), « on voit des chariots chargés de bagages » (p. 196), « on voit çà et là des morts et des blessés » (p. 224) ; en tous ces cas, il s’agit de composer un espace scénique qui va permettre à l’action qui va suivre de trouver sa pertinence et sa vraisemblance. Ajoutons une variation sur l’expression de la vision avec cet autre exemple : « On aperçoit le château à quelque distance » (p. 121) Il s’agit toujours d’inviter le spectateur à voir ou le lecteur à imaginer, une image qui compose l’arrière-plan de l’espace scénique. Mais le glissement de « voir » à « apercevoir » ajoute une précision sur la qualité de l’image, de sorte qu’on pourrait presque l’interpréter comme une recommandation adressée au décorateur ; certes, le panneau décoratif qui représente le château ne sera pas réellement beaucoup plus loin du spectateur que les autres qui composent le décor, mais le verbe choisi indique un flou, une imprécision de l’image qui devra donner l’illusion de l’éloignement : il revient au peintre-décorateur de savoir marquer la différence entre les couleurs des plans rapprochés et celles de ce lointain.
Le théâtre n’est pas fait que d’images, il est aussi composé de sons ; aussi est-ce sans surprise que l’on trouvera sous la plume de Mérimée des didascalies du même type, mais sollicitant le sens auditif : « On entend dans le lointain le bruit du combat », (p. 150), « On entend sonner les trompettes » (p. 196), « On entend des cris confus » (p. 199). Contrairement aux exemples précédents, le « on » pourrait avoir aussi un référent interne à la fable : les personnages comme les spectateurs entendent le « bruit du combat », les « trompettes », les « cris confus ». On sera sensible à ce que ces notations auditives fonctionnent comme relayant les notations visuelles ; les bruits se manifestent dans des espaces invisibles pour le spectateur et attestent ainsi la réalité de ces faits, de ces événements même si on ne les voit pas. Cette stratégie est bien celle du dramaturge qui veut doter son espace scénique d’un espace invisible ou scénographique qui lui assure vraisemblance et garantit sa force d’illusion. À rebours, une scène visible, même très bruyante, n’aura pas besoin que l’on signale les bruits qui sont à attendre puisqu’on en voit la source ; ainsi, à la scène 18, dans la cour intérieure du couvent, la porte est frappée puis défoncée par Le Loup-Garou, mais les didascalies ne mentionnent aucune invitation adressée au spectateur à « entendre » le son : « Il frappe la porte à coups redoublés », « La porte est frappée violemment et semble près de se briser », « Une planche de la porte est enfoncée » (p. 132).
Les bruits permettent donc de faire vivre un espace invisible qui suppose bien un cadre de scène délimitant exactement ce que l’on peut voir et ce que l’on ne peut pas voir : une fois encore, l’écriture de Mérimée est bien celle d’un dramaturge. Ce jeu sur l’espace invisible est particulièrement sensible dans la scène 14, au point que c’est sur l’espace invisible que s’appuie tout le jeu de la scène, au détriment de ce que l’on voit. Le prélude didascalique indique : « Une autre salle du château d’Apremont. » (p. 104) par référence à l’espace de la scène 13 : « La grande salle du château d’Apremont. » (p. 96). Nous découvrons le Page [du baron d’Apremont] en compagnie de Siward, capitaine anglais prisonnier au château, « auprès de la fenêtre ». Leur conversation s’engage sur ce qu’ils voient depuis cette fenêtre :
LE PAGE […] – Tout cela, jusqu’au clocher là-bas, est à monseigneur.
SIWARD – C’est une belle baronnie, ma foi !
Le spectateur devine aisément ce qu’il ne voit pas : un vaste panorama, avec au loin un village duquel dépasse un clocher ; le jugement de Siward – « c’est une belle baronnie » – n’a pas en contexte qu’une valeur esthétique, mais plutôt une valeur quantitative. Il apprécie la richesse que suppose un tel domaine et rêve d’en être le propriétaire par le biais du mariage qu’il pourrait contracter avec Isabelle. Lorsque celle-ci entre peu de temps après, c’est encore en termes d’espace invisible que se dit la situation :
ISABELLE – Beau sire, vous regardez tristement par la fenêtre ; vous semblez soupirer pour quitter nos vieilles murailles et chevaucher encore dans ce beau pays à la tête de vos gendarmes.
SIWARD – […] je songeais combien il me serait doux de chevaucher par cette plaine, un épervier sur le poing, en compagnie de madame Isabelle.
L’échange porte sur le paysage que les deux personnages peuvent voir comme l’attestent les démonstratifs à valeur d’embrayeur : « ce beau pays », « cette plaine ». Tout le reste de la scène est consacré à la cour quelque peu bouffonne que Siward fait à Isabelle, cour totalement assujettie au désir que Siward a de posséder le territoire qu’il découvre dans l’espace invisible. Ainsi, durant la totalité de cette scène – longue de trois pages et demie dans notre édition de référence – l’ensemble du dialogue entre les personnages n’a de sens que par rapport à l’espace invisible. Rien dans le texte échangé ne fait référence à l’espace visible, à savoir cette « autre salle du château ». La plume de Mérimée, si elle avait été tout à fait libérée des contraintes dramaturgiques propres à la représentation, n’aurait certes pas respecté ces codes d’écriture [9]. Pour le lecteur du XXIe siècle que nous sommes, il est aisé de penser au cinéma, à savoir l’art qui permettrait de réaliser le spectacle qu’est La Jaquerie, affranchie de ces contraintes ; nous n’aurions plus des « scènes historiques » mais un scénario. Dès lors, il serait évident que, durant l’échange entre Siward et le page, puis avec Isabelle, la caméra aurait tout loisir de nous montrer le paysage avec les voix hors champ. L’écriture de Mérimée opère le choix inverse, le paysage hors champ et les personnages présents, ce qui est une écriture typiquement théâtrale, propre à l’époque.
Néanmoins, la conception de l’espace à l’œuvre dans cette scène n’incite pas Mérimée à donner plus de précisions ; ainsi il écrit « la fenêtre », donnant à penser que cette fenêtre serait unique ; ce qui dans un château moyenâgeux ne serait pas inconcevable. De surcroît, il ne la situe pas ; est-elle côté cour ou côté jardin, comme on peut le supposer ; une situation en fond de scène est peu pensable puisqu’alors le paysage nous serait visible, mais les personnages trop éloignés et quasi de dos [10]. Mérimée est donc soucieux de gérer les différentes sortes d’espaces propres à la représentation théâtrale : scénique, scénographique et dramatique, sans pour autant aller dans le détail de la mise en scène souhaitée. On peut le comparer sur ce point à Victor Hugo qui, deux ans après la publication de La Jaquerie, débutera une carrière de dramaturge metteur en scène exigeant et souvent très précis [11].
On peut encore cerner de plus près le parti-pris de Mérimée à l’égard de ce recours à la dramaturgie spatiale, en observant comment il indique certains mouvements ou placements de personnages. Ainsi dès la première scène, le didascale note la nature de l’espace scénique : « Une ravine profonde dans une forêt » puis comment cet espace se peuple de personnages : « Des brigands […] paraissent de tous côtés, descendent dans la ravine, et s’assoient en cercle. » (p. 3) La précision est de mise, confirmant le soin que Mérimée apporte à l’image, mais en revanche ses indications relatives au déplacement des personnages restent indépendantes du cadre scénique traditionnel. En effet, les mentions « de tous côtés », puis « en cercle » fournissent bien des indications scéniques, mais sans avoir recours à un point de vue [12], contrairement à ce qu’il faisait en indiquant « sur le devant de la scène » (p. 10) ou « dans le fond » (p. 39). Ce soin de la composition spatiale peut aller jusqu’à vouloir donner à voir un tableau. C’est, semble-t-il, le choix opéré pour la scène 5 ; « [u]ne chambre de paysan. Renaud, Simon, Jeannette, assis autour d’un lit, sur lequel est une femme morte » (p. 50). La didascalie est brève ; néanmoins, on perçoit aisément l’effet recherché : même si Élisabeth la femme de Simon et sœur de Renaud n’aura pas de texte – et pour cause – elle est au centre de la scène, tant du point de vue de l’espace (cf. « autour d’un lit ») que du point de vue de l’échange centré sur les circonstances de sa mort. La composition est bien celle d’un tableau à effet pathétique et dramatique [13]. On songe à l’esthétique théâtrale prônée par Diderot qui recommande la composition de tableaux touchants donnant à voir avec force et éloquence les douleurs ou les joies attachées au foyer. Cependant, on pourra faire la même remarque que précédemment : Mérimée donne les composantes du tableau sans choisir de ligne de perspective.
Nous évoquions la gestion des mouvements des personnages dans l’ensemble de La Jaquerie et à ce titre, il semble important de relever que la grande majorité des trente-six scènes historiques qui la composent s’achèvent sur la mention « (Ils sortent) », pour être plus précis, trente exactement. La grande fréquence de cette mention appelle l’examen ; en effet elle manifeste, à l’extrême fin de la scène – au sens livresque – que la scène – au sens spatial cette fois – se vide de toute présence. Cette sortie générale se justifie assez aisément en certains cas, voire est commentée par les personnages qui ainsi l’intègrent à la fable. C’est le cas, par exemple, de la scène 3 qui se déroule dans une « salle gothique du château d’Apremont », où Isabelle dit à son père pour achever la scène : « N’oublions pas l’ancienne coutume de souper. Je vois l’aiguière qui nous attend là-bas. » Ce à quoi il répond : « Tu as raison, allons souper. » (p. 24) ; là, il est indéniable que la sortie de tous s’impose. Mais en bien d’autres cas, la plupart à dire vrai, elle n’a rien d’absolument nécessaire sur le plan de la fable.
Examinons, dans un premier temps, les cas de figure où elle n’est pas présente, pour tenter d’en cerner la raison. À la fin de la scène 5, déjà évoquée pour son effet tableau, Renaud resté seul – le texte nous le précise – jure de venger la mort de sa sœur. Ce serment constitue une fin parfaite pour la scène, arrivée à son terme naturel si l’on peut dire ; on aurait pu dès lors admettre que Renaud sorte et pourtant Mérimée ne le mentionne pas. Il est probable que c’est la présence d’un cadavre sur scène, par définition ne pouvant sortir, qui justifie cette omission, j’y reviendrai. La fin de la scène 7 offre une situation intéressante ; nous sommes « dans la cellule de Frère Jean » (p. 60) et Frère Jean est en scène ; il reçoit la visite des paysans qui le veulent pour chef. La scène s’achève par la fameuse didascalie « (Ils sortent ») ; mais s’il est normal que les paysans sortent, leur démarche achevée, cela ne l’est plus pour Frère Jean : il est chez lui. Or, la rédaction de la fin de scène reste ambiguë : les paysans s’apprêtent à sortir, et Morand dit « aux autres, en sortant : Je vous disais bien qu’il savait faire de l’or » (p. 67) et Mérimée rajoute « (Ils sortent) ». Cette sixième personne est gênante ; désigne-t-elle les paysans seulement, ce qu’implique le bon sens ? ou désigne-t-elle aussi Frère Jean, ce qui obéirait au désir de vider la scène de toute personne ? Impossible de trancher, mais à l’évidence le flou de la rédaction tend à prouver l’embarras de Mérimée.
À la fin de la scène 13, dans « La grande salle du château d’Apremont », le baron demande à ce que le sommelier monte quatre bouteilles de vin d’Espagne, rendant impossible ainsi sa sortie et celle de ses hôtes.
À la fin de la vingtième scène, pas de mention rituelle et pourtant, elle aurait pu s’imposer aisément. La scène se situe près du champ de bataille : on y voit Frère Jean donner des ordres. Il dit à Simon ce qu’il doit faire, justifiant ainsi la sortie du paysan et lui-même ajoute « je vais faire avancer les piquiers », ce qui pouvait entraîner la sienne. Mérimée n’en fait rien.
La scène 30 présente une fin encore différente ; dans la cour du château où l’on voit la chapelle, des paysans ont assisté au mariage de Siward et d’Isabelle, Pierre qui se révolte contre cette union est tué par Le Loup-Garou ; seul Frère Jean sort de scène : « (Il entre dans la chapelle). »
Pour la scène 33, seul Siward doit sortir de scène, bien qu’aucune didascalie ne le signale, alors que Bellisle demeure, l’espace scénique représentant « la maison dans laquelle » il est gardé.
Enfin la scène finale – 36e – s’achève sur une déroute générale, alors qu’on peut supposer que le cadavre de Frère Jean reste en scène.
Malgré donc ces quelques exceptions, la règle qui semble s’imposer à la logique dramaturgique de Mérimée est de vider le plateau à la fin de chaque scène. Il semble bien que ce mode d’écriture scénique soit hérité de Shakespeare.
On sait que le dramaturge élisabéthain procède de cette façon ; chaque fin de scène s’achève sur la sortie des personnages. Pour comprendre ce choix, il faut prendre en compte les conditions de représentation de ses œuvres. Grâce à l’abondante critique portant sur ce théâtre et grâce aussi aux représentations actuelles du Globe qui se veulent fidèles aux conditions d’époque, nous savons que l’espace scénique n’était que peu voire pas figuré du tout ; gardons en mémoire que les mentions didascaliques qui identifient ces espaces ne sont pas de Shakespeare. Enfin, et ce n’est pas l’une des moindres conditions de spectacle qui soient à prendre en considération, il n’y avait pas de rideau qui occultait l’espace scénique aux yeux des spectateurs, et donc tout se faisait à vue. Autrement dit, c’est uniquement par le discours des personnages que le spectateur a la possibilité de prendre connaissance de la nature de cet espace et tant que le ou les personnage(s) sont en scène, il reste, par convention, le même. Il faut donc qu’ils en sortent pour que l’espace puisse changer par l’entrée d’autres personnages. On pourrait dire que ce n’est pas tant les personnages qui sortent, dans le théâtre de Shakespeare, que les comédiens qui les jouent. On pourrait même admettre que les comédiens sortent pour attendre sagement d’avoir à revenir, annulant ainsi la convention selon laquelle le personnage a une vie en coulisses où il accomplit des actions dont il aura à nous rendre compte, une fois en scène [14]. Shakespeare joue volontiers, comme les dramaturges de son époque, avec ce seuil entre fable et effet de réel : ainsi, très souvent, dans les dernières répliques, un personnage s’adresse aux spectateurs, jetant ainsi le masque de son personnage [15].
Que Mérimée soit ainsi influencé par la manière shakespearienne [16] n’a rien de bien étonnant et la critique l’a signalé depuis fort longtemps [17]. En revanche, ce qui est plus surprenant, c’est qu’il adopte cette facture dramaturgique, alors qu’il n’a pas, comme Shakespeare, à composer avec la réalité scénique. Shakespeare néglige de donner des détails sur la nature de la composition de son espace parce qu’il ne sera quasi pas figuré, alors que Mérimée précise, même assez brièvement, la nature de l’espace scénique de chaque scène. Shakespeare doit vider le plateau à la fin de chaque scène, en raison de l’absence de décor et de rideau de scène, mais Mérimée n’a pas à subir cette contrainte, puisque son texte n’est pas destiné à la représentation. Il semble donc que ce n’est pas tant par souci esthétique ou technique que Mérimée fasse ce choix de gestion de l’espace, mais peut-être seulement par idéologie. Imiter, tant soit peu Shakespeare, c’est être moderne, c’est refuser de se plier aux règles du théâtre classique qui ont encore la vie dure en ces premières décennies du XIXe siècle.
Une autre façon d’aborder le problème de la dramaturgie spatiale de La Jaquerie est d’observer la succession des espaces, autrement dit d’examiner comment cette succession crée un effet de rythme sur l’ensemble de l’œuvre. Rappelons que l’œuvre comprend 36 scènes ce qui est beaucoup face aux 15 des Barricades de Ludovic Vitet ; c’est donc une œuvre longue, qui, si elle était représentée [18], donnerait lieu à un spectacle-fleuve.
Malgré cette longueur, il est clair que la succession de scènes obéit à une composition. Ludovic Vitet, dans la préface aux Barricades écrit :
Je me suis imaginé que je me promenais dans Paris au mois de mai 1588, pendant l’orageuse journée des Barricades et pendant les jours qui la précédèrent […]. On sent qu’il n’a pu résulter de là qu’une suite de portraits, ou pour parler comme les peintres, d’études, de croquis [19], qui n’ont pas le droit d’aspirer à un autre mérite que celui de la ressemblance [20].
Ce disant, Vitet récuse l’idée de composition, il aurait réalisé quelque chose qu’on pourrait appeler de nos jours, un reportage, fictif certes. Mais il ajoute :
Toutefois, ces scènes ne sont pas détachées les unes des autres ; elles forment un tout ; il y a une action au développement de laquelle elle concourt ; mais cette action n’est là en quelque sorte que pour les faire naître et leur servir de lien.
Position ambiguë donc qui souligne qu’il n’y a pas eu de choix esthétique et dramaturgique quant à la présence et l’ordre des scènes, mais qui reconnaît qu’il y a une action qui se développe, ce qui est une concession à la composition théâtrale. Qu’en est-il à propos de La Jaquerie ? Et plus particulièrement, comment la gestion des espaces contribue-t-elle à, voire permet-elle cette composition ?
Quelques remarques méritent d’être faites sur le nombre et la longueur des scènes. Sur les 36 scènes qui composent l’ensemble, quatre sont particulièrement courtes, deux pages ou moins dans notre édition ; ce sont les scènes 16, 20, 27 et 35. Une seule scène, la 4e, compte 23 pages, ce qui est exceptionnellement long. Toutes les autres vont de 3 à 10 pages. Si l’on admet qu’une succession de scènes courtes a pour effet d’accélérer le rythme de l’œuvre, on peut conclure de ces premières observations qu’une accélération de ce type se produit dans la seconde partie de l’œuvre, partie consacrée aux batailles que se livrent les deux camps opposés, celui des nobles et celui des vilains. L’ensemble de l’œuvre suivrait donc un accelerando général.
Les trois premières de ces « scènes féodales » obéissent à une logique propre au genre théâtral, celle de l’exposition. Barbara T. Cooper a fort bien analysé ce phénomène et je me permettrai de reprendre l’essentiel de ses observations [21]. Mérimée nous fait passer d’une forêt profonde (scène 1) où Le Loup-Garou rencontre ses hommes pour introniser un nouveau membre, au monastère de Saint-Leufroy (scène 2) où les moines élisent leur nouveau supérieur, puis au château d’Apremont (scène 3) où la représentation du baron entouré des siens permet, entre autres éléments d’informations, de préciser le moment historique : « Plût à Dieu que […] nous eussions gagné la bataille ! notre brave roi ne serait pas prisonnier à Londres au moment où nous parlons [22]. » Ainsi les trois espaces scéniques correspondent à trois milieux qui sont les principales composantes de ce qui va devenir la Jacquerie : les marginaux (les brigands), les gens d’Église et les nobles. Pour l’heure, aucun des personnages qui apparaît dans l’un de ces milieux, dans une de ces trois premières scènes, ne passe dans l’un des deux autres : c’est le cloisonnement social qui nous est montré par ce procédé du cloisonnement scénique des espaces. Cependant un motif circule d’une scène à l’autre : le sort de Girart, espion pour le compte du Loup-Garou (scène 1), réfugié au monastère (scène 2) et pris par les hommes du baron (scène 3), astucieuse façon de montrer que ce parallèle de mondes qui s’ignorent recèle un ferment de convergence.
La scène 4, la plus longue de l’œuvre donc, est fort complexe mais doit être appréhendée comme plusieurs saynètes qui se succèdent dans un même espace. Il s’agit de « [l]a place du village d’Apremont » (p. 26) ; contrairement aux espaces précédents (la forêt, le monastère, le château) qui étaient en étroite association avec une société et qui ne pouvait admettre la présence d’un étranger à cette société, celle-ci va se donner à voir comme lieu de rencontre possible, lieu de passage. Nous y verrons tout d’abord des paysans boire et bavarder avec Brown, un capitaine d’archers anglais, occasion de nous apprendre qui est Le Loup-Garou, puis de nous informer que « le corps de Girart est là-bas coupé en morceaux » (p. 32). Cette première partie de la 4e scène est donc la dernière partie de l’exposition que nous évoquions précédemment. Pendant 8 pages, nous faisons connaissance avec la dernière société en jeu, celle des paysans et Mérimée met un terme au fil rouge que représentait le sort de Girart. À la sortie de ces paysans, à l’exception de Gaillon, ce sont les nobles qui entrent en scène pour provoquer un premier incident qui attire Frère Jean, puis Isabelle, puis les Anglais, Le Loup-Garou et enfin Gilbert d’Apremont lui-même. C’est dire qu’après cette courte première partie qui parachève l’exposition, Mérimée profite de ce que l’espace le permette pour mettre tout le monde en scène pour un premier affrontement qui oppose tout d’abord les nobles aux paysans, puis les Français aux Anglais et à nouveau les paysans aux nobles sous le regard amusé de Siward ; la dernière partie de la scène remet en scène les paysans qui en viennent à faire le constat amer suivant : « Nous sommes des lâches de nous laisser tondre la laine sur le dos par des gens qui ne sont pas plus forts que nous. » (Renaud, p. 48). Ainsi cette longue séquence est une sorte d’étude in vivo des conditions qui préparent à la Jacquerie : elle opposera les paysans aux nobles, mais les Anglais vont jouer un rôle ambigu et décisif, tantôt favorisant un camp, tantôt l’autre. À la fin de la scène, nous n’avons assisté qu’à une échauffourée qui pourrait être sans prolongement et sans conséquence particulière.
À partir de la scène 5, Mérimée va s’appliquer à mettre en place le subtil engrenage des événements jusqu’à la guerre déclarée : le serment de Renaud de venger sa sœur morte (scène 5), le choix de Frère Jean comme chef de la Jacquerie (scène 7), l’accord entre les deux chefs, des paysans – Frère Jean – et celui des brigands – Le Loup-Garou – (scène 9), l’assassinat du Sénéchal par Renaud (scène 11), le jugement de Renaud (scène 12), la préparation de l’enlèvement de Renaud le jour de son exécution (scène 15). Ce groupe de scènes (5-17) constitue l’étape où un élément déclencheur cristallisé sur le personnage de Renaud, va provoquer la Jacquerie proprement dite. À ce fil « historique », Mérimée va en combiner un autre qui tourne autour de Pierre et ses amours déçues (scènes 6, 8, 10). Le tressage des deux fils est bien perceptible (scènes paires / impaires), mais ce nouveau fil n’est pas un ornement sans utilité : Pierre est le seul personnage à appartenir à deux milieux à la fois et de plus son amour pour Isabelle sera un élément déterminant dans sa trahison, donc dans l’issue du conflit.
La scène 17 est le deuxième « clou » de l’œuvre et elle nous ramène à la même place que le premier [23], à savoir la place du village d’Apremont où une potence a été dressée. C’est donc le retour à un espace scénique vaste qui va autoriser de larges mouvements et une figuration importante. Les paysans renversent la potence, délivrent Renaud, et Siward qui se joint à eux : le jeune fils du baron est tué, ainsi que son précepteur ; un paysan présente une tête à Frère Jean qu’il vient de couper, un autre une tête de femme noble, cependant que Frère Jean déclare à Siward : « Les gens de ce pays ont pris les armes pour recouvrer leur franchises, et se venger des cruautés des barons » (p. 125). Voilà qui est clair, c’est le début de la Jacquerie proprement dite.
La prochaine grande étape de cette crise historique sera la bataille rangée cette fois à proximité de Beauvais. Mérimée va, cette fois, changer de stratégie : la place du village d’Apremont était un lieu large, mais relativement circonscrit. Un champ de bataille n’est pas aussi aisément représentable sur un plateau de théâtre, preuve que Mérimée continue à réagir en dramaturge et que les contraintes de la dramaturgie pèsent toujours sur lui. La leçon shakespearienne sera encore mise à contribution, par le recours à la fragmentation. Le dramaturge élisabéthain met en scène fréquemment des batailles (bataille d’Azincourt dans Henry V, entre autres exemples) en procédant ainsi : jamais n’est représenté le cœur de la bataille elle-même, mais toujours ses marges. Le dramaturge juxtapose de courtes séquences en des lieux non loin de ce cœur, toujours présent dans l’espace dramatique : les personnages en scène le voient mais non le spectateur qui ne peut au mieux que l’entendre. Parfois, des combattants échappés de ce cœur viennent s’affronter sur scène, à la manière d’un débordement de l’action principale qui, elle, reste toujours en coulisse [24]. C’est ainsi que va procéder Mérimée.
De la scène 19 (p. 138) à la scène 23 comprise (p. 167), Mérimée met en place le procédé shakespearien : de courtes scènes se succèdent : « Une colline à quelques lieues de Beauvais » (p. 139), « Une petite colline près du champ de bataille » (p. 150), « Une autre partie du champ de bataille » (p. 152), « Bivouac des insurgés sur le champ de bataille » (p. 156), « Beauvais, la maison de ville. » (p. 160). Ici, pas question de juxtaposer des espaces comme au début de l’œuvre ou de tisser plusieurs fils de l’intrigue comme il le fait de la scène 5 à la scène 17 : certes, les espaces se multiplient mais dans un périmètre restreint, avec comme dénominateur commun – en coulisse – le champ de bataille, comme une série d’instantanés qui cerneraient l’objet, sans le saisir de façon frontale. La première scène de la série se passe dans le camp des nobles et s’achève par ces commentaires :
Les insensés ! Ils me quittent et vont se précipiter tête baissée dans ce marais d’où jamais ils ne sortiront. […] suivez-moi […] et tâchons, s’il se peut, de réparer leur faute […] les voilà dans la boue maintenant.
Discours qui montre bien que la bataille s’engage dans l’espace invisible. La didascalie d’ouverture de la scène suivante précise : « On entend dans le lointain le bruit du combat » (p. 150). La dernière scène de la série montre la révolte des ouvriers de Beauvais contre les bourgeois, marquant ainsi le succès des insurgés contre les nobles.
Le dernier épisode historique à mettre en scène est celui qui mène à la bataille de Meaux qui signe la défaite des insurgés et la fin de la Jacquerie. Mérimée reprend le même procédé que nous venons de décrire, celui de la fragmentation et le mène de la scène 31 à la 36 et dernière, en variant les espaces en fonction de l’objectif à atteindre : « Le camp des révoltés près du château » (p. 196), « Le camp des insurgés sur la route de Meaux » (p. 204), « La maison dans laquelle est gardé Jean de Bellisle » (p. 214), « Le camp des insurgés » (p. 220), « Une plaine auprès de Meaux. La bataille est engagée » (p. 224), « Une forêt. Il fait nuit » (p. 226). Cependant si la stratégie est la même, l’image visée ne l’est pas. Il s’agissait de créer les scènes propres à montrer la victoire des insurgés ; et en cette fin d’œuvre, ce n’est pas tant leur défaite à l’issue d’une bataille qui est à mettre en scène, mais plutôt le processus par lequel la cause des Jacques est progressivement mais assez rapidement lâchée de tous côtés. Les insurgés ne sont pas tant battus par un parti qui les affronte que par une gangrène interne que Mérimée s’applique à détailler.
Dans la scène 31, ce sont certains paysans qui veulent retourner sur leurs terres et abandonnent la lutte ; dans la 32e, les paysans se prononcent pour la paix face à l’émissaire ennemi ; dans la 33e, Siward se rallie à la cause des nobles, ce que Frère Jean déplore dans la scène suivante : « Nous sommes trahis » (p. 221), tandis que Brown fait écho dans la scène suivante (scène 35) : « on vous trahit » (p. 225) ; enfin dans la scène finale, c’est Le Loup-Garou et ses hommes qui lâchent Frère Jean qui tombe alors que les quelques hommes restés autour de lui crient : « Sauve qui peut ! » et que le didascale conclut : « Fuite et déroute générales » (p. 230). L’image finale a quelque chose de dérisoire et cruel à la fois en ce que les insurgés à l’exception de Frère Jean, sont battus non parce qu’ils sont les plus faibles, mais parce qu’ils manquent de confiance dans leur cause.
Le travail de Mérimée en matière de composition de La Jaquerie s’organise donc à partir de quatre temps forts centrés sur des espaces propres à donner à voir les affrontements entre les deux camps : la scène 4 et la scène 17 autour d’un lieu unique, la place du village, puis les ensembles de 19 à 23, puis de 31 à 36, où l’approche fragmentaire héritée de Shakespeare lui permet de donner à percevoir l’ampleur et la vivacité de l’action, d’abord autour de Beauvais, puis de Meaux. C’est donc bien un souci de dramaturge qui le guide, aussi bien dans le choix des espaces, que dans celui des mouvements ou encore dans l’exploitation des espaces invisibles qui jouxtent l’espace scénique.
Ajoutons encore cette remarque : l’œuvre s’ouvrait sur « [u]ne ravine profonde dans une forêt. Le soleil couchant éclaire à peine la cime des arbres » (p. 3) et s’achève sur « Une forêt. Il fait nuit » (p. 226). La quasi-identité des deux espaces invite à voir dans ce double choix une volonté de circularité qui dirait la vanité de la Jacquerie ; rien n’a changé véritablement et le soulèvement révolutionnaire n’a abouti qu’à une restauration du pouvoir des propriétaires sur les travailleurs. La tragédie est là : dans l’impuissance, consentie en partie, des opprimés.
Roger Bellet ouvrait son article sur La Jaquerie en constatant que « l’œuvre la plus “révolutionnaire” de Mérimée […] n’a pas trouvé depuis son édition originale jusqu’à nos jours de grands laudateurs [25] ». Notre souhait ne va pas jusqu’à tenter de vouloir inverser cette tendance ; mais peut-être de réévaluer les mérites qui sont les siens. Il y a chez Mérimée un vrai travail de dramaturge si l’on veut bien oublier les conditions du spectacle telles qu’elles existaient à son époque : cette habileté s’observe à l’usage qu’il fait des compositions spatiales, de leur variété et de leur succession. Même habileté dans la conduite de la fable et de la variété rythmique qui le guide ; l’agencement des scènes, leur longueur, la répartition des temps forts sont la preuve d’une maîtrise dramaturgique d’une grande efficacité. Victor Hugo aurait jugé l’œuvre de Mérimée « d’une médiocrité plate [26] » ; on croit comprendre ce que signifie pour Hugo ce reproche de platitude. En effet, les violences faites aux personnes, les exécutions sommaires et brutales sont légion et jamais Mérimée ne cède au pathos ; aucune mort ne donne lieu à un moment d’émotion que Hugo n’aurait pas manqué de susciter [27]. Il y a une sorte de sècheresse dans le traitement de l’horreur qu’on ne peut cependant prendre pour de la platitude, encore moins pour de l’indifférence. Mérimée aborde une page de l’histoire de France et la met en scène pour analyser les rouages de l’insurrection à laquelle il s’intéresse ; qu’il ne respecte pas stricto sensu les faits n’a que peu d’importance. En revanche, il scrute avec une grande lucidité les motivations de chacun ; pas d’idéalisme, ni d’angélisme qui opposeraient les bons aux méchants. Il étudie les motivations secrètes de chaque combattant, met au jour les zones d’ombre de chaque personnage : il est un véritable clinicien de l’histoire qui a choisi l’image animée que lui offre la dramaturgie pour adopter tous les points de vue et sonder toutes les âmes, sans volonté moralisatrice affichée.