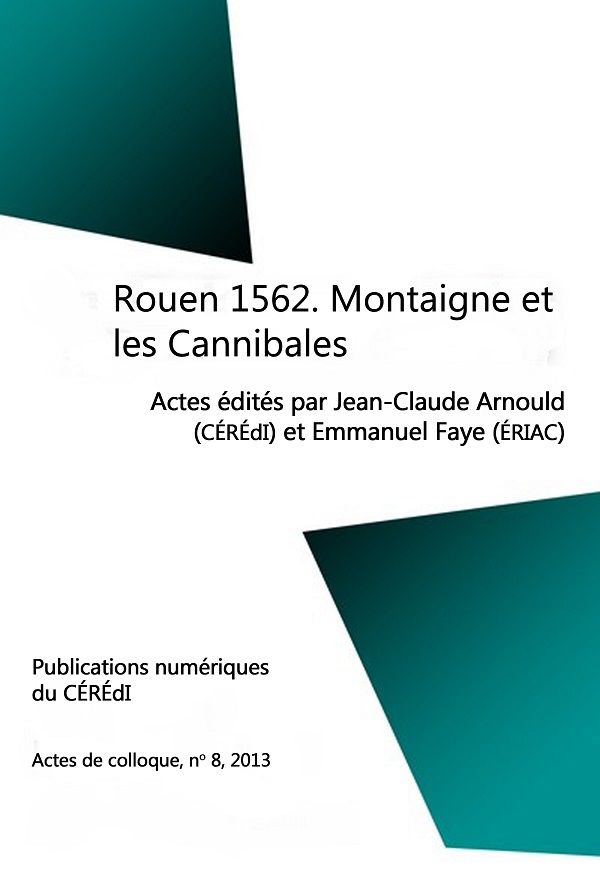De grands cannibales, les Tupinamba. Tous les chroniqueurs l’assurent qui, pour avoir séjourné quelque temps au Brésil dans le cours du XVIe siècle, eurent l’occasion d’observer la façon dont ces Indiens traitaient leurs prisonniers de guerre et les festins qu’ils en faisaient. Il faut croire que les occasions ne manquaient pas. Et, souci sans doute de faire partager à leurs contemporains demeurés par-deçà les mers l’horreur ressentie, ils décrivirent comment ça se passait avec un luxe de détails qui laisse peu à désirer : une précision tout scientifique – du moins s’agissant de ce qui se pouvait voir. Et même, les chiffres ne manquent pas : ainsi, des Chiriguano (une population de la famille tupi), les Jésuites espagnols ont calculé qu’ils dévorèrent, en l’espace d’à peu près un siècle, 60 000 Indiens Chané. Une moyenne modeste, somme toute : pas même deux hommes par jour pour une population qui comptait bien 20 000 âmes.
Les documents donc ne nous font pas défaut. On peut citer, parmi les plus importants, la « véritable histoire » de l’aventurier allemand Hans Staden qui, fait prisonnier en 1545 par les Tupinamba, ne dut qu’au hasard d’une remarque faite en passant mais riche de conséquence d’échapper au sort qui eût été normalement le sien [1] ; le traité du Jésuite portugais Fernão Cardim ; en France, les relations du gentilhomme huguenot Jean de Léry et du cosmographe André Thevet, l’un et l’autre témoins oculaires, mais aussi, rappelons-le pour mémoire, celle de Montaigne, fort bien informé par un serviteur qui avait passé sa jeunesse comme truchement chez les Tupi.
Reconstituer en détail à partir de tous ces témoignages, aussi riches soient-ils, tous les moments du rite est, on s’en doute, impossible. Si dans l’ensemble ils concordent, d’un auteur à l’autre l’ordre change : tel épisode qui, par exemple selon Cardim, prend place juste avant l’arrivée des prisonniers au village, sera situé par Staden à un autre moment. Quand même on s’attarderait à discuter les sources, à évaluer les observations en fonction des tribus où elles furent faites, des dates, des témoins eux-mêmes et de leur situation aussi (spectateur, ou ayant ouï dire, ou encore prisonnier soi-même), on n’obtient pas une description ethnographique, valable pour ce groupe mais non exactement pour cet autre. Cette réserve faite, si c’en est une, on peut tenter de dégager au moins les grandes lignes du rituel et souligner les traits les plus remarquables de ce cannibalisme.
Deux traits pour le caractériser brièvement. En premier lieu, sa dimension systématique : tous les prisonniers de guerre sans exception étaient tués et mangés ; nulle alternative ici qui ouvrît une autre issue. Et si on ajoute que les tribus tupi passaient le plus clair de leur temps à se faire la guerre, que, de surcroît, le but des guerres était de faire des captifs, on aura une idée de l’importance de leur cannibalisme. Remarquable, en second lieu, le côté théâtral des rituels qui se déroulaient avec les prisonniers : leur arrivée au village des vainqueurs, puis, beaucoup plus tard (des années souvent), leur mise à mort, deux moments qui, tantôt en écho, tantôt en opposition, sont comme les temps forts d’une étonnante mise en scène où les rôles ne sont pas seuls distribués par avance, mais réglés également les dialogues, danses et chœurs de femmes, décors, mouvements dans l’espace… Comme si les Tupi avaient cherché à se donner à eux-mêmes en spectacle leur cannibalisme. De grands cannibales, assurément, et avec ostentation.
Le jeu implique un minimum d’accord entre tous les participants y compris par conséquent la future victime. Aussi faut-il préciser que, puisque le cannibalisme se donne dans le contexte de la guerre, les guerres dont il s’agit ici sont celles que l’ont fait entre soi, gens de même langue et de mêmes mœurs [2]. Tupinamba, le nom (attribué indistinctement à toutes les tribus du littoral brésilien) ne connote qu’une unité culturelle et linguistique, non pas politique. Sous ce rapport, les villages tupi se regroupaient en vastes unités territoriales qu’avec les chroniqueurs on nommera des provinces. Entre villages d’une même province prévalaient les relations d’alliance, politique et matrimoniale. Entre provinces, les relations de vengeance : à tout moment en effet, on avait de part et d’autre quelqu’un à venger – guerriers capturés ou tués lors d’un assaut. Il fallait rendre aux responsables la pareille, aller les surprendre chez eux pour, si possible, s’en emparer vivants. L’état de guerre, un système sans fin de règlements de comptes où chacun était tour à tour assaillant et assailli, autant dire presque vainqueur et vaincu. Sommairement donc, entre villages d’une même province, on échangeait les femmes, d’une province à l’autre les prisonniers. À l’intérieur on était beaux-frères ; au-delà, ennemis. Un sel mot en tupi pour désigner l’une et l’autre relation : tovaja.
*
D’emblée se signifiait le statut de nourriture des prisonniers et par un partage subtil du geste et de la parole. « J’arrive, quant à moi, ta nourriture future » : c’est aux femmes que le captif s’annonçait en ces termes quand, aux abords du village, on les croisait dans les plantations. À quoi répondait bientôt la mimique de celles qui attendaient massées à l’entrée du village : indiquant sur son corps, d’une bourrade ou d’un pincement, tel morceau de leur choix, elles se frappaient ensuite la bouche en cadence… On peut repérer deux phases bien marquées dans la réception des prisonniers : celle des femmes, la première, et plus tard des hommes. Sitôt qu’une expédition avait fait son entrée au village, dûment accueillie par la musique des flûtes faites d’os humains, les hommes se retiraient dans le « carbet », la maison du conseil, abandonnant aux femmes leurs captifs entravés. Avec clameurs d’enthousiasme (des vieilles surtout, dit-on), gestes significatifs et railleries à leur adresse elles les traîneraient sans égard jusque sur la place centrale. Elles chantaient alors pour la première fois les chants du jour du sacrifice et dansaient autour d’eux ; à intervalles, l’une ou l’autre se détachant du cercle s’approchait d’un prisonnier pour le frapper violemment : « avec ce coup je me venge de un tel que les tiens ont tué ». Parfois, le captif était lui-même contraint de participer aux réjouissances : elles lui attachaient une sonnaille au-dessus d’un mollet de manière à ce qu’il rythmât leur danse en martelant le sol du pied. Quand on avait bien dansé, les prisonniers étaient traînés dans les maisons et jetés dans des hamacs où, à nouveau, les femmes venaient par groupe se moquer d’eux, les insulter ou leur faire signe qu’elles les voulaient manger. Entre-temps, dans le carbet où on avait réuni toutes les maraca (hochets rituels) les hommes buvaient et chantaient.
En contraste marqué avec celle des femmes, l’attitude des hommes à l’égard des prisonniers quand, dans les jours suivant, le conseil se réunissait dans le « carbet » pour fixer l’ordonnance de la cérémonie finale. Ni brutalité ni raillerie mais, entre ceux que les observateurs nomment des « esclaves » et des « maîtres », un dialogue de reconnaissance. Parés de plumes, peints et coiffés comme les autres, en sorte que plus rien dans l’apparence ne les en distinguaient, les prisonniers inauguraient la séance en dansant avec les maraca. Après la danse on s’asseyait et, tandis qu’on buvait, entre les uns et les autres des propos de ce style :
– Nous sommes partis comme ont coutume de faire les hommes courageux pour vous prendre et vous manger. Vous avez vaincu, peu nous importe… les braves meurent au pays de leurs ennemis… notre terre est grande et les nôtres nous vengeront…
– Oui, vous avez tué beaucoup des nôtres… nous allons vous venger sur vous.
Toujours arrogants, habiles à se glorifier, les prisonniers. C’est l’attitude de mise – mais non pour autant feinte – et approuvée par les autres qui n’en attendent pas moins de leur nourriture future. Nourriture tout de même, on n’avait garde de l’oublier puisque, terminées les palabres, les intéressés (si l’on peut dire) assistaient au partage de leur corps. Dès ce jour-là, en effet, était attribuée à chacun la part qui lui reviendrait le moment venu. Un partage méticuleux, si l’on en croit les témoins, tel qu’il ne reste rien des membres ou des organes qui ne soit distribué. Quelques règles toujours observées : les morceaux délicats réservés aux invités qu’on doit honorer – bouts des doigts, graisse entourant le foie et le cœur ; le cerveau et la langue à des adolescents ; à des femmes les organes génitaux.
Une égale minutie dans la distribution des rôles. Qu’on en juge :
Le même jour, accordent entre eux de celuy qui le doibt tuer, de celuy qui le doibt touzer, et de ceux lesquels le doibvent noircir de genipap, emplumasser, peindre par le visage, de celuy aussi que le doibt prendre quand il est déferré, et qui le doibt laver. Et de celles, lesquelles doibvent mettre le feu aux cheveux, et mettre quand il est tué le tizon dedans le cul, de peur que rien ne se perde de ce qui est dans le corps [3].
C’est peu de dire que les captifs savaient ce qui les attendait. Un seul point laissé dans l’imprécision, mais d’importance : le moment du sacrifice. À Staden qui, après le partage, redoutait de périr sur-le-champ, et d’aussi peu chrétienne manière, un maître rassurant affirma qu’il n’avait pas à s’en faire, on lui laisserait encore du temps à vivre. Le maître d’un prisonnier : selon l’usage, le guerrier qui durant le combat l’a saisi le premier. Mais celui-là peut en faire présent à un autre : un père à son fils, un oncle au fils de son frère… moyen pour le jeune homme qui n’a pas encore pris ni tué d’ennemi d’acquérir du prestige [4] et à charge pour lui de rendre plus tard le cadeau.
L’assemblées des hommes clôturait le cérémonial de l’accueil. On s’est contenté d’en fixer les grandes lignes, dans les faits il pouvait être plus compliqué, inclure par exemple des tournées de présentation des prisonniers aux villages alliés : mais toujours le même système d’attitudes des hommes et des femmes. Un autre rite s’accomplissait encore qui mettait les prisonniers en relation non plus aux vivants mais aux morts de la communauté. C’est avant l’arrivé au village que, semble-t-il, il se déroulait le plus souvent. Chaque guerrier conduisait son prisonnier sur la sépulture d’un parent défunt afin qu’il la renouvelât : ainsi présentait-on aux morts ceux qui serviraient à les venger.
Impossible, on le voit, de définir de façon univoque le statut de l’ennemi fait prisonnier. Grosso modo, les temps et les espaces successifs dessinent tour à tour ses multiples figures : victime sacrificielle sur les lieux funéraires extérieurs au village ; victime dérisoire des femmes dans l’espace du village et objet ambigu de leurs désirs ambigus ; pair reconnu dans la maison des hommes et traité comme un simple gibier, sujet lui-même d’un désir de reconnaissance et de mort.
*
Entre les cérémonies inaugurales et le rituel d’exécution, un intervalle de temps, variable selon les cas de quelques mois à plusieurs années, mais toujours marqué. Il faudra s’interroger sur la raison de ce délai et dire par conséquent ce qui s’y passe, étant donné qu’on ne peut pas tout à fait se satisfaire de la justification avancée par tous les témoins : qu’il s’agissait d’engraisser les captifs « comme pourceaux en l’auge ». Étaient-ils donc toujours si maigres qu’il fallût attendre jusqu’à une décennie pour qu’ils devinssent mangeables ?
Passés les premiers jours, les attitudes entre les captifs, les hommes et les femmes du groupe étaient radicalement modifiées. Tous les chroniqueurs se plaisent à nous décrire des relations empreintes de cordialité et d’affection. Tous remarquèrent, pour s’en étonner, la grande liberté dont jouissaient les prisonniers. Ils pouvaient à leur guise se rendre où ils voulaient, aller à la pêche et à la chasse, ils participaient aux beuveries masculines avec le même entrain qu’aucun autre. Ils partageaient donc l’existence quotidienne des autres, à très peu près… La réserve est importante, car conclure de cette liberté à un changement de statut et dire, ainsi qu’on l’a fait, que le prisonnier dès lors était temporairement intégré au groupe de ses ennemis, c’est faire un pas subreptice que rien n’autorise à franchir. Pour n’être plus entravé, ni objet de menace ou de risée, il n’en demeurait pas moins qu’il était : un ennemi devenu un prisonnier. Intégré si on veut, mais avec ce statut particulier qu’on tentera de préciser bientôt. À preuve, les quelques contraintes qui quand même lui étaient imposées. Ainsi, de temps à autres, à l’occasion d’une fête, on l’exhibait chargé de liens et chacun désignait sur le le morceau qui lui était échu. En outre, dans la maison collective qu’il habitait, il devait, sous peine d’être dépêché sans délai, pénétrer toujours par la porte alors que les autres avaient coutume d’accéder directement à leur espace familial en écartant les branchages des parois. Un interdit anodin en apparence (et dont la sanction s’il venait à être transgressé paraît démesurée) mais pour le captif une servitude quotidienne, et bien propre à marquer l’ambiguïté de sa position : il entre dans la maison qu’il habite comme y pénétrerait un hôte ou un étranger. Simple formalité, mais qui suffit à établir les différences.
Le délai était bref pour un prisonnier déjà âgé ; ou pour une captive. Quoique ce ne fût pas l’objectif recherché, il arrivait en effet qu’on s’emparât parfois des femmes. Étaient-elles reçues et mises à mort de même façon que les hommes ? Nul témoin pour le rapporter. Mais on peut supposer sans grand risque d’erreur qu’il en allait autrement : non seulement parce que le jeu de relations plus haut résumé ne concerne que des hommes, mais parce que leur statut dans le groupe ennemi et, subséquemment, leur destin différaient de ceux des prisonniers. Pour elles, en effet, une alternative : soit que, devenues épouses secondaires de leurs maîtres, elles fussent épargnées ; soit qu’on les sacrifiât, et dans ce cas elles demeuraient célibataires (libres sans doute d’avoir des relations sexuelles avec qui bon leur semblait, mais c’est une autre affaire). Or, cela qui dans le cas d’une prisonnière se pense en termes exclusifs selon une logique de la contradiction, pour un prisonnier en revanche se donne comme des termes successifs selon une logique qui les implique : toujours sacrifiés et nécessairement dotés d’une épouse.
Quelques jours à peine après son arrivée, deux actes donnaient au prisonnier sa place dans la communauté de ses ennemis : on lui remettait, pour son propre usage, tous les objets qui avaient appartenu au défunt donc il avait renouvelé la sépulture – hamac, colliers et ornements de plumes, arcs et flèches que les autres ne pouvaient toucher qu’après qu’un prisonnier s’en était servi. Et on lui donnait une épouse. Thevet, Léry, Cardim s’accordent sur ce point, on donne toujours, disent-ils, une femme aux hommes maison non un mari aux femmes. Le maître du prisonnier choisissait s’il en avait une disponible une femme de sa parenté – fille, sœur… Sinon, il demandait à un autre de fournir l’épouse : requête d’autant mieux accueillie qu’un tel mariage était prestigieux. Cardim remarque que souvent les épouses des captifs étaient des filles de chef, choix qu’il explique en disant qu’elles sont de bien meilleures gardiennes que les autres dans la mesure où ce sont leurs propres frères qu’on a chargés de l’exécution. Il faut noter la relation. Tous les observateurs du reste voient dans ce don d’une épouse au captif un moyen de lui donner en réalité une gardienne. Un moyen exorbitant, c’est le moins qu’on puisse dire, comparé à la fin. D’autant que le prisonnier ne risquait pas de s’échapper, faute tout simplement d’avoir où se réfugier. Il ne pouvait pas, on s’en doute, chercher asile dans un autre village ennemi ; mais retourner chez lui pas davantage : on n’eût pas apprécié la lâcheté, moins encore le peu de confiance – croyait-il par hasard que les siens n’étaient pas assez forts pour le venger le moment venu [5] ? C’est que le jeu de la guerre ne prévoit pas de telles situations : en sont tracées par avance les rares possibilités ; exclu le hasard. Un prisonnier retournant dans sa province d’origine (il n’y eût pas songé) eût été probablement mis à mort par les siens, et sans délai ni cérémonie ; au mieux, on l’eût chassé. Et imagine-t-on le statut d’un fuyard dans cette société de guerriers où les jeunes gens ne pouvaient pas se marier avant d’avoir pris ou tué un ennemi ? Tandis que le prisonnier en a un chez les autres, et honorable ; provisoire, il est vrai, mais pour qui en va-t-il autrement ? Pas de hasard, mais pas de cruauté non plus. Et on ne peut prendre au sérieux ce que disent les témoins du comportement des prisonniers que n’affectaient d’aucune manière la conscience qu’ils seraient un beau jour tués et dévorés. Tout se passe comme si, dès lors qu’il est pris, un homme n’a plus de place dans sa propre communauté et ne peut s’occuper celle qui, chez les autres, lui est assignée de tout temps : un tovaja, ennemi devenu beau-frère, à qui échoit le privilège de dévoiler l’équivoque et donner au mot sa dimension de vérité. Intégré, si on veut, au groupe de ses ennemis, mais dans ce lieu unique, non pas comme l’un quelconque des autres. Le délai donc est important : celui sur qui va s’accomplir la vengeance n’est pas n’importe qui, on le veut chargé de déterminations.
C’est un tovaja donc qui sera mangé. Et avec lui ses enfants. Car après plusieurs années de captivité il peut en avoir. Thevet assista au rituel d’exécution d’un prisonnier et de ses deux enfants, un garçon et une fillette « déjà grandelets », âgés selon lui respectivement de sept et six ans. On tuait les enfants des prisonniers parce qu’ils étaient cunhambira, enfants de prisonnier : la société tupi était patrilinéaire. Parfois le meurtre suivait de peu la naissance ; ou bien on les élevait jusqu’à ce qu’ils fussent, comme dit joliment Thevet, « en âge d’être mangés » : assez gras ? On les tuait alors en présence de leur père, le même jour que ce dernier ; jamais au-delà. Le meurtre des enfants : simple conséquence de la règle de filiation agnatique ? Pourquoi en ce cas les mères (puisque, dit-on, certaines essayèrent) ne parvenaient-elles pas à faire adopter leurs enfants par quelqu’un de leur parenté ?
Les cérémonies qui se concluaient par la mise à mort des prisonniers et le repas cannibale occupaient plusieurs jours : de trois à cinq, selon les tribus, avec des variations de l’une et de l’autre dans les rites ou dans leur déroulement chronologique, mais assez de traits récurrents et des moments partout nettement marqués.
Une beuverie préliminaire. Elle débutait quand les premiers invités arrivaient (les alliés, conviés expressément à venir manger l’ennemi commun, comme en témoigne la formule rituelle qui les accueillaient « vous venez, pour nous aider à manger votre ennemi ») et elles se prolongeaient aussi longtemps qu’ils n’étaient pas tous présents (et certains venaient de très loin, plus de 40 lieues). Les prisonniers y prenaient part avec les autres. Ensuite tout le cérémonial se passerait à l’extérieur, sur la place centrale, tandis que dans une maison on continuerait de boire.
Deux grands actes dans le rituel, destinés le premier à abolir le temps passé et rendre le prisonnier à sa simplicité première (un ennemi, sans plus), l’autre à accomplir la vengeance : le simulacre de la capture, et le meurtre. Ils occupaient chacun tout un jour et incluaient plusieurs scènes : entre prisonniers et hommes et femmes du groupe ; ou autour des deux objets cérémoniels : la corde et l’épée-massue. Un jour entier consacrée à la mussurana [6] chez les Tupi de Bahia. C’étaient les hommes qui l’apprêtaient : un maître en cet art y faisait quantité de nœuds et de boucles très compliqués, et on la teignait avec une sorte d’argile blanche. Le même enduit qui couvrirait, le jour du meurtre, le corps du meurtrier. L’épée-massue, en revanche, toujours ornée par les femmes, et de la même manière que le visage du prisonnier.
Jusqu’au temps de la capture, le prisonnier continuait d’occuper son espace dans la maison collective. Ensuite, sur la place, un abri de palmes individuel (les femmes en construisaient un pour chaque prisonnier), pour la nuit, et pour les intervalles de repos laissés pendant le jour. La capture marque ainsi le premier temps de la séparation que les adieux de l’épouse viendront accomplir.
On éveillait le prisonnier à l’aube pour le conduire à une rivière. Une fois qu’on l’avait lavé des peintures de la veille, épilé et rasé (tonsure sur le devant du crâne, cheveux longs dans le dos : la coiffure des Tupinamba), on le raccompagnait jusqu’à l’entrée du village. Il devait traverser l’espace central (lentement et sur ses gardes, selon les uns, en courant comme pour s’échapper, selon d’autres) entre deux rangs de guerriers tous peints et ornés de plumes, et munis de cordes (comme on fait quand on part en guerre). Brusquement l’un d’eux se jetait sur le prisonnier et tentait de le maîtriser, lui de son côté cherchant à se débarrasser de l’adversaire qu’un autre, le cas échéant, relayait. Le corps à corps pouvait durer jusqu’à ce que quelqu’un parvînt à le maîtriser. Alors les autres se jetaient sur lui pour aider à le ligoter. La lutte finie, sortait d’une maison un cortège de femmes, toutes peintes de rouge et de noir, et portant en sautoir des colliers de dents humaines, qui s’avançaient en dansant. En tête une vieille portait le vase contenant la mussurana toute blanche. On en passait une boucle au cou du prisonnier, tandis que deux femmes en saisissaient les extrémités. Leurs chants : « Nous sommes celles qui étirons le cou de l’oiseau » et : « Si tu étais perroquet, tu t’envolerais pour nous échapper ». Sans cesser de chanter, elles se mettaient à peindre le prisonnier. Elles commençaient par l’enduire sur tout le visage et le corps d’une sève poisseuse (ou de miel). Sur le visage, elles collaient des fragments de coquilles d’œufs verts et elles peignaient des dessins noirs. Sur tout le corps, des fragments de plumes rouges. « La décoration du visage le fait paraître plus grand et brillant », note Cardim, « avec les yeux plus petits », et deux fois plus gros les plumes sur le corps. En même temps que les unes s’affairaient ainsi autour du prisonnier, d’autres, en face de lui de manière à ce qu’il pût voir, apprêtaient l’épée-massue : le même enduit visqueux sur l’extrémité large et tranchante, coquilles vertes et dessins au génipa ; au bout du manche des bouquets de plumes : les « oreilles » de l’épée-massue. Elles suspendaient l’arme dans un abri de palmes construit sur la place à cette fin et chantaient tout autour. Le prisonnier, de son côté, toujours chargé de la mussurana était reconduit dans son abri où il pouvait se reposer dans son hamac, à contempler les femmes qui, par groupes de quatre, passaient devant lui en courant et en se frappant la bouche.
Il passait la dernière nuit avec son épouse, entouré par quelques vieilles femmes qui suspendaient leur hamac autour du sien et psalmodiaient toute la nuit des paroles de circonstance.
Les prisonniers n’estoient beaucoup endormis, oyans la mélodie de ces douces Proserpines. Pour resjouïr iceux prisonniers faisoient entendre… que le temps estoit venu qu’ils payeroient la debte et qu’ils seroient mangés la nuit même.
Les autres ne dormaient pas davantage. Un autre cercle de femmes pour chanter autour de la massue : des chants tristes, au rythme lent d’un tambour, et destinés eux à « endormir » l’arme. Quant aux hommes, ils continuaient à boire : toute la boisson devait être épuisée avant la cérémonie finale (lorsque, pour avoir beaucoup bu, on était trop exténué, on différait l’exécution jusqu’au surlendemain).
Tôt le matin, sa femme quittait le prisonnier : quelques paroles d’adieu entrecoupées de larmes et de sanglots, et elle retournait chez elle. La hutte était démolie, le prisonnier conduit au centre de la place. On enlevait la mussurana de son cou pour la nouer autour de sa taille, et deux hommes cette fois la prenaient aux extrémités. À la fois maintenu et libre de ses mouvements, le captif était invité à se venger. Vengeance verbale d’abord. Léry :
J’ay moi-même, vaillant que je suis, premièrement ainsi lié et garotté vos parens… se tournans d’un costé et d’autre il dira à l’un : j’ay mangé de ton père, à l’autre, j’ay assomé et boucané tes frères : bref, adjoustera-t-il, j’ay en général tant mangé d’hommes, et de femmes, voire des enfants de vous autres… que je n’en sçaurais dire le nombre : et au reste ne doutez pas que pour venger ma mort les Margaias de la nation d’où je suis n’en mangent encore cy-arpès autant qu’ils en pourront attraper.
Et puis en acte. On entassait auprès de lui pierres, tessons de poterie, fruits durs, etc. Ceux qui tenaient la mussurana la tendaient de manière à ne pas laisser au prisonnier trop de champ, et hommes et femmes tournaient rapidement autour de lui qui leur jetait tout ce qu’il avait à portée de la main, blessant souvent plusieurs d’entre eux. Un simulacre de vengeance.
Et à nouveau, entrée en scène des vieilles femmes : sept ou huit, peintes et ornés comme la veille, s’approchaient du prisonnier en dansant et en tambourinant sur les vases peints de frais où elles recueilleraient bientôt son sang et ses entrailles. Le dernier à paraître, le meurtrier. Il sortait de chez lui avec sa suite, parents et amis : couvert d’urucu sur le visage, le corps entièrement blanc, une longue cape de plumes sur les épaules (le manteau des chefs), coiffure de plumes. Il faisait une fois le tour de la place en mimant le faucon prêt à fondre sur la proie avant de s’immobiliser en face de sa victime. Un ancien apportait l’épée-massue, qu’il faisait à plusieurs reprises passer entre les jambes et sous les bras du meurtrier avant de la remettre à ce dernier. Dialogue meurtrier-prisonnier (avec le style de Léry) :
– N’es-tu pas de la nation nommée Margaias qui nous est ennemie ? Et n’as-tu pas toy-même tué et mangé de nos parens et amis ?
– Oui, je suis très fort…
Et mettant les mains sur sa teste, avec exclamation, il dit… oh, combien j’ai esté hardi a assaillir et a prendre de vos gens desquels j’ay tant et tant de fois mangé.
– Toy estant en notre puissance seras présentement tué par moy, puis boucané et mangé de tous nous autres.
– Mes parens me vengeront aussi…
Il s’agissait, pour le tueur, d’assener le coup de massue sur la nuque, et de manière à faire choir la victime face contre terre (on augurait mal d’une chute en sens contraire), et pour l’autre (toujours maintenu par la mussurana) d’esquiver les coups, de retourner l’arme contre le meurtrier, ou de s’en emparer – et à ce point les autres bien sûr intervenaient. La règle veut que le prisonnier résiste et se défende. On l’y encourage toujours, et il ne s’en fait pas faute. Ce n’est pas une victime passive qu’on veut immoler, c’est un ennemi (n’a-t-on pas pris soin de le formuler ?) qu’on veut tuer au combat. Dans un simulacre de combat, puisqu’on en a fixé l’issue longtemps par avance.
Le reste allait sans beaucoup de cérémonie. Un bref éloge du mort dit par la veuve dans une « salutation larmoyante » : comme ont coutume de faire les femmes quand il y a un défunt. Après, c’est une affaire de cuisine, et de pédagogie. Ceux qu’on avait désignés pour le faire accomplissaient les diverses tâches. Des femmes, celle d’échauder le corps, de le gratter, d’obturer l’anus. Un homme celle de le découper. Les femmes encore pour le faire cuire (chairs rôties, entrailles bouillies) et pour, enfin, porter à chacun sa part. On mangeait tout et, hormis le meurtrier contraint d’abord à vomir puis soumis à un jeûne rigoureux, tout le monde participait au repas, y compris l’épouse et, le cas échéant, la mère. Peu de restrictions, d’autre part, sur la chair humaine : la principale portant sur les organes génitaux dont la consommation est toujours réservée à quelqu’un de l’autre sexe. Finalement, la règle essentielle de l’anthropophagie, c’est peut-être l’exigence que tout le monde y participe. Du plus jeune au plus âgé, il fallait que chacun puisse goûter de l’ennemi, si peu que ce soit. Quand, par exemple, il y avait trop peu de viande pour des invités trop nombreux, on mettrait à bouillir un pied ou une main de manière à ce que chacun eût au moins du bouillon. Jusqu’aux bébés qu’on n’oubliait pas, dont les mères s’enduisaient les seins du sang de la victime. Cela dit, qu’on n’aille pas conclure de cette exigence à une participation contrainte. À lire les récits de repas cannibales, on n’a pas l’impression que les convives se forçaient, plutôt le contraire : même si on fait la part du plaisir des conteurs, celui des consommateurs ne fait aucun doute.
Tout le temps que duraient les préparatifs du repas, les plus âgés exhortaient les plus jeunes à continuer de leur procurer de semblables nourritures. On faisait aussi la leçon aux jeunes enfants. On les encourageait à toucher le corps, à en extirper les entrailles, on les barbouillait de sang : pour les venger, pour les rendre courageux à la guerre, pour leur apprendre la manière convenable de traiter les ennemis, et aussi qu’il n’y a pas de mort plus glorieuse que celle qu’ils vous infligent. La pédagogie de la vengeance.
La vengeance. Il faut se venger d’une défaire, il faut venger les prisonniers, venger les morts – morts au combat ou d’une autre manière. Pour les Tupinamba cette catégorie est la clef du système ; elle suffit à rendre compte de tout le processus, depuis la guerre jusqu’au festin. On est ennemis, on se venge. Alors on peut se demander quel est le sens d’une telle réciprocité, et de quoi finalement, les Tupi se vengent-ils. L’analyse de leurs guerres permet, sinon de donner vraiment une réponse, au moins de préciser la question. Comparées, en effet, aux guerres inter-tribales que se faisaient – que se font encore, dans une moindre mesure – d’autres populations amérindiennes (par exemple, les Yanomami ou les Jivaro), celle des Tupi présentent de curieuses inversions. Ailleurs, lorsque les hommes se font la guerre, c’est presque toujours pour capturer des femmes, qu’ils prennent pour épouses. Ici, c’est pour capturer des beaux-frères – des hommes à qui on donne des épouses – que l’on dévore. Dans le premier cas, le gain est évident, et il est double : on gagne des femmes, en même temps qu’on supprime toute obligation envers les « donneurs ». Bien entendu on court le risque d’une perte également double, puisque les guerres se perdent aussi. Mais enfin, le système est clair. Mais chez les Tupi ? Sans doute le beau-frère en question est-il un mauvais beau-frère : c’est l’autre, le « preneur », mis de surcroît en situation de ne pas pouvoir restituer l’épouse reçue (on tue ses filles). Il ne reste plus qu’à s’en débarrasser, en le transformant en nourriture (de préférence nourriture pour les femmes ? Qu’on se rappelle leur rôle dans le rituel). On lui donne la sœur, il est tué par le frère. Mais ou est le bénéfice, et dira-t-on qu’il est seulement alimentaire ? Tant de subtilité pour seulement pouvoir manger son semblable, c’est peu convaincant. Les Tupi, quant à eux, disent que c’est pour la vengeance. En somme, ils ont besoin de transformer en beaux-frères ceux sur qui ils se vengent : manière de se représenter un ordre désiré où n’existeraient pas de telles relations ? C’est de représentation qu’il s’agit ; le réel est autre : ici les alliés, là les ennemis, nulle confusion possible. On ne peut pas se soustraire à l’ordre social ; mais on peut le trouver insupportable, et peut-être les Tupi se vengeaient-ils moins les uns des autres que, tous ensemble, de ce commun malheur.
Quoi qu’il en soit, le cannibalisme s’insère dans un système infiniment complexe, et qui déborde cette seule question. Autour du prisonnier les enjeux sont multiples, et il n’y a pas un rite mais plusieurs. Brièvement : enjeux sociaux et politiques (ainsi les querelles pour savoir qui le premier a pris un ennemi, les cadeaux de prisonniers, le choix du meurtrier) ; rite funéraire (le renouvellement des sépultures) ; rite religieux (les danses avec les maraca : objets sacrés par lesquels passe toute communication avec le surnaturel). Rituel aussi, le cannibalisme : pour pouvoir manger un prisonnier, il était indispensable qu’on l’eût tué selon les règles ; mais s’il mourait de quelque autre façon, on ne le mangeait pas (on se contentait de lui briser le crâne et d’abandonner son cadavre aux charognards).
Pourtant, le cannibalisme ne se laisse pas tout à fait délimiter par l’ordre du rituel. Il est temps de dire, en effet, que les Tupinamba ne se contentaient pas de manger les prisonniers. Ils avaient coutume aussi de ne pas abandonner le champ de bataille avant d’avoir dépecé, rôti et mangé sur place les ennemis tués. Un cannibalisme « sauvage », en quelque sorte, en tout cas sans apprêt – culinaire excepté. Dans un cas, le rituel est indispensable, inexistant dans l’autre. Pourquoi peut-on manger les prisonniers qu’on a tués (sans cérémonie) et ne peut-on pas manger les prisonniers qu’on n’a pas tués (avec des cérémonies) ? Finalement, on ne sait plus trop quoi expliquer dans le cannibalisme. Mettons que c’est l’acte de manger. Veut-on annihiler radicalement l’autre et, en le privant du rite que normalement les siens feraient à sa mort, lui ôter toute chance de vie dans un monde meilleur ? Les précautions prises par le meurtrier pour éviter la vengeance de sa victime permettent de douter que telle soit la raison : il devait changer de nom, se cloîtrer, faire maigre pendant une lune et porter pendant près d’une année le deuil de la victime. Sans compter que, chez les Tupi, le monde meilleur n’était promis qu’aux plus vaillants guerriers et que, pour un nombre non négligeable d’entre eux, c’était un rite funéraire normal que d’être mangés par les ennemis.
S’agit-il d’incorporer les forces de l’ennemi ? L’explication est tombée en disgrâce. Elle en vaut une autre pourtant, car l’idée qu’on assimile les vertus de ce qu’on ingère n’est pas étrangère aux Tupi (ni à la plupart des Indiens) : à preuve, par exemple, l’interdiction faite aux jeunes gens (dont on attend qu’ils soient agiles) de consommer la chair des animaux lents à la course ; ou au contraire, les recommandations faites aux apprentis chamanes (qui doivent savoir très bien chanter) de rechercher pour nourriture des oiseaux au chant mélodieux et de préférer pour boire, l’eau des cascades.
Enfin, variation plus subtile sur le même thème, cherchait-on, en mangeant les ennemis, à manger en réalité les parents et alliés dont ceux-là étaient nourris ? L’idée est émise dans le chapitre que Montaigne a consacré à la question ; et peut-être n’est-elle pas absente des échanges verbaux entre les prisonniers et les autres. Non pas de l’exo-cannibalisme, mais un endo-cannibalisme étrangement contourné. Ce n’est pas impossible ; les Tupi étaient des gens très compliqués.
Laissons la question ouverte et, en guise de conclusion, plutôt rapporter ce que d’autres Indiens, les Guayaki dont un groupe est cannibale et l’autre ne l’est pas, répondirent à la question de l’ethnologue qui voulait savoir pourquoi chacun était ce qu’il était :
Les cannibales : nous mangeons parce que la chair humaine est douce.
Les autres : nous ne mangeons pas la chair humaine, parce que c’est amer.