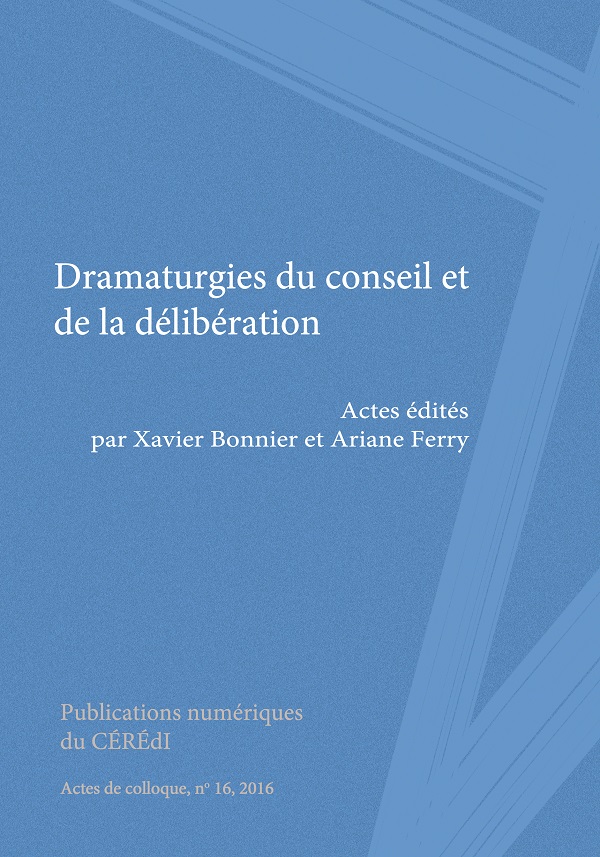Si l’on adopte une perspective rhétorique et que l’on considère la tragédie comme une suite de discours (qui sont destinés à produire des émotions spécifiques chez le spectateur, mais – et c’est là l’ambiguïté du genre dramatique – qui ne lui sont pas directement adressés), on s’aperçoit que le dialogue dans les tragédies n’est très souvent qu’un discours divisé en deux pour la commodité de la représentation. On sait d’autre part qu’un bon orateur ne se contente pas de proposer ses propres arguments et qu’il prévoit ceux de son adversaire en lui faisant des concessions pour les réfuter ensuite. Ainsi les scènes dialoguées d’une tragédie se présentent souvent comme des discours conformes à la disposition rhétorique : exorde, narration, confirmation, réfutation, péroraison, etc. Pour mettre en scène sous forme de dialogue les conflits de valeurs et les affrontements de points de vue, pour constituer les scènes du conseil et de la délibération de manière antithétique et intelligible, la dramaturgie classique dispose, comme on le sait, de certains types de personnages secondaires, le confident et le conseiller du roi, dont nous nous proposons d’étudier quelques exemples particuliers choisis chez Corneille et Racine.
Du confident au conseiller
Image très réaliste des courtisans et dames d’honneur qui sont l’escorte vivante des Grands du XVIIe siècle, le confident [1], loin d’être une convention théâtrale, devient dans la tragédie classique l’un des éléments les plus proches de la réalité. L’entrée d’un roi sur la scène s’accompagne nécessairement d’un certain rituel : l’entrevue avec le roi ou l’empereur doit être d’abord sollicitée par l’intermédiaire d’un messager-confident. Ainsi Antiochus envoie Arsace pour demander à la reine Bérénice un « entretien secret » (I, 1, v. 10). Œnone précède d’un pas l’entrée de Phèdre pour éviter une rencontre fortuite entre sa maîtresse et Hippolyte (I, 3, v. 150) ; à l’acte suivant, c’est Théramène qui annonce à ce dernier l’arrivée de Phèdre (II, 3, v. 561). Il faut noter toutefois que chez Racine, il n’y a rien de systématique dans la mise en scène du protocole de la cour. La première scène de Britannicus (1669) où Agrippine elle-même se campe devant la porte de la chambre de Néron est d’une tension exceptionnelle : « la mère de César » se plaint justement du protocole, c’est-à-dire de la distance, que son fils veut établir entre eux (I, 1, v. 118-122, 139-140).
En dehors de cette fonction traditionnelle de messager, le confident, représentant l’humanité moyenne, a pour fonction de permettre au spectateur l’accès à un autre monde. L’ouverture de Bajazet (1672) nous introduit dans le sérail du Grand Seigneur turc et cette scène inaugurale offre une variante assez intéressante. Osmin, confident du grand vizir Acomat qui prémédite une révolution de palais, vient d’effectuer un voyage de reconnaissance au sein de l’armée partie en expédition ; les deux personnages ont par conséquent à apprendre l’un et de l’autre, ce qui modifie quelque peu le traditionnel jeu de questions-réponses. Quant à Arbate (Mithridate [1673]), il est « confident de Mithridate et gouverneur de la place de Nymphée ». En fait, c’est, beaucoup plus qu’un confident, un homme de confiance qui a été chargé, pendant l’absence du roi, de commander la place forte, de protéger et de surveiller Monime. Confident et complice de Xipharès, il sera également celui qui vient empêcher à temps le suicide de Monime et rapporter le dernier combat de Mithridate : Racine essaie ici de faire l’économie de personnages secondaires dans une pièce dont l’action est déjà assez complexe.
L’une des originalités de Racine en cette matière semble consister dans la complicité qu’il établit entre les héros et leurs confidents : Néron-Narcisse (Britannicus), Phèdre-Œnone (Phèdre, 1677), entre autres, mais encore Oreste-Pylade (Andromaque, 1667), Hippolyte-Théramène (Phèdre) ou Esther-Élise (Esther, 1689). Les confidents représentent le passé, l’état normal des héros ainsi que de la communauté dont ils sont issus (Andromaque-Céphise [Andromaque], Monime-Phœdime [Mithridate]) ; ils sont les témoins privilégiés pour mesurer le chemin parcouru par les héros (« Ma Phœdime […] / Après deux ans d’ennuis, dont tu sais tout le poids », Mithridate, IV, 1, v. 1172-73). D’autre part, à l’image du chœur de la tragédie grecque qui assumait le plus souvent l’expression d’une norme sociale, le confident, par sa surprise, sa réprobation ou son silence, fait ressortir chez son maître la démesure et l’isolement dû à cette démesure, la manifestation d’une grande passion étant souvent un élément perturbateur dans la société. Enfin, il arrive même que le confident se présente comme le double négatif de son maître (Narcisse, Œnone) : le héros tragique, aux moments où s’impose quelque décision importante, voit surgir en lui-même, mais exprimée par le confident, une partie cachée de sa conscience qui tend à l’entraîner à l’opposé de son devoir.
Racine fera un pas de plus dans l’emploi des confidents pour en faire des personnages actifs (et non plus de simples personnages protatiques) qui, à ce titre, se conçoivent mieux en termes d’actants impliqués dans un jeu de forces : vertueuses barrières comme Burrhus ou « détestables flatteurs » aplanissant le « chemin du crime » comme Narcisse, la « détestable Œnone », le prêtre Mathan (Athalie, 1691). Il y aurait une distinction à faire entre les confidents qui représentent l’opinion publique et les personnages qui agissent de leur propre initiative pour influencer les héros, que l’on peut nommer, faute de mieux, conseillers [2]. Cette dernière catégorie peut comporter ceux qui agissent par ambition personnelle ou ceux qui se préoccupent du sort de la Cité : conseillers que l’on peut qualifier de bons ou de mauvais, bien que la distinction ne soit pas toujours évidente. D’ailleurs, un conseiller royal peut-il être considéré comme simple figure conventionnelle de théâtre ? L’exemple de Cinna (1642) doit nous mettre en garde contre une telle interprétation. En effet, Corneille y montre, avec une habileté dramaturgique remarquable, des conspirateurs qui se trouvent malgré eux dans la position de conseillers de l’empereur, lequel est la cible de leur attentat. Cet exemple nous suggère qu’un personnage de conseiller doit être étudié dans la perspective du drame et de la dynamique qu’il crée pour le développement de l’action [3]. On aurait tort, par exemple, de considérer Antiochus (Bérénice, 1670) comme confident ou conseiller de Titus : celui-ci ne subit aucune influence du roi de Comagène dans sa décision ; l’intention de renvoyer Bérénice dont il fait part à Antiochus (III, 1) n’est pas une information nouvelle pour le spectateur. Messager peu efficace, Antiochus apparaît plutôt comme double de Titus, souvenir du passé heureux pour Bérénice, emblème d’un échec de communication pour le spectateur.
On peut penser que, pour être consulté, donc pour avoir la confiance de son maître, le conseiller doit être d’un rang élevé [4] ; mais généralement, pour les personnages secondaires (confidents, messagers), Racine ne se croit pas tenu d’expliciter leur rang social, Narcisse et Œnone étant les exceptions notables qui font l’objet d’une brève justification dans les préfaces. Narcisse est sans doute la figure la plus noire et la plus énigmatique du théâtre de Racine ; mais il est clair que le personnage est conçu davantage comme instrument (ainsi que le suggère ce passage de la préface : « Je lui donne Narcisse comme confident [5] ») que comme entité humaine – point n’était besoin alors de se soucier de lui donner des nuances psychologiques, de faire de lui un personnage « ni tout à fait bon ni tout à fait méchant ». Racine était d’autant plus libre de noircir à souhait le personnage que cet « affranchi » était déjà stigmatisé par Tacite.
Confidence et conseil
Dans la tragédie classique, la première apparition du monarque sur la scène se situe souvent au début de l’acte II. Le personnage royal perdrait quelque peu sa dignité s’il servait, dans l’exposition, d’interlocuteur ou de rapporteur dont la fonction est avant tout d’informer le public des faits nécessaires à la compréhension de l’action. En revanche, l’effet sera grand si le souverain, dont on a certainement parlé au premier acte et dont le public a commencé à se former une certaine image, présente un aspect inattendu à l’acte suivant, lors de sa première apparition. Ainsi, Auguste, peint comme un tyran endurci par Émilie et par Cinna, et après avoir convoqué les deux principaux conjurés (de quoi inquiéter Émilie et le spectateur), se présente au début de l’acte II comme un empereur lassé de la politique et prêt à abdiquer. Un véritable coup de théâtre qui donne d’emblée à Auguste une épaisseur psychologique qui estompe celle des autres personnages. Mais tout en dévoilant une complexité imprévue chez le personnage de l’empereur, cette scène constitue également un ressort dramatique (le dilemme dans lequel Auguste était enfermé étant renvoyé au camp des conjurés) et prépare un dénouement lui-même imprévisible mais justifiable après coup (la clémence étant une vertu inhérente et réservée à un bon souverain).
Racine en a probablement tiré la leçon dans l’exposition de Britannicus : fournir, au début du deuxième acte, les informations complémentaires assorties de l’effet de surprise. La structure est semblable à celle de l’exposition de Cinna.{} L’ingratitude que soupçonne Agrippine, le règne jugé vertueux par sa confidente [6] (donc par le peuple), le droit à l’indépendance défendu par Burrhus : le nom de Néron est évoqué sous de multiples aspects, et pourtant la réalité échappe à tous ces jugements. Racine va pousser l’effet de surprise un peu plus loin, puisqu’il montre, à la première scène de l’acte II, un Néron respectueux de sa mère, soucieux de la stabilité du pouvoir, non dépourvu d’autorité : sa première apparition offre l’image d’un empereur conscient du sérieux de sa fonction. La surprise vient du contraste de cette image publique (il s’adressait à Burrhus, entouré des gardes) et de la confidence qu’il va faire à Narcisse (scène 2). Cette confidence, outre qu’elle révèle la perversion de Néron, bouleverse les données de la situation : Britannicus, qui n’était qu’un déshérité malheureux, inoffensif, devient un rival encombrant. Désormais la machine infernale est déclenchée, le pire est à craindre.
Le contraste est également frappant entre cette scène de confidence et la scène de délibération de Cinna (II, 1). La présence des deux conseillers convoqués par Auguste permet de présenter un débat ample, de montrer l’ouverture d’esprit d’un monarque soucieux de consulter les avis de ses sujets avant de prendre une décision et, par là, de démentir l’image d’un tyran esquissée à l’acte précédent ; à l’inverse, Néron éloigne justement Burrhus pour cette scène de délibération, révélant ainsi sa dépendance à l’égard de Narcisse et sa duplicité. Si la qualité d’un monarque se mesure par les questions qu’il pose à son conseiller, on voit que Néron se préoccupe peu du bien public [7]. La scène se présente comme une négation même du conseil politique que contient nécessairement une tragédie politique à la Corneille ; elle est d’autant plus choquante que Néron, qui se laisse ainsi manipuler par Narcisse, n’est pas un monarque veule, impuissant, dépourvu d’ambition, et qu’il n’est pas non plus doté de cette « grandeur dans le mal » à la manière des monstres cornéliens (Médée, Cléopâtre, par exemple).
Le même procédé se trouve dans Bérénice. Titus, présenté en termes élogieux à l’acte premier (dont le point culminant est la nuit de l’apothéose de Vespasien, évoquée par Bérénice au moyen de l’hypotypose), apparaît, au deuxième acte, chagriné, loin de l’image que l’on peut avoir de l’amant comblé et du monarque « chéri de l’univers ». Ici comme ailleurs (Cinna, Britannicus), la première scène de l’acte II montre un empereur entouré de sa suite qu’il éloigne avant d’ouvrir son cœur à son confident. Cette convention théâtrale qui consiste à présenter un roi avec ses gardes pour sa première entrée, destinée à rehausser le prestige du personnage, et ensuite à éloigner cet entourage pour une scène de confidence ou de conseil [8], est exploitée ici par Racine de manière à accentuer l’écart entre la sphère publique et la sphère privée. Rappelons que Racine a bien précisé que la scène se situe « dans un Cabinet qui est entre l’Appartement de Titus, et celui de Bérénice [9] ». Cette tension entre le public et le privé est perceptible dans la scène suivante (II, 2), où Paulin, consulté au nom d’une « amitié secrète » et sur l’insistance de l’empereur (« Parlez donc », v. 367), n’accorde aucune complaisance à la passion de Titus : il lui rappelle avec franchise les exigences de la loi romaine, en dépassant largement le rôle du confident pour s’approprier le statut de conseiller et d’intermédiaire entre le sénat et l’empereur [10]. Or, ce rappel n’est pas une surprise pour Titus, qui sait déjà la décision qu’il doit prendre [11]. Mais, chose remarquable, la tirade dans laquelle il annonce sa décision de se séparer de Bérénice commence par le passage au tutoiement de Paulin (« Plus ardent mille fois que tu ne peux penser, / Paulin. », v. 422-423) procédé comparable à celui qui est employé dans la scène de l’épanchement de Néron devant Narcisse. Nous sommes donc dans la plus grande intimité avec l’empereur, à ceci près que la confidence de Titus est ici préparée d’abord par un conseil sollicité et accepté par lui-même.
Avec Bajazet, on est à la limite de la validité d’une classification de conseillers établie sur les critères bons ou mauvais [12]. De fait, la répartition des rôles du conseiller s’explique, semble-t-il, par la nécessité dramaturgique, car l’acte II de Bajazet développe le même mouvement scénique que celui de l’acte IV de Britannicus. Tour à tour, on essaie de convaincre Bajazet de la nature impérative de son mariage avec la sultane : Roxane (scène 1), Acomat (scène 3) et Atalide (scène 5) ; et de même que Néron, c’est à l’opinion du dernier qui a parlé que Bajazet va se ranger. Comme le montrent d’autres exemples (Ulysse et Clytemnestre dans Iphigénie, Mardochée et Aman dans Esther, Mathan et Abner dans Athalie), la « double assistance fournie au roi souligne la complexité des situations auxquelles il est confronté [13] ». L’existence de bons et de mauvais conseillers, comme instrument dramaturgique, extériorise le tiraillement intérieur des héros, ce qui est une manière de se conformer à la définition du héros tragique par Aristote (« ni tout à fait bon ni tout à fait méchant », Poétique, chapitre 13, 53a 7-12).
Conseil et délibération
Passons maintenant aux aspects techniques et rhétoriques de la délibération. L’abbé d’Aubignac, dans un chapitre intitulé « Des Délibérations » de sa Pratique du théâtre, laisse de côté les monologues délibératifs ou les « Discours pathétiques », pour parler uniquement des délibérations « qui se font par dessein, et qui sont des représentations de ce qui se passe chez les Grands, lorsqu’ils demandent conseil sur une affaire d’importance [14] » : il s’agit donc des délibérations politiques. D’après d’Aubignac, pour que les scènes de délibération réussissent au théâtre, « il faut que le Sujet en soit grand, illustre et extraordinaire », que « le motif d’une Délibération mise sur la Scène soit pressant et nécessaire », que « les raisonnements répondent à la grandeur du Sujet, et à la nécessité de les faire » et, ajoute-t-il, « il ne faut jamais montrer les Délibérations « dans la chaleur et l’activité de l’Intrigue […] parce qu’elles la ralentissent et en étouffent la beauté [15] ». Naturellement, les exemples réussis en sont fournis par Corneille.
Ce qui nous intéresse ici, c’est l’importance certaine que Corneille accorde à l’usage des maximes politiques dans la tragédie. Ce dernier remarque en effet : « Dans les délibérations d’État, où un homme d’importance consulté par un roi s’explique de sens rassis, ces sortes de discours trouvent lieu de plus d’étendue [16]. » C’est là sans doute une justification a posteriori de la technique qui a fait sa gloire : déjà d’Aubignac rendait hommage (qu’il supprimera après s’être brouillé avec le dramaturge) au caractère hardi et original des sentences cornéliennes. Mais surtout, Corneille semble avoir parfaitement compris le rôle du sens commun placé dans un contexte approprié et exprimé sur un ton digne des grands intérêts d’État. Les scènes du conseil politique dans Cinna (II, 1) et surtout dans Pompée (I, 1) innovent et perfectionnent le genre de la tragédie politique : l’enjeu est ici exclusivement politique, et la présence de plusieurs conseillers donne l’occasion d’un affrontement des points de vue différents et justifie le déploiement de la technique oratoire et du style pompeux.
Dans la scène inaugurale de Pompée (1643-1644), Corneille fait participer au conseil Achillas qui n’a pas le statut de conseiller chez Lucain ; Photin comme Achillas condamnent Pompée à la mort, mais pour des raisons différentes. Cette scène de conseil à plusieurs voix permet ainsi d’informer le spectateur sur une situation initiale assez complexe, tout en donnant de Ptolomée non pas l’image d’un roi criminel par nature, mais celle d’une âme servile entraînée par les « pestes de cour ». Il ne s’agit pas ici d’insérer une sentence morale en guise d’ornement, facilement isolable du contexte dramatique, mais de s’en servir comme preuve argumentative. Sa force de persuasion est due à la pertinence et à la brièveté ; elle apparaît souvent sous forme d’un enthymème (syllogisme elliptique ou tronqué). Ainsi Photin, chef du conseil égyptien, ponctue son argument par les sentences inspirées de Lucain dont la teneur se durcit au fur et à mesure : la justice est une idée vaine devant la force (v. 49-52) ; le soutien donné au camp vaincu, quoique juste, est inopportun, voire « coupable » (v. 73-78) ; la justice n’est pas une vertu du monarque (v. 104-112). Le cynisme et la lâcheté du propos sont ici quelque peu occultés par la grandeur du style : on voit que la sentence, loin d’être moralement utile, est un moyen propice à faire glisser des maximes machiavéliques.
Ce type de raisonnement par sentences et maximes est-il efficace, lorsqu’il est destiné à convaincre un jeune homme, de caractère instable, mû par les pulsions, la jalousie et l’impatient désir d’indépendance, comme c’est le cas du Néron racinien ? Car Racine ajoute un trait essentiel aux mœurs du Néron de l’Histoire déjà réputé pour sa cruauté naturelle : son personnage est complexé, irrationnel, donc imprévisible mais influençable. En revanche, dans Octavie du Pseudo-Sénèque, Néron est un criminel déterminé qui résiste aux remontrances de Sénèque : leur dialogue (v. 440 sq.), qui commence par une longue stichomythie comportant nombre de sentences morales et politiques, est l’affrontement des idées et des convictions dans lequel on voit le Sénèque idéaliste et idéalisé, face au Néron habile et audacieux, non dépourvu de grandeur. L’emploi des sentences réparties sous forme de stichomythie est particulièrement efficace dans une dispute dramatique : celle qui oppose Britannicus à Néron dans la tragédie de Racine (III, 8), quoique dénuée d’un enjeu proprement politique, est le moment où le héros éponyme apparaît sous son meilleur jour.
La mauvaise rhétorique
Dans Britannicus, cependant, le discours est rarement une expression directe de l’êthos (sauf dans les cas de Junie et de Burrhus). Ici, un raisonnement d’ordre politique peut masquer souvent un motif égoïste : à la perversion du caractère (Néron, Narcisse) doit correspondre celle du discours. Ainsi le principe fondamental de l’art de gouverner, on le voit dégénérer en expression d’un cynisme froid dans la bouche de Néron : « J’embrasse mon rival, mais c’est pour l’étouffer » (IV, 3, v. 1314). La figure utilisée ici n’est peut-être pas très originale : Racine puise dans les lieux communs de l’époque. L’effet de ce vers n’en est pas moins saisissant ; il est sans doute dû à la force de la chute qui frappe par sa concision sentencieuse et sa brutalité – expression poétique d’un coup d’État au sens du XVIIe siècle, qui est un signe éclatant, mais perçu toujours a posteriori, du pouvoir souverain.
Agrippine, quant à elle, ne fait jamais appel aux sentences ; elle multiplie, en revanche, des exemples comme preuves techniques et comme moyens de raisonnement par analogie. Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. Sur le plan poétique, les noms propres évoqués par « la fille de Germanicus », aux consonances dures familières aux lecteurs de Tacite, tout en plaçant le drame dans le contexte historique, y ajoutent une aura grandiose. Du point de vue de l’êthos de l’orateur, la mère de Néron n’est pas qualifiée pour énoncer une sentence morale propre à faire revenir le « monstre naissant » dans le droit chemin. D’ailleurs, la stratégie d’Agrippine, dans la grande scène de l’acte IV, consiste à renverser la position d’une accusée sommée de comparaître devant l’empereur (v. 1116-1118) en celle d’une accusatrice révoltée contre l’ingratitude de son fils : l’ambiguïté de la situation est manifeste dans le fait que c’est celle qui est convoquée qui a la préséance sur celui qui l’a convoquée (v. 1115 [17]).
Dans cet affrontement, Agrippine se contente d’exposer ce qu’elle a fait (v. 1118), et non ce qu’elle pense ; son propos n’est pas d’étaler sa conception du pouvoir en général (laquelle n’est pas au fond très éloignée de celle de Narcisse), mais de rappeler les démarches qu’elle a entreprises pour accomplir la conquête de ce pouvoir-ci et, plus particulièrement, le sacrifice qu’elle a consenti pour atteindre ce but. La narration occupe donc la majeure partie de son discours qui est construit d’une série de phrases courtes, simples, presque dépourvues d’adjectifs et d’adverbes, accentuées souvent par l’asyndète (par exemple, v. 1129, v. 1178, v. 1183), d’où se dégage l’impression apparente d’un récit objectif, dénué d’intérêt personnel, impression qui ne trompera pas Néron (IV, 3). La stylisation du discours ne parvient pas à masquer le fait que l’argument d’Agrippine est avant tout ad hominem : l’absence de sentences et, par là, celle de principes généraux qui guident l’action, empêchent, dans ce plaidoyer, le passage des cas particuliers à l’universel.
De façon générale, la crise politique et morale à laquelle on assiste dans Britannicus est perçue et mesurée, non pas à l’aune de la maxime universellement reconnue, mais à celle de la mémoire récente, sans cesse rafraîchie au cours de la pièce. L’inquiétude d’Agrippine s’exprime par l’antithèse qui oppose Néron à Auguste (I, 1, v. 32-34) ; de même, devant Burrhus, elle souhaite que le jeune empereur se conforme aux exemples de ses illustres prédécesseurs (I, 2, v. 162-164). La réplique que donne Burrhus à Agrippine est habile en ce qu’elle repose sur l’emploi équivoque et insistant du mot César, se référant à la fois au titre officiel et à la personne de Néron. Si Agrippine veut écarter de son fils l’influence des gouverneurs (v. 159-168), Burrhus lui répond par la même logique, c’est-à-dire en faisant valoir le désir d’indépendance chez le jeune empereur et il le fait en jouant sur le double sens du mot César :
Toujours humble, toujours le timide Néron
N’ose-t-il être Auguste, et César que de nom ? (v. 197-198)
Ainsi Burrhus prive symboliquement de sa mère le fils devenu « le maître du monde » (v. 181), rappelant le principe de la raison d’État, c’est-à-dire les considérations de l’intérêt général devant lesquelles doivent céder les intérêts particuliers. Au premier abord, la position d’Agrippine (« Néron n’est plus enfant : n’est-il pas temps qu’il règne ? », v. 159) et celle de Burrhus (« Ce n’est plus votre fils, c’est le maître du monde », v. 180) semblent analogues : la mère de Néron soutient l’idée d’empereur absolu qui n’a de comptes à rendre à personne ; le gouverneur exige la toute-puissance de César, qui renforcerait par là même la liberté du peuple romain (v. 214). En fait, le discours d’Agrippine est contradictoire ou hypocrite parce qu’elle veut tout simplement conserver l’influence qu’elle exerçait sur son fils ; l’idéalisme de Burrhus se voit vite trahi par Néron qui commence à se dévoyer (III, 2).
Il est intéressant de constater que dans le discours d’Agrippine comme dans celui de Burrhus, les maximes politiques ont très peu de place, comme s’ils savaient tous deux par avance que la sentence morale ne toucherait pas le cœur de Néron : afin de capter l’attention du jeune homme fuyant et capricieux, il importe d’adopter un ton autoritaire (Agrippine) ou émotionnel (Burrhus). Ce dernier n’a-t-il pas essuyé un refus de la part de Néron, en prononçant un peu naïvement une maxime stoïcienne : « On n’aime point, Seigneur, si l’on ne veut aimer » (III, 1, v. 790) ?
Si Agrippine, dans sa dernière tentative pour réconcilier Néron et son beau-frère, s’appuie sur les « forfaits » (v. 1196) qu’elle a commis en faveur de son fils, Burrhus, lui, ne peut que rappeler les « premières années » (v. 220) du règne vertueux du jeune empereur : argument faible, comme le fait remarquer Agrippine (v. 221), et étonnamment simpliste qu’il va réitérer devant Néron (« Vertueux jusqu’ici vous pouvez toujours l’être », IV, 3, v. 1340). Si le plaidoyer d’Agrippine se résume en un exposé des faits au risque de tomber dans la monotonie (une monotonie certes menaçante et ponctuée par une phrase ironique, v. 1138, 1143), le ton de Burrhus est beaucoup plus varié : pour dépeindre l’état misérable d’un despote qui, entraîné par des flatteurs, finit par « courir de crime en crime » (v. 1334), il recourt à l’hypotypose, mise en valeur par la figure dérivative et le ton sentencieux, puis à la prosopopée (ou plutôt à la sermocination, « sorte de dialogisme où l’homme est donné comme conversant avec lui-même », selon Littré), l’une imaginaire (v. 1360-1364), l’autre authentique (v. 1372), et il finit par ajouter la gestuelle désespérée (v. 1377) dont on n’imaginait pas qu’il était capable.
En ce qu’il rappelle le principe de la vertu stoïcienne qu’est la prudence, le discours de Burrhus est, comme c’est le cas du monologue d’Auguste (Cinna, IV, 2, v. 1162 sq.), un miroir tendu à la conscience du monarque placé devant un choix déterminant. Mais le fait même qu’Auguste examine un cas de conscience dans la solitude montre assez l’êthos du personnage qui, depuis le début de l’acte II, ne cesse de consulter, non seulement son entourage, mais avant tout lui-même. Tandis que Néron, soit à cause de sa jeunesse, soit à cause de sa cruauté naturelle, est incapable d’une telle introspection.
Narcisse survient, et il surpasse Agrippine et Burrhus en psychologie, donc en rhétorique. Après les précautions oratoires (v. 1401), Narcisse cherche, en tâtant Néron de tous les côtés – la rivalité politique, la jalousie amoureuse –, le point sensible de ce dernier. C’est à l’allusion à la fierté d’Agrippine que Néron s’émeut ; en fait, à travers la mère orgueilleuse, c’est l’idée d’influence, de domination, qui l’excède, sans toutefois qu’il soit conscient du fait qu’il est justement sous le contrôle de l’affranchi. Néron reprend les arguments de Burrhus auxquels il ne pouvait résister (v. 1427-1431) pour que Narcisse les réfute à sa place (v. 1432 sq.). Mais la manière la plus efficace de les réfuter, c’est de discréditer l’êthos de celui qui les a formulés. Or, Néron n’a pas encore révélé le nom de celui qui a réussi à le persuader de la nécessité de la réconciliation : « … on nous réconcilie » (v. 1400), « On répond de son cœur » (v. 1409), disait-il simplement. Une fois le nom de Burrhus lâché (v. 1456), il suffit de jeter le discrédit sur lui (v. 1461-1462) ; Narcisse va même plus loin, en amalgamant brusquement le gouverneur de Néron et les autres courtisans, éventuels comploteurs : « Ou plutôt ils n’ont tous qu’une même pensée » (v. 1463). On se rappelle que Néron s’est convaincu de la sincérité de Burrhus, un temps soupçonné d’être complice d’Agrippine, justement à cause de l’hostilité que cette dernière manifestait à l’égard du militaire (v. 1310-1312). C’est donc exactement le contraire que Narcisse essaie d’insinuer à Néron. Il y a sans doute une certaine gratuité dans ce jeu verbal sur lequel est bâtie la réversibilité de la situation ; mais il faut dire aussi que c’est à travers ce jeu psychologique que le caractère des personnages est mis au jour. Ainsi Narcisse, après avoir écarté les arguments de Burrhus, revient encore une fois sur le point sensible de Néron – l’amour-propre – pour lui donner l’estocade [18].
L’échec de Burrhus face à Narcisse est, on le voit, celui d’un certain idéal rhétorique : si la vertu stoïcienne se traduit dans la pratique sous l’aspect d’une conformité de la raison et de l’action, en rhétorique, cette vertu sera l’accord entre soi-même et la parole. Or, il est évident que dans Britannicus, cette vertu, formulée ici par Junie, est systématiquement bafouée :
Cette sincérité sans doute est peu discrète ;
Mais toujours de mon cœur ma bouche est l’interprète. (II, 3, v. 639-40)
Junie sera contrainte à la feinte ou au silence (v. 672) ; Britannicus, également (v. 1052) ; Burrhus sera calomnié par Narcisse : « Burrhus ne pense pas, Seigneur, tout ce qu’il dit » (v. 1461). Junie ne peut que constater cette perversion fondamentale du langage :
Mais (si je l’ose dire) hélas ! dans cette Cour
Combien tout ce qu’on dit est loin de ce qu’on pense !
Que la bouche et le cœur sont peu d’intelligence !
Avec combien de joie on y trahit sa foi ! (V, 1, v. 1522-25)
La tragédie de Britannicus se termine par ce constat de la perversion du langage, de la dislocation de l’acte et de la parole, bref, de l’impuissance du discours politique et rationnel.
Le constat amer de l’échec de l’éloquence délibérative dans Britannicus nous rappelle l’affirmation d’Aron Kibédi Varga :
La rhétorique tragique est une mauvaise rhétorique, le contraire de ce que les traités rêvent : elle réussit là où – moralement et psychologiquement – elle devrait échouer et elle échoue là où, pour les mêmes raisons, elle devrait réussir. […] Le héros tragique est celui qui passe à l’action non pas parce qu’il s’est laissé persuader par la rhétorique mais parce qu’il la refuse [19].
Emblématique en cela est la réplique de Phèdre déclarant à sa nourrice, qui est en même temps sa confidente et sa conseillère, que toute tentative de persuasion, ou plutôt de dissuasion, est désormais vaine :
Enfin, tous ces conseils ne sont plus de saison.
Sers ma fureur, Œnone, et non point ma raison [20]. (II, 5, v. 791-792)
Ainsi le discours du confident-conseiller s’arrête avant l’action : s’il permet de clarifier la situation, de mettre au jour les difficultés auxquels le héros est confronté, s’il prête sa voix à son interlocuteur royal pour imaginer les conséquences favorables de la décision préconisée ou les conséquences néfastes de la décision à écarter, il revient finalement au héros lui-même de retrouver la voix de la raison ou – ce qui arrive le plus souvent – de la réfuter. La structure rationnelle et rhétorique des scènes dialoguées contribue ainsi à mieux faire ressortir la violence irrationnelle de l’action tragique.